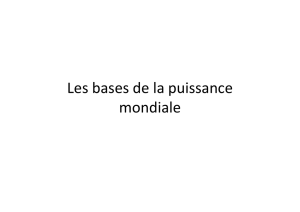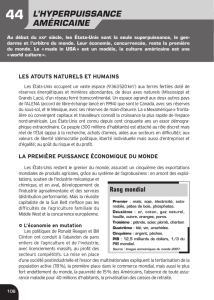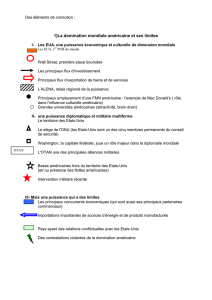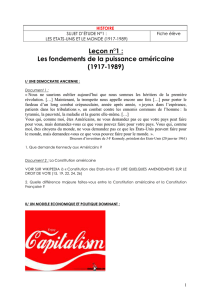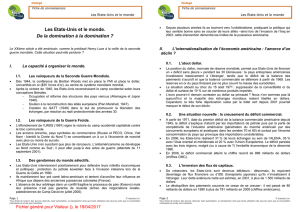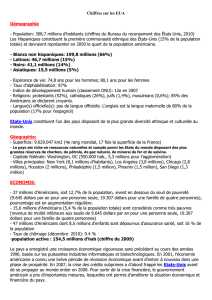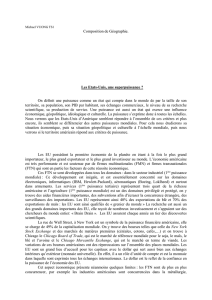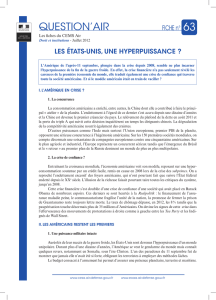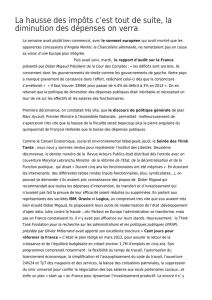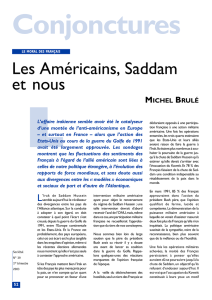De Memphis à Washington

De Memphis à Washington
Réflexions sur l’hégémonie américaine
La première erreur de l’administration de George W. Bush est certainement de ne
considérer le commerce international que de sa propre perspective, sans le
moindre « exo-regard ». Le cortège de règles tacites du libre-échange est
scrupuleusement respecté tant qu’il avantage la valeur ajoutée américaine, mais
devient vite une barrière intolérable, somme de toutes les craintes et de tous les
assauts, lorsqu’il entrave la sainte progression commerciale des Etats-Unis. Allié
aux doctrines d’engagement sélectif, de sécurité coopérative, de néo-
isolationnisme et de primauté, cet unilatéralisme est souvent l’apanage des
puissants. Mais ne s’agirait-il pas ici d’un simple effet dû à une tentative
spasmodique de redressement ? Quoiqu’il en soit, cette attitude révèle un manque
de réelle capacité d’assumer avec tout ce que cela suppose, un véritable
leadership global. La volonté sans la possibilité. Le désir sans la faculté. Ou peut-
être, et ce serait plus dangereux encore, une aboulie appuyée d’un manque
d’usage de la raison.
Après trente années de déficit commercial, les Etats-Unis sont aujourd’hui la
puissance la plus débitrice du monde moderne. Cette dernière a étouffé tous ses
investissements à l’étranger plutôt que de fournir du capital aux autres acteurs, et
plus aucun investisseur américain n’ose encore suivre l’exemple britannique du
XIXè siècle. Les Etats-Unis sont sans aucun doute encore très puissants, même si
le concept de « puissance » est quasiment impossible à définir pertinemment en
relations internationales, tout comme les notions de culture ou encore d’identité. Le
territoire américain possède sans discussion possible ces formidables opportunités
et ces perspectives de liberté et d’accomplissement individuel ou collectif.
Cependant, et pour cette fois-ci à raison, la littérature internationaliste commence à
s’interroger. Existe-t-il encore un modèle d’ordre par l’Empire ou par le Droit ? Si
oui, les Etats-Unis en sont-ils encore les chefs de file ? Si elle est unique, la
puissance américaine est-elle encore une toute-puissance ? Il commence à devenir
nécessaire de dresser un bilan clinique de l’état de santé de la puissance
américaine, en s’attardant sur les critères mouvants comme sur les critères
statiques. C’est à ce prix seulement que nous aurons la regrettable opportunité de
voir un Empire chuter en répandant sur le monde de dangereux effets.
Les Faucons de Washington réduisent les autres puissances au rôle manichéen
d’allié ou d’ennemi, deux rôles très tranchés et sans nuance possible, regroupant
d’un côté les éternels suiveurs inféodés par la force ou la résignation, et de l’autre
les menaces régionales et autres despotes réels ou fantaisistes. Mais le plus
réducteur serait peut-être encore cette facilité déconcertante à mesurer
l’importance d’un Etat à l’aune de ses dépenses regardant la Défense. Bien
entendu, il n’est avantageux ni pour les Etats-Unis ni pour le reste du monde, que
1

ces derniers passent pour une puissance militariste alimentée d’idéaux
messianiques à l’économie essoufflée, et a fortiori prise de troubles passagers de
la conscience. C’est pour cette raison qu’il convient de juger à la fois du degré de
profondeur de la blessure américaine, mais aussi du degré de conscience que les
Faucons de Washington en ont à l’heure actuelle.
Ainsi, nous allons partir à la recherche d’une expression de la puissance
américaine, d’une allégorie en tant qu’illustration d’une idée par le symbole, fondée
sur un modèle familial comme il en existait au temps de l’Egypte ancienne à
l’époque de la XXIIè Dynastie. Le modèle dont il est question, contrairement à tous
ceux qui sont souvent cités ou empruntés en relations internationales ou en
économie, s’illustre par un schéma familial orienté autour de deux figures-clés :
déesse-mère et dieu-père. Ce couple sacré de Memphis s’était articulé autour de la
déesse Sekhmet et du dieu Ptah. Le groupement en famille semble avoir permis, à
l’origine, un rassemblement des dieux locaux autour d’un dieu central ayant pris de
l’importance au sein d’une structure andocratique : le dieu de la métropole. Dans
l’analyse qui nous préoccupe, nous verrons que ce dieu central ne pourra être que
la toute-puissance elle-même… Il ne reste plus qu’à déterminer si cette toute-
puissance américaine n’est pas elle aussi devenue un mythe à l’image de celle de
Memphis il y a plusieurs millénaires ; une jolie légende teintée de tragédie.
I) Le cœur du couple de la puissance américaine : déesse-mère
La Memphis égyptienne et son couple-roi.
Le modèle familial règnant sur Memphis sous la XXIIè Dynastie était articulé autour
d’un couple garantissant la sécurité jusqu’aux portes de la cité, et la prospérité en
son sein. De ce couple divin, dieu-père était la lance d’or, le protecteur et le
combattant héroïque. Il assurait la paix en repoussant les hordes qui grondaient
aux portes de la cité, cherchait à étendre son domaine sans nécessairement le
fédérer, et participait au prestige de son Empire de par ses glorieuses batailles.
Déesse-mère quant à elle, était sans aucun doute le cœur, la nourricière, et
l’épouse aimante. Avec méthode mais aussi chaleur, elle enrichissait le trésor
permettant de vivre dans l’oppulence et la satiété. Elle organisait les tâches et
coordonnait les corps de métiers, tout en fournissant à son époux les ressources
nécessaires pour projeter ses forces et faire resplendir leur domaine. L’équivalent
contemporain serait très certainement l’économie et la finance, qui permettent la
sécurité et la prospérité ainsi que le rayonnement culturel. Figure cardinale de la
puissance traditionnelle américaine, déesse-mère serait par son ipséité même
condamnée à remplir un double rôle : assurer sa fonction au cœur de l’Empire,
mais également permettre celle de son conjoint à l’extérieur. Mais essayons tout
d’abord de saisir comment déesse-mère a rempli son office aux Etats-Unis depuis
la fin de la seconde Guerre Mondiale, et au service de quel Empire…
2

Le dollar au cœur des systèmes monétaires successifs : l’étalon de change-or.
Dès Juillet 1944, les Américains cherchent à assurer la reconstruction de l’Europe
en développant le système de l’étalon de change-or, existant depuis la conférence
de Gênes de 1922. Dans une petite station de montagne du New Hampshire bien
connue, les deux grands vainqueurs occidentaux, Etats-Unis et Grande-Bretagne,
dominent les travaux en tant que nouveaux amis. N’oublions cependant pas que
leur rivalité incessante de l’entre-deux-guerres ne fut pas étrangère au chaos
monétaire et aux dévaluations compétitives responsables de la plus grave
récession de l’ère moderne. Donc, Etats-Unis et Grande-Bretagne décident de
rétablir un régime de change fixe. Au sortir de Bretton Woods, chaque membre
s’est vu définir une parité pour sa monnaie exprimée en poids d’or ou en dollar. La
prééminence du dollar est alors indiscutable, à l’heure où les Etats-Unis vont faire
une déclaration fort mal inspirée, puisqu’ils s’engagent à fournir de l’or au prix de
35 dollars l’once à toute Banque Centrale. La période faste du dollar semble alors
toucher à sa fin, à l’heure où les exports de déesse-mère à l’égard de l’Europe
entraînent pourtant un excédent de la balance des paiements, et des rentrées
massives d’or et de devises.
Le Plan Marshall avait permis à l’Europe de reconstituer son appareil productif, et
les nombreuses dévaluations européennes par rapport au dollar ont eu pour effet
positif de stimuler la compétitivité des exportateurs européens et japonais. En
d’autres termes, les Américains responsables de la reconstruction européenne
venaient de trop vite remettre sur pied une dangereuse économie dominante, alors
qu’ils pensaient pourtant qu’elle serait convalescente pour de nombreuses années.
A cette époque, les Etats-Unis influencent sans être encore trop influencés, et
utilisent avant l’heure un « soft power financier » avec intelligence, en manipulant
les taux d’intérêts aussi bien que les entrepreneurs privés et publics. Ils se rendent
indispensables en termes de partenariat voire de survie, et savent se présenter
comme un allié sincère désireux d’établir des échanges fructueux. Déesse-mère
fournit alors aide et protection malgré une certaine rigueur déclarative, et réussit à
apporter croissance et développement tout en y trouvant son propre compte.
De la même façon, suite aux dévaluations de leur monnaie, les Banques Centrales
européennes se portent mieux car leur pays respectif réalise de plus en plus de
transactions. Elles accumulent du dollar sans en demander la conversion en or
comme proposé par les Etats-Unis, par confiance en la monnaie américaine. C’est
ici précisément que tout va basculer. Le système va commencer à se détériorer en
raison d’une abondance de dollars, et donc à une décote de celui-ci par rapport à
l’or. Nous sommes en 1960, et sur le marché libre de Londres, l’once d’or passe de
35 à 40 dollars. La conséquence est assez évidente : toutes les Banques Centrales
commencent à réclamer la conversion de leurs dollars en or… Les Etats-Unis
convertissent ce qu’ils peuvent comme dû, jusqu’à ce que les réserves d’or
américaines deviennent menacées en termes quantitatifs. Ils finissent alors très
logiquement par refuser, donnant naissance à de nombreuses crises monétaires
qui auraient pu être facilement évitables jusqu’en 1971, date à laquelle Nixon
3

annonce officiellement la suspension de la convertibilité du dollar en or, mettant
ainsi fin au système de l’étalon de change-or. Précisons que la mort lente de ce
système avait déjà commencé à partir de 1968, lorsque les Etats-Unis ont arrêté de
convertir les dollars étrangers en or. Toujours officieusement, le dollar avait déjà
commencé à devenir l’étalon, et c’est ce qui va donner naissance le 15 Août 1971
au nouveau système de l’étalon-devise. Déesse-mère se surprend à être par
moments prise au piège de son internationalisation.
Le dollar au cœur des systèmes monétaires successifs : l’étalon-devise.
Ainsi, dans le système de l’étalon-devise, les monnaies sont assez logiquement
définies par rapport au dollar, lui-même dorénavant inconvertible en or. Quand
Nixon fait sa déclaration officielle, d’importants mouvements de capitaux entraînent
la fluctuation des monnaies appellant aux accords de Washington en Décembre
1971. Le dollar est à nouveau dévalué. La devise américaine n’ayant plus de valeur
fixe, elle ne peut plus être utilisée comme étalon de référence. La vieille loi de
l’offre et de la demande va donc revenir au tout premier plan avec la mort définitive
de Bretton Woods les 7 et 8 Janvier 1976, date à laquelle les pays membres du
F.M.I. vont instaurer un nouveau système de change flottant à la Jamaïque. La
croissance extensive remplace alors la croissance intensive, et la productivité
américaine joue un rôle négatif car la tertiarisation de l’économie freine les gains de
productivité des entreprises. La pénétration du marché américain anciennement
protégé ne fait plus aucun doute au début des années 1980 où 70% des pièces de
la société I.B.M. sont fabriquées en Chine, jusqu’en 1990 où les missiles Patriot
étaient encore dotés d’une majorité de composants électroniques japonais. On voit
bien par ce double-exemple que déesse-mère s’éloigne du concept d’économie
dominante ou hégémonique, puisque son influence n’est plus réalisée sans être
influencé elle-même.
Mais même si la balance des capitaux redevient positive grâce à la guerre du
Kippour qui va étrangement faire du dollar une monnaie de confiance, les entrées
de capitaux étrangers présentent à terme un danger certain pour les Etats-Unis, à
savoir le risque d’une dégradation nette de leur situation sur la scène économique
mondiale. Effectivement, ils doivent maintenant payer des intérêts aux autres
puissances et peuvent aussi susciter le doute et la méfiance, comme tout agent
économique. D’ailleurs, une des causes du krach boursier de 1987 ne fut-elle pas
l’hésitation de puissants investisseurs japonais à acheter des bons du trésor émis
par l’Etat fédéral ? Les conséquences de ce manque de confiance furent
catastrophiques pour les Etats-Unis beaucoup plus que pour le reste du monde. La
situation s’est détérioré jusqu’en 1994, où pour la première fois depuis 1914, les
Etats-Unis connaissent un déficit de la balance des revenus du capital. Déesse-
mère se pose alors une seule et apparemment simple question : comment réduire
le déficit commercial engendré par la fin des trente glorieuses ?
4

Le transfert américain : comment commencer à accepter sa propre médiocrité ?
Les dépréciations successives du dollar pour endiguer la situation ont eu assez
logiquement des conséquences négatives sur le long terme puisqu’elles ont
accéléré l’inflation dans les années 1970, et facilité l’achat d’entreprises
américaines par l’étranger. L’évolution de la compétitivité structurelle est également
problématique à l’époque, et la qualité des fabrications américaines est de plus en
plus mise en cause d’où la « loi pour l’excellence » pour l’automobile en 1987. De
plus, les Etats-Unis sont mal spécialisés : les matières premières représentaient
16% des exportations américaines en 1999, ce qui était beaucoup trop à une
période où les cours baissaient dangereusement. Ajoutons que les Etats-Unis ne
vont pas hésiter non plus à taxer leurs adversaires économiques de déloyauté. Les
adversaires américains sont accusés d’utiliser des procédés déloyaux afin de
pénétrer le marché des Etats-Unis et de protéger le leur. Il est inutile de préciser
que l’Europe est ici totalement visée par ces accusations, a fortiori avec le
développement de la P.A.C. Enfin, certains sont taxés de pilleurs du savoir-faire
américain, en particulier les Nouveaux Pays Industrialisés et plus spécifiquement la
Chine qui figurent sur une liste noire. Ce bilatéralisme agressif teinté de babillages
concerne surtout le Japon, jugé responsable de la moitié du déficit commercial
américain dans les années 1980, mais l’Union Européenne est aussi taxée de
« forteresse Europe » à cause de la P.A.C. et d’Airbus. Les Etats-Unis multiplient
les pressions sur tous leurs partenaires, et l’année 1989 sonne la fin du système de
préférences généralisées pour les N.P.I., puis pour la Malaisie en 1990.
Malgré certains progrès, toutes ces mesures n’ont pourtant pas atteint l’essentiel
de leurs fins. Avec les quotas aux importations, les Japonais ont décidé de vendre
leurs automobiles plus cher et d’attaquer le secteur le plus rentable du marché
américain en vendant des grosses cylindrées. Ainsi, en 1991, les Japonais
détiennent déjà 28% du marché des automobiles haut de gamme. C’est donc au
début de la décennie 1990 que déesse-mère comprend une chose très importante :
Il semble tout simplement qu’en s’internationalisant, les Etats-Unis soient devenus
un pays comme les autres.
Internationalisation de l’économie américaine et fin de l’asymétrie profitable.
En effet, les Etats-Unis connaissent un besoin croissant de certains imports comme
le pétrole, le taux de dépendance pétrolier dépassant les 50% pour la première fois
en 1990. Avec 63,7 millions de tonnes de réserves en 1999, ils importent tout de
même 325,3 millions de tonnes supplémentaires, soit trois fois la consommation
européenne globale. De nombreux secteurs ont besoin des marchés extérieurs
comme l’agriculture et l’aéronautique, et la « job machine » américaine implique un
besoin de travailleurs assez énorme pour produire à meilleur marché. Le point fort
reste tout de même que la puissance économique américaine est une pièce
importante du moteur économique mondial, qui entraîne les autres lorsqu’elle
présente des symptômes de récession, mais se relève plus rapidement, à tout le
moins jusqu’à présent, des crises économiques affrontées. Nous savons que cette
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%