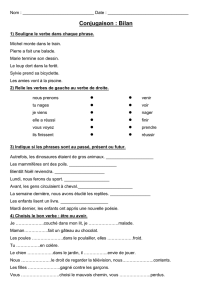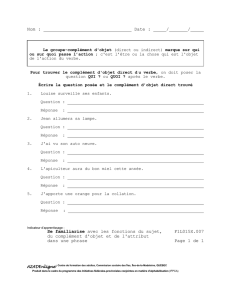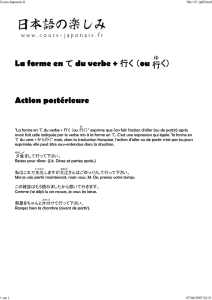UNIVERSITÉ LAVAL MÉMOIRE PRÉSENTÉ À L'UNIVERSITÉ LAVAL COMME EXIGENCE PARTIELLE

UNIVERSITÉ LAVAL
MÉMOIRE PRÉSENTÉ À
L'UNIVERSITÉ LAVAL
COMME EXIGENCE PARTIELLE
DE LA MAÎTRISE EN LINGUISTIQUE
OFFERTE À
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
EN VERTU D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE
PAR
MARGUERITE BOIVIN
LE MARQUEUR ÇA: ENUNCIATION ET DISCOURS
JUIN 1992
Droits réservés

bibliothèque
Paul-Emile-Bouletj
UIUQAC
Mise en garde/Advice
Afin de rendre accessible au plus
grand nombre le résultat des
travaux de recherche menés par ses
étudiants gradués et dans l'esprit des
règles qui régissent le dépôt et la
diffusion des mémoires et thèses
produits dans cette Institution,
l'Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) est fière de
rendre accessible une version
complète et gratuite de cette œuvre.
Motivated by a desire to make the
results of its graduate students'
research accessible to all, and in
accordance with the rules
governing the acceptation and
diffusion of dissertations and
theses in this Institution, the
Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) is proud to
make a complete version of this
work available at no cost to the
reader.
L'auteur conserve néanmoins la
propriété du droit d'auteur qui
protège ce mémoire ou cette thèse.
Ni le mémoire ou la thèse ni des
extraits substantiels de ceux-ci ne
peuvent être imprimés ou autrement
reproduits sans son autorisation.
The author retains ownership of the
copyright of this dissertation or
thesis.
Neither the dissertation or
thesis,
nor substantial extracts from
it, may be printed or otherwise
reproduced without the author's
permission.

Ce mémoire a été réalisé
à l'Université du Québec à Chicoutimi
dans le cadre du programme
de maîtrise en linguistique extensionné
de l'Université Laval
à l'Université du Québec à Chicoutimi

«Ça.
pr. (XVII° s.; admis Acad. 1798
fam.,
abrév. de cela.) Fam. Cela,
ceci.
Ça ira. Comment ça va? Ça va, ça va
pas
bien,
mal...
Il ne manquait plus que
ça.
Je ne veux pas de ça, et absolt. Pas
de ça\ Qu'est-ce que ça peut faire?
Donnez-moi ça. À part ça. Ça n'a rien à
voir. Ça vaut bien ça. Ça me fait de la
peine.
Me faire ça à moi. Comprenez-
vous ça? Et avec ça?»
(Robert, P. Dictionnaire de la langue française)

Sommaire
L'anaphore, décrite grammaticalement comme "un processus
syntaxique consistant à reprendre, par un segment, un autre segment du
discours" (J. Dubois (1973:33)),
n'est
pas un problème nouveau. Elle a été
étudiée autant dans le cadre de la linguistique structuraliste (J. Dubois) que
générativiste (J.-C. Milner). La linguistique textuelle aussi s'y est intéressée.
Pour comprendre la création de chaînes de syntagmes nominaux dans un
texte,
elle a catégorisé différents types de reprises pronominales et lexicales.
Mais ces études ont surtout servi à montrer les contraintes distributionnelles
des reprises anaphoriques et le rôle de continuité thématique de ces
marqueurs grammaticaux (Halliday et Hasan).
En nous inspirant d'approches méthodologiques (Culioli) prenant en
compte les opérations énonciatives et cognitives de construction des valeurs
référentielles, nous avons voulu dépasser cette vieille idée qu'anaphoriser,
c'est reproduire quelque chose de déjà existant dans le cotexte. Dans un
corpus, composé d'une entrevue réalisée auprès d'un notaire dont le bureau
commençait à s'informatiser, nous tentons de montrer comment un marqueur
comme "ça", tantôt anaphore (le plus souvent), tantôt déictique, renvoie non
seulement à des opérations de construction du contenu, mais également à
d'autres opérations énonciatives et argumentatives complexes du sujet.
L'insuffisance des approches strictement linguistiques amène à
consulter de plus en plus les spécialistes de l'analyse du discours et de la
pragmatique qui s'intéressent à la signification en contexte discursif. En effet,
on est de plus en plus conscient que le sens ne s'épuise pas dans l'explicite
du discours et que l'analyse linguistique doit mettre au coeur de ses
préoccupations l'activité de construction de valeurs référentielles par un sujet
nécessairement situé, travaillant constamment l'ajustement entre
énonciateurs, entre idées, entre connaissances et cherchant à valider ses
énonciations soit à partir d'un contexte externe, soit en prenant en charge ce
qu'il énonce.
Nous croyons, dans le cadre de cet élargissement méthodologique,
avoir modestement apporté quelques éléments d'interprétations nouvelles sur
le morphème "ça".
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
1
/
136
100%