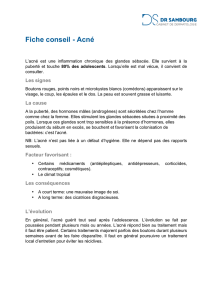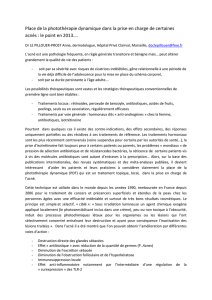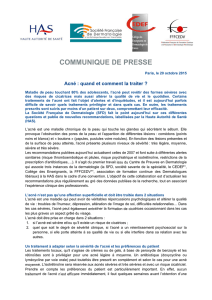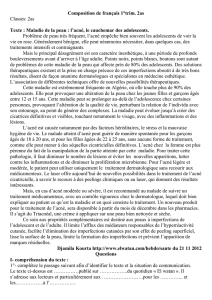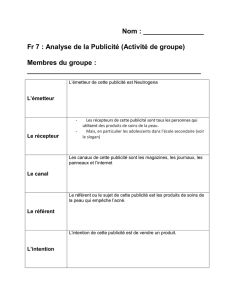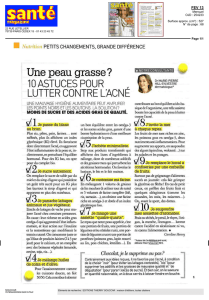L’acné de la naissance à l’adolescence

Médecine
& enfance
L’acné affecte plus de 85 % des
adolescents mais peut se voir à
tout âge. Ainsi, les dermato-
logues et les pédiatres peuvent être
confrontés à des cas d’acné chez le
nourrisson ou le jeune enfant. Cela pose
parfois des problèmes thérapeutiques et
soulève la question d’une pathologie
hormonale sous-jacente. Chez l’adoles-
cent, l’acné doit être considérée comme
une pathologie chronique à l’origine
d’anxiété et de dépression.
QUOI DE NEUF
EN PHYSIOPATHOLOGIE ?
RÔLE PRIMORDIAL
DE L’INFLAMMATION
La pathogénie de l’acné est complexe,
faisant intervenir plusieurs facteurs : hy-
perkératinisation folliculaire, sécrétion
de sébum, colonisation par P. acnes, in-
flammation cutanée et stimulation an-
drogénique excessive. Il est actuelle-
ment admis que, bien avant la formation
du microcomédon, lésion toute débu-
tante de l’acné, il existe un infiltrat in-
flammatoire périfolliculaire intense
constitué de lymphocytes T mémoires et
effecteurs. Ces cellules représentent la
réponse immunitaire adaptative de l’hô-
te à un antigène : P. acnes. Ce n’est que
grâce à ce contexte d’inflammation que
P. acnes se lie aux Toll-like récepteurs
(TLR) des kératinocytes, des sébocytes
et des cellules dendritiques, activant
une cascade de signalisations et la trans-
cription de cytokines telles que TNFa,
IL8 et IL6. Les kératinocytes de l’épider-
me et de l’infundibulum sont alors sti-
mulés et forment un bloc corné. Cela
constitue le début du comédon [1].
RÔLE DU SÉBUM
Plus que l’hyperséborrhée en elle-mê-
me, c’est la composition des lipides du
sébum qui a un rôle très important dans
la genèse des lésions acnéiques. Chez
les sujets « prédisposés » à l’acné, les an-
drogènes sécrétés stimulent la produc-
tion de lipides par les sébocytes. Ces li-
pides sont hydrolysés et forment des
composants irritants qui pérennisent
l’inflammation cutanée [2].
La glande sébacée joue donc un rôle par-
ticulier dans l’initiation de l’acné, car elle
produit toute la machinerie enzymatique
nécessaire à la production des hormones
et des cytokines qui sont impliquées
dans l’inflammation cutanée [3].
IMPORTANCE DE LA GÉNÉTIQUE
Des études anciennes sur des jumeaux
ont permis très tôt de mettre en éviden-
ce le rôle des facteurs génétiques dans
la survenue de l’acné. Plus récemment,
le rôle important des antécédents fami-
liaux a été montré dans l’acné persis-
tante à l’âge adulte et chez les patients
L’acné de la naissance
à l’adolescence
F. Ballanger-Desolneux, dermatologue, Talence
et CHU de Bordeaux
L’acné est une affection inflammatoire chronique du follicule pilosébacé évo-
luant par poussées. S’il s’agit d’une pathologie très fréquente chez les adoles-
cents et les jeunes adultes (plus de 80 %), elle est plus rare chez le nourrisson
et souvent diagnostiquée avec retard. Plusieurs facteurs interviennent dans
l’acné : l’hyperséborrhée, la rétention sébacée, la prolifération de Propionibacte-
rium acnes et l’inflammation cutanée. Les manifestations cliniques sont très va-
riées (lésions rétentionnelles, inflammatoires ou mixtes). La durée d’évolution et
le risque de cicatrices peuvent avoir un retentissement psychologique impor-
tant, influençant la qualité de vie des patients. Les traitements anti-acnéiques
ont beaucoup progressé. Le choix du traitement doit être adapté au type d’acné
et à l’âge de l’enfant. L’observance conditionne la qualité du résultat.
DERMATOLOGIE
novembre 2016
page 275
04 nov16 m&e dermato acné 30/11/16 10:24 Page275

présentant des acnés inflammatoires
sévères. L’influence maternelle semble
être particulièrement importante [4].
INFLUENCE HORMONALE
Les androgènes (dihydrotestostérone,
sulfate de déhydroépiandrostérone et
androgènes surrénaliens) sont reconnus
pour jouer un rôle dans le développe-
ment de l’acné, car ils stimulent la pro-
duction de sébum. Ils se lient à des ré-
cepteurs localisés au niveau des kérati-
nocytes, ce qui induit une hyperkérati-
nisation, et au niveau des sébocytes, ce
qui stimule le développement des
glandes sébacées et la synthèse de sé-
bum. La glande sébacée a un rôle clé
dans le métabolisme des androgènes.
En effet, elle possède une enzyme, la
5a-réductase de type 1, qui transforme
la testostérone en dihydrotestostérone,
hormone qui a le plus d’affinité pour le
récepteur aux androgènes [3].
D’autres hormones telles que l’hormo-
ne de croissance (GH) ou l’IGF-1 ont
également un rôle dans la survenue de
l’acné. En effet, l’augmentation de la
production de sébum observée à l’ado-
lescence survient au moment où les
taux de GH et d’IGF-1 sont maximaux.
Une corrélation a été observée entre le
taux moyen d’excrétion de sébum et le
taux sérique d’IGF-1 chez des patients
post-adolescents [3].
ORIGINE MICROBIENNE ?
P. acnes est présent à la surface de la
peau de tous les adultes, mais cette co-
lonisation varie en fonction de l’âge et
des régions du corps. La densité de
P. acnes est plus importante au niveau
des régions séborrhéiques. A la puberté,
la quantité de sébum excrétée augmen-
te, ainsi que la densité cutanée de
P. acnes. Cependant, des études micro-
biologiques réalisées sur des lésions ac-
néiques ont montré que P. acnes n’était
présent que dans 70 % des lésions. De
plus, les patients ayant une acné sévère
n’ont pas plus de P. acnes à la surface de
la peau. P. acnes n’aurait donc pas de
rôle dans l’initiation du comédon, ni
dans celle des lésions inflammatoires.
Par contre, il aggraverait une desqua-
mation anormale et coloniserait secon-
dairement les lésions inflammatoires,
entraînant une intensification des phé-
nomènes inflammatoires par ses activi-
tés enzymatiques, antigéniques, d’acti-
vation du complément et de stimulation
des TLR2 et TLR4 [5].
IMPACT DES RÉGIMES
ALIMENTAIRES
A côté des facteurs pathogéniques clas-
siquement connus, les effets de l’envi-
ronnement et du mode de vie ont égale-
ment été analysés. Des études compa-
rant différents modes de vie suggèrent
que le stress chronique, le manque d’ac-
tivité physique et le régime alimentaire
déséquilibré auraient un impact sur la
survenue de plusieurs pathologies, dont
l’acné [6]. Il est bien reconnu actuelle-
ment que les régimes avec index glycé-
mique élevé augmentent l’IGF-1, entraî-
nant des modifications endocrinolo-
giques et la synthèse d’androgènes.
TABLEAUX CLINIQUES
La classification de l’acné de l’enfant est
fonction de l’âge et distingue cinq caté-
gories [7].
L’acné néonatale, de zéro à quatre se-
maines de vie. L’acné serait liée à la fois
à l’augmentation de la production de
DHEA, à l’hypertrophie de la zone pro-
ductrice d’androgènes au niveau des
surrénales et au passage transplacentai-
re d’androgènes qui stimulent la glande
sébacée. Elle est à distinguer de la pus-
tulose céphalique néonatale.
L’acné infantile, de un à douze mois. El-
le touche préférentiellement le garçon
(80 % des cas). L’acné est caractérisée
par la présence de comédons sur les
joues, associés parfois à des nodules
inflammatoires. L’acné est le plus sou-
vent isolée, sans association à une en-
docrinopathie. On retrouve fréquem-
ment des antécédents familiaux d’ac-
né. Le plus souvent, cette acné guérit
spontanément, mais la durée d’évolu-
tion peut être longue, avec un risque
cicatriciel dans les formes inflamma-
toires et un risque de développer une
acné à l’adolescence.
L’acné de la moyenne enfance, de un à
sept ans. Elle ne doit en aucun cas être
considérée comme normale. Il faut se
méfier d’une puberté précoce ou d’une
endocrinopathie sous-jacente. L’acné
précoce est un mode de révélation rare
mais classique d’un bloc enzymatique
surrénalien. L’examen clinique doit re-
chercher une pilosité pubienne et axil-
laire, une augmentation de volume des
organes génitaux et des glandes mam-
maires, et doit être complété par un bi-
lan biologique (FSH, LH, SDHEA,
17-OH progestérone, testostérone, pro-
lactine) et une radiographie du poignet
gauche pour déterminer l’âge osseux.
L’avis d’un endocrinologue pédiatre est
recommandé en cas d’anomalie.
L’acné du préadolescent, de sept à onze
ans. Cela touche le plus souvent les
filles. Cliniquement, on observe une
prédominance de comédons localisés
sur la zone T et au niveau des oreilles.
Cela peut être le premier signe de dé-
but de la puberté. L’examen clinique
doit être attentif afin d’exclure un hy-
perandrogénisme ou un syndrome des
ovaires polykystiques, et si besoin
complété d’un bilan biologique hormo-
nal. Ces enfants présentant des signes
de puberté précoce doivent être suivis,
car il existe un risque de survenue de
syndrome dysmétabolique. On consta-
te actuellement un âge moyen plus
précoce de survenue de l’acné, et cela
est bien corrélé avec la survenue plus
précoce de la puberté, que l’on objecti-
ve particulièrement chez les filles (figu-
re 1) [8]. Cette évolution pourrait s’ex-
pliquer par des facteurs environne-
mentaux tels que le statut nutritionnel
(qui influence le poids de l’enfant),
l’exposition à des produits chimiques
(pesticides, bisphénols) ou des fac-
teurs socioéconomiques. Or, la surve-
nue d’une acné précoce serait prédicti-
ve d’une acné plus sévère et plus diffi-
cile à traiter [4].
L’acné de l’adolescent. C’est la forme clas-
siquement décrite. Les premières lésions
surviennent en général vers douze-treize
ans chez la jeune fille, souvent plus tar-
divement chez le garçon. La première
manifestation est l’hyperséborrhée,
Médecine
& enfance
novembre 2016
page 276
04 nov16 m&e dermato acné 30/11/16 10:24 Page276

à laquelle s’associent ensuite des lésions
rétentionnelles (figure 2) qui deviennent
progressivement papulo-pustuleuses.
Le visage est en général atteint en prio-
rité (figure 3), mais les lésions peuvent
s’étendre au niveau du dos, des épaules
et du décolleté. L’évolution, même en
l’absence de traitement, est spontané-
ment favorable, et l’acné guérit dans
90 % des cas vers dix-huit à vingt ans.
Néanmoins, des formes graves peuvent
être observées :
첸
l’acné nodulaire (ou conglobata) est
une acné suppurative chronique. Elle
survient plutôt chez le garçon et débute
à la puberté. Elle comporte des lésions
papulopustuleuses profuses au niveau
de la face, avec extension progressive
des lésions au niveau du cou, du tronc,
des fesses et de la racine des membres.
La peau est couverte de comédons poly-
poreux, de microkystes, de kystes folli-
culaires de grande taille, de papules, de
pustules et de nodules fermes ou abcé-
dés (figure 4). Ces nodules vont laisser
place à des lésions cicatricielles dépri-
mées ou à des chéloïdes ;
첸
l’acné fulminans (ou acné nodulaire
aiguë fébrile et ulcéreuse) est la forme
la plus grave d’acné. Elle touche avec
prédilection les adolescents de sexe
masculin. Le mécanisme physiopatho-
génique ferait intervenir les antigènes
de P. acnes, qui, lorsqu’ils sont pro-
duits en excès, formeraient des com-
plexes immuns circulants à l’origine
d’une réac tion inflammatoire généra-
le. Il s’agit d’une éruption nodulaire de
survenue brutale localisée au niveau
thoracique : nodules inflammatoires et
suppuratifs très nombreux évoluant
vers l’émission de pus hémorragique
ou la formation d’ulcérations nécro-
tiques. Cette éruption est associée à
une atteinte importante de l’état géné-
ral : hyperthermie à 39-40 °C, dou-
leurs articulaires et musculaires et
parfois érythème noueux au niveau
des membres inférieurs. L’introduction
de l’isotrétinoïne comme traitement
d’une acné papulopustuleuse peut être
responsable de la survenue d’une acné
fulminans, mais cela reste exception-
nel comparé au nombre de patients
traités. Les facteurs prédictifs de la
survenue de l’aggravation d’une acné
sous isotrétinoïne sont le sexe mascu-
lin, le jeune âge et l’importance de l’at-
teinte rétentionnelle (comédons ou-
verts et fermés).
DIAGNOSTICS
DIFFÉRENTIELS
De multiples dermatoses moins
connues sont parfois responsables de lé-
sions du visage pouvant faire évoquer le
diagnostic d’acné. Divers diagnostics
sont à évoquer en fonction de l’âge de
l’enfant.
DURANT LE PREMIER MOIS DE VIE
L’acné néonatale doit être distinguée de
deux pathologies plus fréquentes au
cours de cette période : la pustulose cé-
phalique néonatale et l’hyperplasie néo-
natale des glandes sébacées.
첸
La pustulose céphalique néonatale
affecte près de 20 % des nouveau-nés.
Elle se présente sous la forme de lésions
inflammatoires et pustuleuses, souvent
limitées aux zones séborrhéiques : front
et joues. Le rôle de la colonisation de la
peau par Malassezia a été souligné.
L’absence de soins d’hygiène adaptés
(absence de lavage du visage pendant
les premières semaines) entraîne une
accumulation de sébum dans les orifices
pilaires des zones séborrhéiques. Le dia-
gnostic repose sur la topographie et l’as-
pect des lésions. L’absence de comédon
permet d’éliminer une acné.
첸
Le second diagnostic différentiel est
la miliaire sudorale, mais dans ce cas il
s’agit de vésicules translucides qui sont
Médecine
& enfance
novembre 2016
page 277
Figure 1
Figure 3
Figure 2
Figure 4
04 nov16 m&e dermato acné 30/11/16 10:24 Page277

également retrouvées sur le reste du
corps. Enfin, les grains de milium se dif-
férencient des comédons fermés par leur
aspect plus blanchâtre et superficiel.
APRÈS L’ÂGE DE DEUX ANS
첸
Les pyodermites froides peuvent po-
ser le problème du diagnostic différen-
tiel avec des lésions inflammatoires
d’acné. Mais il s’agit le plus souvent
d’une lésion unique, rénitente, de la
joue, évoluant par poussées inflamma-
toires. L’antibiothérapie est inefficace.
La chirurgie est peu souhaitable en rai-
son du risque de cicatrice. La régression
peut se faire spontanément sur plu-
sieurs mois.
첸
Les éruptions rosacéiformes de l’en-
fant se présentent sous la forme de pa-
pules érythémateuses et de pustules, le
plus souvent périorales, causées par
l’utilisation de corticoïdes topiques, in-
halés ou systémiques.
PRINCIPES
DE TRAITEMENT [7, 9, 10,11]
L’acné doit être prise en charge de
manière globale. Il faut prendre le
temps de parler avec l’adolescent pour
expliquer simplement la pathogénie
de l’acné, son caractère physiologique
et son évolution sur plusieurs années,
et pour apprécier sa motivation à se
traiter. De plus, une information sur
les traitements proposés permet une
meilleure compréhension et améliore
l’observance du traitement. Enfin, il
est important d’apprécier le retentis-
sement psychique de la dermatose,
ainsi que ses répercussions sur la qua-
lité de vie.
Dans tous les cas, on recherchera un
facteur aggravant (médicament, cosmé-
tiques comédogènes) et on conseillera
des soins adaptés : toilette quotidienne
ou biquotidienne avec un produit non
irritant (pain surgras, gel nettoyant
sans savon…), application quotidienne
d’une crème hydratante adaptée à la
peau acnéique afin d’améliorer la tolé-
rance des traitements anti-acnéiques.
La photoprotection est recommandée
en raison du risque phototoxique de
certains traitements anti-acnéiques et
du risque de pigmentation des cicatrices
chez les sujets à peaux mates.
MOYENS THÉRAPEUTIQUES
TOPIQUES
Trois classes médicamenteuses ont fait
la preuve de leur efficacité dans le trai-
tement local de l’acné.
Le peroxyde de benzoyle est un agent ké-
ratolytique et antibactérien. Il est adap-
té aux acnés essentiellement inflamma-
toires mais a une action minime sur les
lésions rétentionnelles [12]. Deux effets
indésirables sont possibles : une irrita-
tion cutanée, en particulier en début de
traitement, et une phototoxicité, qui li-
mite son utilisation l’été. Il faut égale-
ment avertir le patient que ce produit
peut décolorer certains vêtements. Le
peroxyde de benzoyle est disponible en
gel ou en lotion à des concentrations de
2,5, 5 et 10 %.
Les rétinoïdes topiques (trétinoïne 0,025,
0,05 et 0,1 % ou adapalène) ont une ac-
tivité kératolytique prédominante et
sont donc indiqués dans les acnés réten-
tionnelles. Ils modifient la différencia-
tion kératinocytaire terminale et dimi-
nuent la cohérence du bouchon corné,
aboutissant à la fonte et à l’expulsion
des microkystes ou des comédons. Le
principal effet secondaire est l’irritation
cutanée secondaire à la sécheresse cuta-
née. L’application du produit le soir, sur
peau sèche, en faible quantité et à dose
lentement progressive permet de limiter
ce phénomène. Une photoprotection ef-
ficace est recommandée pendant toute
la durée du traitement.
Les antibiotiques locaux ont une action à
la fois antibactérienne et anti-inflamma-
toire. On les réserve aux acnés papulo -
pustuleuses modérées. En France, deux
molécules sont disponibles : l’érythro-
mycine et la clindamycine. Les antibio-
tiques locaux ne doivent pas être utilisés
en monothérapie dans le traitement de
l’acné, en raison du risque d’apparition
de résistance bactérienne. Ils doivent
être réservés au traitement de deuxième
intention, prescrits sur une durée limi-
tée (un mois) et ne pas être associés à
un antibiotique systémique.
Les traitements topiques combinés. On
constate actuellement le développe-
ment de nouvelles stratégies combinant
plusieurs traitements topiques. La com-
binaison associant rétinoïdes topiques
et érythromycine ou clindamycine to-
piques est plus efficace que chaque
agent utilisé seul. De même, la combi-
naison érythromycine ou clindamycine
avec peroxyde de benzoyle diminue le
risque de résistance bactérienne et aug-
mente l’efficacité. Enfin, l’association
adapalène et peroxyde de benzoyle
(Epiduo®) augmente le spectre d’activi-
té de l’adapalène seul. Cette association
est efficace dans les acnés modérées du
préadolescent [13].
MOYENS THÉRAPEUTIQUES
SYSTÉMIQUES
Il existe quatre classes de traitements
médicamenteux.
Les antibiotiques
Leur principale indication est l’acné in-
flammatoire modérée à sévère. Ils agis-
sent par leur activité antibactérienne en
inhibant la prolifération de P. acnes
mais aussi par leur activité anti-inflam-
matoire (inhibition du chimiotactisme
des polynucléaires neutrophiles, activi-
té antilipasique, inhibition de la produc-
tion des cytokines inflammatoires), ce
qui explique leur mode d’utilisation
Médecine
& enfance
novembre 2016
page 278
QUAND ADRESSER
AU SPÉCIALISTE ?
첸
Devant un échec thérapeutique malgré
une bonne observance après antibiothéra-
pie et traitement local bien menés.
첸
Devant une acné inflammatoire modérée
ou sévère où apparaissent les premières ci-
catrices.
첸
Quand une acné est nodulaire et étendue.
첸
Quand une acné s’aggrave brutalement
avec poussée inflammatoire sévère.
첸
Quand une acné s’aggrave sous isotréti-
noïne orale.
첸
Quand l’acné est associée à des signes
d’hyperandrogénie.
첸
Quand l’acné survient dans un contexte
inhabituel (acné prépubertaire, acné fami-
liale…).
04 nov16 m&e dermato acné 30/11/16 10:24 Page278

Médecine
& enfance
novembre 2016
page 280
dans l’acné à faible dose (100 mg pour
les cyclines de deuxième génération,
300 mg pour la lymécycline). Les princi-
pales molécules utilisées sont les tétra-
cyclines : doxycycline et lymécycline.
Les effets secondaires les plus fréquents
sont des troubles digestifs, des candi-
doses vaginales et une photosensibilité
(principalement rapportée avec la doxy-
cycline).
L’un des problèmes posés actuellement
par ces traitements est la survenue de
résistances bactériennes. Pour éviter le
développement de ces résistances, il
faut privilégier les traitements courts
(quatre mois maximum), obtenir une
bonne compliance du patient et éviter
la multiplication de cures itératives
avec différents antibiotiques [14]. L’asso-
ciation d’une antibiothérapie locale et
d’une antibiothérapie générale est
contre-indiquée.
Il est également possible de prescrire
des macrolides (érythromycine princi-
palement) dans les acnés infantiles, où
les cyclines sont contre-indiquées en rai-
son du risque de coloration des dents.
Le gluconate de zinc
Il a une activité anti-inflammatoire en in-
hibant le chimiotactisme des polynu-
cléaires, la production de TNF alpha et
en favorisant l’élimination des radicaux
libres. Il est utilisé dans les acnés inflam-
matoires minimes à modérées. Ce traite-
ment a l’avantage de ne pas avoir de
contre-indication ; il peut en particulier
être utilisé pendant l’été. La dose préco-
nisée est de 2 gélules par jour (30 mg de
zinc élément) à prendre à distance des
repas. Ses effets secondaires sont rares et
modérés, à type de gastralgie.
L’isotrétinoïne
C’est le seul traitement réellement cura-
tif dans l’acné. Tout en réduisant l’in-
flammation, l’isotrétinoïne induit une
atrophie de la glande sébacée par apop-
tose des sébocytes ainsi qu’une diminu-
tion de l’hyper kératinisation canalaire.
Elle est recommandée dans les acnés
ayant résisté à un traitement bien
conduit de trois mois associant un anti-
biotique oral et un traitement local, et
dans les acnés sévères (nodulaires ou
conglobata) en raison du risque de cica-
trices. Des effets secondaires nombreux
et potentiellement graves sont décrits,
sa prescription est donc bien codifiée.
Depuis 2015, l’ANSM a décidé de res-
treindre les conditions de prescription
et de délivrance de l’isotrétinoïne orale
et de renforcer les mesures de minimi-
sation des risques liés à la tératogénici-
té. La prescription initiale d’isotrétinoï-
ne orale est désormais réservée aux der-
matologues. Les renouvellements de
prescription peuvent toutefois être ef-
fectués par tout médecin [15].
Chez l’adolescent, la dose orale initiale
est de 0,5 mg/kg/j (en une prise quoti-
dienne au cours d’un repas), poursuivie
jusqu’à une dose cumulée totale de 120 à
130 mg/kg. Le traitement dure donc en
moyenne six à neuf mois suivant la dose
utilisée. Des récidives s’observent dans
20 à 30 % des cas, souvent lorsque la cu-
re n’a pas été complète. La réalisation
d’une deuxième cure est alors licite.
Les effets secondaires de l’isotrétinoïne
sont dose-dépendants. Le plus grave est
la tératogénicité. La jeune fille doit obli-
gatoirement signer un consentement
après information concernant les
risques de malformations fœtales et les
autres effets secondaires avant que le
traitement puisse être débuté. Une
contraception (à l’exception de Dia-
ne®35) doit être instaurée un mois
avant le début du traitement et poursui-
vie jusqu’à un mois après l’arrêt. Par
ailleurs, des tests de grossesse sont réa-
lisés systématiquement avant de débu-
ter le traitement, puis tous les mois et
un mois après l’arrêt du traitement [10].
La prescription et la délivrance de l’iso-
trétinoïne se font uniquement sur pré-
sentation du carnet-patiente (tableau I).
Les effets secondaires cutanéomuqueux
sont les plus fréquents : chéilite, xérose,
sécheresse conjonctivale (pouvant gê-
ner le port de lentilles), nasale (parfois
associée à des épistaxis) ou vaginale. Le
patient doit être informé de ces éven-
tuels effets indésirables. La prescription
d’émollients pour le visage et les lèvres
et éventuellement de larmes artificielles
permet de les prévenir. D’autres effets
secondaires sont observés plus rare-
ment : douleurs musculo-articulaires,
granulomes péri-unguéaux, troubles
auditifs…
Il existe actuellement une controverse
sur les symptômes psychiatriques asso-
ciés au traitement par isotrétinoïne. Des
cas de dépressions ont été rapportés
sous isotrétinoïne. Il s’agit de cas isolés,
apparaissant dans les premiers mois de
traitement. Même s’il a été montré que
les rétinoïdes pouvaient influencer bio-
logiquement le système nerveux central,
il n’y a actuellement aucun lien de cau-
salité admis entre isotrétinoïne et patho-
logie psychiatrique [16]. De plus, l’acné
elle-même peut être un facteur de risque
de syndrome dépressif. Il semble donc
nécessaire, avant de mettre en route le
traitement par isotrétinoïne, d’informer
Tableau I
Avant la prescription d’isotrétinoïne :
첸information des patients sur les effets secondaires et sur le risque tératogène
첸bilan biologique
La prescription d’isotrétinoïne chez les femmes en âge de procréer impose :
첸un mois de contraception efficace et bien suivie avant la première prescription
첸le recueil de l’accord de soins et de contraception et la remise d’un carnet-patiente complété
avant la première prescription
첸la réalisation d’un test de grossesse en laboratoire avec résultat négatif dans les trois jours
précédant chaque prescription et cinq semaines après la fin du traitement
첸une ordonnance limitée à un mois de traitement
첸la délivrance dans les sept jours suivant la prescription
첸la délivrance après vérification de l’ensemble des mentions obligatoires devant figurer sur le
carnet-patiente (formulaire d’accord de soins et de contraception complété et signé par la patiente,
date et résultat du test de grossesse négatif)
첸la notification de la date de délivrance sur le carnet-patiente
04 nov16 m&e dermato acné 30/11/16 10:24 Page280
 6
6
 7
7
1
/
7
100%