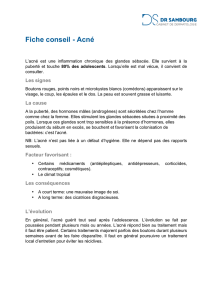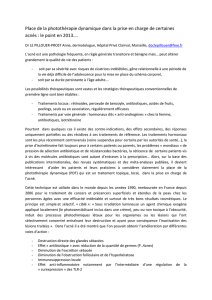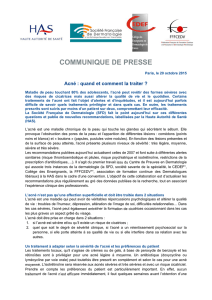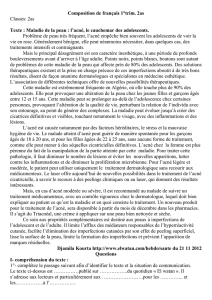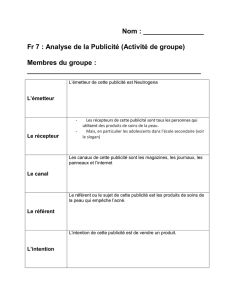Acné: quand doit-elle (ou non) être médicalement traitée ?

2136 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
11 novembre 2015
actualité, info
La limite des mots, la vie
blessée et le ras-le-bol
des médecins face à l’AI
Cher Juriste de l’Assurance Invalidité,
Je veux vous parler de ma patiente. Vous ne
la connaissez pas. C’est normal, vous êtes
juriste et vous examinez les dossiers. Des
collègues, médecin et psychologue, qui sui-
vent ma patiente depuis longtemps, vous
envoient des rapports écrits. Ils ont le souci
de l’honnêteté. Ils vous transmettent des ob-
servations, des résultats. Vous ne rencontrez
pas les personnes, vous soupesez les mots
des certificats médicaux. Les mots… peu-
vent informer comme égarer le destinataire.
Et le destinataire peut mépriser et refuser les
mots qui lui sont adressés.
Tenez, prenons les mots qui se réfèrent à
l’évaluation des capacités cognitives. Les rap-
ports vous signalent la dysharmonie évolutive,
l’intelligence limite, au niveau moyen-inférieur.
carte blanche
Acné : quand doit-elle (ou non) être
médicalement traitée ?
Cette maladie de peau omniprésente à l’ado-
lescence pose au soignant la question de l’op-
portunité de son traitement médicamen teux
– et ce devant des demandes généralement
insistantes. En France, la Société française
de dermatologie (SFD) vient de formuler,
sous le sceau de la Haute autorité de santé
(HAS), une série de recommandations pra-
tiques qui peuvent être d’une grande utilité
pour le praticien.1 Ce sont des recomman-
dations d’autant plus intéressantes qu’elles
viennent actualiser celles publiées en 2007 –
une actualisation rendue nécessaire après
une série d’«alertes sanitaires» caractérisées
par un embarras certain des responsables de
la politique sanitaire.
De ce point de vue, ces dernières recom-
mandations témoignent de la réactivité d’une
société savante à des événements de la sphère
médiatique – et ce alors que ces sociétés sont
souvent accusées d’être des structures aller-
giques à ces événements ; des événements
tenus généralement pour superficiels alors
même qu’ils suscitent et alimentent l’intérêt
de l’opinion publique et donc des patients
et de leurs proches. «Certains traitements de
l’acné ont fait l’objet d’alertes et d’inquié-
tudes, et il est aujourd’hui parfois difficile de
savoir quels traitements privilégier et dans
quels cas, résument les auteurs de ces nou-
velles recommandations. En outre, les trai-
tements prescrits sont suivis par moins d’un
patient sur deux, compromettant leur effica-
cité.»
Rien n’est simple avec l’acné, à commen-
cer avec son étymologie, le terme semblant
emprunté à l’anglais (il y a deux
siècles) d’après une forme erronée
du mot grec ακμή (akmế), qui si-
gnifie «pointe», «sommet» et qui a
été transformé par une erreur de
copiste en akne. Il a été employé
alors pour définir les points noirs
et autres granules de peau tout en
se dégageant assez difficilement de
l’ensemble «couperose ; dartre mi-
liaire ; dartre disséminée» ; vinrent
ensuite : acné simplex ; acné puncta-
ta Willan ; acné indurata.
Tout le monde s’accorde aujour-
d’hui pour parler d’une maladie
chronique du follicule pilo-sébacé,
survenant à l’adolescence, et qui
est liée à l’hypersécrétion de sé-
bum (hyperséborrhée) ainsi qu’à
des anomalies de la kératinisation.
Au final, obstruction du canal ex-
créteur du follicule pilo-sébacé et
formation de «comédons» (points
noirs et blancs) et/ou «boutons»
(papules, pustules, voire nodules).
Ces lésions rétentionnelles et dis-
gracieuses peuvent en effet se compliquer
d’éléments inflammatoires secondaires d’ori-
gine bactérienne anaérobie (Propionibacterium
acnes). En fonction des lésions présentes et
de la surface de peau atteinte, l’acné présente
plusieurs niveaux de sévérité : très légère,
moyenne, sévère et très sévère.
Depuis 2007, différentes alertes sanitaires
sont survenues en France ayant directement
à voir avec la thérapeutique antiacnéique ; il
s’est agi notamment du risque thrombo em-
bolique, associé à des spécialités pharma-
ceutiques antiacnéiques ayant également des
propriétés contraceptives, du risque psychia-
trique associé à l’isotrétinoïne ou des nou-
velles restrictions de la prescription d’anti-
biotiques.
«L’acné est une maladie qui peut avoir de
véritables répercussions psychologiques et
altérer la qualité de vie : troubles de l’hu-
meur, dépression, altération de l’image de
soi, difficultés relationnelles, écrivent les
auteurs des recommandations. Dans les cas
sévères, l’acné peut également entraîner la
formation de cicatrices occasionnant dans
les cas les plus graves un aspect grêlé du vi-
sage.» Selon eux, l’acné doit être prise en
charge dans deux situations : si l’acné est
sévère et/ou qu’il existe un risque de cica-
trices ; quel que soit le degré de sévérité cli-
nique, si l’acné a un retentissement psycho-
social sur la personne, si elle porte atteinte à
sa qualité de vie ou si elle interfère dans sa
relation avec les autres.
Ils ajoutent que les traitements locaux
(crè mes ou gels à base de peroxyde de ben-
zoyle) et les rétinoïdes sont à privilégier
pour une acné légère à moyenne. Un anti-
biotique (doxy cycline ou lymécycline par
voie orale) peut toutefois être prescrit en
complément et selon le cas pour une acné
moyenne. En revanche, l’isotrétinoïne sera
réservée aux acnés «sévères» et «très sévères»
et avec un risque cicatriciel.
Il faut en outre «prendre en compte les
préférences du patient». «En effet, aucun
traitement de l’acné n’est efficace immédia-
tement, il faut quelques semaines avant l’ob-
tention d’une amélioration et le bon suivi
du traitement est gage de sa réussite, sou-
lignent les auteurs des nouvelles recomman-
avancée thérapeutique
CC BY Christopher Macsurak
44_47.indd 1 09.11.15 11:47

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
11 novembre 2015 2137
1 Il s’agit ici du premier travail issu, en France, du «Centre
de preuves en dermatologie». Ce dernier associe trois
instances de la dermatologie (la SFD, société savante
de la spécialité, le CEDEF (Collège des enseignants) et
la FFFCEDV (association de formation continue des der-
matologues libéraux). L’objectif de cette collaboration
est d’actualiser les recommandations plus régulière-
ment au gré des données publiées de la recherche, tout
en associant l’expérience clinique des professionnels.
Datées du 20 octobre 2015, les dernières recomman-
dations concernant l’acné sont disponibles à l’adresse
suivante : www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2564525/fr/
acne-quand-et-comment-la-traiter
Pour vous, elle ne rentrait donc pas dans la
catégorie administrative de la débilité.
Les mots des médecins sont eux aussi limi-
tés pour décrire, dans sa dimension existen-
tielle, la souffrance de la patiente, le tragique
de son histoire. La relation entre les événe-
ments traumatiques et la capacité de travail,
ou entre l’histoire de vie et la vie elle-même,
semble régulièrement ignorée par l’AI.
La scolarité de cette dame dans des éta-
blissements spécialisés a été difficile. Parmi
de nombreux diagnostics psychiatriques, on
a posé celui de séquelles de troubles enva-
hissants du développement.
Elle a grandi dans une famille multi-problé-
matique, démunie et négligente. Son enfance
a été meurtrie – cela vous avez dû le lire – mais
par souci de protection de la sphère privée,
on ne vous a pas dit qu’elle a été abusée par
son frère. Au fond, à quoi bon ? Vous discrimi-
nez les maladies qui donnent ou pas droit à
des prestations ; vous n’êtes pas payé pour
considérer la vie blessée qui les a générées.
En thérapie, au début, elle n’arrivait pas à
parler ; sa pensée, ses mots étaient bigrement
confus. Maintenant elle s’exprime mieux. Le
développement «limite» de son intelligence a
été la conséquence probable des violences
subies : elle ne pouvait pas comprendre l’hor-
reur de ce qui lui arrivait. A l’âge adulte, ce pli
de non-compréhension risque d’être peu utile
pour l’adaptation au travail.
Ma patiente est aujourd’hui obèse. Diabé-
tique. Elle souffre de douleurs partout. Elle n’a
pas encore trente ans. Plus les mauvais trai-
tements et les abus ont été traumatiques, plus
la douleur est précoce ou forte. Cette violence
laisse bien souvent des dommages persis-
tants. Et ceci d’autant plus lorsque l’enfant n’a
pas été soigné. Cela, nos rapports vous l’ont
bien signalé : vous faites fi des avis des méde-
cins de premier recours.
Non, elle n’est pas un rejeton monstrueux
de l’espèce humaine, passif et paresseux.
Votre refus d’entrer en matière pour la réadap-
tation que nous avions préconisée pourrait
nous faire suspecter une pareille appréciation
de votre part.
Mais, Cher Juriste, les médecins s’attendent
à plus de respect pour leur avis, même si les
mots qu’ils utilisent ne sont pas – et ils ne
peuvent pas l’être – juridiquement parfaits.
Pour vous, ce sont les concepts clairs, l’éva-
luation géométrique des mots et leur adéqua-
tion à la loi qui comptent, vous ne pouvez pas
mesurer la souffrance : une expertise ne vous
a même pas paru nécessaire. Dans un sens
heureusement. Faite par un de ces rares col-
lègues, outrageusement tendancieux et avi-
des, à qui vous persistez à attribuer des man-
dats, elle aurait constitué une ultérieure for me
de maltraitance pour ma patiente.
Elle ne peut pas travailler maintenant. Je
m’attends à ce que l’AI la soutienne pour un
apprentissage protégé, pour qu’elle puisse
avoir une occupation utile, sans nécessaire-
ment être rentable. Elle est limitée, angoissée,
perdue. Mais elle reste digne de respect et
mérite la solidarité que la société lui doit.
Pardonnez-moi : je n’arrive pas à me rési-
gner à l’injustice que tout le système AI produit.
Pr Marco Vannotti
Cerfasy
2000 Neuchâtel
mvannotti@gmail.com
dations. Or à ce jour, moins d’un patient sur
deux (de 32 à 50%) suit correctement le trai-
tement qui lui a été prescrit.»
Utiliser des antibiotiques ? Comme pour
de nombreuses autres maladies, il convient
ici de restreindre leur utilisation aux situa-
tions où ils sont nécessaires afin de limiter
l’émergence de souches bactériennes résis-
tantes. Pour ce qui est de l’isotrétinoïne, son
usage est, on le sait, proscrit chez les femmes
enceintes. Un test de grossesse négatif doit
impérativement être fourni avant chaque
prescription et renouvelé chaque mois par
les femmes pendant la durée du traitement
– ainsi que durant les cinq semaines sui-
vantes.
Suicide ? «L’augmentation du risque de
troubles dépressifs avec l’isotrétinoïne n’a
pas été observée dans les études sur un grand
nombre de patients mais a été exceptionnel-
lement suspectée dans des cas individuels,
précisent les auteurs. Pour cette raison, le
patient doit communiquer à son médecin –
avant le début d’un traitement – tous ses
éven tuels antécédents personnels et fami-
liaux de troubles psychologiques et psychia-
triques et avoir un suivi rapproché, notam-
ment au début du traitement.»
Contraception ? C’est, en France, une ques-
tion importante compte tenu de l’écho mé-
diatique et politique qu’a eu l’affaire dite des
pilules de 3e et 4e générations. Il est acquis
que certaines pilules contraceptives peuvent
avoir un effet positif sur l’acné. Pour autant,
les auteurs des recommandations estiment
qu’«on ne peut pas prescrire un contraceptif
à une femme qui n’a pas besoin de contra-
ception ou de ce type de contraception». «Le
choix du type de contraception doit être une
décision partagée entre le gynécologue et la
femme, en tenant compte de ses préférences
et de ses différents risques – notamment du
risque accru de maladie thromboembolique
veineuse pour les pilules de 3e ou 4e généra-
tions.»
En pratique, si un contraceptif doit être
prescrit à une femme présentant de l’acné, il
sera recommandé de prescrire en première
intention du lévonorgestrel (2e génération)
et en seconde intention du norgestimate (assi-
milé 2e génération) qui comportent une au-
torisation de mise sur le marché pour la con-
tra ception chez la femme présentant une
acné. Les antiacnéiques Diane 35 (acétate de
cyprotérone 2 mg-éthinylestradiol 35 mg) et
leurs génériques ne peuvent être envisagés
qu’en dernière intention si l’acné persiste
malgré un traitement dermatologique bien
conduit – et ce «en concertation avec la pa-
tiente et un gynécologue, et en tenant compte
des caractéristiques de la femme, concernant
notamment le risque thromboembolique».
Le cas échéant, on n’oubliera pas la question,
majeure, de l’arrêt du tabac.
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com
Le Centre Médical
de Vernier
Cherche 2 médecins
généralistes/internistes
avec éventuellement une
sous-spécialité
pour compléter son équipe
Contact :
Téléphone : 079 321 2545
1007615
44_47.indd 2 09.11.15 11:47
1
/
2
100%