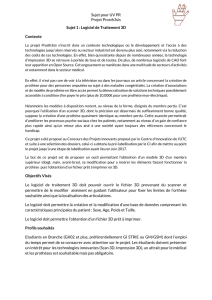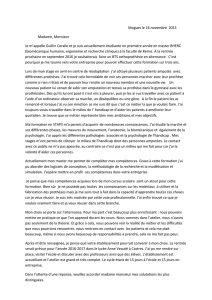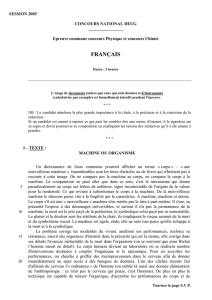EN UNE RÉFÉRENCE

42 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XII - n° 3 - mai-juin 2009
EN UNE RÉFÉRENCE
Référence
Cancer œsophagien avancé : quand protéger
les voies aériennes centrales ?
H. Dutau (unité d’endoscopie thoracique, pôle cardiovasculaire et thoracique, hôpital Sainte-Marguerite, CHU de Marseille)
Paganin F, Schouler L, Cuissard L et al. Airway and esopha-
geal stenting in patients with advanced esophageal can-
cer and pulmonary involvement. PLoS ONE 2008;3(8):
e3101.
L
a prise en charge de l’atteinte des voies aériennes centrales
(VAC) par les cancers œsophagiens avancés est assurément une
problématique relativement fréquente pour les pneumologues
(interventionnels).
Plusieurs aspects sous-tendent cette problématique et varient d’un
centre hospitalier à l’autre.
En premier lieu, ce sont les gastro-entérologues qui effectuent le
➤
bilan et la prise en charge thérapeutique initiale, de même que le suivi
des patients atteints de cette pathologie grave. Le plus souvent, les
pneumologues ne sont consultés qu’en cas de symptômes respiratoires,
mais rarement avant que ceux-ci n’apparaissent.
Habituellement, les premiers symptômes sont digestifs, avec une
➤
dysphagie aux solides puis aux liquides, pouvant évoluer vers l’aphagie.
C’est à ce stade que la mise en place d’une prothèse œsophagienne
est indiquée.
La prise en charge multidisciplinaire, qui devrait être de mise dans
➤
cette pathologie, n’est pas toujours effective, et rares sont les patients
qui bénéficient d’une double endoscopie (œsophagienne et trachéo-
bronchique), à la recherche d’une atteinte des VAC, préalable à la mise
en place d’une prothèse œsophagienne.
Le plus souvent, cette atteinte se situe dans la région carénaire
➤
(soit dans le tiers inférieur de la trachée, soit dans la moitié proximale
de la bronche principale gauche).
Cette atteinte peut être de plusieurs types : une compression extrin-
➤
sèque de gravité variable pouvant entraîner une dyspnée, une atteinte
intrinsèque par envahissement de contiguïté avec d’éventuelles lésions
exophytiques dans la lumière des voies aériennes, ou une atteinte mixte
(intrinsèque et extrinsèque).
Ces lésions peuvent se compliquer de fistules œso-trachéobronchi-
➤
ques, dont le pronostic est très sombre, avec une espérance de vie de
l’ordre de quelques semaines. En l’absence de traitement endoscopique,
les patients meurent de complications infectieuses sévères à type de
pneumopathies extensives ou de choc septique.
En cas d’atteinte des VAC (et surtout en cas de fistule), la mise en place
de deux prothèses, une œsophagienne et une trachéobronchique, est
recommandée
(1)
.
À l’ère de la médecine fondée sur les preuves, ces recommandations
n’ont pas beaucoup de poids, car elles relèvent de l’avis d’experts
ou de quelques études rétrospectives. Aucune étude prospective n’a
été réalisée à ce jour. De ce fait, beaucoup de questions demeurent,
concernant en particulier le moment idéal pour la mise en place de ces
prothèses et, à un degré moindre, le type de prothèses à utiliser.
Quelques considérations peuvent nous éclairer :
– la mise en place d’une prothèse œsophagienne seule en cas d’atteinte
des VAC méconnue expose le patient à une détresse respiratoire aiguë.
En effet, les prothèses utilisées dans l’œsophage sont des prothèses
métalliques auto-expansibles (PMAE), qui peuvent ajouter une pression
supplémentaire à une compression extrinsèque préexistante des VAC ;
– une PMAE œsophagienne seule expose le patient au risque d’ap-
parition d’une fistule, en raison du traumatisme qu’elle engendre au
niveau de ses deux extrémités non couvertes. Ce risque est majoré en
cas de radiothérapie associée ;
– en cas d’atteinte des VAC nécessitant la mise en place d’une prothèse,
celle-ci doit donc être mise en place avant la prothèse œsophagienne ;
– en cas d’atteinte de l’œsophage haut, la mise en place d’une prothèse
œsophagienne peut se révéler impossible en raison de la proximité de
la bouche de Killian. Toute prothèse à ce niveau est très mal tolérée
cliniquement. Dans ces cas rares, une prothèse trachéale seule peut
constituer l’unique possibilité lorsque le patient présente une fistule.
Analyse critique
L’article proposé par F. Paganin et al. tente d’apporter un autre regard
sur la prise en charge de cette pathologie. Faut-il mettre en place une
prothèse trachéobronchique en prévention des possibles complications
des prothèses œsophagiennes, ou faut-il attendre ces complications ?
Matériel et méthode
Quarante-quatre patients (37 hommes et 7 femmes) ont été inclus
dans une étude d’observation entre 2001 et 2007. Tous ces patients
présentaient des cancers de l’œsophage avancés nécessitant la pose
d’une prothèse œsophagienne. Une fibroscopie bronchique définissait
le type d’atteinte possible. Une fistule était retrouvée chez 41 % des
patients, une compression extrinsèque chez 29,5 % et une infiltration
tumorale chez 29,5 %. La mise en place de deux prothèses était la
règle pour tous les patients présentant une fistule ou une compression

La Lettre du Pneumologue • Vol. XII - n° 3 - mai-juin 2009 | 43
EN UNE RÉFÉRENCE
extrinsèque supérieure à 40 % de la lumière. Pour ceux qui présentaient
une infiltration tumorale sans réduction significative du calibre des
VAC, une prothèse trachéale ou bronchique était placée en prévention
des possibles complications des prothèses œsophagiennes. Deux sous-
groupes étaient ensuite formés. Le groupe 1 (7 patients) regroupait des
patients chez qui la mise en place de la prothèse des VAC était effectuée
dans l’urgence en raison de symptômes respiratoires aigus, alors que
le groupe 2 (37 patients) était composé des autres patients.
Résultats
Dans le groupe 1, la mise en place d’une prothèse dans les VAC s’est
révélée impossible chez 5 patients sur 7, alors que, dans le groupe 2,
tous les patients ont pu recevoir une prothèse avec succès. Les raisons
des échecs sont mal explicitées et leur nombre élevé est difficile à
comprendre, même dans le cadre de l’urgence. Il a résulté de l’inter-
vention un taux de mortalité très élevé dans le groupe 1 (86 % des
patients ont succombé à des complications immédiates) alors qu’il est
nul (0 %) dans le groupe 2 juste après l’opération. La différence est
bien évidemment significative (p < 0,0001).
La survie des patients du groupe 2, qui ont pu bénéficier pour la plupart
d’un traitement complémentaire anticancéreux (radiochimiothérapie),
est de 26 ± 11 semaines, alors que celle des 2 patients du groupe 1
est de 6 ± 7,6 semaines (p < 0,001).
Discussion et conclusion
La conclusion des auteurs, pour qui la mise en place d’une prothèse
trachéobronchique en prévention des complications des prothèses
œsophagiennes est nécessaire – même s’il y a une certaine logique à
cela –, est difficile à accepter au vu des données.
En effet, les deux sous-groupes ne sont pas comparables. Le groupe 1
(beaucoup plus petit que le groupe 2) regroupe des patients qui semblent
présenter les complications majeures des prothèses œsophagiennes
dans les voies aériennes centrales, probablement associées à de graves
répercussions respiratoires. Ce sont ces dernières qui sont à l’origine
du décès des patients et non pas leur cancer. Or, dans la méthode, il
était pourtant écrit que tous les patients étaient candidats à la mise
en place d’une prothèse œsophagienne et trachéobronchique, et que
cette dernière devait être placée en premier.
Il est difficile de comprendre le schéma exact de l’étude, et trop de
variables ne peuvent pas être prises réellement en compte.
Par ailleurs, il est clair que la mise en place d’une prothèse dans les
voies aériennes peut s’avérer très compliquée en cas de protrusion
d’une prothèse œsophagienne dans les VAC, mais, selon notre expé-
rience, les échecs sont rares. Cela étant, même en cas de succès, les
décès, de cause infectieuse pour la plupart, sont fréquents malgré une
amélioration symptomatique initiale.
Les données de cette étude ne suffisent pas pour justifier une attitude
pourtant logique : prévenir plutôt que guérir. Une véritable étude pros-
pective comparant deux groupes de même taille serait nécessaire ; les
patients, qui auraient tous besoin d’une prothèse trachéobronchique, en
bénéficieraient ou non de manière randomisée. Les patients nécessitant
la pose d’office d’une prothèse trachéobronchique en raison d’une réduc-
tion cliniquement significative du calibre des VAC en seraient exclus.
Cela permettrait également de connaître les complications de la mise en
place préventive d’une prothèse en l’absence de symptôme respiratoire.
Le problème des fistules est encore différent et plus compliqué, et là
aussi une étude prospective randomisée est indispensable : prothèse
œsophagienne avec ou sans prothèse trachéobronchique.
On le voit, beaucoup de travail reste à faire dans une discipline (la pneu-
mologie interventionnelle) qui présente encore à ce jour un manque cruel
d’études de niveau de preuve élevé. La complexité et la relative rareté
des cas rendent les choses compliquées ; seules des études prospectives
multicentriques et comparatives pourront répondre aux nombreuses
questions. Le Groupe d’endoscopie de langue française (GELF, groupe de
travail de la Société de pneumologie de langue française) doit œuvrer
dans ce sens. ■
Bibliographie
1. Kvale PA et al. American college of chest physicians. Lung cancer. Palliative
care. Chest 2003;123(Suppl. 1):284S-311S.
Réponse des auteurs aux commentaires de H. Dutau
F. Paganin, A. Bourdin (service de pneumologie, groupe hospitalier Sud-Réunion, Saint-Pierre)
de l’arbre bronchique après la mise en place d’une prothèse
œsophagienne. L’incidence élevée de cancers œsophagiens à La
Réunion nous a permis de recueillir une plus grande quantité
de données.
Le contexte a été parfaitement explicité par Hervé Dutau dans
son commentaire introductif. La fréquence des complications
trachéobronchiques induites par les prothèses œsophagiennes
N
ous sommes tout à fait d’accord avec l’analyse d’Hervé
Dutau sur les conclusions de notre étude, qui n’a jamais
eu pour but de prouver ni de démontrer une attitude
conforme aux règles de la médecine fondée sur les preuves.
Il s’agit d’un travail relatant une expérience accumulée au
cours des années. En parlant avec nos collègues, nous avons
constaté que beaucoup d’entre nous ont été confrontés à des
situations difficiles de patients qui avaient des complications

44 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XII - n° 3 - mai-juin 2009
EN UNE RÉFÉRENCE
est inconnue. Pour preuve, la grande variation des complications
rapportées dans la littérature gastroentérologique (2 à 30 %).
À notre avis, ces complications sont sous-estimées, car elles ne
sont pas systématiquement recherchées. Comme le souligne
Hervé Dutau, de nombreux patients ne bénéficient pas d’une
évaluation bronchoscopique initiale avant la pose de la prothèse
œsophagienne. Nous pensons que, en cas de complications
respiratoires non asphyxiques, beaucoup de patients sont consi-
dérés comme ayant une évolution péjorative de la maladie, le
traitement endoscopique étant considéré comme palliatif.
Les deux groupes de malades de notre étude sont parfaitement
comparables à la phase initiale, c’est-à-dire avant l’intervention
œsophagienne
(cf. PLoS ONE 2008;3[8]:2, tableau II)
, l’impact
de la prothèse œsophagienne ayant un retentissement majeur
sur la survie.
Nous comprenons l’interrogation d’Hervé Dutau sur les
méthodes. Tous ces patients ont eu une évaluation préalable
(ce qui, déjà, est un progrès). Cependant, ce n’est pas parce
que le pneumologue émet des recommandations, des réserves
ou des conseils que ceux-ci sont suivis ! La réalité quotidienne
est différente. Comme le souligne Hervé Dutau, la pneumologie
interventionnelle est une discipline confidentielle et balbutiante.
Beaucoup de nos collègues pneumologues n’ont pas d’expé-
rience en la matière. Devant une fistule trachéale ou bronchique
avérée, on peut facilement estimer que la mise en place d’une
prothèse œsophagienne permettra d’occlure la fistule, sans
penser que le retentissement sur l’arbre bronchique peut être
majeur. Cette attitude est d’ailleurs revendiquée par beaucoup
de gastro-entérologues. L’idée d’un appareillage préalable de
l’arbre bronchique est assez audacieuse, car la logique veut
que l’on commence par l’organe initialement atteint.
Nous avons eu beaucoup d’échecs dans le groupe des patients
admis en urgence, ce qui a étonné Hervé Dutau. Tous les échecs
ne sont pas dus uniquement à un problème technique. L’état
général de ces patients est précaire, et l’anesthésie est parfois
difficile (ou infaisable). En cas de protrusion de la prothèse
œsophagienne dans la trachée ou la bronche souche gauche,
il est relativement facile de mettre en place une prothèse
endobronchique après une dilatation au ballon qui repousse
la prothèse vers l’œsophage. En revanche, la mise en place
d’une prothèse de Dumon en Y est beaucoup plus complexe
(indication dans le cas de la figure 1 de l’article initial, PLoS ONE
2008;3[8]:2)
. Une petite prothèse ne répond pas forcément à
la situation et risque d’être écrasée par la force d’expansion
de la prothèse œsophagienne. Une grosse prothèse en Y est
difficile à positionner quand la lumière trachéobronchique
est encombrée par la prothèse œsophagienne et par du tissu
tumoral. Ces situations complexes sont exacerbées pour des
praticiens polyvalents qui n’ont pas le niveau d’expertise des
centres de référence. Les nouvelles prothèses métalliques en Y
montées sur fil guide permettront certainement de simplifier ces
procédures techniques. Au bout du compte, les résultats sont
malheureusement identiques, ce qui justifie l’adage employé
par Hervé Dutau : “Mieux vaut prévenir que guérir”. Nous
adhérons totalement à cette idée (même si, dans le contexte,
le mot “guérir” n’est guère adéquat), et c’est bien l’esprit de
l’article publié dans
PLoS ONE
. La concertation est également
devenue la règle en cancérologie au travers des unités de
concertation pluridisciplinaire (UCP). Le caractère insulaire de
l’Île de la Réunion et le petit nombre d’endoscopistes inter-
ventionnels (gastro-entérologues et pneumologues) a permis
de mettre en place une procédure d’évaluation. Nous pensons
que cette attitude a amélioré la prise en charge de ces patients
et limité les hospitalisations non programmées, sources d’une
mauvaise qualité de vie pour les malades et d’une inflation
des coûts de santé pour la société.
Le concept de prothèse préventive que nous avons employé
dans l’article peut surprendre ou irriter le lecteur. Dans notre
expérience, la mise en évidence d’une compression extrinsèque,
même mineure, associée à une rigidité de l’arbre bronchique
sur la zone concernée lors d’une manœuvre de toux suggère
un risque d’atteinte de la paroi bronchique en cas d’insertion
d’une prothèse œsophagienne. C’est dans ces conditions que
nous avons préconisé de mettre en place une prothèse endo-
bronchique de contre-pression. Ces compressions extrinsèques
sans infiltrations de la muqueuse bronchique et, a fortiori, sans
signes de fistule ne sont pas forcément reconnues comme une
lésion significative. L’un des quatre relecteurs de notre article
considérait aussi que la compression extrinsèque endobronchique
était un élément pathologique majeur, mais il ne précisait pas
le pourcentage d’obstruction de la lumière bronchique.
Comme le souligne Hervé Dutau, bien des interrogations demeu-
rent, et encore une fois notre article n’a jamais eu la prétention
d’y répondre. Le choix de présenter notre travail dans une
revue en accès libre (téléchargement gratuit) et généraliste
était délibéré, afin de permettre une diffusion pluridiscipli-
naire. Les pistes de travail proposées par Hervé Dutau sont
incontournables, et nous en mesurons la difficulté. Une étude
française ou européenne serait intéressante pour répondre
à ces questions. Nous serions bien sûr heureux de pouvoir y
participer et d’apporter notre modeste expérience.
En attendant des recommandations fondées sur des niveaux de
preuve élevés, nous espérons que notre travail pourra contri-
buer à une meilleure coopération entre gastroentérologues et
pneumologues, afin de parvenir à prendre en compte ensemble
les différents organes concernés. ■
L’article est téléchargeable sur le site de PLoS ONE et de PubMed.
1
/
3
100%