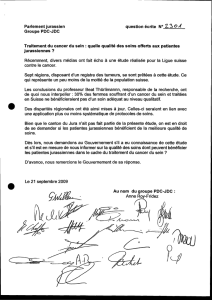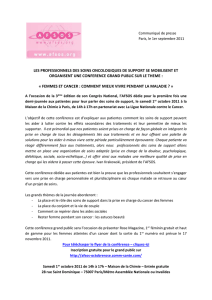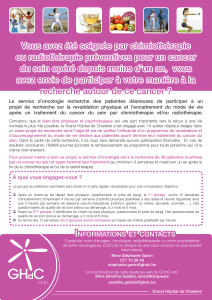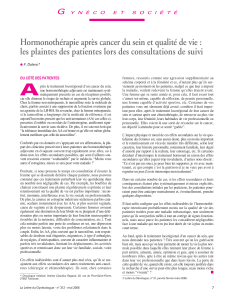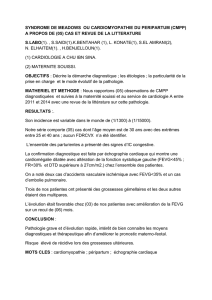Impacts territoriaux d`un réseau de soins

GÉOCARREFOUR
VOL
78
3/2003
255
Bernard BOUREILLE
CREUSET
Université de Saint-Étienne
Nicole
COMMERÇON
CNRS - UMR 5600 Lyon
"Environnement-Ville-
Société"
Myriam NORMAND
CREUSET
Université de Saint-Étienne
RÉSUMÉ
A partir de
l'exemple
du
réseau de
soins
ONCORA
(Oncologie Rhône-Alpes),
sont soulignés les effets
territoriaux d'un mode de
fonctionnement innovant en
matière de prise
en
charge
des
soins
de cancérologie.
En repérant
les
trajectoires
des patientes des
échantillons
retenus,
il
est
montré que
si
la hiérarchie
hospitalière et urbaine
demeure, elle n'en est pas
moins réduite par une
meilleure diffusion des
compétences médicales
entre tous
les
partenaires du
réseau.
L'effet
réseau
se
traduit
à la
fois par
un
gain
d'efficience économique du
système de
soins
et par une
plus
grande accessibilité à
une
thérapeutique
appropriée, quel que soit le
lieu de résidence des
patientes de Rhône-Alpes.
MOTS CLÉS
Réseau de
soins,
oncologie,
ONCORA, recomposition
territoriale,
trajectoires de
patientes.
ABSTRACT
Using
the example
of
the
ONCORA network (oncology
in
Rhône-Alpes),
this article
outlines the territorial effects
of
an
innovative way of
providing cancer treatment.
By identifying the
trajectories of female
patients
in
the sample used,
it
is
shown that although
hierarchies of
urban
centres
and hospitals
still
exist,
this
phenomenon
is
reduced by a
better diffusion of medical
skills between the different
partners of
the
network. The
effect of
the
network
is
to
provide a more economically
efficient healthcare system
Impacts territoriaux d'un réseau
de soins oncologiques
en Rhône-Alpes
Il convient de rompre avec
l'idée
simpliste selon
laquelle l'accélération des mobilités permises par
le développement technologique des communi-
cations viderait les lieux de leur sens en les
rendant parfaitement substituables. Au contraire,
la diversité des mutations des modes de produire
aboutit à une redécouverte du rôle
"actif"
et
structurant que jouent les territoires dans la
dynamique économique actuelle, en particulier les
nouvelles organisations réticulaires, y compris au
sein du service public.
Dans ce domaine, le secteur de la santé apparaît
davantage pertinent. En effet, il a développé
récemment maintes mutations qui ont conduit à
dépasser les découpages territoriaux pré-existants.
Le principal changement se résume dans la
substitution
d'une
offre de soins de plus en plus
technique à une médecine davantage clinique,
dans un contexte de nécessaire maîtrise des
dépenses de santé, mais aussi de développement
de
l'accès
équitable aux services de soins ; aussi
des innovations organisationnelles sont-elles
élaborées, qui mobilisent de plus en plus des
formes diverses de partenariat entre les
prestataires de soins, entre ces prestataires et
d'autres acteurs tels que les collectivités
territoriales et le milieu associatif. Ces partenariats,
parfois anciens, initient des relations territoriales
dont les configurations s'émancipent des
frontières institutionnelles - et notamment
urbaines -, pour participer à la dynamique de
recomposition des espaces urbains.
En France, au cours de ces dernières années, sous
l'impulsion
d'une
redéfinition de la méthodologie
de la planification sanitaire - introduction de
critères qualitatifs dans une logique purement
quantitative de la carte sanitaire -, fleurissent des
formes réticulaires d'offre de soins, en réponse à
un impératif réglementaire introduit par la loi
hospitalière du 31 juillet 1991 et renforcé
notamment par les ordonnances de
1996.
Certains
de ces réseaux de soins se développent à
l'intérieur
des frontières traditionnelles de la ville ;
d'autres s'étendent sur des échelles territoriales
qui dépassent le strict cadre urbain ;
ainsi,
en
est-il,
plus particulièrement, des traitements en
oncologie qui, dans la région Rhône-Alpes,
s'organisent sur ce mode autour
d'une
institution-
pivot, le Centre Léon Bérard (CLB) localisé
à
Lyon1.
Celui-ci met en relation, en particulier à travers le
réseau Oncologie Rhône-Alpes (ONCORA), divers
acteurs de santé des secteurs ambulatoire et
hospitalier à statut public, privé, ou privé
participant au service public, localisés dans une
vingtaine de villes de la région Rhône-Alpes et de
sa périphérie (fig. 7). Dans ce cas spécifique, le
réseau structure l'oncologie au sein des disciplines
médicales, en la situant
à
la croisée des spécialités
verticales (d'organes) et, tout en lui donnant sa
lisibilité disciplinaire, concourt à la recomposition
des territoires par le biais des villes concernées, de
la métropole aux villes de taille intermédiaire. Le
réseau participe aussi à une logique de construc-
tion
d'une
nouvelle culture médicale en amenant
à
travailler ensemble des prestataires de soins
formés dans des "écoles" jusque-là relativement
indépendantes.
Ces innovations organisationnelles en matière de
santé sont donc amenées à terme à redessiner le
paysage sanitaire français : à un système à
éléments hiérarchisés, centralisés et cloisonnés, se
substituerait une mosaïque d'unités "cellulaires" à
compétences diverses mais coordonnées.
Cette étude vise, à partir de la structuration du
réseau ONCORA autour du CLB, à analyser les
recompositions spatio-médicales en matière
d'offre de soins que cette innovation organisation-
nelle
a
favorisées.
La méthode de statique comparative adoptée ici
part des données recueillies par le CLB. Celles-ci
sont organisées selon trois types de documents
(Brunet, 2 000). Le premier : le "dossier papier" est
le plus traditionnel et potentiellement le plus
exhaustif en termes d'informations, car il devrait
inclure les diverses correspondances médicales et
les comptes-rendus des examens propres au
patient
;
mais il est aussi le plus lourd
à
utiliser et le
moins bien systématiquement organisé. Le
deuxième : le "dossier patient informatisé", mis en
place à partir de 1992, est bien renseigné et bien
organisé, mais à usage clinique avec des
procédures de protection qui en interdisent la
consultation.
Le
troisième : la "fiche
EPC"
est créée
pour chaque patient lors de sa première venue au
CLB et a pour vocation d'alimenter "l'Enquête
Permanente Cancer" menée
à
l'échelle
nationale et
de ce fait recense principalement les variables qui
décrivent les caractéristiques des lésions et de leur
traitement. Cependant, elle contient également des
informations relatives à l'origine, au motif de la
première consultation du patient au CLB et à sa
localisation géographique dont l'exploitation est
utile pour la constitution des échantillons.
La méthode consiste à analyser, dans un premier
temps, les fiches
EPC
qui ont été créées au CLB en
1992 - année antérieure à la naissance d'ONCORA
- et en 1999 - année postérieure à la création de ce
réseau -, pour permettre de décrire la population
des nouvelles patientes du CLB consultant pour
une tumeur maligne du sein à ces deux dates2.
On se dote ainsi des éléments nécessaires à la
construction de deux échantillons de population
dont les individus seront ensuite caractérisés par
des variables plus complètes que celles des fiches
EPC,
puisqu'extraites par enquête des dossiers
médicaux papiers. Ce qui permettra, dans un
second temps, d'exploiter les données des
échantillons pour repérer la dynamique des
trajectoires médico-spatiales présente entre 1992
et 1999.

256 VOL 78 3/2003 Impacts territoriaux
d'un
réseau de soins
oncologiques
en
Rhône-Alpes
en 1992 en 1999 and improved accessibility
to
an
appropriate therapy
irrespective of where the
patient resides
in
the Rhône-
Alpes region.
KEY
WORDS
Healthcare network,
oncology, ONCORA,
territorial restructuring,
patients'
treatment
trajectories.
Figure
1
: Répartition des nouvelles patientes selon leur zone d'habitation, en 1992 et en 1999
A terme, ces analyses de statique comparative
conduisent à révéler certains effets réticulaires au
niveau territorial et médical.
RECOMPOSITION DU BASSIN DE SANTÉ ET DES
MODALITÉS
DE
SAISINE
DU
CLB
Les informations extraites des fiches EPC de 1992
et 1999 sont de nature spatiale ou médicale. Elles
portent sur la localisation géographique des
patientes nouvellement accueillies au CLB ou
caractérisent la cause de leur première consulta-
tion,
en termes de modalités d'entrée et d'objectifs
demandés.
Évolution de la provenance géographique des
patientes
du CLB
La provenance géographique des patientes est
indiquée dans les fiches EPC par le nom de la
commune (et de son code postal) de leur
rési-
dence.
Ces informations permettent, à un premier
niveau,
de décrire la répartition de ces patientes
par départements d'origine, puis, à un second,
d'affiner l'analyse de la localisation de celles-ci en
zones urbaines d'habitation puisque la dénomi-
nation de la commune permet de retrouver son
code INSEE et son aire urbaine de rattachement.
Les nouvelles patientes du CLB résident principa-
lement dans les départements de la Région
Rhône-Alpes. En effet, ce sont, 83% et
85%
de ces
malades qui habitent respectivement
en
1992 et en
1999 dans l'un des huit départements de Rhône-
Alpes.
Seulement
11%
de l'effectif en 1992, voire
5% en 1999, provient des départements limitro-
phes à cette dernière Région. Parmi ces derniers,
la Saône-et-Loire est l'origine prépondérante.
Ce premier constat des états de la répartition
résidentielle des patientes conduit à ne conserver,
pour la suite de l'étude, que l'ensemble des
malades provenant de la région Rhône-Alpes et du
département de la Saône-et-Loire ; ce qui
représente un effectif de 985 individus en 1992
(soit
91%
du total des personnes nouvellement
accueillies) et un effectif
de
1270 en 1999 (soit
88%
du total des personnes nouvellement accueillies).
Le détail de la répartition de la localisation des
nouvelles patientes du CLB exprimée en termes
d'aires urbaines est présenté dans le tableau
1
ci-
dessous où l'on remarque notamment, entre 1992
et 1999, la baisse de l'effectif originaire des zones
de Mâcon et d'Annecy et
à
l'inverse la croissance
de celui qui est
issu
de
l'aire
de Grenoble.
Le regroupement de ces zones d'habitation en
trois grandes catégories :
l'aire
urbaine de Lyon,
les autres aires urbaines et les communes rurales
laisse apparaître, entre 1992 et 1999, une légère
réduction spatiale de l'attractivité du CLB. En effet
cet établissement accueille parmi ses nouvelles
patientes en 1999, par rapport à 1992, proportion-
nellement plus de résidentes de
l'aire
de Lyon et
moins de celles des autres aires urbaines et des
communes rurales
(fig.
1).
Ce premier résultat de l'analyse, en termes de
statique comparative, de la localisation des
patientes nouvellement accueillies au
CLB
en 1992
et en 1999 peut être interprété comme
conséquence d'un effet réseau. La constitution du
réseau ONCORA, son extension spatiale par le
biais de l'adhésion de nouveaux partenaires et
l'élaboration en commun de protocoles de soins,
qui participent à l'accroissement cumulatif et à la
généralisation dans ce milieu réticulaire des
compétences des acteurs, font que les malades
trouvent plus à proximité de leur domicile en
1999,
qu'en 1992, les offreurs capables de
répondre à un certain niveau à leur demande de
santé.
Ainsi le CLB renforce-t-il relativement son
rôle d'établissement de proximité.
Cette évolution du système localisé de
l'offre
de
soins en oncologie amène à formuler une
nouvelle hypothèse de travail. En effet, le CLB se
voit décharger par les établissements du réseau
1 - Les auteurs remercient
vivement le Professeur Thierry
Philipp, directeur du Centre
Léon Bérard et le Docteur
Fadila Farsi, responsable du
réseau ONCORA, pour leur
active collaboration.
2 - Le sein étant le siège de
localisation le plus fréquent
des cancers. En 1992, 5148
fiches EPC ont été créées dont
3511 indiquent le site de la
tumeur qui est pour 1082 cas
le sein (soit environ
31
% des
cas renseignés) ; en 1999,
6906 fiches ont été créées,
dont 5894 sont renseignées
quant au siège qui est pour
1445 cas le sein (soit 24,5%
des cas renseignés).

Impacts territoriaux d'un réseau de soins oncologiques en Rhône-Alpes VOL 78 3/2003 257
Figure 2 : Répartition des
nouvelles patientes selon
l'origine de la première
consultation, en 1992 et en 1999
en 1992
en
1999
Tableau 1 : Répartition des nouvelles patientes selon leur
zone
d'habitation de la nécessité de l'accueil de certaines patientes ;
dès lors
n'a-t-il
pas la possibilité de substituer au
sein de son activité, à une partie devenue banale,
une partie de pointe, c'est-à-dire une offre de soins
plus en phase avec la sophistication de son
plateau technique et les hautes compétences de
ses ressources humaines
?
La vérification de cette
hypothèse passe par une analyse de l'évolution
des modalités des premières consultations
effectuées
au
CLB.
Évolution
de la
saisine médicale
du
CLB
Les fiches EPC renseignent, à
l'aide
de deux
variables, sur deux des caractéristiques de la
première consultation des patientes au CLB. La
première variable, dénommée "origine", précise
l'acteur qui a l'initiative de la demande ; la
seconde, appelée "but", désigne la nature de la ou
des investigations souhaitées par le demandeur de
la consultation.
Les
initiateurs
de la
première consultation
Les modalités de la variable "origine" sont
regroupées pour les besoins de J'analyse en trois
catégories
:
Patiente,
Médecin et Établissement.
Globalement, on assiste à une double évolution
structurelle (fig. 2), qui se manifeste, d'une part,
par le renforcement du rôle, déjà important,
d'initiateurs que les médecins du secteur
ambulatoire jouent en adressant au CLB 50% (en
1992) puis 62% (en 1999) de ses nouvelles
patientes ; et d'autre part, par le recul du recours
au CLB en première intention : la proportion des
nouvelles patientes venant consulter d'elles-
mêmes décroît
de
30%
à
18%,
entre 1992 et 1999
Spatialement, l'évolution de cette pratique n'a pas
la même intensité (fig. 3). L'origine de la
consultation diffère sensiblement selon le lieu de
résidence des patientes. Le mode de saisine,
nettement indirect, du CLB par les ruraux change
très peu au cours de la période considérée. En
revanche, celui des patientes de
l'aire
urbaine de
Lyon se modifie radicalement. En 1992, 38% des
patientes lyonnaises sont venues consulter de leur
propre initiative alors que cette fréquence est
réduite à moins de 25% pourcelles résidant en
dehors de cette zone urbaine. En
1999,
les compor-
tements tendent
à
s'uniformiser, la part des patien-
tes consultant en première intention se réduit
considérablement quelle que soit l'origine géogra-
phique des patientes, les patientes étant alors plus
souvent adressées
au CLB
par un médecin.

258 VOL 78
3/2003
Impacts territoriaux
d'un
réseau de soins
oncologiques
en
Rhône-Alpes
Autrement dit, on assiste globalement, entre 1992
et
1999,
à une nette tendance
à
l'allongement de la
filière de soins amont des nouvelles patientes
urbaines, et surtout de
l'aire
de Lyon, du CLB. Ce
qui tend à infirmer l'hypothèse de l'accroissement
de la fonction d'établissement de proximité du
CLB au cours de la période.
Évolution des modalités de la demande de la
première consultation
au
CLB
La figure 4 décrit la répartition des premières
consultations effectuées au CLB en 1992 et 1999
suivant les modalités de leur finalité. Le dépistage
est une activité très marginale du CLB, il concerne
environ 1% des demandes de consultation.
L'examen
spécial est un but beaucoup plus
présent
en 1999
avec
10%
des consultations contre
seulement
1%
en 1992, ce sont principalement les
médecins et les établissements qui en sont les
prescripteurs. La plupart des consultations,
environ 90%, se distribue selon trois modalités :
avis diagnostique, avis thérapeutique et traitement
regroupant traitement initial, complémentaire et
secondaire. Une évolution notable
s'est
produite
entre 1992 et 1999 avec une nette augmentation
des consultations pour avis thérapeutique.
La figure 5 montre que
l'évolution
du but des
consultations observée ci-dessus dépend du statut
du demandeur. Les établissements adressent leurs
patientes principalement pour traitement, il n'y a
pas de véritable évolution entre 1992 et 1999. En
revanche, pour les patientes envoyées par un
médecin ou venant d'elles-mêmes, la consultation
se fait pour avis thérapeutique plus fréquemment
en
1999
qu'en 1992.
Il convient donc de souligner la tendance à
l'allongement amont des filières de soins des
nouvelles patientes du CLB que permettent
l'existence et le renforcement du réseau ONCORA
en termes d'acteurs de santé et de compétences
accrues et plus diffusées dans le milieu réticulaire.
Ce qui permet de décharger le CLB d'actes
devenus standardisés, puisque pouvant être faits
par d'autres agents en d'autres lieux, pour qu'il
puisse se focaliser sur des activités plus
innovantes. L'évolution, ci-dessus décrite, de la
nature de la demande des premières consultations
des nouvelles patientes du CLB confirme, à un
premier niveau, le renforcement de
l'activité
médicale de pointe de cet établissement. En
effet,on assiste, proportionnellement, à une
montée des examens spéciaux, des avis thérapeu-
tiques, mais à une réduction des avis diagnos-
tiques, et à une demande par des établissements
de traitements dont on peut penser qu'ils sont de
plus
en
plus sophistiqués.
Il convient, dès lors, d'affiner
l'analyse
en essayant
de repérer et de décrire plus précisément les
Tableau 2 : Description de
l'échantillon
Figure 4 : Répartition des consultation de 1992 et 1999 selon leur finalité
Figure 5 : Évolution de la finalité de
la première consultation entre 1992
et 1999 selon le statut du
demandeur
Figure 3 : Évolution de
l'origine
de la première consultation
entre 1992 et 1999 selon le lieu
de résidence des patientes

Impacts territoriaux d'un réseau de soins oncologiques en Rhône-Alpes VOL 78
3/2003
259
Tableau 3 : Déplacements du patient vers le prescripteur
Tableau 4a : Détails des déplacements entre la patiente et le prescripteur en 1992
Tableau 4b : Détails des déplacements entre la patiente et le prescripteur en 1999
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%