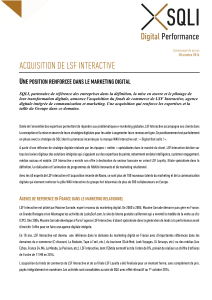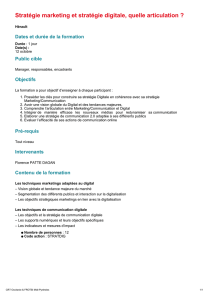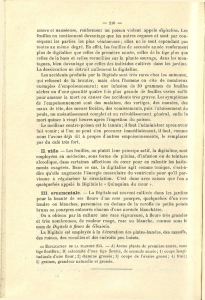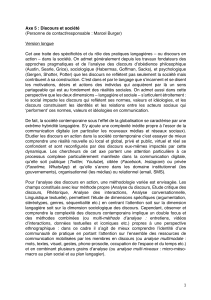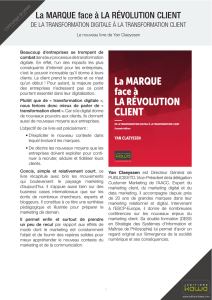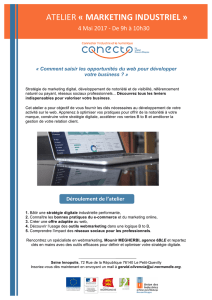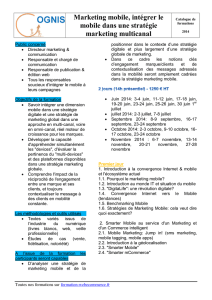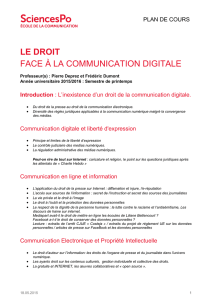Nécroses digitales Digital necrosis

Revue
du
rhumatisme
monographies
79
(2012)
96–100
Disponible
en
ligne
sur
www.sciencedirect.com
Nécroses
digitales
Digital
necrosis
Eric
Hachulla∗,
Pierre-Yves
Hatron
Service
de
médecine
interne,
centre
de
référence
des
maladies
auto-immunes
et
systémiques
rares
(sclérodermie
systémique),
hôpital
Claude-Huriez,
CHU
de
Lille,
59037
Lille
cedex,
France
i
n
f
o
a
r
t
i
c
l
e
Historique
de
l’article
:
Accepté
le
9
aoˆ
ut
2011
Disponible
sur
Internet
le
3
mars
2012
Mots
clés
:
Nécrose
digitale
Sclérodermie
Maladie
de
Buerger
Artériopathie
professionnelle
Embolie
r
é
s
u
m
é
Alors
que
l’ulcère
digital
reflète
en
général
la
présence
d’une
ischémie
focale
liée
à
une
microangiopa-
thie,
la
gangrène
digitale
serait
plus
la
conséquence
d’une
macroangiopathie
parfois
associée
aussi
à
la
microangiopathie.
La
gangrène
digitale
est
une
manifestation
clinique
fréquente
des
connectivites,
particulièrement
de
la
sclérodermie
systémique.
Il
y
a
cependant
de
multiples
autres
causes
possibles
:
la
maladie
de
Buerger,
les
causes
professionnelles
comme
le
syndrome
du
marteau
hypothénar
ou
les
vasculopathies
obstructives
dues
à
des
embolies
d’origine
sous-clavière
ou
cardiaque.
Plus
rarement,
on
peut
trouver
comme
cause
une
vascularite,
une
cryoglobulinémie,
une
thrombocytémie
essentielle
ou
une
maladie
de
Vaquez,
voire
une
tumeur
solide.
Il
peut
s’agir
d’un
mode
inaugural.
Il
faut
dans
tous
les
cas
aussi
rechercher
une
cause
médicamenteuse
comme
la
bléomycine
ou
l’interféron
alpha.
Un
examen
clinique
minutieux
est
bien
souvent
suffisant
pour
évoquer
une
cause
spécifique.
L’échocardiographie
et
l’écho-Doppler
des
MS,
un
bilan
biologique
à
la
recherche
d’un
syndrome
inflammatoire,
NF,
recherche
de
cryoglobuline,
d’anticorps
anticytoplasme
des
polynucléaires
neutrophiles
(ANCA)
et
la
recherche
d’anticorps
antinucléaires
sont
nécessaires.
Dans
certains
cas,
l’artériographie
du
membre
supérieur
est
nécessaire
pour
identifier
un
mécanisme
causal
comme
un
anévrisme
sous-clavier
ou
une
plaque
d’athérome
ou
bien
pour
confirmer
l’existence
d’une
authentique
artérite
digitale
comme
au
cours
de
la
maladie
de
Buerger.
Une
amputation
limitée
est
souvent
nécessaire
mais
elle
peut
survenir
spontanément.
Le
traitement
est
d’abord
celui
de
la
cause.
©
2012
Publi´
e
par
Elsevier
Masson
SAS
pour
la
Société
française
de
rhumatologie.
Keywords:
Digital
necrosis
Scleroderma
Buerger’s
disease
Occupationnal
arteriopathy
Embolism
a
b
s
t
r
a
c
t
As
digital
ulcers
usually
reflect
focal
ischemia
due
to
a
microangiopathy,
digital
gangrene
is
more
likely
to
be
the
consequence
of
a
macroangiopathy
which
can
also
sometimes
be
associated
with
a
microangiopa-
thy.
Digital
gangrene
is
a
common
skin
manifestation
of
connective
tissue
diseases,
especially
systemic
sclerosis.
Other
multiple
causes
are
possible:
Buerger’s
disease,
occupational
diseases
(particularly
hypo-
thenar
hammer
syndrome)
or
obstructive
vascular
disease
due
to
subclavian
artery
embolism
or
cardiac
embolism.
More
rarely
vasculitis,
cryoglobulinemia,
polycythemia
vera
and
essential
thrombocythemia
or
solid
cancer
are
associated
with
digital
gangrene,
sometimes
as
a
first
manifestation.
Drug-induced
digital
gangrene
should
in
all
cases
be
checked
(particularly
bleomycine
and
interferon
alpha).
A
thorough
clinical
examination
is
frequently
enough
to
evoke
a
specific
cause.
Cardiac
and
upper
limbs
echo-Doppler,
biological
examination
looking
for
an
inflammatory
syndrome,
an
abnormal
blood
formula,
the
presence
of
a
cryoglobulinemia,
antineutrophil
and
antinuclear
antibodies
is
mandatory.
In
some
cases,
upper
limb
arteriography
is
needed
to
identify
a
mechanism
such
as
subclavian
aneurism
or
atherosclerotic
plaques
or
to
confirm
digital
arteritis
as
shown
in
Buerger’s
disease.
Limited
amputation
is
frequently
needed,
but
may
sometimes
occur
spontaneously.
The
main
treatment
is
to
treat
the
cause.
©
2012
Published
by
Elsevier
Masson
SAS
on
behalf
of
the
Société
française
de
rhumatologie.
La
nécrose
ou
gangrène
digitale
est
le
terme
évolutif
d’une
isché-
mie
digitale
dont
les
causes
sont
multiples
et
variées.
La
démarche
∗Auteur
correspondant.
Adresse
e-mail
:
(E.
Hachulla).
étiologique
est
l’étape
essentielle
de
la
prise
en
charge
d’une
nécrose
digitale
et
repose
d’abord
sur
une
analyse
clinique
précise
et
méthodique,
qui
permet
très
souvent
d’approcher
la
patholo-
gie
causale
et
d’orienter
ainsi
les
explorations
paracliniques.
Très
schématiquement,
quatre
principaux
mécanismes
peuvent
être
en
cause
:
embole
d’origine
cardiaque
ou
artérielle,
thrombose
1878-6227/$
–
see
front
matter
©
2012
Publi´
e
par
Elsevier
Masson
SAS
pour
la
Société
française
de
rhumatologie.
doi:10.1016/j.monrhu.2012.01.001

E.
Hachulla,
P.-Y.
Hatron
/
Revue
du
rhumatisme
monographies
79
(2012)
96–100
97
Fig.
1.
Stries
hémorragiques
sous-unguéales
(ischémie
digitale).
vasculaire,
vascularite
ou
angiopathie
spécifique
comme
dans
la
sclérodermie
[1].
1.
Diagnostic
d’une
nécrose
digitale
La
nécrose
digitale
s’installe
après
un
stade
initial
d’ischémie
digitale,
dont
il
importe
de
reconnaître
au
plus
vite
les
signes,
afin
d’éviter
la
constitution
irréversible
de
la
nécrose
ou
gangrène.
Le
délai
entre
la
survenue
de
ces
signes
d’ischémie
et
la
constitu-
tion
des
troubles
trophiques
est
variable
en
fonction
de
l’étiologie.
La
gangrène
peut
s’installer
d’emblée
comme
dans
les
proces-
sus
emboliques
ou
thrombotiques,
ou
après
une
longue
période
d’ischémie
comme
dans
la
microangiopathie
de
la
sclérodermie.
L’ischémie
digitale
peut
se
manifester
initialement
par
un
phéno-
mène
de
Raynaud
atypique
par
sa
sévérité
et
par
sa
localisation
:
une
phase
syncopale
particulièrement
prolongée
survenant
sans
réel
refroidissement,
douloureuse,
ces
douleurs
pouvant
persister
entre
les
crises,
notamment
la
nuit.
Ce
phénomène
de
Raynaud
d’apparition
récente
peut
ne
toucher
qu’une
main
ou
qu’un
ou
quelques
doigts
de
la
main.
Une
cyanose
douloureuse,
pulsatile
et
froide,
d’un
ou
plusieurs
doigts
prenant
volontiers
un
aspect
livédoïde
est
également
un
signe
d’alerte.
À
l’examen
clinique,
la
présence
de
stries
hémorragiques
sous-unguéales
est
pathogno-
monique
d’une
ischémie
digitale
(Fig.
1).
La
manœuvre
d’Allen
(Matériel
supplémentaire,
Vidéo
S1)
(la
manœuvre
consiste
dans
un
premier
temps
à
comprimer
l’artère
radiale
et
l’artère
cubitale
au
poignet.
Le
patient
ferme
ensuite
le
poing
fermement
de
fac¸
on
répétée,
une
dizaine
de
fois,
avec
flexion,
extension
des
doigts.
Ensuite,
le
patient
garde
la
main
ouverte
et
l’examinateur
relâche
dans
un
premier
temps
l’artère
radiale,
puis
relâche
l’artère
cubitale,
cinq
à
dix
secondes
plus
tard.
La
manœuvre
doit
être
répétée
en
relâchant
tout
d’abord
l’artère
cubitale.
Cette
manœuvre
permet
ainsi
de
contrôler
la
bonne
per-
méabilité
des
artères
radiale
et
cubitale
mais
aussi
des
arcades
palmaires
ainsi
que
des
collatérales
digitales
;
sur
la
vidéo,
on
peut
voir
une
patiente
atteinte
de
sclérodermie
systémique
ayant
une
thrombose
cubitale)
est
indispensable
pour
confirmer
l’ischémie
digitale,
en
montrant
le
retard
de
recoloration
d’un
ou
de
plu-
sieurs
doigts
à
la
levée
de
la
compression
artérielle,
et
permet
même
d’approcher
la
topographie
des
lésions
artérielles
(isché-
mie
d’un
ou
de
plusieurs
doigts,
souffrance
du
territoire
radial
ou
cubital,
atteinte
uni
ou
bilatérale).
Au
stade
ultérieur,
les
troubles
trophiques
apparaissent,
avec
ulcération
ou
excoriation
pulpaire,
infarctus
péri
unguéal
(Fig.
2),
gangrène
pulpaire
plus
ou
moins
étendue
(Fig.
3).
Fig.
2.
Infarctus
périunguéal.
Le
diagnostic
d’ischémie
digitale
est
essentiellement
clinique
et
peut
être
aidé
par
la
mesure
de
la
pression
systolique
digitale,
exa-
men
précieux
pour
faire
l’inventaire
des
doigts
lésés,
et
rechercher
notamment
une
atteinte
infraclinique
de
la
main
controlatérale.
L’imagerie
vasculaire
tant
à
l’échelon
microcirculatoire
(capilla-
roscopie)
que
macrocirculatoire
(écho-Doppler,
angioscanner
et
angio-IRM,
éventuellement
artériographie),
s’inscrit
beaucoup
plus
dans
le
cadre
d’une
démarche
étiologique
que
du
diagnostic
positif.
2.
Recherche
de
la
cause
Les
trois
principales
causes
d’ischémie
digitale,
qui
à
elles
seules
concernent
près
des
deux
tiers
des
patients,
sont
les
connectivites,
au
premier
rang
desquelles
la
sclérodermie,
la
maladie
de
Léo-
Buerger
et
enfin
les
causes
professionnelles
et
occupationnelles
(Tableau
1).
L’examen
clinique
doit
permettre
d’orienter
les
explorations
paracliniques
:
capillaroscopie,
écho-Doppler
des
membres
supé-
rieurs
statiques
et
dynamiques,
angioscanner
aortique
à
la
recherche
d’une
éventuelle
plaque
d’athérome,
échocardiographie,
Holter
rythmique
et
bilan
biologique
(Tableau
2).
2.1.
Connectivites
C’est
de
loin
la
sclérodermie
qui
prédomine
dans
ce
groupe
d’étiologies.
Les
ulcères
digitaux
touchent
en
effet
un
patient
sur
Fig.
3.
Gangrène
digitale.

98
E.
Hachulla,
P.-Y.
Hatron
/
Revue
du
rhumatisme
monographies
79
(2012)
96–100
Tableau
1
Étiologies
des
nécroses
digitales,
à
propos
de
278
observations
personnelles
(don-
nées
non
publiées).
Connectivites 30,5
%
Sclérodermies 26,5
%
Artérite
juvénile
tabagique
(Buerger)
16,5
%
Causes
professionnelles
15
%
Syndrome
du
marteau
hypothénar
10,5
%
Causes
emboliques
8,5
%
Point
de
départ
sous-clavier 4,5
%
Cardiaque 3
%
Vascularites 4
%
Cryoprotéines
3
%
Hémopathies
3
%
Syndrome
des
antiphospholipides
2
%
Fistules
ou
malformations
artérioveineuses 1,5
%
Cancers 1
%
Artérite
radique <1
%
Artériopathie
diabétique
<1
%
Artériopathie
iatrogène
<1
%
Association
syndromique 7
%
Indéterminée
4
%
deux
atteints
de
cette
affection.
On
peut
très
schématiquement
en
distinguer
trois
types
:
les
ulcérations
en
regard
des
reliefs
articulaires
et
notamment
des
interphalangiennes
proximales
et
métacarpophalangiennes
qu’on
observe
dans
les
sclérodactylies
évoluées,
les
ulcérations
liées
à
une
calcinose
sous-cutanée
et
enfin
les
ulcères
réellement
ischémiques,
qui
vont
de
la
petite
ulcéra-
tion
pulpaire
millimétrique
aux
gangrènes
digitales.
Ces
ulcérations
surviennent
souvent
précocement
dans
l’histoire
de
la
maladie
[2]
et
peuvent
même
être
révélatrices.
Elles
sont
plus
fréquentes
dans
la
forme
diffuse
de
la
maladie,
mais
les
gangrènes
digi-
tales
de
grande
taille
responsables
d’amputation
majeure,
semblent
concerner
surtout
les
formes
limitées
avec
anticorps
anticentro-
mère
[3]
et
reflètent
l’existence
d’une
macroangiopathie.
Elles
peuvent
même
survenir
avant
l’apparition
des
premiers
signes
cutanés
de
la
maladie.
La
capillaroscopie
prend
ici
toute
son
impor-
tance
dans
l’orientation
diagnostique.
2.2.
Autres
connectivites
La
nécrose
digitale
est
une
complication
rare
du
lupus
érythé-
mateux
systémique
touchant
moins
de
1
%
des
patients
[4].
Elle
n’est
pas
toujours
en
rapport
avec
un
syndrome
des
antiphospholi-
pides
ou
avec
une
cryoglobulinémie
[5].
Le
syndrome
primaire
des
antiphospholipides
n’est
pas
une
cause
exceptionnelle
de
nécroses
digitales
(3
à
8
%)
[6]
et
peut
être
une
manifestation
révélatrice.
Il
peut
réaliser
un
tableau
clinique
voisin
de
la
maladie
de
Buerger
[7].
Des
nécroses
digitales
peuvent
également
s’observer
au
cours
des
dermatomyosites
ou
du
syndrome
des
antisynthétases
[8],
elles
y
sont
souvent
associées
à
un
syndrome
de
Raynaud.
Enfin,
de
fac¸
on
exceptionnelle,
les
nécroses
digitales
peuvent
s’observer
au
cours
du
syndrome
de
Gougerot-Sjögren
primitif,
notamment
en
cas
de
cryoglobulinémie.
Tableau
2
Examens
biologiques
à
réaliser
en
cas
de
gangrène
digitale.
Numération
formule
Glycémie,
cholestérol,
triglycérides
(«
exploration
d’une
anomalie
lipidique
[EAL]
»
[prescription
remboursée])
VS,
CRP,
fibrinogène
Électrophorèse
des
protéines
sériques
Cryoglobulinémie
et
CH50
Anticorps
antinucléaires
Anticorps
antiprothrombinase,
anticorps
anticardiolipine
Anticorps
anticytoplasme
des
polynucléaires
neutrophiles
(ANCA)
Fig.
4.
Anévrisme
cubital
thrombosé
au
cours
d’un
syndrome
du
marteau
hypothé-
nar
vu
en
échographie.
2.3.
Causes
professionnelles
Elles
sont
au
deuxième
rang
derrière
les
connectivites.
Il
fau-
dra
penser
au
syndrome
du
marteau
hypothénar
en
présence
d’une
nécrose
digitale
touchant
un
ou
plusieurs
des
trois
doigts
cubitaux
de
la
main
dominante,
chez
un
sujet
exposé
professionnellement
aux
traumatismes
directs
ou
indirects
de
l’éminence
hypothénar
(bâtiment,
métallurgie,
menuiserie),
précédée
d’un
phénomène
de
Raynaud
apparu
quelques
mois
auparavant,
rapidement
sévère
et
compliqué
de
troubles
trophiques.
La
manœuvre
d’Allen
est
tou-
jours
pathologique
et
le
diagnostic
est
confirmé
par
l’écho-Doppler
(Fig.
4)
puis
l’angiographie,
révélant
la
thrombose
ou
l’anévrisme
de
l’artère
cubitale
dans
le
canal
de
Guyon.
Beaucoup
plus
rarement,
l’atteinte
digitale
peut
être
bilatérale
chez
les
patients
ambidextres
ou
dont
les
deux
mains
sont
exposées
au
traumatisme
[9].
Un
accident
ischémique
digital
secondaire
à
un
anévrisme
avec
thrombus
partiellement
occlusif
au
poignet
constitue
une
indica-
tion
de
résection-anastomose
chirurgicale.
Cette
intervention
peut
aussi
être
envisagée
avant
le
stade
de
complication
sur
un
ané-
vrisme
cubital.
La
maladie
des
vibrations
qui
concerne
les
sujets
utilisant
des
machines
rotatives
(tronc¸
onneuse),
plus
souvent
que
percutantes,
ne
se
complique
qu’exceptionnellement
de
troubles
trophiques.
2.4.
Thromboangéïte
de
Buerger
La
caractéristique
de
la
maladie
de
Buerger,
outre
le
terrain
d’homme
jeune
fumeur,
est
l’atteinte
simultanée
des
artères
dis-
tales
des
membres
supérieurs
et
inférieurs,
chez
plus
de
la
moitié
des
patients
[10].
Si
on
la
recherche
systématiquement
par
arté-
riographie,
l’atteinte
des
membres
supérieurs
est
encore
plus
fréquente
et
concerne
environ
neuf
patients
sur
dix.
L’intoxication
au
cannabis
parfois
associée
au
tabac
est
un
facteur
de
risque
sup-
plémentaire
de
maladie
de
Buerger
[11].
La
maladie
de
Buerger
peut
aussi
se
révéler
par
un
tableau
d’arthrites
intermittentes,
ce
qui
confère
à
cette
affection
un
caractère
systémique
[12].
2.5.
Causes
emboliques
Elles
représentent
environ
10
%
des
étiologies
des
nécroses
digitales.
Une
origine
embolique
est
évoquée
devant
le
carac-
tère
strictement
unilatéral
de
l’ischémie,
sa
survenue
brutale,
sans
phénomène
de
Raynaud
préexistant,
et
une
taille
souvent
centimétrique
de
la
nécrose.
Le
point
de
départ
sous-clavier
est
plus
fréquent
:
plaques
athéromateuses
ulcérées
(Fig.
5),
exceptionnellement
artériopathies
inflammatoires,
dépistées
par
l’écho-Doppler
et
l’angioscanner
aortique.

E.
Hachulla,
P.-Y.
Hatron
/
Revue
du
rhumatisme
monographies
79
(2012)
96–100
99
Fig.
5.
Nécrose
digitale
chez
une
patiente
atteinte
de
polyarthrite
rhumatoïde
(a)
par
embole
sous-clavier
sur
plaque
d’athérome
(b).
Un
syndrome
du
défilé
cervico-thoracobrachial
peut
se
révé-
ler
par
une
nécrose
digitale,
uniquement
lorsqu’il
est
compliqué
d’un
anévrisme
post-sténotique
partiellement
thombosé
ou
d’une
plaque
ulcérée
d’où
partent
des
emboles
vers
les
artères
digi-
tales.
Il
doit
être
recherché
systématiquement
par
les
manœuvres
dynamiques,
l’écho-Doppler
dynamique
de
l’artère
sous-clavière,
et
l’angioscanner.
Dans
la
grande
majorité
des
cas,
il
s’agit
d’un
syndrome
du
défilé
lié
à
une
compression
osseuse
(première
côte
ou
côte
cervicale)
[13].
2.6.
Causes
hématologiques
2.6.1.
Syndromes
myéloprolifératifs
Ces
syndromes,
et
notamment
la
maladie
de
Vaquez
ou
la
thrombocytémie
essentielle,
peuvent
se
révéler
par
une
nécrose
digitale.
La
présence
d’un
orteil
bleu,
d’un
livedo
réticularis,
ou
encore
d’une
érythermalgie,
bien
que
non
spécifiques,
sont
des
éléments
cliniques
d’orientation.
Ces
complications
vasculaires
peuvent
survenir
alors
qu’il
n’y
a
pas
encore
d’anomalie
franche
de
la
numération
formule
sanguine,
et
la
recherche
de
la
mutation
JAK2
prend
ici
tout
son
intérêt.
Beaucoup
plus
exceptionnellement,
il
peut
s’agir
d’une
thrombocytose
réactionnelle.
2.6.2.
Cryoglobulinémies,
cryofibrinogène
et
agglutinines
froides
Les
nécroses
ou
ulcérations
digitales
peuvent
s’intégrer
dans
le
cadre
des
manifestations
de
vascularites
liées
aux
cryoglobu-
linémies
mixtes
de
type
II
ou
III,
souvent
associées
à
d’autres
manifestations
cutanées
:
purpura,
livédo,
ou
systémiques
(rénales
et
neurologiques
notamment).
Elles
peuvent
également
être
la
conséquence
de
l’hyperviscosité
favorisée
par
le
froid
des
cryoglo-
bulinémies
avec
volumineux
composant
monoclonal
(type
I
et
II)
observées
surtout
au
cours
des
syndromes
lymphoprolifératifs
[14].
La
découverte
d’une
cryoglobulinémie
justifie
en
elle-même
un
bilan
étiologique
spécifique,
les
principales
étiologies
étant
infec-
tieuses
(hépatite
virale
C),
les
syndromes
lymphoprolifératifs,
et
les
maladies
auto-immunes
systémiques
comme
le
syndrome
de
Gougerot-Sjögren.
Comme
la
cryoglobulinémie,
le
cryofibrinogène
peut
être
res-
ponsable
de
nécroses
digitales.
Ses
manifestations
cliniques
sont
voisines
de
celles
des
cryoglobulinémies,
mais
il
s’y
ajoute
un
risque
de
thrombose
des
gros
vaisseaux
artériels
ou
veineux
[15].
Au
cours
de
la
maladie
des
agglutinines
froides,
des
troubles
vasomoteurs
comme
un
phénomène
de
Raynaud
sont
rares,
et
les
nécroses
digi-
tales
exceptionnelles
sont
souvent
une
conséquence
des
propriétés
de
cryoprécipitation
de
ces
agglutinines.
2.7.
Vascularites
systémiques
La
micropolyangéite
granulomateuse
(maladie
de
Wegener),
la
périartérite
noueuse
macroscopique,
ou
encore
l’angéite
de
Churg
et
Strauss,
peuvent
se
compliquer
ou
se
révéler
par
des
nécroses
digitales
(Fig.
6).
Dans
la
majorité
des
cas,
le
tableau
clinique
est
bruyant,
avec
altération
de
l’état
général,
phénomène
de
Raynaud
d’apparition
récente,
troubles
trophiques
multiples,
autres
manifestations
systémiques,
et
syndrome
inflammatoire.
Toutefois
plus
exception-
nellement,
la
gangrène
peut
survenir
avant
l’installation
des
signes
systémiques
et
du
syndrome
inflammatoire.
Fig.
6.
Gangrène
digitale
multiple
au
cours
d’une
micropolyangéïte
granuloma-
teuse.

100
E.
Hachulla,
P.-Y.
Hatron
/
Revue
du
rhumatisme
monographies
79
(2012)
96–100
2.8.
Syndrome
hyperéosinophile
Le
syndrome
hyperéosinophile
peut
exceptionnellement
se
révéler
par
une
nécrose
digitale
comme
nous
l’avons
observé
chez
deux
patients.
Il
peut
même
réaliser
un
tableau
clinique
proche
de
la
maladie
de
Buerger
[16].
2.9.
Cancers
Dans
environ
1
%
des
cas,
la
nécrose
digitale
est
une
manifes-
tation
paranéoplasique
associée
à
une
tumeur
solide.
Les
cancers
les
plus
fréquents
sont
gastro-intestinaux,
pulmonaires,
et
ova-
riens.
Le
trouble
trophique
peut
être
révélateur,
malheureusement
accompagné
d’une
dissémination
métastatique
dans
deux
tiers
des
cas
[17].
La
physiopathologie
reste
imprécise,
et
est
sans
doute
multifactorielle.
Des
anticorps
antiphospholipides
sont
parfois
trouvés.
Ces
syndromes
paranéoplasiques
peuvent
être
distingués
des
nécroses
digitales
induites
par
la
chimiothérapie.
2.10.
Causes
iatrogènes
L’ergotisme
causé
notamment
par
l’association
de
dérivés
de
l’ergot
de
seigle
et
antibiotiques
de
la
classe
des
macrolides
(TAO,
érythromycine)
est
devenu
exceptionnel.
Une
nécrose
digitale
peut
venir
compliquer
une
chimiothérapie,
les
molécules
le
plus
souvent
incriminées
étant
la
bléomycine
[18]
ou
la
gemcitabine
[19].
Des
observations
de
nécroses
ou
de
vascularites
digitales
ont
également
été
décrites
après
traitement
par
interféron
ou
anti-TNF-␣
ou
par
thalidomide,
ou
encore
sous
-bloquant
et
traitement
antivitamine
K
associé
à
une
thrombopénie
induite
par
héparine.
2.11.
Causes
indéterminées
Rarement,
dans
4
%
des
cas
selon
notre
expérience,
l’enquête
étiologique
reste
négative,
et
la
cause
de
la
nécrose
digitale
demeure
inconnue.
Enfin,
de
fac¸
on
non
exceptionnelle,
plusieurs
facteurs
étiologiques
coexistent,
et
il
est
difficile
de
déterminer
la
cause
précise
de
la
nécrose
digitale
(sclérodermie
induite
par
une
silicose
et
associée
à
un
syndrome
du
marteau
hypothénar,
scléro-
dermie
et
syndrome
du
défilé.
.
.).
Le
tabac
est
le
cofacteur
le
plus
fréquent,
trouvé
chez
plus
d’un
patient
sur
deux.
3.
Traitement
La
prise
en
charge
thérapeutique
repose
d’abord
sur
le
trai-
tement
de
la
cause
de
l’ischémie
digitale,
quand
il
est
possible,
seul
moyen
d’éviter
les
récidives.
Le
traitement
symptomatique
comprend
les
soins
locaux,
essentiels,
avec
nettoyage,
détersion
et
excision
des
tissus
nécrotiques
sous
anesthésie
locale
et
couver-
ture
antalgique.
Une
antibiothérapie
adaptée
sera
proposée
en
cas
de
surinfection.
Le
traitement
médical
vasoactif
fait
appel,
dès
que
l’ischémie
est
sévère,
aux
analogues
de
prostacycline
(Iloprost®)
administrés
à
la
seringue
auto
pulsée,
par
cure
d’une
ou
de
plusieurs
semaines.
Cer-
taines
équipes
restent
fidèles
aux
techniques
d’hémodilution.
Bien
qu’il
n’y
ait
pas
de
donnée
dans
la
littérature,
les
antiagrégants
pla-
quettaires
sont
quasi
systématiquement
prescrits.
Les
héparines
de
bas
poids
moléculaire
doivent
être
utilisées
dans
les
formes
aiguës
dès
que
l’on
suspecte
une
étiologie
embolique
ou
un
syndrome
des
anticorps
antiphospholipides.
En
cas
de
résistance
au
traitement
médical,
dans
les
formes
particulièrement
sévères
et
hyperalgiques,
une
sympathectomie
thoracique
par
voie
endoscopique
ou
digitale
peut
être
propo-
sée
mais
le
résultat
n’est
souvent
que
transitoire
et
les
récidives
fréquentes.
Une
amputation
est
malheureusement
parfois
indis-
pensable
(moins
de
20
%
des
cas
selon
notre
expérience).
Elle
doit
toujours
être
la
plus
limitée
possible.
En
conclusion,
les
nécroses
digitales
se
caractérisent
par
la
grande
diversité
de
leurs
étiologies.
Il
importe
de
savoir
recon-
naître
au
plus
vite
les
premiers
signes
d’ischémie
digitale
pour
éviter
l’évolution
vers
la
nécrose
et
gangrène
irréversible.
Un
inter-
rogatoire
et
un
examen
clinique
attentif
et
méthodique
permettent
dans
la
grande
majorité
des
cas
d’approcher
ce
diagnostic
étiolo-
gique,
d’orienter
les
explorations
paracliniques
et
d’adapter
la
prise
en
charge
thérapeutique
afin
d’éviter
les
récidives.
Déclaration
d’intérêts
Les
auteurs
déclarent
ne
pas
avoir
de
conflits
d’intérêts
en
rela-
tion
avec
cet
article.
Annexe
A.
Matériel
complémentaire
Le
matériel
complémentaire
(Vidéo
S1)
accompagnant
cet
article
est
disponible
sur
http://www.sciencedirect.com
et
doi:10.1016/j.monrhu.2012.01.001.
Références
[1]
Carpentier
PH,
Guilmot
JL,
Hatron
PY,
et
al.
Digital
ischemia,
digital
necrosis.
J
Mal
Vasc
2005;30:S29–37.
[2]
Hachulla
E,
Clerson
P,
Launay
D,
et
al.
Natural
history
of
ischemic
digital
ulcers
in
systemic
sclerosis:
single-center
retrospective
longitudinal
study.
J
Rheumatol
2007;34:2423–30.
[3]
Wigley
FM,
Wise
RA,
Miller
R,
et
al.
Anticentromere
antibody
as
a
predictor
of
digital
ischemic
loss
in
patients
with
systemic
sclerosis.
Arthritis
Rheum
1993;36:285–7.
[4] Dubois
EL,
Arterberry
JD.
Gangrene
as
a
manifestation
of
systemic
lupus
ery-
thematosus.
JAMA
1962;181:366–74.
[5]
Vocks
E,
Welcker
M,
Ring
J.
Digital
gangrene:
a
rare
skin
symptom
in
systemic
lupus
erythematosus.
J
Eur
Acad
Dermatol
Venereol
2000;14:419–21.
[6] Cailleux
N,
Levesque
H,
Gilbert
P,
et
al.
Digital
necrosis
of
the
arm
excluding
scleroderma.
Retrospective
study
of
45
cases.
J
Mal
Vasc
1994;19:22–6.
[7]
Vasugi
Z,
Danda
D.
Systemic
lupus
erythematosis
with
antiphospholipid
anti-
body
syndrome:
a
mimic
of
Buerger’s
disease.
J
Postgrad
Med
2006;52:
132–3.
[8]
Leteurtre
E,
Hachulla
E,
Janin
A,
et
al.
Vascular
manifestations
of
dermatomyosi-
tis
and
polymyositis.
Clinical,
capillaroscopic
and
histological
aspects.
Rev
Med
Interne
1994;15:800–7.
[9]
Marie
I,
Hervé
F,
Primard
E,
et
al.
Long-term
follow-up
of
hypothenar
hammer
syndrome:
a
series
of
47
patients.
Medicine
(Baltimore)
2007;86:334–43.
[10]
Olin
JW,
Young
JR,
Graor
RA,
et
al.
The
changing
clinical
spectrum
of
throm-
boangiitis
obliterans
(Buerger’s
disease).
Circulation
1990;82:IV3–8.
[11]
Disdier
P,
Granel
B,
Serratrice
J,
et
al.
Cannabis
arteritis
revisited
–
10
new
case
reports.
Angiology
2001;52:1–5.
[12]
Puéchal
X,
Fiessinger
JN.
Thromboangiitis
obliterans
or
Buerger’s
disease:
chal-
lenges
for
the
rheumatologist.
Rheumatology
(Oxford)
2007;46:192–9.
[13]
Gillard
J,
Pérez-Cousin
M,
Hachulla
E,
et
al.
Diagnosing
thoracic
outlet
syndrome:
contribution
of
provocative
tests,
ultrasonography,
electrophy-
siology,
and
helical
computed
tomography
in
48
patients.
Joint
Bone
Spine
2001;68:416–24.
[14]
Sanmugarajah
J,
Hussain
S,
Schwartz
JM,
et
al.
Monoclonal
cryoglobuline-
mia
with
extensive
gangrene
of
all
four
extremities:
a
case
report.
Angiology
2000;51:431–4.
[15]
Belizna
CC,
Tron
F,
Joly
P,
et
al.
Outcome
of
essential
cryofibrinogenaemia
in
a
series
of
61
patients.
Rheumatology
(Oxford)
2008;47:205–7.
[16]
Hachulla
E,
Hatron
PY,
Janin
A,
et
al.
Artérite
digitale
et
syndrome
hyperéosi-
nophile
:
une
complication
inhabituelle.
Rev
Med
Interne
1995;16:434–6.
[17]
Chow
SF,
McKenna
CH.
Ovarian
cancer
and
gangrene
of
the
digits:
case
report
and
review
of
the
literature.
Mayo
Clin
Proc
1996;71:253–8.
[18]
Correia
O,
Ribas
F,
Azevedo
R,
et
al.
Gangrene
of
the
fingertips
after
bleomycin
and
methotrexate.
Cutis
2000;66:271–4.
[19]
Holstein
A,
Batge
R,
Egberts
EH.
Gemcitabine
induced
digital
ischaemia
and
necrosis.
Eur
J
Cancer
Care
(Engl)
2010;19:408–9.
1
/
5
100%