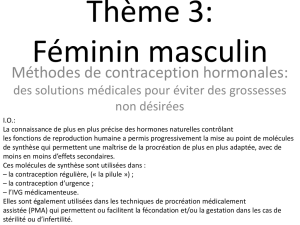A Contraception progestative après cancer du sein ? DOSSIER THÉMATIQUE

26 | La Lettre du Sénologue • n° 41 - juillet-août-septembre 2008
Progestatifs et cancer du sein
DOSSIER THÉMATIQUE
* Cabinet de gynécologie, 28, rue
de Norvège, 17000 La Rochelle.
** Centre Alexis-Vautrin, avenue de
Bourgogne-Brabois, 54511 Vandœuvre-
lès-Nancy.
Contraception progestative
après cancer du sein ?
Progestin-only contraception
in breast cancer survivors?
G. Boutet*, A. Lesur**
Avec 49 814 nouveaux cas estimés en 2005 en
France, les cancers du sein infiltrants représen-
tent 36,7 % de l’ensemble des nouveaux cas
de cancer chez la femme. Les cancers du sein in situ
sont exclus des analyses et représentent 5 à 15 % de
l’ensemble des cancers du sein (1). Le taux d’incidence
standardisée a presque doublé, passant de 56,8 en
1980 à 101,5 en 2005, selon les dernières données
publiées le 30 janvier 2008. Le taux d’évolution, en
moyenne de + 2,4 % par an entre 1980 et 2005, est
cependant légèrement moins important sur la dernière
période, entre 2000 et 2005 (+ 2,1 % par an) [2, 3].
Pour s’en tenir au groupe d’âge de 15 à 39 ans, cette
incidence annuelle cumulée peut être évaluée à 2 388,
nombre auquel il faut ajouter 8 211 pour la tranche
d’âge 40 à 49 ans. On peut donc considérer que plus
de 10 000 nouvelles femmes par an sont, au moins
théoriquement, confrontées au problème de la contra-
ception après traitement d’un cancer du sein. Comme
le risque cumulé 0-74 ans est passé de 8,68 à 12,14 %
des femmes nées en 1935 à celles nées en 1950 (2),
même si la tendance devait s’infléchir, la question est
donc d’importance.
Soulignons en préambule que si l’on considère qu’en-
viron une femme de moins de 40 ans sur 200 déve-
loppera un cancer du sein (4), l’envers de la question
contraceptive est celle du désir d’enfant. Il appartient
donc au praticien de permettre à chaque femme consul-
tant pour un désir de contraception après cancer du
sein d’exprimer aussi un possible désir d’enfant
(1)
et
de répondre de façon adaptée à ses interrogations en
sachant que 15 % des femmes de 35 ans, qui ont béné-
ficié d’une chimiothérapie comportant un alkylant, sont
ménopausée à un an, 40 % des femmes de 40 ans et
75 % des femmes de 45 ans (5). Le risque de défaillance
ovarienne prématurée chimio-induite dépend de la
molécule, les alkylants comme le cyclophosphamide
étant très gonadotoxiques, de l’âge de la patiente au
moment où elle reçoit la chimiothérapie, de la dose
reçue, des modalités et de la durée du traitement. La
question de la contraception après cancer du sein se
pose donc surtout chez les femmes de moins de 40 ans
qui ont échappé à une défaillance ovarienne prématurée
chimio-induite, qu’elles soient ou non en aménorrhée
non ménopausique sous tamoxifène (TAM).
La culture médicale française a longtemps considéré
les progestatifs comme ayant des actions globalement
bénéfiques sur la glande mammaire (6), conception
d’ailleurs partagée par les femmes françaises et qui n’a
réellement été remise en cause qu’après la publication
des essais randomisés américains sur le traitement
hormonal de la ménopause. C’est dire que jusqu’aux
années 2000, prescrire une contraception progestative
“à la française”, c’est-à-dire par un progestatif antigo-
nadotrope à une femme après cancer du sein n’était
pas de pratique exceptionnelle, y compris dans certains
Centres de lutte contre le cancer, tout particulièrement
si la patiente avait des mastodynies controlatérales
et/ou des troubles menstruels.
La réévaluation de toutes nos prescriptions dans le
souci de présenter à nos patientes des informations
à la fois claires, actualisées et validées réinterroge
de façon critique cette conduite.
Contraception progestative pure
La contraception progestative pure se présente
en France sous plusieurs formes. La contraception
progestative pure orale peut être assurée par ce
(1) L’Association francophone de l’après-cancer du sein (AFACS : http://
www.afacs.fr) fait actuellement une enquête auprès des femmes ayant
eu un cancer du sein et ayant été enceintes et met à cet effet à la dis-
position des patientes un numéro vert : 0800 770 736.

La Lettre du Sénologue • n° 41 - juillet-août-septembre 2008 | 27
qu’il est convenu d’appeler micropilule (Cérazette®,
Microval®, Milligynon®, l’Ogyline® étant en voie
d’être retirée du marché). La contraception dite
“macroprogestative” consiste à prendre, usuelle-
ment 21 jours sur 28 ou du 5e au 25e jour du cycle,
un norstéroïde, le lynestrénol (Orgamétril®), un
norprégnane (Lutényl 5® , Surgestone 0,500®), un
dérivé 17 OH progestérone (Lutéran 10®), à la dose
considérée consensuellement en France comme
contraceptive (7). Sont également des contracep-
tions progestatives pures le dispositif intra-utérin
au lévonorgestrel (DIU LNG [Mirena®]) et l’implant
contraceptif à l’étonogestrel (Implanon®). Enfin et
de façon plus confidentielle en France, habituelle-
ment réservée à des cas particuliers, notamment en
milieu psychiatrique, la contraception injectable IM
trimestrielle par 150 mg d’acétate de médroxypro-
gestérone retard (AMPR [Dépo-Provera®]).
Parmi ces produits, seuls les micropilules, le DIU LNG,
l’implant, le lynestrénol (en deuxième intention chez
les femmes présentant une contre-indication à la
contraception estroprogestative) et l’AMPR sont titu-
laires dans leur AMM de l’indication contraception.
Contraception progestative
pure après cancer du sein :
bénéfique, néfaste ou neutre ?
Données fondamentales
S’il existe désormais une importante littérature qui
analyse le risque de cancer du sein sous traitement
progestatif, avant ou après la ménopause, comme le
documente l’article de G. Plu-Bureau et A. Gompel
dans ce dossier, les données épidémiologiques analy-
sant les effets de la contraception progestative pure
après cancer du sein, associée ou non à la prise de
TAM, sont remarquablement limitées. Force est donc
pour étayer une décision de se tourner d’abord vers
les résultats des études fondamentales.
Si dans les théories générales de la carcinogenèse,
il est admis qu’un agent qui augmente la prolifé-
ration cellulaire augmente dans le même temps
la possibilité de mutations qui peuvent initier la
cancérisation, la question est donc de savoir si les
progestatifs exercent un effet prolifératif sur le
tissu mammaire. Après avoir recensé les données
de la littérature des études menées in vitro et chez
l’animal, les directives cliniques communes de la
Société des obstétriciens gynécologues du Canada
et de la Société des gynécologues oncologues du
Canada, dont la rédaction de cet article a largement
bénéficié (5), ont conclu : “La progestérone et les
progestatifs peuvent exercer un effet prolifératif,
antiprolifératif ou neutre sur le tissu mammaire,
selon le type, le moment de l’administration et la
dose du progestatif utilisé.” Il faut ajouter que cet
effet peut varier selon le type de lignée cellulaire et
leur caractère, malin ou non.
Pour sortir de cette difficulté, quelques pistes ont
récemment été ouvertes, sans encore de conclusions
définitives.
Pour Santen (8), les progestatifs pourraient être
métabolisés en dérivés pregnènes qui inhiberaient
la prolifération cellulaire ou en dérivés prégnanes
qui pourraient la stimuler, les cellules cancéreuses
privilégiant cette voie. Une autre piste serait que
la présence d’une protéine particulière (G protein
associated receptor 30 [GPR 30]) permettrait aux
progestatifs d’inhiber la prolifération alors qu’en
son absence, ils la stimuleraient. Ainsi, tout à la fois,
les chemins métaboliques préférentiels des cellules
considérées, comme la présence ou pas de la GPR
30, pourraient déterminer des effets biologiques
opposés pour un même progestatif, indépendam-
ment des capacités spécifiques de liaison de chaque
progestatif aux différents récepteurs (estrogéniques,
androgéniques, glucocorticoïdes, etc.) et à la variété
des effets ainsi susceptibles d’être induits.
Par ailleurs, sur un plan proprement expérimental,
Lange (9) souligne qu’au contraire des cultures
monocouches en 2D, dont les résultats sont forts
discordants, les progestatifs sont clairement mito-
gènes dans des systèmes de culture en 3D. Cet auteur
suggère que l’action proliférative de la progestérone
nécessite une polarisation cellulaire, qui n’est pas
mise en évidence dans les cultures 2D, et rappelle
que dans ce type de système, la réponse des cellules
cultivées est variable en fonction de la composition
de la matrice extracellulaire à leur contact.
Au total, les résultats des données fondamentales
sont actuellement trop discordants pour étayer
une décision clinique. Les études épidémiologiques
apportent-elles une réponse ?
Données épidémiologiques
Nous n’avons retrouvé, à une exception près et
nous y reviendrons, aucune donnée épidémiolo-
gique analysant les effets de la prescription d’une
contraception progestative pure, quelle que soit sa
forme, chez une femme avec antécédent personnel
de cancer du sein traité. Seules seraient donc possi-
bles des extrapolations, à partir du risque de cancer
du sein sous traitement progestatif chez des femmes
indemnes. Si l’utilisation de cette contraception
Mots-clés
Cancer du sein
Contraception
Progestatif
Keywords
Breast cancer
Contraception
Progestin

28 | La Lettre du Sénologue • n° 41 - juillet-août-septembre 2008
Progestatifs et cancer du sein
DOSSIER THÉMATIQUE
n’entraînait pas de hausse significative du risque
dans la population générale, le recours à celle-ci
pourrait être envisagé chez une femme après cancer
du sein “dans les cas où les avantages liés ou non
à la contraception l’emportent sur quelque hausse
potentielle inconnue que ce soit du risque de récur-
rence” (5). À côté de ces extrapolations dont il est
difficile d’apprécier la pertinence, compte tenu des
données fondamentales précitées, il pourrait être
argué qu’une légère augmentation potentielle du
risque est négligeable par rapport à l’importance
du risque déjà établi lié à l’antécédent néoplasique
mammaire personnel. En appliquant ce raisonne-
ment à la contraception injectable trimestrielle par
AMPR, la directive commune canadienne souligne
tout à la fois que les femmes ayant présenté un
cancer du sein sont peu enclines à courir quelque
risque complémentaire que ce soit et que de fortes
doses d’acétate de médroxyprogestérone ont fait la
preuve de leur efficacité dans le cadre du traitement
du cancer du sein métastatique hormonodépendant
de la femme ménopausée (5, 10). La recomman-
dation canadienne conclut donc que “le recours à
l’AMPR chez une survivante du cancer du sein peut
être envisagé dans les cas où les avantages liés ou
non à la contraception l’emportent sur quelque
hausse potentielle inconnue que ce soit du risque
de récurrence (III-C)”. Cette recommandation, avec
le même niveau de preuve, est appliquée à l’iden-
tique aux micropilules et au DIU LNG. Cette directive
commune précise qu’elle ne peut énoncer aucune
recommandation concernant les implants contra-
ceptifs car on ne dispose d’aucune donnée, ni dans
la population générale, ni chez les survivantes après
cancer du sein et ne mentionne pas la contraception
macroprogestative “à la française”.
Depuis la publication de ce consensus, deux nouvelles
études nous paraissent intéressantes à rapporter.
La première, randomisée, en double aveugle contre
placebo, est une étude pilote pour préciser les effets
de la tibolone (Livial®) sur l’étude de la prolifération
cellulaire, appréciée en particulier par la mesure de
l’expression du Ki-67, sur des prélèvements biopsiques
mammaires chez des femmes postménopausiques
présentant un cancer du sein de stade initial I/II,
récepteurs estrogéniques positifs (RE +). Rappelons
que la formule chimique de la tibolone, sans être
identique, présente une forte analogie avec celle
du lynestrénol. Cette étude, portant sur 46 cas et
49 contrôles, conclut que chez les patientes RE +,
2,5 mg de tibolone par jour pendant 14 jours n’ont
pas d’effet significatif sur la prolifération des cellules
tumorales mammaires (11). Malheureusement, et
une nouvelle fois, ces résultats séduisants sur des
marqueurs intermédiaires viennent d’être contredits
par l’essai clinique LIBERATE, dont les résultats ont
été présentés à l’occasion d’une communication
orale faite le 21 mai 2008 à Madrid. Dans cette
étude clinique multicentrique randomisée en double
aveugle comparant Livial® à un placebo chez plus de
3 000 femmes avec un antécédent récent de cancer
du sein, dont certaines sous TAM, le risque global
de récidive est significativement augmenté sous
traitement (RR = 1,40 ; p = 0,001) après un suivi
moyen de trois ans.
La seconde étude est celle de Trinh et al. (12), qui
est spécifiquement consacrée à l’utilisation du DIU
LNG chez des patientes atteintes d’un cancer du
sein. Il s’agit d’une étude rétrospective cas-contrôles
portant sur 79 patientes sous traitement versus 120
contrôles. Le critère principal est le pourcentage de
récidive. Si dans la population totale, il n’y a pas
de modification significative du risque de récidive
(21,5 % sous DIU LNG versus 16,6 % ; adjusted hazard
ratio [HR] : 1,86 ; IC
95
: 0,86-4), une analyse en
sous-groupes montre que les femmes sous DIU LNG
(n = 38) au moment du diagnostic de cancer et qui
ont continué à l’utiliser ont un risque augmenté de
récidive (HR : 3,39 ; IC
95
: 1,01-11,35 ; p = 0,048).
Les femmes chez qui le DIU LNG a été inséré après le
diagnostic et le traitement de cancer du sein (n = 41)
n’ont pas d’augmentation constatée de risque
(HR : 1,48 ; IC95 :0,62-3,49 ; p = 0,38). Annonçant
qu’une étude prospective est en cours d’initiation
en Belgique pour suivre les femmes atteintes d’un
cancer du sein avant la ménopause, qui compor-
tera des données sur l’utilisation des contraceptifs,
les auteurs restent cependant prudents dans leurs
conclusions, compte tenu des limites méthodolo-
giques de leur travail et en appellent à des études
complémentaires. Ils soulignent cependant le point
particulier des femmes non ménopausées qui ont
bénéficié d’une castration médicale et sont sous
inhibiteurs de l’aromatase. Dans ce cas, il est parti-
culièrement important d’enlever le DIU LNG car ces
patientes risquent dans ce contexte de présenter une
hypersensibilité hormonale, d’autant qu’une partie
au moins de l’effet prolifératif in vitro du LNG sur
les cellules malignes MCF-7 emprunte la voie des
RE (12). À l’inverse, les bases théoriques qui font
de ce DIU LNG un possible traitement préventif
des lésions endométriales sous TAM font qu’il est
probable qu’un certain nombre d’études soient en
cours, avec comme critère principal la pathologie
de l’endomètre, où sera pris en compte le risque de
récidive de cancer du sein.
1. Molinié F, Colonna M. Sein.
Evolution de l’incidence et de la
mortalité par cancer en France
de 1980 à 2005. http:// www.
invs.sante.fr
2. Belot A, Grosclaude P, Bossard
N et al. Cancer incidence and
mortality in France over the period
1980-2005. Rev Epidemiol Santé
Publique 2008;56:159-75.
3. Estève J. Incidence du cancer
du sein en France et dans les
pays développés. Presse Med
2007;36:315-21.
4. Jones AL. Fertility and
pregnancy after breast cancer.
Breast 2006;15(S2):S41-S46.
5. SOGC/GOC joint clinical
practice guidelines. Progeste-
rone-only and non-hormonal
contraception in the breast
cancer survivor: joint review and
committee opinion of the Society
of Obstetricians and Gynaecolo-
gists of Canada and the Society
of Gynecologic Oncologists of
Canada. Int J Gynecol Obstet
2008;101:309-18.
6. Plu-Bureau G, Mauvais-Jarvis P.
Hormones et sein. In : P. Mauvais-
Jarvis, G. Schaison, P. Touraine.
Médecine de la reproduction.
Paris : 3e ed. Flammarion Méde-
cine-Sciences, 1997:423-43.
7. Sitruk-Ware R, Serfaty D.
Contraception progestative. In :
Contraception. D. Serfaty. Paris :
3e ed. Masson, 2007:112-21.
8. Santen RJ. Risk of breast cancer
with progestins: critical assess-
ment of current data. Steroids
2003;68:953-64.
9. Lange CA. Challenges to
defining a role for progeste-
rone in breast cancer. Steroids
2008;73:914-21.
10. Leriche N, Bonneterre J.
Progestatifs et métastases
osseuses dans les cancers du sein.
Bull Cancer 1997;84:891-4.
11. Kubista E, Planellas Gomez
JVM, Dowsett M et al. Effect
of tibolone on breast cancer
cell proliferation in postme-
nopausal ER+ patients: results
from STEM Trial. Clin Cancer Res
2007;13:4185-90.
Références
bibliographiques

La Lettre du Sénologue • n° 41 - juillet-août-septembre 2008 | 29
DOSSIER THÉMATIQUE
Conduite pratique
Rappelons en préambule les résultats de la seule
enquête française, à notre connaissance, consacrée à
cette question, initiée et coordonnée par le Groupe
d’étude et de réflexion sur les mastopathies (GERM)
en 2003. Sur les 2 005 questionnaires adressés aux
gynécologues français, 200 observations ont été
reçues dont 185 exploitables. Sur ces 185 dossiers,
une contraception progestative a été utilisée après
cancer du sein dans 37 cas par progestatifs micro- ou
macrodosés et dans 15 cas par DIU LNG (13).
Compte tenu des résultats théoriques contradictoires,
de l’absence d’études cliniques spécialement dédiées
à cette question, des obligations déontologiques
et légales et des diverses pressions médiatiques, le
praticien se doit d’appliquer les recommandations
pour la pratique clinique (RPC). Elles sont de deux
types, internationale, les critères de recevabilité pour
l’adoption et l’utilisation continue d’une méthode
contraceptive de l’OMS (14), et nationale, éditées par
l’Afssaps-Anaes-Inpes (AAI) [15], concordantes.
Ces recommandations sont présentées de façon
synthétique dans le tableau.
On peut en conclure que, pour l’OMS aussi bien que
pour l’AAI, la contraception orale microprogestative,
les progestatifs seuls, les progestatifs injectables,
l’implant à l’étonogestrel, le DIU LNG ne peuvent
être prescrits en cas de cancer du sein en cours ou
actuel. En cas de rémission depuis cinq ans ou plus,
les risques théoriques ou avérés de la prescription de
ces contraceptifs l’emportent généralement sur les
avantages procurés par l’emploi de la méthode. Ces
contraceptions ne sont en règle générale pas recom-
mandées à moins, précise l’AAI, que des méthodes
plus indiquées ne soient pas disponibles ou accep-
tables : un suivi rigoureux est alors nécessaire. Dans
cette dernière situation, il n’y a donc en théorie pas de
contre-indication formelle pour autant qu’une déci-
sion collégiale, dans le cadre d’une Unité de concer-
tation pluridisciplinaire en oncologie l’envisage et
que la patiente, informée des incertitudes attachées
à cette contraception, l’accepte.
Un élément supplémentaire reste cependant à prendre
en compte, la mise à jour régulière des décisions de
la commission de la transparence de la HAS (http://
www.has-sante.fr) et de la direction de l’évaluation
des médicaments et des produits biologiques de l’Afs-
saps (http://afssaps.sante.fr), régulièrement traduites
par l’évolution des résumés des caractéristiques des
produits (RCP) rapportés par le Vidal®.
C’est ainsi que dans la version 2008 du Vidal®, on
peut noter que toutes les micropilules encore disponi-
bles sur le marché sont contre-indiquées (Microval® :
contre-indication [CI] : cancer du sein et de l’en-
domètre ; Cérazette® : CI : tumeurs sensibles aux
progestatifs ; cancer du sein et cancer de l’endomètre ;
Milligynon® : CI : cancer du sein et de l’endomètre).
Pour Depo-Provera®, on retrouve aussi dans les
contre-indications : cancer du sein et de l’endomètre.
Pour ce qui concerne Implanon®, le cancer du sein en
lui-même n’est pas mentionné comme une contre-
indication, elle est formulée de la façon suivante :
“tumeurs progestogènes dépendantes”. Il est, en
outre, précisé : “Un effet biologique des hormones
ne pouvant être exclu, le rapport bénéfice/risque
doit être évalué individuellement chez les femmes
atteintes d’un cancer du sein et chez les femmes pour
lesquelles un cancer du sein est diagnostiqué pendant
l’utilisation d’Implanon®”. Pour ce qui est du DIU LNG
(Mirena®), le Vidal® 2008 stipule que : “Le retrait du
DIU devra être envisagé en cas de survenue ou de réci-
dive de : suspicion ou diagnostic d’une tumeur hormo-
nodépendante, y compris cancer du sein.” Enfin, le
cancer du sein ou un antécédent de cancer du sein ne
font pas partie des contre-indications formellement
énoncées pour les macroprogestatifs, l’Orgamétril®,
le Lutéran® 10, le Lutényl® 5 et la Surgestone® 0,500
mais il est précisé pour chacune de ces molécules,
sauf la dernière, qu’avant le début du traitement, le
médecin doit s’assurer de l’absence de cancer du sein
ou de l’endomètre, ce qui n’est guère différent. Pour
les trois dernières spécialités, il est aussi précisé que
les études pharmacocliniques n’ont pas permis de
démontrer un effet antigonadotrope complet chez
toutes les patientes, ce qui explique que ces produits
n’ont pas l’AMM dans l’indication de contraception,
quelle que puisse être leur efficacité cliniquement
constatée. Dans le contexte dans lequel nous nous
plaçons, toute thérapeutique hors AMM peut être
lourde de conséquence pour le prescripteur en cas
d’événement indésirable, même s’il ne s’agit que de
coïncidence malheureuse. Enfin, il est à noter qu’au 31
juillet 2008, aucun RCP n’est actuellement disponible
pour ces spécialités sur le site de l’Afssaps.
Conclusion
Au terme de cette revue, deux options sont envi-
sageables pour répondre à la question posée, “une
contraception progestative après cancer du sein est-
elle possible ?”, puisque aucune donnée relevant de
l’Evidence-based medicine (EBM) n’est disponible.
La première, exclusivement appuyée sur la RPC
française, très proche de celles de l’OMS et de la
12. Trinh XB, Tjalma WAA, Makar
AP et al. Use of the levonorges-
trel-releasing intrauterine system
in breast cancer patients. Fertil
Steril 2008;90:17-22.
13. Gorins A, Espié M. Contracep-
tion estroprogestative et cancer
du sein. In Le Sein, du normal au
pathologique : état de l’art. Paris :
3
e
ed. M. Espié, A. Gorins. Editions
ESKA, 2007:664-70.
14. OMS. Critères de receva-
bilité pour l’adoption et l’utili-
sation continue des méthodes
contraceptives. OMS : Genève ;
2005. Référence consultable
sous format électronique : URL :
http://who.int.
15. Afssaps-Anaes-Inpes. Recom-
mandations pour la pratique
clinique. Stratégies de choix des
méthodes contraceptives chez
la femme. Afssaps, Anaes, Inpes :
Paris ; 2004. Référence consul-
table sous format électronique :
URL/http://afssaps.sante.fr.
Références
bibliographiques

30 | La Lettre du Sénologue • n° 41 - juillet-août-septembre 2008
Progestatifs et cancer du sein
DOSSIER THÉMATIQUE
directive clinique commune canadienne, considé-
rerait comme licite une contraception progestative
à partir du moment où elle relève de la proposition
d’une Unité de concertation pluridisciplinaire en
oncologie à une femme précise, dans une situation
particulière et qui accepte les incertitudes de la
balance bénéfices-risques de la prescription, bien
sûr au prix “d’un suivi rigoureux alors nécessaire”.
Lors de la prescription des macroprogestatifs autres
que le lynestrénol, le praticien sera en porte à faux
par l’absence de l’indication de contraception dans
l’AMM. Notons qu’il n’est nulle part fait mention de
la contraception d’urgence, progestative pure, par
la prise unique d’un comprimé de 1,5 mg de lévo-
norgestrel, mais que le RCP de ce produit (Norlévo®
1,5 mg) ne mentionne aucune contre-indication,
hormis une hypersensibilité à la molécule ou à l’un
des excipients.
La deuxième, prenant à la lettre, dans leur application
la plus rigoureuse, les résumés des caractéristiques
des produits, qui vont au-delà de la RPC, récusera
toute prescription non seulement de contraceptif
progestatif mais de tout progestatif chez une femme
atteinte d’un cancer du sein, quel que soit son statut
d’hormonodépendance, rejoignant d’ailleurs très
souvent le souhait des patientes régulièrement alar-
mées par les médias.
S’il est maintenant d’usage de terminer tout texte
consacré à une zone grise de l’EBM par le refrain de
l’appel à de nouvelles études randomisées en double
aveugle, il est peu probable que, dans ce domaine, on
puisse espérer prochainement une réponse claire et
objective, scientifiquement fondée, à l’abri de la peur
du médico-légal. Il faudra donc en pratique continuer
à élaborer au cas par cas une décision partagée dans
ce colloque singulier régulièrement enrichi par de
nouvelles données, si bien nommé consultation, du
latin consultatio, tout à la fois “action de délibérer”
et “question posée à quelqu’un”. L’avenir dira ce que
seront les futures mises à jour des résumés des carac-
téristiques des produits sur le site de l’Afssaps. ■
Tableau. Contraceptions progestatives pures : Critères de recevabilité de l’OMS (14) et Stratégies
de choix de l’Afssaps-Anaes-Inpes (AAI) [15] en cas de cancer du sein.
Cancer du sein
Définitions OMS En cours En rémission depuis 5 ans
Définitions AAI Actuel En rémission > 5 ans
Critères de recevabilité OMS (a)/
Stratégie de choix AAI (b)
OMS* (a) AAI (b) OMS* (a) AAI (b)
Contraception orale
microprogestative
4 -- 3 -
Progestatifs seuls (OMS)
Macroprogestatifs (AAI) 4 -- 3 -
Implant à l’étonogestrel 4 -- 3 -
Acétate de médroxyprogestérone
(150 mg/3 ml) i.m.
4 -- 3 -
Dispositif intra-utérin
au lévonorgestrel
4 -- 3 -
(a) Critères de recevabilité pour l’adoption et l’utilisation continue de méthodes contraceptives. OMS
(14)
.
1 : État où l’utilisation de la méthode contraceptive n’appelle aucune restriction.
2 : État où les avantages de la méthode contraceptive l’emportent en général sur les risques théoriques ou avérés.
3 : État où les risques théoriques ou avérés l’emportent généralement sur les avantages procurés par l’emploi de
la méthode.
4 : État équivalent à un risque inacceptable pour la santé en cas d’utilisation de la méthode contraceptive.
* Cancer du sein : le cancer du sein est une tumeur hormonodépendante. Les craintes relatives à l’évolution de la
maladie sont moins prononcées dans le cas des stérilets au lévonorgestrel que dans celui des contraceptifs oraux
combinés ou des progestatifs seuls fortement dosés.
(b) Possibilité d’utilisation des différentes méthodes en fonction de situations particulières. Afssaps-Anaes-Inpes
(15)
.
“++” : Situation où la méthode contraceptive peut être utilisée sans aucune restriction.
“+” : Situation où les avantages de la méthode contraceptive sont généralement supérieurs aux inconvénients.
D’une manière générale, la méthode est utilisable. Si la femme choisit cette méthode, le suivi médical doit être plus
attentif qu’en règle normale.
“-” : Situation où les risques théoriques ou avérés l’emportent sur les avantages procurés par l’emploi de la mé-
thode. L’emploi de la méthode n’est en règle générale pas recommandé, à moins que des méthodes plus indiquées
ne soient pas disponibles ou acceptables. Un suivi rigoureux est alors nécessaire.
“--” : Situation où l’emploi de la méthode expose à un risque pour la santé inacceptable. Il est recommandé de ne
pas utiliser la méthode (à proscrire).
COURS SUPÉRIEUR DE MASTOLOGIE
Du 16 au 18 Octobre 2008, Montpellier
PRÉSIDENTS DU COURS
Pr. J-B. Dubois, Pr. J-P. Daurès, Pr. Ph. Rouanet - Montpellier
PRÉSIDENT HONORAIRE
Pr. J-L. Lamarque
PROGRAMME SCIENTIFIQUE PRÉVISIONNEL
16 OCTOBRE 2008
INTRODUCTION
• Epidémiologie - Prévention
Dépistage - Evaluation micro-
économique
• Imagerie
17 OCTOBRE 2008
• Carcinome Canalaire In Situ
(CCIS)
• Actualités thérapeutiques
18 OCTOBRE 2008
• Hormonothérapie - Chimiothérapie
Traitements ciblés
• Test final interactif
SECRÉTARIAT
SCIENTIFIQUE
G. Dusacq
Tel : +33 (0)4 67 61 31 13
Fax : +33 (0)4 67 61 30 73
E-mail :
MANOSMED 2008
www.manosmed2008.com
SUPAGRO - 2, PLACE PIERRE VIALA - MONTPELLIER (FRANCE)
AGENCE
ORGANISATRICE
Alpha Visa Congrès
624, rue des Grèzes
34070 Montpellier - France
Tel : +33 (0)4 67 03 03 00
Fax : +33 (0)4 67 45 57 97
E-mail :
!!" #$%%&
!
!"#$!%&%'(
)#*#+!%+ , -.. ./)##+!+'
#"!/%#/%+%$!/ #*-&0-!%+
#"!/-& $-'!+'
1
0/-& -)/!+%$- + !0
23
#)- #0!/ /%+)%*#).!#.
"#$%#)- ( -+"
%)$%+-& )#-$#+ -)'#
/#$%#)- !#.
"!+-& !+#)-/!*# #.
# $
%& '(( )*+, -. -/ (/ /(
01& '(( )*+, -. -/ (* .(
!&
23453$$$
4
6 78
-9, 3 #:
(,*.* 0$
%& '(( )*+, -. *( *( **
01& '(( )*+, -. ,; ;. <.
!&
439**=$
Université Montpellier 1
1
/
5
100%

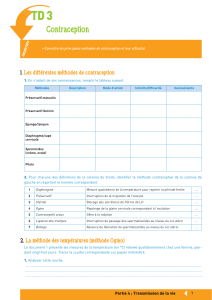
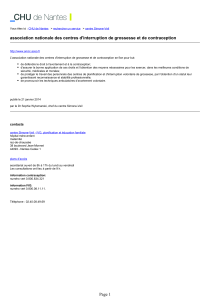
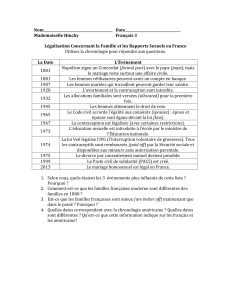
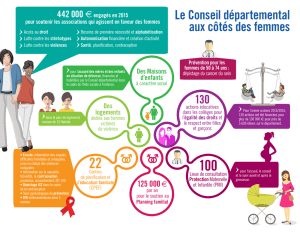
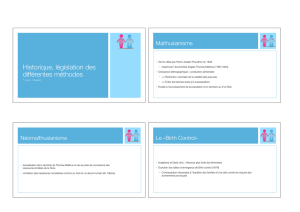
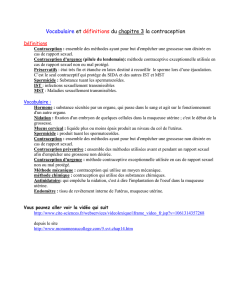
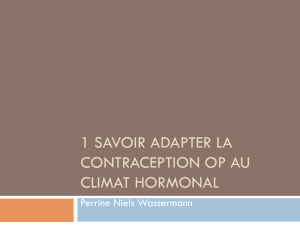
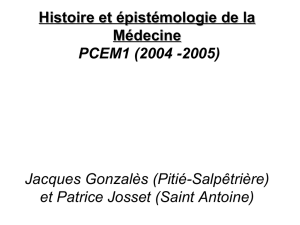
![Version imprimable [PDF | 549,2 Ko. ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/002867014_1-94984025a6f47b57b52e0ab77255415a-300x300.png)