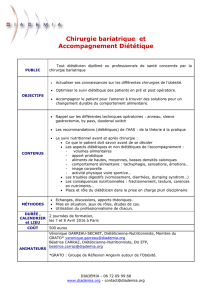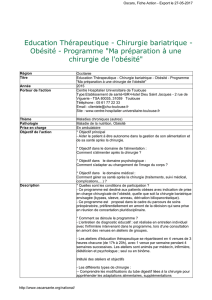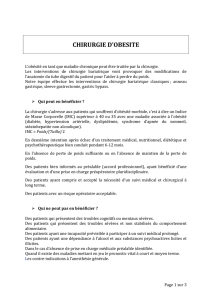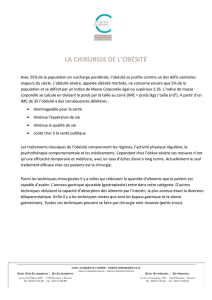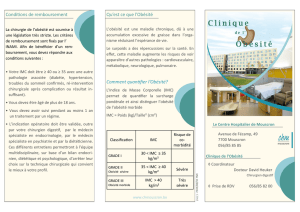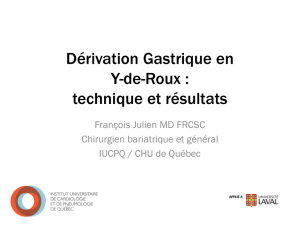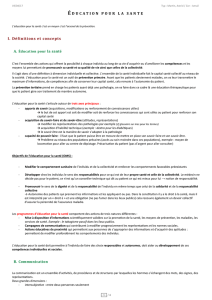Prise en charge de l`obésité en 2012 : le point de vue d`un

103
Résumé
L’obésité est une maladie sévère menaçant la santé des individus du fait des
nombreuses comorbidités qu’elle entraîne avec comme corollaire une diminution de
l’espérance et de la qualité de vie. La chirurgie de l’obésité est un traitement efficace pour
perdre du poids et contrôler les comorbidités (complications métaboliques et celles liées au
surpoids).
La chirurgie de l’obésité s’adresse aux patients atteints d’obésité extrême (IMC >
40 ou > 35 en présence de comorbidités). Elle est au mieux réalisée au sein d’équipes
spécialisées, après décision opératoire prise au sein d’une réunion de concertation
pluridisciplinaire (chirurgien, anesthésiste, nutritionniste, psychologue, diététicien…).
Les techniques opératoires sont multiples, mais en pratique, 3 interventions sont
couramment pratiquées en France : l’anneau de gastroplastie ajustable, la gastrectomie
sleeve, le by-pass gastrique. Chacune de ces 3 interventions a des avantages et des
1 - Université Versailles Saint-Quentin - 5 avenue des États-Unis - 78000 Versailles
2 - Hôpital Ambroise Paré - Chirurgie digestive, oncologique et métabolique - 9 avenue
Charles de Gaulle - 92100 Boulogne Billancourt
* Correspondance : jl.bouillot@apr.aphp.fr
Prise en charge de l’obésité en 2012 :
le point de vue d’un chirurgien
spécialisé en obésité
J.L. BOUILLOT 1*, N. CORIGLIANO 2, G. CANARD 1,
S. SERVAJEAN 2, N. VEYRIE 1
(Versailles, Boulogne-Billancourt)

inconvénients, qui doivent être évalués pour tout candidat à la chirurgie bariatrique.
L’anneau est une intervention simple, réversible, autorisant une perte de poids modérée
mais avec un taux de complications et d’échecs à long terme importants. Le by-pass
présente le meilleur rapport coût-bénéfices (sur la perte de poids et la correction des
comorbidités, notamment du diabète), mais il s’agit d’une intervention complexe, avec
des risques de carence justifiant la prise à long terme de suppléments vitaminiques. La
gastrectomie sleeve, d’apparition plus récente, est une intervention mutilante de gravité
moyenne avec des résultats à moyen terme intéressants (le long terme est encore inconnu),
tant sur le poids que sur la correction des comorbidités. Le choix de telle ou telle procédure
est fonction de l’âge des patients, de la gravité de l’obésité, de la compétence des équipes
et du choix des patients. Il n’y a pas à l’heure actuelle de consensus pour privilégier telle
intervention ou telle autre. La problématique actuelle est de savoir s’il faut d’emblée
proposer l’intervention la plus efficace ou s’il faut, notamment chez les patients jeunes,
s’orienter vers une stratégie à plusieurs étapes, en débutant par un anneau et en cas
d’échecs ou de complications proposer alors une sleeve, laquelle peut être transformée
ultérieurement en by-pass si nécessaire.
Il est vraisemblable qu’à moyen et long termes, d’autres procédures éventuellement
non chirurgicales ou moins invasives verront le jour. Actuellement cependant, la chirurgie
reste le seul traitement ayant prouvé son efficacité. Elle doit être mise en œuvre au sein
d’une stratégie de prise en charge globale et multidisciplinaire des patients obèses.
Mots clés : obésité, chirurgie bariatrique, recommandations, résultats
Déclaration publique d’intérêt
Les auteurs déclarent ne pas avoir d’intérêt direct ou indirect
(financier ou en nature) avec un organisme privé, industriel ou
commercial en relation avec le sujet présenté.
104
BOUILLOT &COLL.

L’obésité est définie par un indice de masse corporelle supérieure
à 30 (IMC : poids/taille 2). Elle s’est développée de façon considérable
au cours des 20 dernières années, dans les pays occidentaux comme
dans les pays émergents, devenant un phénomène préoccupant de
santé publique. En France, si l’incidence de l’obésité n’a augmenté que
faiblement au cours des années 80, on observe depuis lors un net
accroissement. De 6,5 % en 1991, l’incidence a grimpé à 13,1 % en
2006. Il existe actuellement environ 3 millions de Français adultes
obèses et 300 000 obèses sévères (IMC > 40). Ces chiffres sont encore
loin de ceux rencontrés outre-Atlantique où on notait en 2002 aux
États-Unis un taux d’obèses supérieur à 30 % et plus de 5 % des adultes
avaient un IMC supérieur à 40 [1].
L’obésité sévère (dite morbide) entraîne de nombreuses compli-
cations qui font la gravité de la maladie : complications métaboliques
(hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2,
dyslipidémies), complications en rapport avec l’excès de poids (problèmes
rhumatologiques, apnée du sommeil), complications gynécologiques
(syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), aménorrhée, infertilité).
Elle est responsable d’un nombre important de décès prématurés, sans
compter le très lourd retentissement psychologique, familial et social.
Les dépenses ainsi engendrées sont estimées par la sécurité sociale à
plusieurs milliards d’euros par an.
Face à cette épidémie et compte tenu du caractère souvent
décevant à long terme des traitements médicaux classiques, on a assisté
à une véritable explosion dans le monde entier de la chirurgie de
l’obésité (encore appelée bariatrique). Elle seule semble à même de
lutter contre la surcharge pondérale massive et de corriger les
comorbidités. L’étude SOS publiée en 2004, suivant une cohorte de
plusieurs milliers de patients, les uns opérés, les autres traités
médicalement, a clairement établi l’efficacité de la chirurgie bariatrique
à long terme dans la prise en charge de l’obésité [2]. Les patients du
groupe traité médicalement (ayant bénéficié d’un traitement médical
optimal) présentent une courbe de poids quasi stable tout au long des
15 années de suivi, résultat fort appréciable si l’on en juge par la
tendance naturelle à une prise pondérale progressive en l’absence de
prise en charge médicale. À l’opposé, chez les patients opérés on
observe une perte de poids d’environ 20 % du poids initial un an après
anneau gastrique ajustable (AGA), de près de 32 % après by-pass
gastrique (BPG), résultat perdurant puisque malgré une certaine reprise
pondérale on observe une perte de poids à 15 ans de l’ordre de 13 et
25 % respectivement. De plus, cette même étude objective montre une
baisse de mortalité dans le groupe chirurgical, comparativement au
105
PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ EN 2012 : LE POINT DE VUE D’UN CHIRURGIEN SPÉCIALISÉ EN OBÉSITÉ

groupe médical, différence liée essentiellement au risque accru de mort
par maladies cardiovasculaires et par cancer dans le groupe médical
[2-4].
Cette efficacité explique le développement considérable de la
chirurgie bariatrique dans les pays occidentaux au cours des
20 dernières années. Bien que les premières interventions chirurgicales
pour obésité (il s’agissait à l’époque de courts-circuits intestinaux) aient
été proposées dès les années 1950, que le premier BPG ait été imaginé
dès l’année 1967, ce n’est réellement qu’au cours des années 1980 et
surtout 1990 que cette discipline a pris son véritable essor. En France,
le nombre d’interventions est passé de quelques dizaines dans les
années 90 à 15 000 en 2003, pour atteindre 25 000 en 2011 (données
PMSI) [1].
I. INDICATIONS CHIRURGICALES
Elles sont bien établies, identiques dans tous les pays où se
pratique cette chirurgie [5, 6].
La chirurgie ne s’adresse qu’à un nombre très restreint de patients
obèses, ceux chez qui l’espérance de vie et la qualité de celle-ci sont
altérées par la surcharge pondérale. Elle s’adresse à des patients adultes ;
il n’y a pas d’indication à l’heure actuelle à opérer des adolescents,
même si une réflexion est en cours pour élargir les indications à ce
groupe d’âge (cadre strict, circonstances particulières, centres experts).
À l’inverse, il n’y a pas d’âge limite supérieur pour poser une indication
opératoire, mais au-delà de 65 ans, il faut peser l’indication avec soin
car le risque opératoire est plus élevé, la récupération postopératoire
plus difficile et le risque de dénutrition plus important que dans une
population plus jeune.
Les patients doivent avoir un IMC supérieur à 40. Cette limite a
été établie au vu du risque relatif de mortalité augmentant de façon
importante au-delà de cette valeur. Cette borne est abaissée à 35 en
présence de comorbidités : syndrome d’apnée du sommeil, asthme,
insuffisance respiratoire, diabète, affections cardiovasculaires, hyper-
tension artérielle, syndrome métabolique, dyslipidémie, affections
rhumatologiques, stéatose hépatique non alcoolique (NASH), inconti-
nence urinaire d’effort, reflux gastro-œsophagien, insuffisance veineuse,
SOPK…
106
BOUILLOT &COLL.

Le patient doit avoir bénéficié d’une prise en charge médicale et
diététique au moins 6 mois avant la décision chirurgicale. Cette période
permet au patient de ne s’engager dans cette démarche qu’en toute
connaissance de cause après s’être informé des avantages, inconvénients,
risques et contraintes des interventions.
Enfin, la décision d’opérer doit être prise au sein d’une réunion de
concertation pluridisciplinaire réunissant des médecins, des chirurgiens,
des anesthésistes, des psychologues ou des psychiatres, des diététi-
ciennes, décision devant être communiquée au médecin traitant.
Le bilan préopératoire est plus ou moins large selon les patients et
les habitudes des équipes. Il convient dans tous les cas de rechercher
et traiter un syndrome d’apnée du sommeil extrêmement fréquent dans
cette population souvent défavorisée, d’évaluer la fonction cardio-
vasculaire, d’explorer l’estomac à la recherche de pathologie pouvant
contre-indiquer une intervention, de rechercher une éventuelle
infection à Helicobacter pylori qu’il conviendra d’éradiquer avant toute
intervention, d’évaluer l’état dentaire (une bonne fonction masticatoire
est un prérequis indispensable à toute intervention bariatrique) et chez
les femmes de s’assurer de l’absence de pathologie gynécologique
(bilan sénographique et examen gynécologique récent). Les contre-
indications à la chirurgie sont rares : obésités curables d’origine
endocrinienne, troubles psychiatriques graves, pathologie cancéreuse
en évolution, addictions aux drogues ou à l’alcool, et pour certains
obésité d’origine génétique [6].
II. INTERVENTIONS CHIRURGICALES
L’intervention idéale n’a pas encore été inventée. Elle devrait
permettre une perte de l’excès de poids (PEP) à long terme d’au moins
50 %, avec une morbi-mortalité péri-opératoire faible et peu de
réinterventions à distance.
Les interventions se répartissent selon leur mécanisme d’action.
On distingue ainsi les interventions restrictives qui réduisent l’apport
alimentaire (AGA, gastrectomie en manchon encore nommée sleeve
gastrectomie), les interventions malabsorptives (diversion bilio-pancréa-
tique) et les interventions mixtes type BPG.
107
PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ EN 2012 : LE POINT DE VUE D’UN CHIRURGIEN SPÉCIALISÉ EN OBÉSITÉ
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%