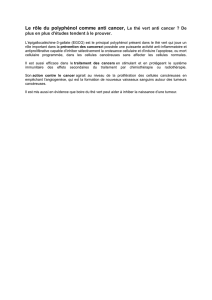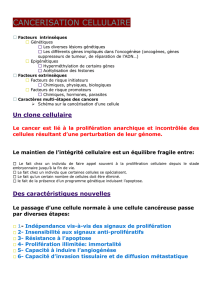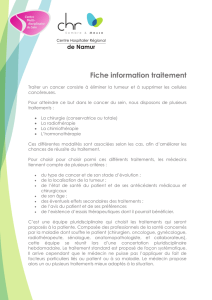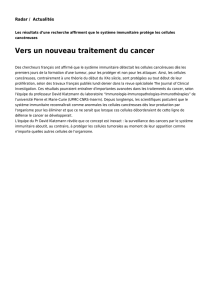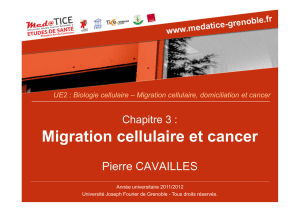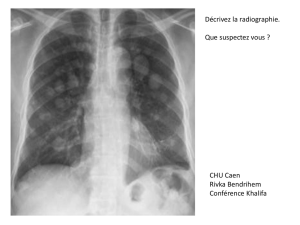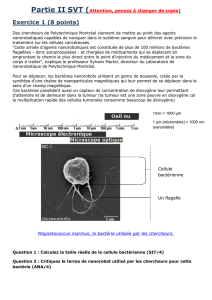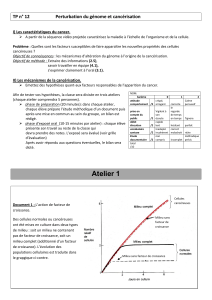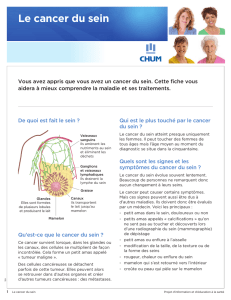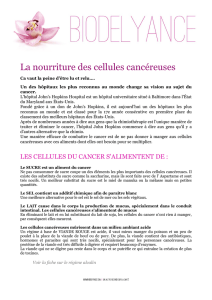Cancer : les mécanismes biologiques - 01/03/2012

Printed with joliprint
Cancer : les mécanismes biologiques -
01/03/2012
Malgré l’anarchie qui caractérise le déve-
loppement d’une tumeur, l’oncogenèse et
sa progression suivent des principes valables
pour l’ensemble des cancers.
La progression de tumeurs dépend de mutations génétiques, de modications
épigénétiques et d’agents cancérigènes. © Rory Duncan et Linda Sharp, Well-
come Images/Flickr CC by nc-nd 2.0
Les oncogènes et les gènes
suppresseurs de tumeurs
Les cellules tumorales évoluent vers une prolifé-
ration ou un pouvoir d’invasion accrus en faisant
l’acquisition de nouvelles capacités, ce qui les fait
progresser d’un stade de l’oncogenèse au suivant.
Pour acquérir de nouvelles capacités, elles doivent
subir des mutations génétiques sur deux types de
gènes gouvernant la marche des cancers : les onco-
gènes et les gènes suppresseurs de tumeurs.
Les oncogènes stimulent la progression tumorale
alors que les gènes suppresseurs de tumeurs frei-
nent ou stoppent cette progression. Les mutations
qui font progresser l’oncogenèse sont activatrices
d’oncogènes ou inactivatrices de gènes suppresseurs
de tumeurs. Un oncogène activé exerce sa fonction
de manière exagérée comme par exemple une sti-
mulation permanente de la prolifération cellulaire.
Un gène suppresseur de tumeurs inactivé ne peut
plus exercer sa fonction qui peut être une inhibition
de la prolifération cellulaire.
L’initiation et la progression tumorale
La progression tumorale dépend de deux types
d’agents cancérigènes : les initiateurs et les pro-
moteurs de tumeurs (Figure 6).
Figure 6. Mode d’action schématique des initiateurs et des promoteurs de
tumeurs. Un initiateur modie l’information génétique et il est capable de
transformer une cellule saine. Un promoteur de tumeur ne transforme pas
une cellule, il stimule la progression de l’oncogenèse s’il exerce son action
(dans cet exemple, une stimulation de la prolifération cellulaire) sur des
cellules qui ont déjà initié l’oncogenèse. © Grégory Ségala
Les initiateurs de tumeurs provoquent des muta-
tions génétiques qui peuvent toucher des oncogènes
ou des gènes suppresseurs de tumeurs. Comme leur
nom l’indique, les initiateurs initient l’oncogenèse
mais ils la font aussi progresser en provoquant de
Grégory Ségala
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/les-mecanismes-du-cancer_1453/c3/221/p5/#xtor=AL-40
Page 1
Futura-Sciences

Printed with joliprint
Cancer : les mécanismes biologiques - 01/03/2012
nouvelles mutations conférant de nouvelles capa-
cités aux cellules tumorales. Ils peuvent être :
• d’origine chimique comme le benzopyrène
présent dans la fumée de cigarette ;
• d’origine physique comme les radiations
ionisantes ;
• d’origine biologique c’est-à-dire des ini-
tiateurs générés par nos propres cellules
comme les espèces oxygénées réactives pro-
duites par notre métabolisme énergétique.
Les promoteurs tumoraux accélèrent la progression
tumorale sans provoquer directement de mutations
sur l’ADN. Souvent, les promoteurs tumoraux sont
des stimulateurs de la prolifération cellulaire. L’ac-
tion d’un promoteur tumoral seul sur des cellules
saines est totalement nulle sur l’initiation de l’on-
cogenèse. Son effet de promotion tumorale n’a lieu
que sur des cellules qui ont déjà initié l’oncogenèse.
Certains promoteurs tumoraux sont produits par
notre organisme comme les hormones sexuelles
qui stimulent la prolifération des cellules des or-
ganes sexuels. L’inammation chronique est un
promoteur tumoral fort. Ainsi, les pathologies qui
font intervenir l’inammation chronique comme les
ulcères de l’estomac, l’alcoolisme ou les infections
chroniques sont indirectement des promoteurs de
tumeurs. Le benzopyrène est un promoteur tumo-
ral chimique en provoquant l’inammation tout en
étant, comme nous l’avons vu ci-dessus, un initiateur
de tumeur ce qui en fait un cancérigène complet.
Sélection clonale et progression
tumorale
Une cellule qui a subi une mutation initiatrice de
l’oncogenèse prolifère et donne naissance à une
nouvelle population de cellules transformées iden-
tiques entre elles : c’est une population monoclonale
(Figure 7).
Figure 7. La sélection clonale. Une mutation initiatrice provoque l’apparition
d’une population monoclonale de cellules transformées. Au sein de cette po-
pulation, de nouvelles mutations apparaissent : la mutation A et la mutation
B. La mutation A est plus avantageuse que la mutation B et permet à la popu-
lation qui la porte, la population A, d’être plus importante que la population
B qui porte la mutation B. Cet avantage sélectionne la population A pour la
poursuite de l’oncogenèse : c’est à partir de la population A que l’oncogenèse
continue à progresser grâce à l’incidence de nouvelles mutations (mutation
C). © Grégory Ségala
Certaines cellules de cette population peuvent elles-
mêmes subir de nouvelles mutations ce qui génère
de nouvelles populations monoclonales. Les muta-
tions se font au hasard mais une hiérarchie s’ins-
talle entre les différentes populations de cellules
: la population qui possède les mutations les plus
avantageuses prend le dessus démographique sur
les autres populations, elle est donc sélectionnée
naturellement. C’est à partir de cette population
sélectionnée que se poursuit l’oncogenèse.
Ainsi, toute nouvelle mutation conférant un avan-
tage sélectif fait émerger une nouvelle population
monoclonale plus évoluée qui est sélectionnée pour
poursuivre l’oncogenèse. Ce principe fondamen-
tal dénit le sens de la marche de la progression
tumorale.
Grégory Ségala
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/les-mecanismes-du-cancer_1453/c3/221/p5/#xtor=AL-40
Page 2

Printed with joliprint
Cancer : les mécanismes biologiques - 01/03/2012
L’oncogenèse : un processus lent
évoluant par étapes
De nombreuses mutations de gènes impliqués dans
le cancer surviennent au cours de l’oncogenèse. À
cause de ces mutations, la cellule cancéreuse pos-
sède des capacités nouvelles comme une forte pro-
lifération, une forte capacité de survie ou encore la
capacité d’envahir les tissus voisins. L’acquisition
de ces capacités se fait par la sélection de plusieurs
mutations ayant un intérêt dans l’oncogenèse mais
survenant de manière aléatoire. Par conséquent, il
existe au cours de la progression tumorale de mul-
tiples paliers pendant lesquels les cellules cancé-
reuses n’évoluent pas car elles ne bénécient pas
de nouvelles mutations avantageuses. Ces paliers
dénissent des étapes que les cellules cancéreuses
doivent franchir pour progresser dans l’oncogenèse.
Entre chacune de ces étapes, le temps de latence
est de durée variable et peut correspondre à plu-
sieurs années. Généralement, on estime à plusieurs
décennies le temps qui s’écoule entre la mutation
initiatrice de l’oncogenèse et le cancer, bien qu’il y
ait une variabilité dans la durée de développement
des cancers.
L’épigénétique
L’épigénétique regroupe les mécanismes de la cel-
lule qui modient l’expression des gènes sans affec-
ter l’information génétique qu’ils portent. Le taux
d’expression d’un gène dénit le taux de synthèse
de la protéine codée par ce gène. La protéine établit
la fonction du gène dans la cellule. Par conséquent,
plus un gène est exprimé, plus sa protéine est pro-
duite et plus l’action du gène est forte dans la cellule.
Des dérégulations épigénétiques très complexes
d’oncogènes et de gènes suppresseurs de tumeurs
participent essentiellement à la progression tumo-
rale. Les modications épigénétiques qui favorisent
la progression tumorale augmentent l’expression
des oncogènes (on parle de surexpression) alors
qu’elles diminuent voire éteignent l’expression
des gènes suppresseurs de tumeurs (on parle de
répression).
Les mutations génétiques et les dérégulations épi-
génétiques sont les deux types d’événements cellu-
laires qui font progresser l’oncogenèse.
Notre organisme possède un nombre de cellules
nement régulé ce qui contribue à l’équilibre des
tissus. Les cellules cancéreuses quant à elles se
multiplient en permanence, leur prolifération
est incontrôlée : c’est une caractéristique uni-
verselle et majeure des cancers.
Les cellules cancéreuses prolifèrent de façon autonome dans l’organisme.
Elles ne répondent pas au cycle cellulaire normal. © Dr. Yi Feng, University of
Bristol, Wellcome Images/Flickr CC by nc-nd 2.0
Dans l’organisme, les cellules ne prolifèrent que si
des signaux extérieurs de prolifération le permet-
tent. Ces signaux proviennent de communications
avec d’autres cellules ce qui permet une entente
entre les cellules et participe à l’équilibre des tissus.
Grégory Ségala
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/les-mecanismes-du-cancer_1453/c3/221/p5/#xtor=AL-40
Page 3

Printed with joliprint
Cancer : les mécanismes biologiques - 01/03/2012
La capacité principale des cellules cancéreuses est
de proliférer fortement et de manière autonome,
sans dépendre des communications qui régulent
normalement la prolifération cellulaire. Elles ne res-
pectent plus l’équilibre du tissu dont elles font partie.
Cette prolifération incontrôlée et surstimulée fait
émerger un nouveau tissu de structure anarchique
: le tissu tumoral. Nous allons nous intéresser au
mécanisme de la prolifération cellulaire en détail
an de situer les points de contrôle que la cellule
cancéreuse détourne à son prot.
La signalisation de la prolifération
Une cellule normale ne prolifère que si elle reçoit
les signaux de prolifération adéquats.
Une cellule peut recevoir différents types de signaux
en provenance d’autres cellules qui activent sa pro-
lifération. Ces signaux sont portés par les facteurs
de croissance, comme le facteur de croissance épi-
thélial EGF (Epithelial Growth Factor) qui active la
prolifération des cellules épithéliales (Figure 8).
Figure 8. La signalisation de la prolifération cellulaire. En se xant à son
récepteur, l’EGF entraîne l’activation d’une cascade de signalisations, appelée
voie mitogène, qui aboutit à la synthèse de protéines engendrant la proliféra-
tion cellulaire. © Grégory Ségala
L’EGF est une protéine extracellulaire qui représente
un signal de prolifération. Elle se lie à son récepteur
présent à la surface des cellules épithéliales, l’EGFR
(récepteur de l’EGF). Cette liaison active l’EGFR qui
déclenche dans la cellule une cascade d’activations
en chaîne de plusieurs protéines signalisatrices. Ces
protéines s’organisent en une voie de signalisation
de la prolifération appelée voie mitogène. La signa-
lisation parvient jusqu’au noyau de la cellule où
se trouve le génome. La voie mitogène active alors
l’expression des gènes de la prolifération cellulaire.
Les protéines qui orchestrent la prolifération cel-
lulaire sont synthétisées : la cellule se multiplie en
réponse au signal de prolifération porté par l’EGF.
Le cycle cellulaire
La prolifération est contrôlée au niveau du cycle
cellulaire qui représente l’ensemble des étapes
que doit effectuer une cellule pour générer deux
cellules lles.
Le contrôle de la prolifération s’effectue au cours
du cycle cellulaire (Figure 9). Le cycle cellulaire re-
groupe les différentes phases qui permettent à une
cellule de générer deux cellules lles :
• la première phase du cycle, la phase G1,
est une phase de croissance cellulaire où la
cellule accroît sa taille ;
• ensuite une phase de duplication de l’ADN
se met en place, c’est la phase S ;
• la cellule nalise la duplication de l’ADN
ainsi que la croissance cellulaire en phase
G2 ;
• elle entre alors dans la dernière phase du
cycle cellulaire, la phase M, qui correspond
à la division cellulaire qui génère deux cel-
lules lles.
Ces cellules peuvent chacune recommencer un cycle
cellulaire si les signaux de prolifération le permet-
tent. Le déroulement du cycle cellulaire est vérié
au niveau de points de contrôle placés pendant les
phases du cycle cellulaire. Ils déterminent si le cycle
cellulaire peut progresser au sein d’une phase ou
s’il peut passer à la phase suivante.
Grégory Ségala
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/les-mecanismes-du-cancer_1453/c3/221/p5/#xtor=AL-40
Page 4

Printed with joliprint
Cancer : les mécanismes biologiques - 01/03/2012
Figure 9. Le cycle cellulaire. Durant la phase G1, les signaux de prolifération
désactivent la protéine Rb ce qui permet de lever le point de restriction du
cycle cellulaire. La cellule entre en phase S où elle duplique son génome.
Ensuite elle entre en phase G2 où elle se prépare à se diviser et enn elle
termine son cycle cellulaire par la phase M qui correspond à la division
cellulaire. © Grégory Ségala
Déroulement du cycle cellulaire
Le premier point de contrôle du cycle cellulaire, le
point de restriction, se situe en phase G1 et décide
si un nouveau cycle cellulaire doit être lancé par la
cellule (Figure 9). La protéine gardienne du point
de restriction est la protéine Rb. Elle détecte si les
signaux de prolifération reçus par la cellule justient
par leur intensité l’initiation d’un cycle cellulaire.
Si les signaux de prolifération sont susamment
intenses, ils inactivent Rb, ce qui permet l’expression
des gènes de la prolifération et par conséquent l’en-
trée de la cellule dans un nouveau cycle cellulaire.
Après l’inactivation de Rb, la cellule entre en phase
S qui correspond à la phase de duplication de l’ADN.
Pendant cette phase, le génome est dupliqué c’est-à-
dire qu’il est copié par le système de réplication de
l’ADN pour qu’il y ait deux copies du génome dans
la cellule mère. La cellule mère pourra ainsi donner
naissance à deux cellules lles qui posséderont cha-
cune une copie du génome. Le point de contrôle de
la phase S est activé lorsque des dommages de l’ADN
sont détectés ou lorsque le système de réplication de
l’ADN est bloqué. L’activation du point de contrôle
arrête temporairement le cycle cellulaire. Il n’est
désactivé que lorsque les anomalies détectées sont
résolues, ce qui autorise la reprise du cycle.
En phase G2, la cellule nalise la duplication du
génome et répare les derniers dommages éventuel-
lement présents sur l’ADN, ce qui est vérié par le
point de contrôle de la transition entre la phase G2
et la phase M (point de contrôle G2/M). Une fois la
duplication et la réparation de l’ADN terminées,
le point de contrôle G2/M est inactivé et la cellule
entre en phase M. Les deux copies du génome de la
cellule mère sont séparées pour former le noyau de
chaque cellule lle. Enn, la cellule mère se scinde
progressivement en son centre pour nalement don-
ner naissance à deux cellules lles qui reviennent
chacune en phase G1.
Pour se multiplier sans cesse, les cellules can-
céreuses court-circuitent de nombreuses régu-
lations de la prolifération cellulaire, ce qui les
amène à proliférer de manière incontrôlée. Ces
cellules ont plusieurs solutions pour éviter la
sénescence.
Figure 10. Dérégulation de la prolifération cellulaire. En situation saine, une
cellule a besoin de facteurs de croissance pour proliférer. Dans une situation
cancéreuse, la cellule cancéreuse peut muter un oncogène pour qu’il génère
de façon permanente des signaux de prolifération, indépendamment de la
présence de facteurs de croissance. © Grégory Ségala
Grégory Ségala
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/les-mecanismes-du-cancer_1453/c3/221/p5/#xtor=AL-40
Page 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%