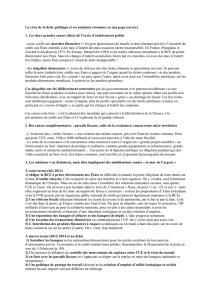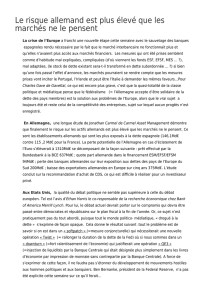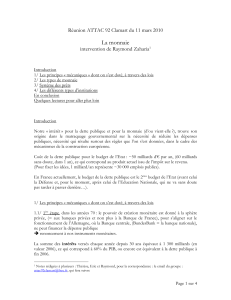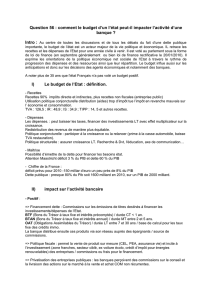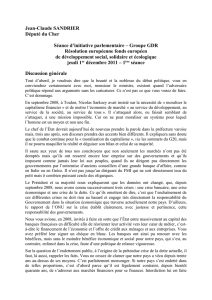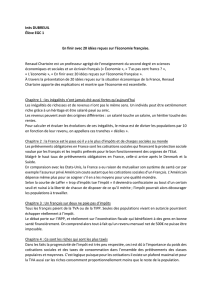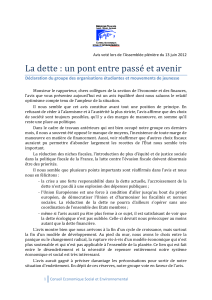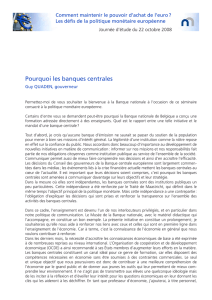culture s cience

science
.mag
culture
ABéCédaire
de la crise
De A comme triple A à V comme Vocabulaire
la crise s’invite dans les laboratoires

4 CONFÉRENCE
Triple A. L’évaluation sur le divan
Le psychothérapeute et psychanalyste Roland Gori présentait à Nice
son dernier ouvrage, La Dignité de Penser (Les liens qui libèrent). Il y
revient sur «la religion des marchés».
7 ENTRETIEN
Banques
An de mieux comprendre comment fonctionnent les
établissements bancaires, CultureScience.mag a rencontré les spécialistes Eric Nasica
et Olivier Bruno.
11 ANALYSE
La crise de la Dette souveraine
par Albert Marouani
15 LIVRE
Le jeu de la Chine en Euro(pe)
Jean-Paul Guichard et Antoine Brunet publient La visée hégémonique de la Chine.,
nominé pour le prix du meilleur livre d’économie nancière de l’année.
18 Idéologie en berne
Sandye Gloria-Palermo, chercheuse au GREDEG, publie en 2010 un article intitulé «Le néoli-
béralisme à l’épreuve des subprimes»
22 Les marqueurs de la Justice sociale
Collatérale à la crise, la «pauvreté» menace de faire de nouvelles victimes. Mais que signie,
en 2012, ce terme, dans un pays développé comme la France?
25 Les Laboratoires enquêtent sur les agents rationnels
Confrontés aux imprévisibilités de l’agent économique parfait décrit dans les modèles mathé-
matiques, des chercheurs se tournent vers l’expérimentation in vivo.
28 ENTRETIEN
Philosophie économique
Entretien avec Jean Robelin, professeur émérite de philosophie au Centre de Re-
cherche en Histoire des Idées (CRHI).
32 REPÈRES
Les mécanismes de Régulation
par Dominique Torre
35 Villes en Transitions
Des expérimentations discrètes bous-
culent le modèle socio-économique
dominant.
Vocabulaire
Abraham Lioui décrypte une série
d’expressions «techniques» passées
dans le langage courant.
Directrice de la publication : Frédérique Vidal
Directeur scientique : Pierre Coullet
Rédacteur en chef / Rédaction: Laurie Chiara
Crédit Photographique : Institut Culture Science Alhazen
Illustrateur : Matthieu Chiara
Maquette et mise en page papier : Guy Viens
Version pour le web : Laurie Chiara
Copyright : La reproduction des textes, illustrations,
partiellement ou dans leur totalité est interdite, sauf accord
préalable de la rédaction.
Sommaire

Le casse-tête à débuté sur un curieux mot,
échappé des pages économiques pour se fau-
ler en «une» des 20 heures. Les «subprimes»,
comme des balles à blanc tirées d’un pistolet de
starter, ont sonné le départ d’une course longue
et technique. Depuis 2007, pour comprendre le
monde, il semblerait falloir toucher sa bille en
vocabulaire, avoir à son chevet un dictionnaire
d’économie.
Car après la crise des crédits à haut risque,
l’épineuse question de la titrisation, les repor-
tages et autres documentaires se sont engouf-
frés dans les coulisses d’un univers largement
méconnu. Paisibles derrière leur poste, les
traders ont eu à orienter l’écran de leurs
ordinateurs face caméra. Déance vis à vis des
banques, imbroglio des places nancières, opa-
cité des transactions, tout, soudain, surprend et
indigne.
Or, à peine familiarisés avec les métamorphoses
lexicales des créances individuelles, les spec-
tateurs de la nance se trouvent confrontés
à un épineux débat sur la dette, la croissance
et la monnaie unique. La «crise» américaine
et ses sous-entendus ont traversé l’Atlantique
et ont pris d’assaut la tribune politique. À une
poignée de semaines de l’élection présidentielle
en France, les candidats au poste ne manquent
ainsi pas de plaider, à renfort de chiffres et de
graphiques «pédagogiques». Toutefois, occupés
à convaincre les spécialistes de l’économie du
bien fondé de leur programme, ils en oublie-
raient presque de se faire entendre
de leurs éventuels électeurs.
Ceci mériterait sans doute de s’interroger sur
la pertinence à maintenir les sciences écono-
miques et sociales au rang de discipline option-
nelle, et ce jusqu’au crépuscule du secondaire.
Elles ont sans doute, autant que les sciences
de la nature et du vivant, leur place dans un
socle commun de culture générale. Car elles
paraissent également indispensables pour com-
prendre le monde contemporain.
CultureScience.mag a donc choisi d’interroger
les chercheurs de l’Université Nice Sophia Anti-
polis sur onze mots et autant d’idées, évoqués
ces derniers mois aux heures de grande écoute.
Ces derniers se sont prêtés à l’exercice sans
chiffres et sans graphiques. En majeur partie des
économistes, mais pas seulement, ils éclairent
chacun à leur façon une crise dénitivement
multidimensionnelle.
Laurie Chiara.
Tous au
rattrapage

Triple A
l’évaluation sur le divan
Avec son dernier ouvrage, La dignité de penser, le psychothérapeute et
psychanalyste marseillais Roland Gori s’élève contre «la religion du marché».
Le néon phosphorescent d’une enseigne
à trois lettres grésille, intermittent. L’ar-
mature métallique vacille, puis bascule.
La France a perdu un A et ses agents éco-
nomiques tâtonnent dans une soudaine obscurité.
Le front tendu, les tempes humides, ils s’accordent
sur la cause, avec ses allures de lapin blanc, la dette
publique. Ils divergent sur le remède, croissance
ou austérité. Mais ce satané «A» et ses deux homo-
logues rescapés, quasi oubliés, ont-ils seulement
du sens, une histoire, une réalité? Comment penser
cette blessure? Il sufrait, semble-t-il, de corriger
les erreurs, de rentrer dans les clous. En d’autres
termes, de se conformer aux exigences des mar-
chés.
Ainsi, perdre un A, cela reviendrait grossièrement
à présenter un Indice de Masse Corporelle hors
normes. Les Pays se trouvent soumis à un diagnos-
tique mathématique irréfutable associé à un juge-
ment de valeur. Et s’ils veulent être heureux, ac-
ceptés, ils ont le choix des outils : diététique, sport,
pharmacopée, thérapie comportementale.
Or, d’après le psychothérapeute et psychanalyste
Roland Gori, cette situation révèle «de nouveaux
dispositifs de servitude», dans lesquels l’évalua-
tion toute-puissante balaie l’inutile du champ des
compétences humaines.
Invité le 8 février dernier à présenter son dernier
ouvrage, La Dignité de Penser, à la Villa Arson
à Nice, cet universitaire marseillais a ainsi tenté
d’éclairer le public sur le glissement de notre civi-
lisation vers le conformisme.
Selon lui, cette tendance repose sur des dispositifs
de néo évaluation. C’est-à-dire qu’il ne s’agirait
plus de donner de la valeur («bon, beau» ou «mau-
vais, laid»), mais de contraindre, grâce à la menace
de la dévalorisation. «Nous voilà donc en présence
d’un dispositif de gouvernance des populations et
des États, qui tend à se substituer à la pensée et au
débat démocratique», prévient Roland Gori.

culture des résultats,
civilisation des chiffres
Or cette «tyrannie de la gestion», «culture des
résultats», ou encore «civilisation des chiffres»,
se trouverait intimement liée au progrès tech-
nologique et numérique, ainsi détourné de ses
nobles applications. Nullement opposé à l’exis-
tence des accessoires et outils de dernière géné-
ration, le psychothérapeute nous met en garde
contre «la colonisation des esprits». Car selon
lui, l’homme a lui-même transféré «le centre de
pensée», du sujet vers la machine. Ainsi, l’in-
formation au sens technique, chiffré, se serait
substituée au savoir narratif, autrement dit à la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
1
/
40
100%