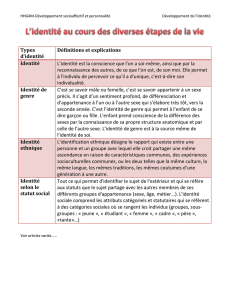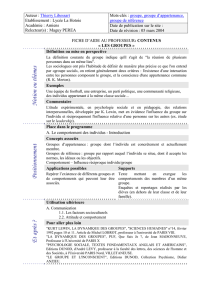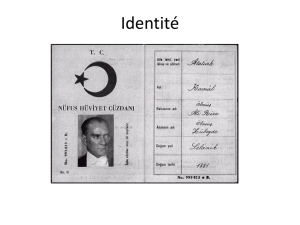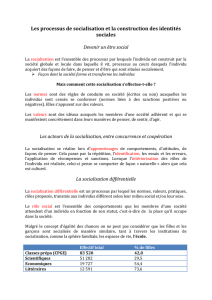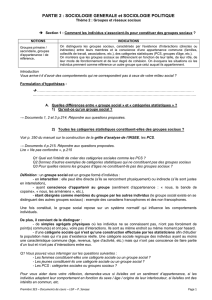5. Les dimensions subjective et objective de la construction identitaire

Socialisation, règles informelles et construction identitaire
Introduction
Le rapport au travail est autre chose qu’un simple contrat de travail, la mise à disposition
d’une force de travail contre une rémunération. Le travail suppose une initiative, une
mobilisation qui ne peut se résumer à un contrat de travail et à des règles formelles. On parle
alors de « motivation », ce qui pousse l’individu à agir en l’absence de sanction ou de
récompense immédiate. À tous les niveaux de l’échelle sociale, on trouve des gens qui font
preuve d’initiatives, engagent leur volonté à satisfaire l’entreprise, alors que leurs chances
d’évolution sont nulles. Mais on trouve aussi l’inverse : les managers ont souvent le sentiment
d’être face à des individus ou même un groupe de travail qui « freinent », ne prennent pas
d’initiative. Il existe des contrats de travail et des techniques de management qui ont pour
objectif d’orienter l’action d’un subordonné : individualisation des rémunérations,
enrichissement du travail, délégation de responsabilité, perspectives de carrières… Mais ces
techniques ont des effets très variables d’une personne à l’autre, d’une situation à l’autre.
Pour répondre à ces questions, les sociologues proposent d’étudier plus en détail le rapport
des individus à leur travail. Ils se demandent par quoi ce rapport est déterminé initialement,
comment il se construit, comment il évolue au gré des expériences. Ils montrent que notre
rapport au travail est en grande partie déterminé par notre socialisation, notre milieu d’origine,
nos expériences et nos insertions sociales diverses au fur et à mesure de notre existence. Il est
aussi affecté par le fait que le travail participe à l’image que l’on a de soi ou que l’on veut
donner de soi aux autres. On y investira davantage quand on pourra s’identifier à ce que l’on
réalise. Il y a donc un lien entre le rapport de l’individu au travail et son identité.
La première approche de la question identitaire se réfère à la question de l’appartenance à un
collectif. L’appartenance à un collectif se pose d’abord comme une nécessité, compte tenu de
notre dépendance à autrui. L’appartenance à un collectif donne un certain nombre de repères
comportementaux qui nous permettent d’être acceptés, insérés, mais aussi d’accéder à une
position sociale. On peut aussi se référer à un autre collectif que le groupe d’appartenance
pour se positionner dans la société : ce que l’on appelle le groupe de référence. L’approche en
terme de position sociale permet d’envisager de nombreux aspects des comportements au
travail, par exemple, la façon de construire sa carrière, d’avoir recourt à la formation.
Enfin, nous verrons que l’on peut établir des rapprochements entre la question identitaire et
d’autres questions. Ainsi, identité et relation de pouvoir ont de nombreux liens. Tout collectif
est engagé dans une relation de pouvoir avec ses membres et avec le reste de la société ou de
l’organisation. Réciproquement, le sentiment d’appartenance à un collectif facilite l’action
collective : organisation interne au collectif, valeurs partagées… Autre thème qui peut être
rapproché de la notion d’identité : l’attitude face au changement. Dans un changement
organisationnel, toutes les positions sociales ne sont pas menacées ou favorisées de la même
façon. Une menace peut conduire le collectif à se ressourcer dans une définition la plus
traditionnelle de sa culture commune, et donner du poids à ses leaders les plus radicaux. Une
situation de changement organisationnel peut donc conduire à renforcer un collectif, qui peut
ainsi développer une capacité d’action, de résistance, et de négociation du changement.
1. La socialisation
Dans les travaux de sociologie de Durkheim, les comportements sont principalement
expliqués par la notion de socialisation, c’est-à-dire l’intériorisation de repères, de
représentations, de valeurs du groupe d’appartenance. Si on regarde son milieu d’origine,
son éducation, mais aussi les diverses insertions sociales que l’on a connues dans son histoire
(milieu étudiant…), tous ont laissé des traces, des comportements quotidiens que l’on ne
questionne plus.
Pourquoi un tel mécanisme d’intériorisation ? L’homme est le seul animal qui ne peut
survivre sans l’aide des autres hommes : il a besoin de repères comportementaux pour être
accepté. Dans un nouvel espace de socialisation, chacun adoptera les modèles de
comportement, par souci de s’intégrer. Cette socialisation conduit à un apprentissage

comportemental extrêmement important : la maîtrise de soi, le respect des
« convenances »… Les déterminations sociales (origines sociales) sont renforcées par le
phénomène d’exclusion des déviants : ceux qui se retrouvent dans un groupe dont ils ne
maîtrisent les convenances, le langage, la culture, peuvent en être exclus. Ce qui a pour effet
de renvoyer chacun dans son groupe d’appartenance et de renforcer la ségrégation sociale
(le film « le goût des autres » en est un très bon exemple).
De nombreuses études mettent en relation étroite les comportements des gens avec leur
éducation : par exemple en ce qui concerne la différenciation entre les rôles féminins et
masculins, et ce malgré une adhésion au discours sur l'égalité des sexes… Si l’on s’intéresse
aux activités de loisir, la pratique sportive et artistique, les voyages, là aussi les origines
sociales, sont déterminantes. On s’est aussi aperçu que des sports étaient d’autant plus
pratiqués par une classe sociale qu’ils étaient porteurs de valeurs de cette classe sociales et de
comportements qui ne sont pas si éloignés d’ailleurs des comportements attendus dans le
travail. On peut prendre comme exemple le golf et le foot, sports individuels, concentration et
calcul d’un côté, sports collectifs, force et réactivité de l'autre.
Dans l’entreprise et en ce qui concerne les comportements au travail, on retrouve les marques
des socialisations antérieures. Des comportements acquis lors de la scolarisation sont
entretenus dans les situations de travail. Le comportement en salle de classe se reproduit en
réunion : on n’ose pas poser de questions quand on n’a pas compris, on ose peu avancer ses
propres opinions.
La situation de travail elle-même façonne progressivement les comportements. La stabilité
d’une situation de travail conduit à la stabilisation des pratiques et comportements sous la
forme de routines, en général pertinentes dans la situation. Elles permettent en général à
l’individu une certaine performance, de faire davantage de chose en moins de temps, en moins
d'effort et donc de prendre en charge des activités supplémentaires. Progressivement, la
personne ne va plus questionner ou remettre en question ce qui lui semble efficace La mise en
place de ces routines, efficace dans une situation donnée, a évidemment une forte inertie :
elles pourront perdurer malgré une évolution du contexte.
L’intériorisation des comportements est renforcée quand la personne est soumise à une forte
pression externe, à des facteurs de stress. On constate une attitude défensive dans les métiers
directement confrontés au public ou à la clientèle, surtout quand celle-ci exprime une certaine
agressivité ou une certaine souffrance : c’est comme cela que l’on explique l’attitude très
"mécanique" et "distante" des agents au guichet de la sécurité sociale. Ils sont soumis à des
pressions fortes : la file d'attente, l’obligation d’un respect scrupuleux des règles sinon le
dossier ne passera pas quand il sera examiné… La tension est telle que l'agent finit par se
blinder. On peut faire un constat similaire pour les infirmières.
La socialisation dans un collectif de travail
Les premières analyses systématiques des comportements au travail sont celles de l’École des
Relations Humaines, sous la direction de Elton Mayo. Celles-ci font apparaître que les
comportements ne correspondent pas directement aux règles formelles ou à l’action de la
hiérarchie. Il y a d’autres facteurs à prendre en compte, en particulier l’existence de collectifs
de travail, qui semblent imposer à leurs membres des modèles comportementaux, des règles
aussi contraignantes que les règles formelles mais formalisées nulle part. Quand on entre dans
l’entreprise, pour se faire accepter par ses pairs, il faut respecter ces règles informelles. Les
règles informelles constituent une véritable organisation informelle, résultante de
l’accumulation des comportements et des interactions.
Ces règles informelles se développent et se reproduisent à la façon d’une culture commune,
par le jeu des interactions entre les membres du groupe, par son langage, par ses rituels, ses
échelles de valeurs et de prestige. Ces règles informelles comportent souvent des règles de
solidarité entre les membres de chaque groupe et permettent la défense des intérêts du groupe.
Elles deviennent rapidement des évidences que plus personne ne questionne. Chacun oublie
leur existence et leur raison d’être.
Dans l’entreprise, il n’y a pas d’homogénéité, chaque groupe développe ses règles
informelles, sa sous-culture, sa façon de gérer ses relations avec d’autres groupes de travail,

par exemple, les ouvriers professionnels par rapport aux ouvriers non qualifiés, par rapport
aux cadres. Chaque groupe tente de se différencier avec ses échelles de valeurs et de prestige
qui le valorisent. Chaque groupe développe un jugement sur les autres groupes à partir de ses
propres valeurs. Ces échelles de valeurs et de jugements sont une façon pour chaque groupe
de se situer dans l’échelle sociale.
L’Ecole des Relations Humaines a été fortement contestée pour son orientation normative très
marquée par un point de vue managérial. Le texte évoqué ici explique qu’il s’agit d’évaluer si
cette organisation informelle sert les objectifs de l’organisation formelle, d’étudier comment
elle pourrait mieux les servir, comment avoir une influence sur celle-ci. Cette école de pensée
a surtout été critiquée pour avoir proposé une opposition entre une logique de coût et
d’efficacité, qui appartiendrait au rationnel, à une logique des sentiments, irrationnelle, du
côté de l’informel, expliquée par leur approche culturelle. Cette qualification des motivations
est tout-à-fait asymétrique. Elle est marquée par le point de vue des cadres et dirigeants : le
rationnel est associé à l’action des dirigeants et l’irrationnel, les sentiments, à celle des
ouvriers. Or, on constate bien souvent que ce qui est irrationnel et inefficace pour les uns, est
souvent tout à fait rationnel et efficace pour les autres, les certitudes des uns, seront jugées
comme des croyances sans fondement par les autres, et c…
2. Identité et action collective
Les règles informelles produites au sein d’un groupe ont longtemps été renvoyées dans le
registre des sentiments, de l’affectif. Les travaux des sociologues montrent que ces règles
résultent d’un effort de coopération entre acteurs qui ont aussi de « bonnes raisons » de
coopérer. La règle informelle est le résultat d’un processus tacite de négociation. La règle
informelle a pour raison d’être la défense d’intérêt bien compris dans le cadre d’un rapport de
pouvoir entre le collectif et l’organisation qui l’entoure.
Les travaux de D. Roy sur le « freinage » donnent une lecture davantage politique du rôle de
la règle informelle. Dans un atelier d’usinage où les ouvriers sont payés au salaire aux pièces,
D. Roy observe l’existence d’une norme de performance inscrite nulle part, mais respectée de
tous les ouvriers : quand un ouvrier a atteint une certaine rémunération, il s’arrête de
travailler. S’il va au-delà, il sait qu’il fait courir le risque que le prix de la pièce soit modifié
pour une rémunération moindre. Son intérêt individuel est de travailler avec la plus grande
productivité possible. L’intérêt collectif est au contraire de respecter cette norme.
On trouve des situations proches de celle décrite par D. Roy dans les situations de
changement organisationnel, par exemple, quand on cherche à développer la polyvalence en
production. Les jeunes recrutés, mieux formés que les plus anciens ouvriers, sont incités par
l’entreprise à réaliser une grande diversité de tâches, y compris de tâches réservées auparavant
aux techniciens (qualité, maintenance). On leur promet des possibilités d’évolution s’ils
coopèrent. Mais la polyvalence n’est pas de l’intérêt des anciens qui risquent d’y perdre, du
fait d’un travail plus intensif et plus complexe. En général, le collectif souhaite que ces
nouvelles tâches soient reconnues et que les rémunérations soient adaptées en conséquence. Il
arrive alors que le collectif fasse pression sur le jeune recruté pour qu’il refuse cette
polyvalence, par exemple en l’excluant des espaces de convivialité, en refusant de l’aider pour
les tâches qu’il ne connaît pas…
Ces deux exemples montrent que ces règles informelles ne relèvent pas simplement du
mimétisme mais d’une action collective et visent à établir un rapport de force avec
l’entreprise, dans une négociation des statuts des membres du groupe, de la même façon
qu’une grève.
Dans la même logique, J.D. Reynaud propose les concepts de régulation de contrôle, de
régulation autonome et de régulation conjointe. La régulation de contrôle désigne la
production de règles par la hiérarchie, le pouvoir extérieur au collectif, par exemple ici, le
salaire à la pièce. La régulation autonome désigne la production de règles par le collectif
soumis à la régulation de contrôle, en réponse à celle-ci, par exemple le « freinage ». La
régulation conjointe résulte de la combinaison des deux régulations. Cette régulation
conjointe relève d’une négociation entre deux sources distinctes de règles.

On peut expliquer que l’adhésion aux règles du collectif peut être « très rationnelle ». Mais il
n’y a pas non plus toujours un calcul avant de participer à une action collective. Dans l’action
collective, on trouve une grande diversité de registre, de l’intérêt personnel à la loyauté
inconditionnelle. L’approche identitaire permet de mieux expliquer pourquoi, dans de
nombreuses situations, les individus participent à une action collective (par exemple grève),
respectent les règles du groupe, renoncent à leur intérêt individuel au profit de l’intérêt
collectif. C’est le problème bien connu du paradoxe d’Olson, qui reprend à son compte
l’idée de passager clandestin. En théorie, personne n’a d’intérêt à participer à une grève : le
non-gréviste ne risque pas de perte de salaire et pourra bénéficier des augmentations
distribuées à tous si la grève réussit. Bien sûr il y a parfois des pressions exercées par les
leaders du mouvement, des menaces et des piquets de grève, mais ce type d’explication ne
suffit pas. Il faut donc un fort sentiment d’appartenance au groupe, d’unité, de solidarité, et
une forte légitimité de la grève (à ses propres yeux) pour que l’individu renonce à son intérêt
individuel. Quand un groupe a un sentiment fort de communauté d’intérêt et de destin, quand
ses membres partagent le même statut, les mêmes compétences, les mêmes contraintes de
travail, la même idéologie, les mêmes valeurs, il a une forte capacité d’action collective, de
négociation de sa position. C’est le cas des verriers, des cheminots, des ouvriers du livre… On
parle alors d’identité collective.
3. La profession : une ressource essentielle de la construction identitaire
Nous avons montré qu’il y a un lien entre l’identité personnelle, le collectif de travail, les
règles définies par ce collectif, mais aussi comment ce collectif négocie sa place dans
l’organisation.
Les « professions » instituées se construisent avec les mêmes mécanismes, jusqu’à se donner
une forme institutionnalisée, en général par l’existence d’une association qui en regroupe les
membres, un titre qui les différencie…
Décortiquer les fondements d’une profession institutionnalisée, formellement reconnue,
comme les professions médicales ou paramédicale, permettra de mieux comprendre les
mécanismes de différenciation sociale. On verra, à travers un exemple, comment une
profession se différencie et s’institutionnalise. La profession instituée nous servira de
« modèle » pour rendre compte de la construction d’identité professionnelle collective, mais
non institutionnalisée.
Une profession est institutionnalisée par l’existence d’un ordre ou d’une association
professionnelle. Cette institutionnalisation peut prendre une forme juridique et s’exprimer à
travers la possession d’un titre, qui qualifie le professionnel au-delà du simple diplôme : la
possession du titre, l’appartenance à l’ordre ou l’association professionnelle est une condition
pour exercer une activité. L’ordre garantit que les membres ont la compétence nécessaire pour
exercer une activité donnée. Mais en même, il contrôle l’accès des membres : il peut exiger
l’obtention d’un diplôme, et une expérience validée. Par exemple, pour appartenir à l’ordre
des médecins, il faut avoir le diplôme, avoir pratiqué comme médecin interne… Un ordre gère
aussi le nombre de ses membres, c’est ce que l’on appelle le numerus clausus. Elle se donne
aussi la possibilité d’exclure les membres qui n’ont pas respecté certaines règles.
En contrepartie d’un certain « monopole » sur une activité, les membres d’une profession ont
aussi, en général, des obligations à respecter et même une responsabilité juridique
personnelle.
Dans de nombreux cas, ce modèle de la profession « instituée » prend une forme juridique.
Cette forme juridique peut être plus ou moins marquée. Par exemple, il existe un ordre des
architectes, mais des entreprises générales peuvent assurer une grande partie des tâches de
conception d’un architecte. On constate aussi qu’une même profession n’est pas instituée de
la même façon dans différents pays : aux Etat Unis, l’exercice du métier d’ingénieur suppose
l’appartenance à une association professionnelle, qui valide certes le diplôme mais aussi les
premières expériences comme assistant, alors qu’en France, s’il existe un diplôme celui-ci
n’est pas imposé systématiquement. Autre exemple : le titre de psychologue est nécessaire
pour un certain nombre d’activité (faire passer des tests) mais ce droit peut être délégué à un
autre membre de la structure.

On trouve des formes d’affirmation d’une profession, sans qu’il y ait de véritablement de titre
ou d’obligation d’appartenir à un ordre. Cette affirmation emprunte en général, de façon
beaucoup moins officielle, les mêmes stratégies de fermeture, de monopole…
Pour bénéficier de ce statut particulier, la profession a besoin de définir son utilité sociale,
montrer qu’elle assure une fonction sociale ou économique indispensable. Elle produit donc
une représentation de la société ou de l’entreprise de telle façon qu’elle apparaisse comme un
rouage essentiel. Ces discours sont produits par les associations professionnelles et repris dans
diverses situations. On retrouve aussi ce discours des professionnels lors des réorganisations.
Par exemple les valeurs associées au service public (l’égal accès au savoir par exemple) fait
partie des sources d’investissement des agents des entreprises publiques ou des
fonctionnaires. L’ouverture à la concurrence ou la privatisation de certaines entreprises
publiques a fait face à une certaine résistance liée à cette identité fortement stabilisée.
L’existence d’une profession, son institutionnalisation n’est pas une évidence en soi :
l’institutionnalisation d’une profession est le résultat d’une construction historique, d ’un
rapport de force avec d’autres professions, et avec l’Etat, qui peut reconsidérer l’utilité sociale
de cette profession, son degré d’ouverture ou de fermeture...
L’exemple des auxiliaires-puéricultrices illustre ce travail de construction, par un groupe
professionnel, de reconnaissance de son rôle et de ses savoir-faire. Pendant longtemps,
l’activité des auxiliaires-puéricultrices était assurée par des femmes de formation courte, dont
les savoirs n’étaient pas reconnus, mais qui, en maternité, pouvait avoir des responsabilité
importante du fait du manque d’infirmières. Elles se sont organisées en association et ont
tenté à plusieurs reprises d’obtenir une reconnaissance de savoirs de soin des nouveaux nés ou
des enfants. Cette reconnaissance a été bloquée par les infirmières, craignant de voir des
compétences de soin reconnues pour des non-infirmières. L’association professionnelle
connut une mobilisation très forte suite à la publication de textes officiels qui alignaient les
auxiliaires-puéricultrices sur les aides soignantes. Elles ont refusé ce qu’elles ont considéré
comme une assimilation à une profession dont elles souhaitaient se différencier : par exemple,
elles revendiquaient un « rôle » éducatif auprès des enfants, rôle que ne tiennent pas les
aides-soignantes. Plutôt que d’obtenir une reconnaissance de compétence de nature médicale,
voie qui leur était refusée, elles ont eu comme stratégie de faire reconnaître des compétences
de nature éducative et psychologique. Cela s’est traduit par la définition d’un cursus de
formation où la psychologie tient une place importante.
De nombreuses professions ne sont pas institutionnalisées. On peut trouver néanmoins les
mêmes efforts de leur membres pour les faire reconnaître. Dans l’entreprise, les cultures
professionnelles s’affrontent, chacune essaie de faire reconnaître sa légitimité.
Les groupes professionnels permettent aux individus de se situer. Un groupe professionnel
s’affirme par des compétences particulières, des savoir-faire, mais aussi une habileté, et même
des savoir-être (autrement dit des règles de comportements). Ces savoirs lui permettent de se
différencier des autres et de justifier la position sociale du groupe. En même temps ces savoirs
offrent aux membres du groupe des repères pour se positionner personnellement par rapport
aux autres. Chaque groupe professionnel contient sa propre échelle de valeur pour évaluer les
savoirs et les comportements de ses membres.
L’autonomie joue un rôle essentiel dans la possibilité de construire une identité
professionnelle. L’expression de ces capacités personnelles, reconnues par soi et par les autres
au travers des réalisations, dans l’entreprise, suppose un espace d’autonomie. Le cadre de
travail et donc l’espace d’autonomie est en général défini par son niveau professionnel.
Dans une organisation, l’organisation formelle et le contrôle hiérarchique tentent de définir
l’espace d’autonomie. Mais l’espace d’autonomie est parfois conquis de façon informelle
dans le cours même de l’activité de travail. Cet espace d’autonomie joue un rôle essentiel de
la construction identitaire : c’est dans cet espace que la personne exprime ses compétences,
ses spécificités, affirme son appartenance à un groupe professionnel ou non, affirme ses
compétences particulières au sein d’un groupe professionnel. Si l’autonomie vient à se
réduire, du fait d’une réorganisation, cela peut affaiblir le rapport de l’individu à son travail et
l’investissement personnel.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%