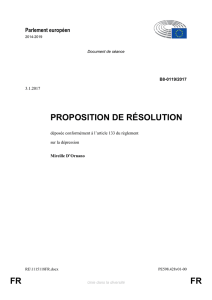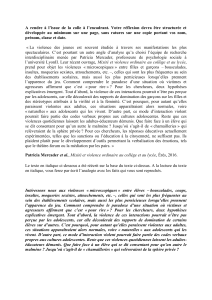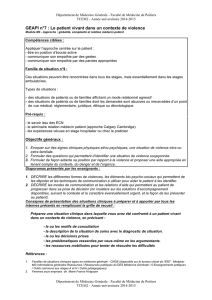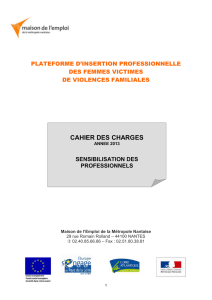Télécharger l'article au format PDF

S 558
L’Encéphale, 2006 ;
32 :
558-60, cahier 3
Dépressions de la femme : du rapport de l’OMS…
au contexte français
N. GUEDJ
(1)
(1) Paris.
Dans le monde, ce sont aujourd’hui 450 millions de per-
sonnes qui sont concernées par un trouble mental. Et il
est prévu que ce chiffre s’accroisse dans les années à
venir.
Or, la santé mentale a longtemps été la grande oubliée
des programmes de santé publique, aussi bien dans les
pays à faible et moyen revenu, que dans les pays les plus
riches.
Afin de changer cet état de fait, l’OMS a récemment ins-
crit la santé mentale au 1
er
rang de sa stratégie mondiale
d’amélioration de la santé et a même fait de l’année 2001
celle de la santé mentale dans le monde.
Parallèlement à cette approche globale, l’OMS a mis
en évidence les disparités qui existent entre les hommes
et les femmes en matière de santé mentale. C’est l’objet
d’un rapport publié en 2000, « Gender disparities in Mental
health » qui brosse un tableau relativement complet de la
spécificité de la condition féminine dans ce domaine.
Il cible tout particulièrement la dépression : si l’on en
croit l’indicateur mis en place par l’OMS et la Banque Mon-
diale, le « Global burden of disease », qui se fonde sur les
années de vie perdues en termes de mortalité et de
morbidité (DALY – Disability Adjusted Life Years), la
dépression devrait en effet passer au 2
e
rang des causes
de ces années de vie perdues d’ici 2020, alors qu’elle
n’était qu’en 4
e
position en 1990 !
Toutes pathologies confondues, si les troubles men-
taux concernent autant les hommes que les femmes, la
dépression se rencontre en effet deux fois plus chez ces
dernières : on comprend mieux l’importance particulière
qui est lui réservée dans ce rapport de l’OMS…
De manière générale, l’Organisation internationale
insiste sur le fait que la dépression, qui est une maladie
à part entière, reste encore largement ignorée ou passée
sous silence. On connaît peu ses mécanismes et on peine
à la diagnostiquer : selon une étude mondiale de 1995 (1),
dont l’OMS reprend les conclusions, moins de la moitié
des patients atteints de dépression sont susceptibles
d’être identifiés comme tels lors de la première consulta-
tion médicale généraliste !
Si l’on adopte une approche hommes/femmes, il ressort
qu’une étude en fonction du genre se justifie particulière-
ment dans le cadre de cette maladie.
La différence entre les sexes dans les taux de dépres-
sion survient à l’âge de la puberté et s’atténue après la
ménopause, ce qui souligne les interactions complexes
et réciproques qui surgissent entre les facteurs biologi-
ques, psychologiques et socioculturels.
Si l’on ne méconnaît pas le rôle des événements de la
vie génitale des femmes dans le déterminisme de certai-
nes dépressions, on ne devrait pas méconnaître les fac-
teurs tels que le stress, la violence, la pauvreté, l’inégalité,
le sexisme, qui augmentent la vulnérabilité des femmes
à la dépression.
Ainsi, l’impact sexué en matière de santé mentale est
aggravé par ses interrelations avec d’autres déterminants
sociaux et structurels. Il s’agit notamment de l’éducation,
des revenus et de l’emploi ainsi que du rôle et du rang dans
la société. Cela se concrétise par un certain nombre de
constats :
– Les femmes représentent plus de 70 % des pauvres
dans le monde (2) et supportent un fardeau 3 fois plus
lourd de travail productif, reproductif ou social ;
– Les épisodes pathologiques en matière de santé
mentale sont 2 à 2 fois et demies plus élevés parmi les
personnes les plus défavorisées, dont la majorité sont des
femmes ;
– Certaines politiques économiques, dès lors qu’elles
induisent des changements soudains et perturbateurs
(sur les revenus, l’emploi et les conditions de vie) ont une
incidence sur la santé mentale et sur les mécanismes de
la dépression. Or, il faut rappeler que les femmes sont déjà
défavorisées par rapport aux hommes dans le milieu du
travail : elles subissent donc encore plus les effets directs
ou indirects de ces politiques ;

L’Encéphale, 2006 ;
32 :
558-60, cahier 3 Dépressions de la femme : du rapport de l’OMS … au contexte français
S 559
– La violence contre les femmes atteint des niveaux
élevés, notamment en matière de violences conjugales.
Cette violence, physique, sexuelle et psychologique,
est corrélée aux taux élevés de dépression : ils sont 3
à 4 fois supérieurs parmi celles qui subissent des vio-
lences comparativement à celles qui n’y sont pas expo-
sées. Elle est souvent répétitive et s’accroît dans le
temps.
À la suite d’un viol, c’est quasiment 1 femme sur 3 qui
développe un stress post-traumatique, contre 1 sur 20, en
l’absence de viol.
Les spécialistes de l’OMS demandent aux Gouverne-
ments une meilleure prise en charge des spécificités fémi-
nines en matière de santé mentale. Que ce soit dans le
traitement curatif de la dépression, mais également dans
la réduction des niveaux d’exposition aux risques.
Cela passe par exemple par l’introduction dans les
réformes économiques d’une approche équitable hom-
mes/femmes ou encore par la réduction drastique des vio-
lences faites aux femmes, qui constituent de véritables
atteintes aux droits de l’homme.
Dans tous les cas, cela passe, selon l’OMS, par le déve-
loppement de politiques nationales liées à la santé men-
tale qui soient fondées sur une analyse explicite des dis-
parités sexuées en termes de risques et de résultats.
Notre pays, en termes de chiffres, s’inscrit pleinement
dans le constat d’alerte de l’OMS. Ainsi, la prévalence sur
la vie entière des troubles dépressifs est évaluée en
France, selon les chiffres avancés par le ministère de la
Santé (3) à environ 10 % de la population.
À ces chiffres déjà élevés s’ajoutent les 500 000 per-
sonnes qui souffrent d’un trouble bipolaire (3)
.
Les trou-
bles dépressifs entraînent une importante mortalité : ils
sont responsables d’une grande partie des 10 000 décès
annuels par suicide (chiffre probablement sous estimé) et
des 160 000 tentatives de suicide observées chaque
année (3).
Ils sont également à l’origine de handicaps et d’incapa-
cités lourds, entraînant une détérioration de la qualité de
vie du sujet atteint, mais aussi de ses proches. Enfin, pour
en finir avec ces quelques chiffres, seulement 25 à 50 %
des personnes souffrant de troubles auraient recours au
système de santé (3).
A. Le Plan de santé mentale 2005-2008
, présenté le
4 février dernier par le ministre de la Santé fait le double
constat suivant :
– la réponse publique n’est pas adaptée en France et
– l’offre de soins psychiatriques est inégale sur
l’ensemble du territoire et souffre de cloisonnement.
Il prévoit donc un renforcement des moyens matériels
et humains, mais aussi le développement de l’accompa-
gnement médico-social.
Il comprend également un programme spécifique qui
concerne l’amélioration de la prise en charge de la dépres-
sion et la lutte contre le suicide.
1. Dans le cadre de cette lutte contre la dépression, il
s’agit essentiellement de développer des actions de
prévention, de mieux repérer la dépression grave et
d’améliorer sa prise en charge. Il s’agit également de
développer
la recherche
sur les déterminants de la
dépression ainsi que sur les pratiques de soins, avec deux
actions principales :
– La réalisation d’une campagne média grand public,
par l’INPES (Institut de Prévention et d’Éducation à la
Santé), pour expliquer aux Français la différence qui
existe entre « la déprime » et la dépression et en souli-
gnant que les antidépresseurs ne sont pas forcément une
bonne réponse à la tristesse ;
– Une aide accrue aux professionnels de santé en leur
diffusant des guides au diagnostic des troubles dépressifs
et des recommandations quant aux conduites à tenir.
2. Concernant le suicide, les efforts entrepris
entre 2000 et 2005 sont poursuivis, notamment à desti-
nation des jeunes : il s’agit d’améliorer le dépistage de la
dépression dans les établissements scolaires. La santé
scolaire jouera donc un rôle clé dans ce dispositif. Le per-
sonnel infirmier en milieu scolaire en particulier, sera
formé à l’écoute des jeunes, pour lesquels il constitue déjà
un référent naturel – notamment pour l’accès à la pilule
du lendemain pour les filles.
B.
Sur la question primordiale des
violences faites
aux femmes
, la France emboîte le pas de l’OMS.
Le rapport « Violence et santé »
(rapport Dr TURSZ),
remis le 18 octobre dernier au ministre de la Santé, con-
firme, à l’échelon français, les constatations de l’organi-
sation internationale.
Les effets péjoratifs sur la santé des femmes victimes
concernent non seulement le court mais également le long
terme, même longtemps après que les violences ont
cessé. La violence subie de façon chronique est cause de
peur, d’angoisse, d’un sentiment de honte et de culpabi-
lité, qui tend à isoler la victime.
L’impact des violences physiques ou sexuelles sur la
santé psychique des femmes a été mesuré
(dans le cadre
de l’enquête ENVEFF : Enquête Nationale sur les Violen-
ces Envers les Femmes en France) :
– 17 % des femmes ayant subi un épisode violent et
25 % de celles qui ont subi plusieurs épisodes violents ont
un niveau de stress post-traumatique élevé. Ce taux est
de 5 % chez les femmes qui n’ont pas connu ce type d’évé-
nement.
– Le taux de suicide semble aussi très lié à la survenue
de violences. De 0,2 % chez les femmes qui n’ont pas
déclaré de violences, le taux passe à 3 % pour les femmes
ayant déclaré un épisode violent et à 5 % pour les femmes
qui en ont déclaré plusieurs.
– Le niveau de consommation médicale est également
différent. Les femmes victimes de violence consomment
plus souvent et régulièrement des médicaments
psychotropes : 30 % lorsqu’elles déclarent plusieurs épi-
sodes violents, 20 % lorsqu’elles en déclarent un et 10 %
lorsqu’elles n’en déclarent pas.
– Enfin, la probabilité d’avoir été hospitalisée est signi-
ficativement plus élevée lorsque les femmes ont subi des
agressions.

N. GUEDJ L’Encéphale, 2006 ;
32 :
558-60, cahier 3
S 560
La ligne téléphonique « Violence conjugale-femmes
info service » recueille des informations sur les consé-
quences des violences, rapportées en termes de santé
physique et psychologique.
– 70 % de ces femmes rapportent le plus souvent de
la dépression, une perte de l’estime de soi ou une
« destruction psychologique ».
Viennent ensuite :
– des tremblements, une tension permanente dans
61 % des cas,
– de la peur dans 65 % des cas.
La violence conjugale atteint également les enfants. Le
risque pour les enfants de mères violentées d’être eux-
mêmes maltraités est 6 à 15 fois plus élevé.
La dernière étude publiée fin novembre indique qu’en
France, une femme sur 10 serait victime de violences…
et qu’en moyenne, une femme meurt tous les 4 jours des
suites des violences au sein du couple !
Afin de lutter contre ces tendances récurrentes, notre
pays a lancé en novembre 2004 un plan d’action global
contre les violences faites aux femmes. Les femmes vic-
times de violences figurent désormais parmi les publics
prioritaires des centres d’hébergement et de réinsertion
sociale. Sous le slogan « Stop Violence - Agir, c’est le
dire », des formations initiales et continues ont renforcé
la sensibilisation du grand public et des professionnels, à
côté de la mobilisation des commissions départementales
d’action contre les violences faites aux femmes.
Aujourd’hui, ce dispositif s’étoffe :
– La palette des dispositifs d’hébergement des fem-
mes va être élargie grâce à l’expérimentation d’un accueil
à titre onéreux dans des familles ;
– La coordination des différents professionnels de
santé concernés par la prise en charge des femmes vic-
times de violence va être améliorée par la création de
réseaux d’accueil dans trois sites hospitaliers dès
janvier 2006 à titre expérimental : Créteil, Nantes et
Clermont-Ferrand ;
– Afin d’assurer une meilleure protection des victimes,
le renforcement des sanctions contre les auteurs est en
cours de discussion au parlement (actuellement en 2
e
lec-
ture au Sénat).
– Enfin, une brochure sera diffusée dans les semaines
qui viennent à l’ensemble des professionnels concernés.
Destinée à les appuyer dans leur accompagnement des
femmes victimes de violences, elle est constituée de
fiches qui pourront être régulièrement mises à jour sur
Internet.
Tout cela participe de la réduction de la violence à
l’égard des femmes : cela aura immanquablement un effet
sur la réduction des symptômes dépressifs et/ou post-
traumatiques.
Il s’agit là d’une action publique nécessaire : elle con-
firme qu’en matière de santé, toute approche ne peut être
strictement limitée à la sphère médicale. Elle doit être plu-
ridisciplinaire et s’atteler au traitement de la maladie, mais
également à la réduction de ses causes.
À défaut, les pouvoirs publics risquent de voir sans
cesse se remplir le tonneau des Danaïdes.
Références
1. USTIN, T.B., SARTORIUS, N.
Mental illness in General Health
Care : An international study
: John Wiley on behalf of the World
Health Organization, 1995.
2. Selon l’UNDP (United Nations development Program) sur les
1,3 milliards de personnes qui vivent dans la pauvreté, 70 % sont
des femmes (revenus et niveaux de consommation en dessous du
seuil de pauvreté défini nationalement).
3. Chiffres cités dans le Plan de santé mentale 2005-2008, ministère
de la Santé ; p. 63.
1
/
3
100%