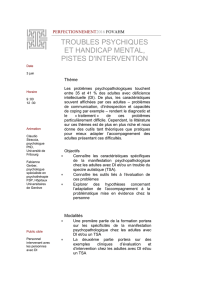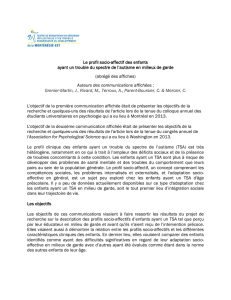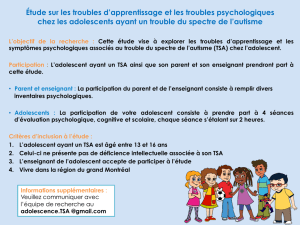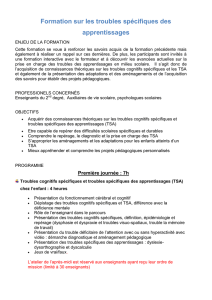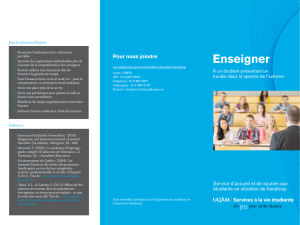L’Encéphale (2012) 38, S67-S69

*Correspondance.
Adresse e-mail : [email protected] (M. Sokolowsky)
© L’Encéphale, Paris, 2012. Tous droits réservés.
L’Encéphale (2012) 38, S67-S69
Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep
Endophénotypes et tro ubles du spectre autistique
Endophenotypes and autism spectrum disorders
M. Sokolowskya,*, E. Fakrab, J.-M. Azorinb
aService de Pédopsychiatrie, Hôpital Sainte-Marguerite, 13274 Marseille cedex 9, France
bSHU Psychiatrie Adultes – Pavill on Solaris, Hôpital Sainte Marguerite, 13274 Marseille cedex 9, France
Résumé Les facteurs génétiques des troubles autistiques restent inconnus après 30 ans
de recherches. Le concept d’endophénotype semble une voie d’approche de ces facteurs.
L’existence de « phénotypes élargis » chez les apparenté sains permet d’approcher ces
endophénotypes. Ces « Phénotypes élargis » incluent des signes cliniques, des anomalies
cérébrales morphologiques et fonctionnelles permettant d’approcher la physiopathologie
des TSA et la physiologie cérébrale. À terme la connaissance des endophénotypes des
TSA devrait permettre l’identifi cation des facteurs génétiques de risque de TSA. Cette
connaissance pose des questions éthiques quand aux notions de « porteurs sains » et d’un
éventuel diagnostic anténatal.
© 2012 L’Encéphale, Paris, 2012
Summary Genetic factors of ASD stay unknown after 30 years of research. The concept
of “endophenotype” seems an interesting approach toward these factors. “Enlarged
phenotypes” in families of ASD persons could lead to the defi nition of ASD endophenotypes.
“Enlarged phenotypes” include clinical symptoms, morphological and functional brain
anomalies enlightening ASD physiopathology and brain physiology. Knowledge of
endophenotypes will lead to ASD genetic risk factors. This knowledge will open ethical
questions about prenatal diagnosis.
© 2012 L’Encéphale, Paris, 2012
MOTS-CLÉS
Endophénotype ;
Autisme ;
Facteurs de risque
KEYWORDS
Endophenotype;
Autism;
Risk factors
Les troubles du spectre autistique sont les plus génétique-
ment déterminés des troubles mentaux et, toutes pathologies
confondues, parmi les troubles complexes les plus généti-
quement déterminés [1].
Dès 1977, l’étude de Folstein et Rutter [2] sur les jumeaux
monozygotes montrait que le phénotype associé à la prédis-
position génétique autistique inclut des altérations cognitives
et sociales s’étendant bien au delà du trouble tel que défi ni
alors. Dans le suivi du groupe des jumeaux ne validant pas
les critères diagnostiques de trouble autistique, la majorité
à l’âge adulte présentait des altérations cognitives et/ou
sociales qui pour les plus sévères validaient alors les critères
de TSA [3].
L’analyse de l’environnement familial des enfants
TSA retrouve des altérations qualitatives similaires des
interactions sociales, de la communication, des activités
chez les ascendants et collatéraux, bien que ne validant
pas quantitativement les critères de TSA [4]. Les individus
présentant un TSA représentent en fait une faible proportion
des individus apparentés présentant une expression atténuée
du phénotype. Ce « phénotype large » ou ce « variant élargi »
est retrouvé chez 20-30 % des apparentés [5,6]. Le spectre
des symptômes autistiques est donc bien plus large que le
spectre des troubles autistiques.
Le risque génétique de TSA ne se distribue pas de façon
mendélienne. Plusieurs gènes interagissent probablement

S68 M. Sokolowsky et al.
entre eux pour produire le phénotype selon un modèle
multi local avec épistasie. Au moins 3-4 gènes prédisposant
seraient impliqués [7], avec près de 15 loci [8]. Le polymor-
phisme et l’hétérogénéité clinique des TSA est un refl et du
polymorphisme génétique.
D’autres facteurs comme le sexe et l’environnement
infl uencent l’expression phénotypique. L’intervention de
mécanismes épigénétiques comme les défauts de méthyla-
tion de l’ADN sont probables [9,10].
Si les TSA sont hautement héritables, l’identifi cation des
gènes de susceptibilité reste vaine. En raison de la probable
hétérogénéité génétique, mais aussi de notre ignorance de la
physiopathologie des TSA, ce qui ne permet pas la recherche
de gènes candidats.
Les études de linkage sur la totalité du génome des TSA
et de leurs apparentés ont produit de maigres résultats, en
regard de la complexité et du coût de telles études. Ces
résultats constituent cependant une première étape vers
l’identifi cation des locus de susceptibilité. Une douzaine
d’études a été publiée ces dix dernières années dans le
cadre « Autism Project Consortium 2007 ». L’intérêt se centre
autour de quelques régions [11] :
• Chr 7q région AUTs 1 ;
• Chr 2q, Lamb 2005 ;
• 17q ;
• 11q12-13.
Reste à préciser le rôle de ces locus ; ce qui s’annonce
bien diffi cile. Les études de linkage ont surtout mis en lumière
l’absence de reproduction des résultats entre les différentes
études. Ce qui souligne l’extension de l’hétérogénéité du
déterminisme génétique des TSA.
Le phénotype TSA, comme tout phénotype, exprime la
coopération de son génotype avec l’environnement. Les
modèles de troubles complexes génétiquement déterminés
sont un ballet interactivement chorégraphié impliquant
génotype, environnement et facteurs épigénétiques d’où
émerge le phénotype particulier.
La psychiatrie rencontre peu de succès dans l’identifi ca-
tion de gènes ou de locus « coupables » du développement
de catégories de troubles mentaux tels que référencés dans
les classifi cations.
Les raisons en sont multiples. Ces catégories de trouble
sont souvent hétérogènes et recouvrent probablement des
dimensions de pathologies distinctes. Le déterminisme de
ces pathologies est multifactoriel et, lorsqu’un déterminisme
génétique est impliqué, il est au moins polygénique, du moins
au niveau des gènes candidats. Enfi n le cerveau est le plus
complexe de tous les organes. C’est même l’objet le plus
complexe de l’univers.
Comment rechercher les gènes candidats
au phénotype TSA ?
En recherchant des altérations comportementales ou des
anomalies cérébrales, morphologiques ou fonctionnelles,
avec une connexion génétique. C’est l’objectif du concept
d’endophénotype en psychiatrie, utilisé dans les schizoph-
rénies et les troubles bipolaires.
Pour qu’un marqueur soit considéré comme un endophé-
notype, il doit répondre à 5 critères :
• 1. Le marqueur est associé avec la pathologie dans la
population ;
• 2. Le marqueur est héritable ;
• 3. La présence du marqueur est constante que la pathologie
soit active ou inactive ;
• 4. Dans la famille le marqueur et la pathologie sont liés ;
• 5. Le marqueur retrouvé chez les membres affectés de la
famille doit être retrouvé chez les membres non affectés
à un taux plus élevé que dans la population générale.
Mais la tâche est complexe. Les TSA ne forment pas une
catégorie de troubles, mais une dimension de troubles dont
le spectre d’expression clinique va du plus dense au plus
ténu voire à l’indécelable. Les TSA présentent une grande
hétérogénéité clinique et, semble t-il, génétique. Nous
savons mesurer l’intensité des 3 syndromes constitutifs du
trouble : altération qualitative des interactions sociales,
altération qualitative de la communication et activités
restreintes et stéréotypées. Sur le plan para clinique
l’imagerie cérébrale a permis d’établir un catalogue
d’anomalies cérébrales morphologiques et fonctionnelles
dont aucune n’est spécifi que, mais retrouvées chez les
apparentés indemnes de TSA. Si la corrélation statistique de
ces anomalies cérébrales avec le phénotype TSA est établie,
nous ne savons pas faire le lien physiopathologique entre ces
anomalies cérébrales et les syndromes comportementaux
du phénotype TSA.
Symptômes cliniques
La recherche s’est orientée vers le niveau symptomatique
avec l’évitement du regard. Nacewicz et Dalton [12], ont
retenu ce symptôme majeur de TSA et l’ont recherché dans
la fratrie indemne d’enfants TSA. Pour retrouver le même
taux d’évitement du regard dans la fratrie indemne que
chez les enfants TSA. La comparaison des IRM cérébrales
des deux groupes retrouve une identique hypotrophie de
l’amygdale cérébrale. L’amygdale cérébrale est impliquée
dans la poursuite oculaire et la reconnaissance faciale. Or il
semble que les enfants victimes de TSA soient en diffi culté
pour reconnaitre les émotions traduites par les expressions
faciales. Leurs frères indemnes de TSA sont eux capables de
reconnaissance des émotions sur les visages.
Hypothèse, les frères indemnes pourraient avoir déve-
loppé des systèmes palliatifs aux fonctions défaillantes de
l’amygdale hypotrophiée.
Hypothèse qui ouvre une cascade d’hypothèses
conséquentes.
Sur le plan pathogénique, si l’altération phénotypale
au niveau de l’amygdale est la même, des facteurs envi-
ronnementaux sont-ils impliqués dans le développement
ou le non développement de circuits de suppléance ? Si des
circuits de suppléance se sont développés sous l’action de
l’environnement chez les frères indemnes, ne pourrait-on
pas modifi er l’environnement des TSA pour permettre le
développement de ces suppléances ? La modifi cation de
l’environnement des enfants victimes de TSA est à la base
de toutes les stratégies de soin actuellement validées.
Mais ces modifi cations sont, pour l’heure, totalement
empiriques.
Nacewicz et Dalton utilisent ensuite l’IRM fonctionnelle
pour examiner l’activité cérébrale entrante et sortante de
l’amygdale lorsque les TSA regardent des images de visages
exprimant différentes émotions. Pour constater un défi cit des
connections de l’amygdale avec le cortex préfrontal et une
hypertrophie des connections de l’amygdale avec des struc-
tures cérébrales archaïques, impliquées dans le traitement

Endophénotypes et troubles du spectre autistique S69
des émotions comme les hippocampes. Ces anomalies de
connexion de l’amygdale sont corrélées avec les anomalies
du traitement des émotions portées par le visage suggérant
que l’altération de ces connexions contribue directement à
l’incapacitation sociale des TSA. Reste à identifi er les locus
responsables.
Imagerie cérébrale fonctionnelle
Les cerveaux des parents de TSA présentent des anomalies
dans les régions impliquées dans les processus de cognition
sociale similaires à celles retrouvées chez les TSA [13]. Les
cerveaux des parents présentent également des anomalies
quantitatives de matière grise dans les gyrus pré et post
centraux. Ces gyrus sont impliqués dans la planifi cation,
l’exécution et la régulation du mouvement de même que
dans la compréhension des structures faciales complexes.
Par ailleurs Peterson retrouve une hypotrophie de la subs-
tance blanche dans les fi bres issues des zones du cervelet
impliquées dans la reconnaissance faciale. Défi cit encore
de la substance blanche dans le cortex frontal impliqué
dans la reconnaissance des états mentaux d’autrui et dans
l’élaboration de réponses adéquates.
Pour Peterson l’étape suivante est la recherche chez
les parents de TSA des signes cliniques du TSA bien que
n’en validant pas les critères quantitatifs afi n d’établir des
critères de sélection pour des études génétiques visant à
identifi er les gènes candidats dans la cognition sociale.
Endophénotypes ou phénotypes élargis ?
Dans le domaine des TSA, nous sommes encore loin de
l’identifi cation d’endophénotypes permettant de rechercher
les loci candidats. Nos connaissances actuelles ne portent
que sur des phénotypes intermédiaires qui diffèrent des
endophénotypes par l’absence de connexion directe avec le
génotype. Ils n’en ont pas moins un rôle clé dans le processus
biologique conduisant au phénotype TSA. Ces phénotypes
intermédiaires nous permettent d’avancer dans la découverte
de la physiopathologie des TSA et dans la compréhension du
fonctionnement du cerveau.
Sur le plan clinique la détermination d’endophénotypes
permettrait, théoriquement, un repérage précoce du trouble
dans les familles à risque ainsi qu’un traitement précoce des
altérations des interactions sociales.
Endophénotypes des TSA,
mais pour quoi faire ?
La recherche des facteurs génétiques impliqués dans les TSA
soulève néanmoins des questions d’éthique. En s’étendant
aux membres non symptomatiques de la famille elle fait
apparaitre chez certains individus la notion d’un « phénotype
élargi de TSA », les confrontant à un risque individuel de
pathologie ultérieure et à un risque pour leur descendance.
La révélation d’un « phénotype élargi de TSA » chez les
parents d’un enfant symptomatique risque de réactiver chez
eux un sentiment de culpabilité, non seulement naturel, mais
aussi de reviviscence post-traumatique après les aberrations
de ces 60 dernières années sur la causalité environnementale
exclusive des Troubles autistiques. Certains irréductibles
voyant dans la notion d’endophénotypes du TSA, la confi r-
mation de leur croyance environnementale. Sans parler de
la réactivation possible de la mythologie bien française de
« l’hérédo dégénérescence » encore latente dans notre
culture.
Enfi n devant le drame individuel et familial des TSA,
devant le coût astronomique de leur diagnostic et de la prise
en charge, force est de se poser la question de l’usage qui
pourrait être fait de la découverte d’un pool de loci impliqués
dans le déterminisme des TSA. Une telle découverte ouvrirait
inéluctablement la question d’un diagnostic prénatal. Avec
quelles conséquences ? Nous savons que le déterminisme du
phénotype TSA est loin d’être une causalité linéaire comme
dans la trisomie 21. La faillite croissante de notre système
de santé laissera-t-elle encore un espace à la réfl exion ?
Déclaration d’intérêts
Les auteurs déclarent n’avoir aucun confl it d’intérêt en lien
avec cet article.
Références
[1] Rutter M. Genetic studies of autism: from 1970s into the
millennium. J Abnorm Child Psychol 2000;28:3-14.
[2] Folstein S, Rutter M. Infantile autism: a genetic study of 21
twin pairs. J Child Psychol Psychiatry 1997;18:297-321.
[3] Bailey A, Le Couteur A, Gottesman I, et al. Autism as a strongly
genetic disorder: evidence from a British twin study. Psychol
Med 1995;25:63-77.
[4] Bolton P, Macdonald H, Pickles A, et al. A case control
family history study of autism. J Child Psychol Psychiatry
1994;35:877-900.
[5] de Jonge MV. The search for endophenotypic markers of autism
spectrum disorders. 2006, 192 p.
[6] Fombonne E, Bolton P, Prior J, Jordan H, Rutter, M. A family
study of autism: Cognitive patterns and levels in parents and
siblings. J Child Psychol Psychiatry 1997;38:667-83
[7] Pickles A, Bolton P, Macdonald H, et al. Latent class analysis
of recurrence risks for complex phenotypes with selection and
measurement error: a twin and family study of autism. Am J
Hum Genet 1995;54:717-26.
[8] Risch N. Linkage strategies for genetically complex traits. Am
J Hum Genet 1999;46:222-53.
[9] Abdomalsky HM, Smith CL, Faraone SW, et al. Methylomics in
psychiatry: Modulation of gene-environment interactions may
be through DNA methylation. Am J Med Genet B Neuropsychiatr
Genet 2004;127:51-9.
[10] Lamb JA, Barnby G, Bonora E, et al. Analysis of IMGSAC autism-
suceptibility loci: Evidence for sex limited and parent of origin
specifi c effects. J Med Genet 2005;42:132-7.
[11] Bachelli E, Maestrini E. Autism spectrum disorders: Molecular
genetics advances. American Am J Med Genet C Semin Med
Genet 2006;142:13-23.
[12] Dalton KM, Nersesian MM, McDuffi e A, et al. Presented at the
International Meeting for Autism Research – Montreal Canada
– June 1-2, 2006.
[13] Peterson E, Schmidt GL, Tregellasa JR, et al. A voxel-based
morphometry study of gray matter in parents of children with
autism. NeuroReport 2006;17;1289-92.
1
/
3
100%