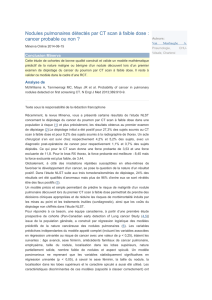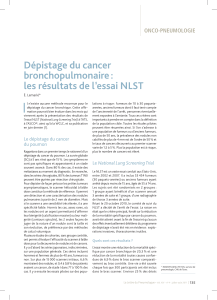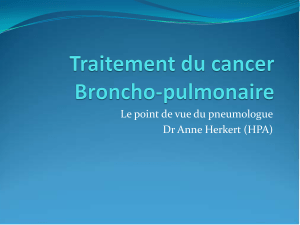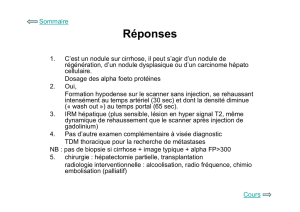L Le dépistage du cancer bronchopulmonaire : passé et futur

La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 4 - juillet-août 2013 | 153
ONCO-PNEUMOLOGIE
Le dépistage du cancer
bronchopulmonaire :
passé et futur
Lung cancer screening: past and perspectives
S. Couraud*, B. Milleron**
* Service de pneumologie, Hospices
civils de Lyon, centre hospitalier
Lyon Sud, Pierre-Bénite, et faculté
de médecine et de maïeutique Lyon-
Sud - Charles-Mérieux, université
Lyon-I, Oullins.
** Service de pneumologie, hôpital
Tenon, AP-HP, Paris.
L
e cancer bronchopulmonaire est une maladie à
la fois fréquente et grave. Son principal facteur
de risque – le tabac – est bien connu, ce qui
facilite la mise en évidence de sujets à haut risque.
Par ailleurs, le pronostic de la maladie est étroite-
ment lié à son stade lors du diagnostic. Le traitement
des stades avancés est malheureusement essen-
tiellement palliatif tandis que les stades I opérés
de petit volume ont une survie à 5 ans supérieure
à 80 % (1, 2). Pour toutes ces raisons, le cancer
bronchopulmonaire est un candidat idéal au dépis-
tage (c’est-à-dire sa détection précoce, avant qu’il
ne devienne symptomatique) selon les critères de
l’Organisation mondiale de la santé.
Depuis une quarantaine d’années, une recherche
clinique très active a exploré plusieurs modalités
pour ce dépistage : l’examen cytologique des expec-
torations, la recherche de biomarqueurs sériques ou
dans les expectorations, la radiographie pulmonaire
et, plus récemment, le scanner thoracique. Cette
mise au point est toutefois limitée aux techniques
radiologiques.
Le dépistage du cancer
bronchopulmonaire
par radiographie pulmonaire
Les études concernant la radiographie pulmonaire
ont été d’abord des études de cohortes (simples et
cas-témoins), puis des études randomisées.
Les études de cohorte ont démontré que la radio-
graphie permettait de dépister des cancers de stades
plus précoces comparativement aux données histo-
riques ou aux témoins. Toutefois, l’efficacité d’un
dépistage doit être jugée sur la diminution significa-
tive de la mortalité spécifique par cancer broncho-
pulmonaire dans la population étudiée, comparée à
une population non soumise au dépistage.
Pour faire cette démonstration, des études randomi-
sées étaient donc nécessaires. Deux études ont alors
été menées dans cette optique : le Mayo Lung Project
d’une part (3, 4), une étude tchéco slovaque (5)
d’autre part. Toutes deux comportaient un bras
comparatif “soins usuels” comprenant des sujets
non soumis au dépistage. Les résultats montraient
que, comme dans les études de cohortes, les cancers
dépistés étaient plus fréquemment opérables et donc
de meilleur pronostic que les cancers diagnostiqués
dans la population témoin. Néanmoins, ces 2 études
n’ont montré aucune diminution significative de la
mortalité dans le bras dépisté. La principale raison
était que l’incidence des cancers y était supérieure.
Les cancers étaient moins graves, mais, comme ils
étaient plus nombreux, la survie spécifique ne variait
pas. En conséquence, les résultats de ces 2 études ont
été considérés comme entachés d’un biais d’avance
au diagnostic (“length-time bias” : il y a un excès de
cancers peu évolutifs chez les patients dépistés),
d’une part, et, dans une moindre mesure, d’un biais
de surdiagnostic (des cancers ont été diagnostiqués
grâce au dépistage alors qu’ils n’auraient pas entraîné
de décès), d’autre part. L’autre écueil de ces 2 études
– largement commentées dans la littérature – était
leur manque de puissance statistique (elles portaient
toutes 2 sur moins de 10 000 sujets).
La question a été tranchée récemment par la publica-
tion d’une autre étude : l’étude PLCO (6). Cette étude
randomisée – portant sur plus de 150 000 partici-
pants – avait pour objectif de tester l’impact d’une

154 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 4 - juillet-août 2013
Résumé
radiographie thoracique annuelle comparativement
aux soins usuels (absence de radiographie). Les résul-
tats montraient qu’il n’y avait pas de différence signi-
ficative de mortalité entre ces 2 groupes, y compris
dans le sous-groupe des patients à haut risque, du
fait de leur comportement tabagique. L’inutilité de
la radiographie pulmonaire pour le dépistage paraît
donc définitivement démontrée.
Le dépistage par scanner
thoracique faiblement dosé
Les premières études utilisant le scanner non injecté
et moins irradiant qu’un scanner habituel ont montré
que cet examen était beaucoup plus sensible que la
radiographie pulmonaire pour détecter des cancers.
Par exemple, la première publication de l’étude de
cohorte ELCAP (7) rapporte que plus de 350 nodules
non calcifiés ont été découverts par le scanner alors
que moins de 100 étaient observés sur le cliché stan-
dard chez 1 000 volontaires ayant fumé au moins
10 paquets-année (PA). L’histoire s’est alors répétée,
et le scanner a suivi les mêmes étapes que le dépis-
tage radiologique standard, en 2 phases.
Dans une première phase, des études ouvertes
ont été menées. Toutes montraient que le scanner
découvrait au moins 1 nodule thoracique chez 1 à
2 personnes sur 4. La plupart de ces nodules n’étaient
pas des cancers et étaient donc des faux positifs
du dépistage. Ainsi, si le scanner était capable de
déceler beaucoup de stades précoces, il avait une
très mauvaise spécificité. Cela laissait penser que le
dépistage allait induire un taux de complications et
un coût élevés en relation avec l’exploration de ces
nombreuses lésions aspécifiques. En revanche, la
découverte de cancers de stade précoce, en nombre
bien plus élevé que ne le permettait la radiographie
pulmonaire, représentait une importante raison
d’espérer en l’efficacité du scanner.
La deuxième phase qui a logiquement succédé à
celle de ces études ouvertes est celle des études
randomisées (tableau I). Les résultats de certains
de ces essais sont connus. Le plus important d’entre
eux est l’essai randomisé américain National Lung
Screening Trial (NLST) [11], qui porte sur plus de
Le cancer bronchopulmonaire est une maladie répondant aux critères de l’Organisation mondiale de la
santé pour l’éligibilité à un dépistage.
Si la radiographie pulmonaire a démontré son inutilité dans cette indication, ce n’est pas le cas du scanner
basse dose. L’étude américaine NLST a en effet montré une réduction de 20 % de la mortalité par cancer du
poumon chez des patients à haut risque soumis chaque année (pendant 3ans) à un scanner de dépistage.
Bien que ces résultats soulèvent aussi beaucoup de questions, de nombreuses sociétés savantes recom-
mandent désormais d’envisager le scanner de dépistage. En France, l’Intergroupe francophone de cancérologie
thoracique, le Groupe d’oncologie de langue française et la Société d’imagerie thoracique ont publié une
position commune détaillée sur ce sujet.
Mot-clés
Cancer
bronchopulmonaire
Scanner basse dose
Dépistage
Fumeurs
Summary
Lung cancer patients may
benefit from screening,
according to the World Health
Organization criteria.
Although chest-radiography
was demonstrated as ineffec-
tive in this indication, recent
results from the National Lung
Screening Trial (NLST) showed
that annual low-dose CT scan
decreased lung cancer-related
mortality by 20% in high-risk
individuals.
Indeed, these results raised
many questions. However,
following the NLST trials, many
academic groups published
guidelines in which they
consider lung cancer screening.
In France, the French Intergroup
IFCT, the Oncology branch of
the French-Speaking Pulmo-
nology Society and the Thoracic
Branch of the French Radiology
Society published a common
statement.
Keywords
Lung cancer
Screening
Low-dose CT scan
Smoking
Tableau I. Principales études randomisées sur le dépistage par scanner faible dose.
Étude Bras contrôle N scanner N témoin État Puissance4Réf. Résultat principal
DLCST1Observation 2 052 2 052 Terminée NON
(8)
Négatif pour les données
de survie à 5ans (10ans
prévus)
DANTE1Observation 1 276 1 196 Terminée OUI
(9)
Négatif pour la mortalité
à 3ans
MILD1Observation 2 37631 723 Terminée NON
(10)
Négatif pour la mortalité
à5 ans (10ans prévus)
NLST Radiographie 26 722 26 732 Terminée OUI
(11)
Positif sur la mortalité
globale et spécifique
ITALUNG1Observation 1 613 1 593 Terminée -
(12)
Résultats à 4ans (7ans
prévus) publiés unique-
ment pour le bras scanner
NELSON1Observation 7 907 7 915 Terminée NON
(13)
Résultats des scanners
des3 premiers tests
publiés (sans comparaison)
UKLS2Observation 2 000 2 000 En cours OUI
(14)
-
LUSI1Observation 2 029 2 023 Terminée NON
(15)
Données du premier test
(bras scanner uniquement)
publiées
DEPISCAN Observation 385 380 Terminée NON
(16)
Négatif
1. Études appartenant au consortium européen prévoyant une publication groupée des résultats. 2. Concerne l’étude pilote; l’étude
complète prévoit d’inclure 28 000 participants. 3. La moitié des patients du groupe scanner ont eu 2 examens par an, l’autre moitié,
un seul. 4. Puissance suffisante pour mettre en évidence une différence de mortalité.

La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 4 - juillet-août 2013 | 155
ONCO-PNEUMOLOGIE
53 000 patients. D’autres essais européens sont
en cours – ou en cours de publication – mais leurs
effectifs sont plus limités, et ils n’auront donc pas
la puissance nécessaire, pris individuellement, pour
observer des différences en termes de mortalité.
Toutefois, la plupart de ces études se sont regroupées
au sein d’un consortium européen, dont l’effectif
total devrait atteindre plus de 20 000 participants
environ, et qui a d’ores et déjà prévu une analyse
groupée de leurs résultats.
La preuve de l’effet significatif du scanner faiblement
dosé sur la mortalité spécifique par cancer broncho-
pulmonaire a été apportée par le NLST. Cet essai
prospectif randomisé qui comparait scanner faible-
ment dosé et radiographie pulmonaire annuels avait
comme objectif principal de démontrer une diminu-
tion de 20 % de la mortalité spécifique par cancer
bronchopulmonaire. Plus de 53 000 participants
âgés de 55 à 74 ans ont été inclus. Ils étaient fumeurs
ou anciens fumeurs (ils devaient dans ce cas avoir
arrêté leur consommation de tabac depuis moins de
15 ans). Dans tous les cas, ils devaient avoir fumé
au moins 30 PA. Un scanner a été réalisé chaque
année pendant 3 ans. Le dépistage était considéré
comme “positif” lorsqu’il mettait en évidence des
nodules non calcifiés de plus de 4 mm et/ ou des
masses. Les résultats de cette étude ont montré,
comme dans les études précédemment publiées, que
le scanner décelait beaucoup d’anomalies (25 % des
scanners étaient “positifs”, c’est-à-dire présentaient
un nodule de taille ≥ 4 mm), mais la plupart de
celles-ci n’étaient pas des cancers. Ainsi, 96,4 % et
94,5 % des résultats positifs étaient en réalité des
faux positifs dans les bras scanner et radiographie
pulmonaire respectivement. Toutefois, les parti-
cipants présentant des anomalies étaient, dans la
plupart des cas, simplement investigués par des
scanners additionnels, et peu d’examens invasifs
ont finalement été réalisés avec, y compris pour
les cas opérés, peu de complications. Très récem-
ment, les résultats détaillés du premier round de
NLST ont été publiés (17). On peut y lire que seuls
0,8 % (57/6 779) des faux positifs ont eu un abord
par ponction sous scanner, et 1,3 % ont subi un geste
chirurgical par médiastinoscopie, thoracoscopie ou
thoracotomie (90/6 779).
Cet essai s’est avéré positif, puisque la mortalité par
cancer bronchopulmonaire était réduite de 20 %
(p = 0,004) dans le bras scanner comparativement
au bras radiographie. De plus, la mortalité globale
(toutes causes) était également significativement
réduite de 6,7 % (p = 0,02). Cette étude prospective
multicentrique de bonne puissance démontre donc
pour la première fois, et avec un niveau de preuve
élevé, que l’utilisation du scanner thoracique pour
le dépistage du cancer bronchopulmonaire diminue
de façon très importante la mortalité spécifique de
la maladie, et même la mortalité globale, ce qui
est particulièrement remarquable pour un test de
dépistage. Compte tenu des effectifs des essais en
cours, il est prévisible qu’aucune étude ne pourra
dans les prochaines années, avec la même puissance
statistique, confirmer ou infirmer ces résultats.
À la suite de la parution des résultats de l’essai NLST,
plusieurs sociétés savantes américaines s’en sont
rapidement fait l’écho en publiant des recommanda-
tions de pratique. Ainsi, l’American College of Chest
Physicians (ACCP) et l’American Society of Clinical
Oncology (ASCO) ont publié une revue conjointe
dans laquelle elles reconnaissent l’efficacité d’un tel
dépistage et proposent de l’appliquer de manière
individuelle aux individus éligibles selon les mêmes
critères que ceux de l’étude NLST (18). Le National
Cancer Center Network (NCCN), associé à l’Ame-
rican Association for Thoracic Surgery (AATS), suit
le mouvement et propose même – de manière un
peu étonnante – d’étendre les critères d’éligibilité
aux sujets âgés de 50 à 55 ans et/ou avec un taba-
gisme à 20 PA sous réserve d’être exposés à au moins
un facteur de risque additionnel parmi lesquels le
radon environnemental, le tabagisme passif, les
cancérogènes professionnels, un antécédent fami-
lial de cancer bronchopulmonaire, un antécédent
personnel de bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO), de fibrose inter stitielle diffuse
ou de cancer (19). Bien que la discussion sur la néces-
sité de dépister des patients présentant un risque
intermédiaire de cancer bronchopulmonaire reste
ouverte, il n’existe à ce jour aucune preuve tangible
pour étendre les critères d’éligibilité au-delà de ceux
du NLST (d’autant plus qu’il n’existe pas de moyen
validé d’évaluer de manière reproductible et fiable
les autres facteurs de risque, comme l’exposition
professionnelle ou le radon domestique) [20]. Pour
terminer, plus récemment, l’American Cancer Society
a publié ses recommandations en faveur du dépistage
et selon les critères du NLST (21).
Les propositions françaises
sur le dépistage
En France, des experts se sont réunis à l’initiative de
l’Intergroupe francophone de cancérologie thora-
cique (IFCT), du Groupe d’oncologie de langue fran-
çaise (GOLF) et de la Société d’imagerie thoracique

156 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 4 - juillet-août 2013
ONCO-PNEUMOLOGIE Le dépistage du cancer bronchopulmonaire : passé et futur
(SIT). Ce groupe multidisciplinaire réunissait des
pneumologues, des oncologues, des radiologues,
des chirurgiens thoraciques, des méthodologistes
et des médecins généralistes. Après analyse de la
littérature, les experts ont élaboré des propositions
pratiques (22).
En premier lieu, le groupe a jugé que les preuves
étaient suffisantes pour proposer un dépistage à
l’échelon individuel, sur la proposition du médecin
ou à la demande du sujet, sous réserve de respecter
certaines conditions.
Population éligible
Les sujets éligibles au test sont ceux qui répondent
aux mêmes critères que ceux de l’étude NLST :
➤être âgé de 55 à 74 ans au moment du premier
scanner ;
➤présenter un tabagisme à plus de 30 PA ;
➤être fumeur actif ou être sevré depuis moins de
15 ans ;
➤
ne pas présenter de comorbidité compromettant
une chirurgie thoracique ni de signes évocateurs d’un
cancer bronchopulmonaire ;
➤
s’inscrire volontairement dans la démarche, après
information sur les risques et les bénéfices ;
➤
accepter, si le patient est fumeur actif, de consi-
dérer une démarche d’aide au sevrage tabagique, que
le prescripteur se doit de proposer systématique-
ment. En effet, tout programme de dépistage ne peut
être efficace que s’il est associé à une lutte contre le
tabagisme, tant sur le plan individuel que collectif.
Bien entendu, cette personne doit être parfaitement
asymptomatique (état général et respiratoire). Un
sujet rapportant une plainte fonctionnelle et/ou
ayant un examen clinique anormal doit bénéficier
des investigations diagnostiques dédiées.
Une information détaillée doit être délivrée. Le
groupe d’experts français a d’ailleurs récemment
publié des fiches de synthèse et d’information
destinées aux prescripteurs et aux patients (23).
Ces informations doivent notamment comprendre :
➤
le risque de découverte d’une anomalie, quelle
qu’en soit la nature (7,8 à 20,8 % de scanners posi-
tifs ou indéterminés ; 1,8 à 2,6 % de tests positifs
au final) ;
➤la probabilité de devoir subir des investigations
complémentaires, parfois invasives (85 à 88 % des
cas), voire des interventions chirurgicales, abou-
tissant à un diagnostic de malignité dans 35 % des
cas ou, le plus souvent, à un diagnostic de lésion
bénigne ;
➤le risque de voir diagnostiquer des tumeurs qui
n’auraient probablement jamais eu de traduction
clinique (risque de surdiagnostic), voire d’impact sur
la survie (formes indolentes), même si ces formes
sont probablement peu fréquentes ;
➤
le risque lié à l’irradiation induite par la répétition
des scanners, même s’il s’agit de faibles doses (équi-
valant à 6 mois d’irradiation naturelle en France). Le
risque de développer des cancers radio-induits ne
doit pas être minimisé. Une modélisation prenant
en compte ce risque montre que le dépistage reste
malgré tout bénéfique en termes de réduction de la
mortalité (24). Néanmoins, une publication récente
montre que des scanners passés dans l’enfance
augmentent le risque de cancer à l’âge adulte, ce qui
incite à la prudence (25) ;
➤l’intérêt porté au sevrage tabagique, quels que
soient l’âge et le niveau d’exposition, et au fait que
le dépistage n’a de sens que s’il s’accompagne d’un
arrêt de l’intoxication tabagique ;
➤
l’intérêt du dépistage pour le diagnostic et/ou
le dépistage d’autres pathologies, liées ou non au
tabac, même si leur impact et leur fréquence ne
sont pas chiffrés à ce jour.
Modalités du test et durée
Il n’y a pas de définition consensuelle pour un scanner
basse dose. Dans ces conditions, les experts ont retenu
une limite en termes de produit dose × longueur
(PDL), avec une limite supérieure admissible de
150 mGy.cm pour un adulte de poids moyen (70 kg),
à adapter à la corpulence du sujet (26). Dans tous
les cas, il s’agit d’un scanner réalisé sans injection de
produit de contraste iodé.
Peu de données sont disponibles dans la littérature
pour conclure quant à la durée optimale de suivi à
proposer aux patients. Il apparaît néanmoins que
le minimum à recommander est la réalisation de
3 scanners à 1 an d’intervalle, conformément au
protocole de l’étude NLST. Cependant, par analogie
avec les programmes de dépistage des cancers
d’autres organes, et considérant qu’un programme
(collectif) de dépistage ne se conçoit que s’il est
continu dans la recherche des cas, il semble approprié
de poursuivre la réalisation des scanners faible dose
à un rythme a priori annuel, sans qu’il soit là encore
possible de déterminer la rythmicité optimale. Cela
semble d’autant plus pertinent que, dans l’étude du
NLST, des cancers étaient découverts lors de chaque
dépistage annuel : 3,8 % au scanner initial, puis 2,4 %
et 5,2 % aux scanners à 1 an et 2 ans, respectivement.

Figure. Anomalies typiquement retrou-
vées sur des scanners de dépistage :
nodule solide (A) ; nodule en verre
dépoli pur (B) ; nodule mixte (C) ; nodule
calcifié (D) et ganglion intrapulmonaire
juxta-scissural (E). (Collection person-
nelle S. Couraud)
A
D
B
E
C
La Lettre du Pneumologue • Vol. XVI - n° 4 - juillet-août 2013 | 157
ONCO-PNEUMOLOGIE
L’essai MILD, dont l’un des objectifs était d’évaluer la
fréquence idéale (entre un examen annuel et un tous
les 2 ans), a retrouvé une incidence plus élevée dans
le bras annuel, sans effet sur la mortalité ou sur la
distribution des stades. Ces résultats n’incitent donc
pas à augmenter la fréquence (10). De même, l’étude
de cohorte COSMOS – qui a poursuivi les scanners
annuels pour une période de 10 ans – montre que de
nouveaux cancers sont bien diagnostiqués chaque
année (0,8 % de la population en moyenne). Le béné-
fice lié à la poursuite du dépistage chez les patients de
plus de 75 ans (ayant effectué au moins les 3 scanners
initiaux) et chez les sujets ayant dépassé les 15 ans
d’abstinence tabagique n’est pas établi, et cette atti-
tude n’est donc pas indiquée. Enfin, la survenue d’une
pathologie évolutive mettant en jeu le pronostic vital
chez un patient devra faire reconsidérer l’opportunité
de poursuivre le dépistage, le patient entrant alors
dans une phase de diagnostic et de suivi (tableau II).
Modalités d’interprétation du scanner
On peut schématiquement retrouver 5 types de
lésions nodulaires sur un scanner de dépistage :
les nodules solides, les nodules en verre dépoli,
les nodules mixtes (en verre dépoli et solides),
les nodules calcifiés et les autres nodules bénins
(figure). Les nodules entièrement calcifiés ou
présentant une calcification centrale sur 2 plans
de coupe orthogonaux, quelle que soit sa taille, sont
considérés comme bénins. De même, la présence
d’un foyer de densité graisseuse ( 40 à 120 unités
Hounsfield) au sein du nodule ou des caractéristiques
évocatrices d’un ganglion intrapulmonaire (nodule
de moins de 10 mm, distant de moins de 10 mm de
la plèvre, situé au-dessous du niveau de la carène
et présentant une forme angulaire) constituent des
critères de bénignité et ne sont donc pas considérées
comme des tests positifs.
Tableau II. Critères de sélection de la population éligible au dépistage (22).
Critères d’inclusion Critères d’exclusion Critères de “sortie”
55 à 74 ans > 30 PA
Fumeur actif ou sevré < 15 ans
Être volontaire après information
Accepter de considérer une démarche d’aide
au sevrage tabagique
Antécédent de cancer
Comorbidité sévère, dont état respiratoire contre-indiquant
une exploration thoracique invasive
Antécédent d’hémoptysie
Amaigrissement inexpliqué
Antécédent d’infection pulmonaire < 1 an
> 75 ans après les 3scanners initiaux
> 15 ans de sevrage tabagique
Survenue d’une comorbidité sévère
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%