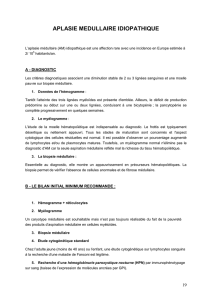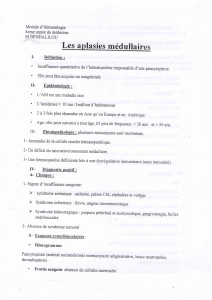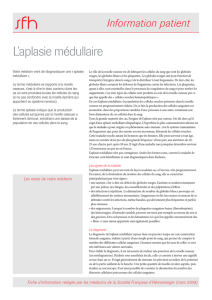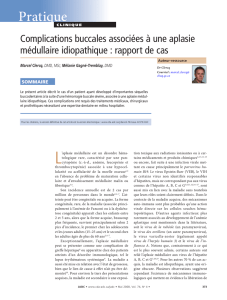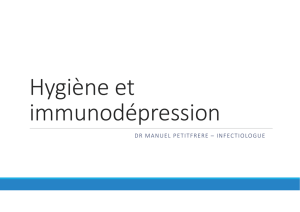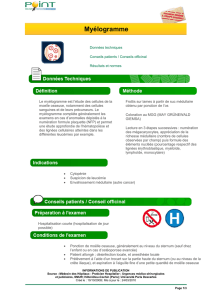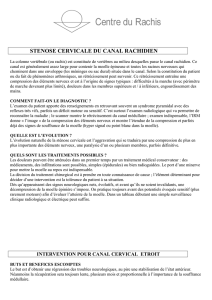Biologie des maladies : à propos de l’aplasie médullaire

27
27
Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 1 - janvier-février-mars 2009
dossier thématique
Coordinateurs : M.C. Béné, G. Cartron
L
e médecin éponyme de cette session
plénière, Edward Donnall Thomas, l’un
des pionniers de la greffe de moelle
osseuse, a été corécipiendaire, avec Joseph
Edward Murray, du prix Nobel de physiologie
ou de médecine en 1990. Il était tout à fait
judicieux, dans le cadre du thème choisi, que
N.S. Young entame sa conférence en rendant
hommage à ce médecin texan. En effet, dès
1964 il avait rapporté le traitement d’un patient
souffrant d’aplasie médullaire par greffe de
moelle osseuse prélevée chez son jumeau,
après déplétion du receveur grâce à un traite-
ment sublétal par Thiotépa
®
(1). La question
que nous pouvons poser rétrospectivement est
de savoir comment cette intervention a permis
une guérison du malade : par la greffe ou par
l’immuno suppression du conditionnement ?
L’APLASIE MÉDULLAIRE
L’aplasie médullaire (aplastic anemia pour les
Anglo-Saxons) a été décrite pour la première
fois par Paul Ehrlich en 1888 (2) lors de l’auto-
psie d’une femme enceinte décédée des suites
d’hémorragies et d’infections, dans un tableau
d’anémie. L’examen de son sang et de sa moelle,
avec les techniques de coloration cellulaire qu’il
avait développées, devait conduire P. Ehrlich,
devant l’absence de cellules nucléées et l’aspect
graisseux de la moelle fémorale, à conclure à “un
dysfonctionnement de la moelle osseuse”.
Les patients atteints de cette maladie rare, le
plus souvent jeunes, décédaient dans les 2 ans
en l’absence traitement. L’étiologie de la mala-
die reste obscure. Une source très étudiée a
été l’expo sition aux solvants, notamment bien
Biologie des maladies :
à propos de l’aplasie
médullaire
Résumé de l’E.D. Thomas Lecture,
awarded to Dr N.S. Young, ASH 2008
Biology of diseases: about aplastic anemia
M.C. Béné*
* Laboratoire d’immunologie,
faculté de médecine et CHU de Nancy.
R
ÉSUMÉ
L’histoire du traitement des aplasies
♦
médullaires pose d’elle-même la question
de savoir si c’est la greffe de moelle ou
l’immunosuppression associée qui permet
l’amélioration des patients. Sur cette
base historique et observationnelle, Neal
Young a déroulé et discuté les hypothèses
physiopathologiques et thérapeutiques
associées à cette maladie rare mais riche
d’enseignements.
Mots-clés : Aplasie médullaire – Infections –
Auto-immunité – Télomères.
Summary. The historical perspective
of aplastic anemia therapy raises the
question of the true root of effi cient
stem cell transplantation: reconstitution
of hematopoiesis or the associated
immunosuppression? On the basis of these
early observations, Neal Young pondered
and discussed pathophysiological and
therapeutic hypotheses associated to this
rare but teaching disease.
Keywords: Aplastic anemia – Infections –
Auto-immunity – Telomeres.

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 1 - janvier-février-mars 2009
28
28
dossier thématique
Coordinateurs : M.C. Béné, G. Cartron
Biologie des maladies : à propos de l’aplasie médullaire
documentée pour les utilisateurs de benzène.
Une origine iatrogène est également rapportée
dans certains cas (3). Une étiologie infectieuse est
fortement suspectée, en particulier dans les pays
en voie de développement. La grande prévalence
des insuffi sances médullaires en Orient a ainsi
conduit à la mise en place de vastes études épidé-
miologiques (4). Le chloramphénicol et le benzène
ont été incriminés, mais il s’est également avéré
que la majorité des patients buvaient l’eau des
sources ou des réseaux urbains et non de l’eau
minérale embouteillée, suggérant plutôt ainsi
une piste infectieuse. Par ailleurs, ces régions
sont endémiques pour des syndromes hépati-
ques séronégatifs pour tous les virus connus,
souvent associés à une insuffi sance médullaire.
Ces études ont donc pour objectif de trouver un
agent étiologique, possiblement viral mais non
encore identifi é.
Une autre approche est de considérer une origine
immunologique dans laquelle une réponse immu-
nitaire, initiée par un antigène quelconque, pour-
rait se retourner vers une destruction des cellules
souches hématopoïétiques. Cette hypothèse est
confortée par le fait qu’une aplasie médullaire est
observée dans de nombreuses autres pathologies,
souvent à composante immunologique (3).
LA PISTE IMMUNOLOGIQUE
Un mécanisme immunologique a ainsi été for-
tement suggéré par l’observation clinique de
patients aplasiques traités par greffe de moelle
osseuse qui, bien que ne développant pas de
chimérisme, retrouvaient une hématopoïèse
“spontanée”. Il fallait en conclure que le trai-
tement immunosuppresseur accompagnant la
procédure de greffe de cellules souches était la
clé de cette “guérison” et ce type d’observation
a effectivement conduit à modifi er la prise en
charge de l’insuffi sance médullaire en utilisant
des immunosuppresseurs (3).
Ce type de reconstitution a aussi été décrit dans
des cas d’aplasie médullaire posthépatitique,
après traitement par immunosuppresseurs (sérum
antilymphocytaire [SAL] ou cyclosporine) [5].
Sur le plan thérapeutique, P. Scheinberg et
al. (6) ont rapporté que l’hémogramme initial
permet de prédire la réponse aux immunosup-
presseurs, notamment au SAL, et aux anticorps
monoclonaux, en particulier l’alemtuzumab. En
fait les échecs de ces traitements immunosup-
presseurs sont observés dans les aplasies liées
à une déplétion des cellules souches d’origine
non immunologique.
La moelle osseuse des sujets aplasiques est
essentiellement constituée d’adipocytes, et les
seuls éléments CD34+ observés sont les cellu-
les endothéliales des vaisseaux sanguins. Sur
le plan fonctionnel, cette diminution drastique
des cellules souches se traduit par une dimi-
nution d’environ deux logarithmes des cellules
hémato poïétiques. Cela indique qu’un phéno-
mène délétère pour les cellules souches hémato-
poïétiques se déroule dans la moelle osseuse de
ces patients. Dans l’hypothèse d’un mécanisme
immunologique, une destruction auto-immune
semble plausible.
Une étude en micro-array des cellules hémato-
poïétiques immatures CD34+ résiduelles de
patients en insuffi sance médullaire par rapport
à leur contrepartie CD34+ médullaires de sujets
sains a conforté cette hypothèse (7). En effet, ces
cellules CD34+ présentent de nombreuses ano-
malies, en particulier la surexpression de gènes
impliqués dans le fonctionnement du système
immunitaire ou le contrôle de l’apoptose. De
plus, des cellules CD34+ normales incubées in
vitro avec de l’interféron-gamma développent
les mêmes dérégulations (7), ce qui suggère
une production anormalement élevée de cette
cytokine chez les patients, compatible avec une
activation de l’immunité cellulaire.
Les lymphocytes périphériques et médullaires
des patients atteints d’aplasie médullaire sont
effectivement riches en lymphocytes cytotoxiques
activés, oligoclonaux, producteurs d’interféron-
gamma (8). Ces clones dominants disparaissent
sous l’effet de l’immunosuppression, favorisant le
retour d’une lymphopoïèse polyclonale normale.
Si le clone cytotoxique réémerge et retrouve sa
dominance ou son état d’activation intrinsèque,
la maladie peut cependant rechuter et la présence
de ce clone peut de nouveau être démontrée.
De nombreux travaux ont confi rmé l’implication du
système immunitaire dans l’insuffi sance médul-
laire, avec notamment l’intervention de cytokines
comme le TNF-alpha et l’interféron-gamma (3).
Par ailleurs, une activation de T-bet, un facteur de
transcription associé à l’orientation des réponses
immunitaires vers un profi l de sécrétion cytokini-
que Th1, a été mise en évidence chez les patients
atteints d’aplasie médullaire (9). Cela suggère une
amplifi cation des réponses immunitaires cellu-
laires, notamment auto-immunes cytotoxiques,
comme on en observe dans d’autres maladies
auto-immunes telles que le diabète de type I.

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 1 - janvier-février-mars 2009
30
30
dossier thématique
Coordinateurs : M.C. Béné, G. Cartron
Un des antigènes cibles pouvant intervenir
chez l’homme est WT1, en particulier lors de sa
surexpression dans les cas de trisomies 8, un
effet bystander pouvant persister pour détruire
les cellules à WT1 muté. Dans les monosomies 7
traitées longtemps par facteurs de croissance,
aucun élément immunologique n’a été rapporté,
mais il pourrait se développer une expression
anormale du récepteur au G-CSF.
Des modèles murins ont permis de conforter
la piste immunologique de façon encore plus
probante. Il est en effet possible d’induire
l’apparition d’une aplasie médullaire dans un
modèle de réaction du greffon contre l’hôte. Le
transfert de lymphocytes ganglionnaires (pas
des cellules souches) de ces premières souris
induit chez les animaux receveurs une aplasie
caractérisée par une moelle osseuse désertique,
grasse et contenant des lymphocytes T cytotoxi-
ques (10). Ces lymphocytes tuent plutôt par la
voie Fas-Fas ligand que par la voie des granzy-
mes, pour induire l’apoptose des cellules cibles.
Cette maladie peut en revanche être modulée par
l’administration de lymphocytes T-régulateurs
(T-regs), ce qui renforce encore l’hypothèse
immunitaire (11).
De façon très intéressante, une récente étude
suggère le rôle des T-regs en association avec l’im-
munosuppression chez l’homme. En effet, les SAL
peuvent être produits chez le cheval ou le lapin
en immunisant les animaux avec des lymphocytes
humains périphériques ou thymocytaires. Or, les
SAL de lapin, et eux seuls, semblent capables
d’induire la génération de T-regs in vitro, associée
à l’uprégulation démontrée en micro-array de plus
de 100 gènes (12).
UN NOUVEAU MAILLON DANS LA CHAÎNE :
LES TÉLOMÈRES
Les télomères sont étymologiquement
(telos :queue, meros :partie) des “extrémités
terminales” et, en génétique, ce terme désigne
effectivement les deux extrémités des chromoso-
mes. Dans ces régions se trouvent des séquences
répétitives d’ADN non codant qui ne sont pas
copiées par les ADN polymérases. Ces régions
télomériques, ou “télomères”, ont pour objectif
de protéger le patrimoine génétique. Les télo-
mères assurent ce rôle, d’une part, en évitant
la fusion des chromosomes, et, d’autre part, en
maintenant la fonctionnalité des gènes les plus
terminaux des brins d’ADN. Les télomères sont
donc raccourcis lorsque les cellules se multi-
plient, phénomène compensé, notamment dans
les cellules à renouvellement fréquent, par une
enzyme, la télomérase, qui les reconstitue sur les
nouveaux chromosomes. Le raccourcissement
des télomères est considéré comme un événe-
ment associé à la sénescence. Il peut conduire à
la perte de gènes fonctionnels, phénomène qui
s’observe dans certaines pathologies associées
à un “raccourcissement des télomères” comme
la dyskératose, l’anémie de Fanconi ou le syn-
drome de Shwachman-Diamond (12). Dans ces
trois pathologies, la télomérase attendue dans
des cellules à renouvellement rapide ne fonc-
tionne pas, conduisant à la maladie. Au cours
de la vie, et en fonction des renouvellements cel-
lulaires, on observe une longueur assez stable
des télomères avec une première période de rac-
courcissement dans l’enfance et une seconde,
associée au grand âge.
Dans l’aplasie médullaire, un raccourcissement
anormal des télomères a été rapporté depuis une
quinzaine d’années, et était initialement consi-
déré comme un signe d’épuisement des cellules
souches (12). En fait, des travaux plus récents ont
permis d’identifi er chez les patients souffrant
d’aplasie médullaire des mutations de gènes
impliqués dans la production de la télomérase
et essentiellement du gène TERT (TElomerase
Reverse Transcriptase) indispensable pour cet
ajout attendu de télomères protecteurs. De plus,
les télomères courts sont associés à une insta-
bilité génomique, suggérant une plus grande
propension pour les sujets porteurs d’une
mutation de TERT à développer une aneuploï-
die péjorative eu égard au développement d’un
syndrome myélodysplasique ou d’une leucémie
myéloblastique.
Les membres de la famille de ces patients sont
souvent également porteurs de mutations de
TERT. Ils sont cliniquement normaux, mais ont
un nombre diminué de cellules souches. Cela
peut avoir des conséquences si un tel membre
de la fratrie est choisi comme donneur de moelle
osseuse.
Cette anomalie est notamment étudiée dans
des familles mennonites chez lesquelles les
patients rapportent fréquemment le cas d’un
ou d’ancêtre(s) “pâle(s) et agressif(s)” !
Par ailleurs, des associations entre les mutations
de TERT et des pathologies hépatiques ont été
rapportées, suggérant que des anomalies des
télomérases peuvent avoir des impacts multiples,
en plus de l’insuffi sance médullaire.

31
31
Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 1 - janvier-février-mars 2009
Biologie des maladies : à propos de l’aplasie médullaire
La longueur des télomères apporte ainsi proba-
blement une autre valeur pronostique, mais sans
doute indépendante de la réponse aux immuno-
suppresseurs et des mécanismes immunologiques
détaillés plus haut. Quoique… Il y a une quinzaine
d’années, un traitement par androgènes a été pro-
posé dans le traitement des anémies réfractaires
avec un certain succès. Or, il se trouve que les
hormones sexuelles augmentent l’activité de TERT
dans les lymphocytes humains normaux. Cela sug-
gère que d’autres cibles cellulaires pourraient être
impliquées dans ces traitements par androgènes,
induisant, pourquoi pas, une restauration de la
longueur des télomères dans les cellules souches
et une expression plus conforme des cibles anti-
géniques, les faisant par là même échapper aux
effets délétères de l’auto-immunité.
CONCLUSION
Il est diffi cile de conclure autrement qu’en sou-
lignant que les éléments principaux de cette
impressionnante série de travaux pointent vers
une base auto-immune pour les mécanismes de
la plupart des insuffi sances médullaires, tout en
encourageant à rechercher quel antigène peut
bien être à l’origine de cette réponse déviante !
La réponse est-elle en Asie ?
■
RÉFÉRENCES
1. Thomas ED, Lochte HL Jr, Kasakura S et al. Restoration of
marrow function after lethal doses of Thiotepa
®
by infusion
of isogenic marrow. Bibl Haematol 1964;19:271-3.
2. Ehrlich P. Ueber einem fall von anämie mit bemerkun-
gen über regenerative veränderungen des knochenmarks.
Charité-Annalen 1888;13:300-9.
3.
Young NS, Calado RT, Scheinberg P. Current concepts
in the pathophysiology and treatment of aplastic anemia.
Blood 2006;108:2509-19.
4. Issaragrisil S, Kaufman DW, Anderson T et al. The
epidemiology of aplastic anemia in Thailand. Blood
2006;107:1299-307.
5. Osugi Y, Yagasaki H, Sako M et al. Japan Childhood
Aplastic Anemia Study Group. Antithymocyte globu-
lin and cyclosporine for treatment of 44 children with
hepatitis associated aplastic anemia. Haematologica
2007;92(12):1687-90.
6. Scheinberg P, Wu CO, Nunez O et al. Predicting response to
immunosuppressive therapy and survival in severe aplastic
anaemia. Br J Haematol 2009;144:206-16.
7. Zeng W, Chen G, Kajigaya S et al. Gene expression
profiling in CD34 cells to identify differences between
aplastic anemia patients and healthy volunteers. Blood
2004;103:325-32.
8. Lu J, Basu A, Melenhorst JJ et al. Analysis of T-cell
repertoire in hepatitis-associated aplastic anemia. Blood
2004;103:4588-93.
9. Solomou EE, Keyvanfar K, Young NS. T-bet, a Th1 trans-
cription factor, is upregulated in T cells from patients with
aplastic anemia. Blood 2006;107(10):3983-91.
10.
Bloom ML, Wolk AG, Simon-Stoos KL et al. A mouse
model of lymphocyte infusion-induced bone marrow failure.
Exp Hematol 2004;32(12):1163-72.
11. Chen J, Ellison FM, Eckhaus MA et al. Minor antigen
h60-mediated aplastic anemia is ameliorated by immu-
nosuppression and the infusion of regulatory T cells. J
Immunol 2007;178:4159-68.
12. Feng X, Kajigaya S, Solomou EE et al. Rabbit ATG
but not horse ATG promotes expansion of functional
CD4+CD25highFOXP3+ regulatory T cells in vitro. Blood
2008;111:3675-83.
13. Calado RT, Young NS. Telomere maintenance and
human bone marrow failure. Blood 2008;111(9):4446-55.
1
/
4
100%