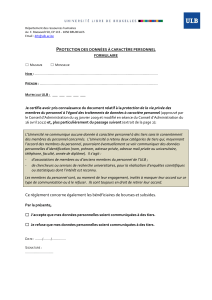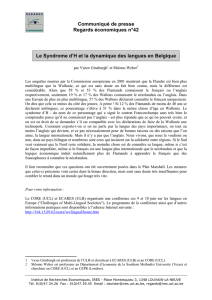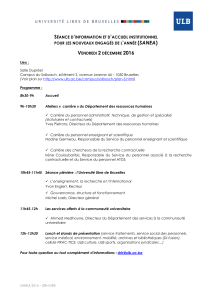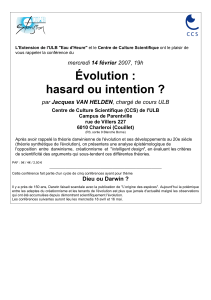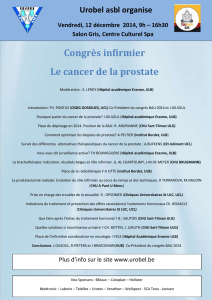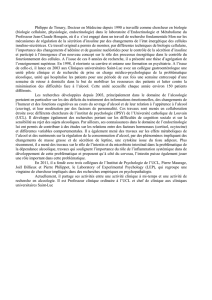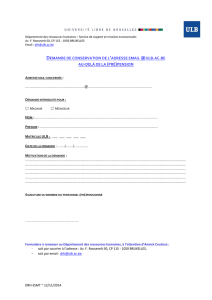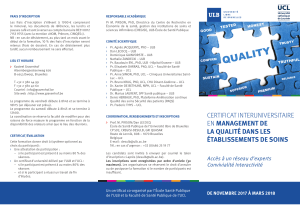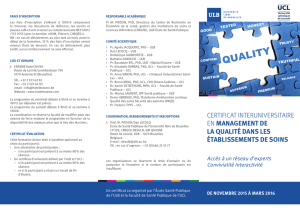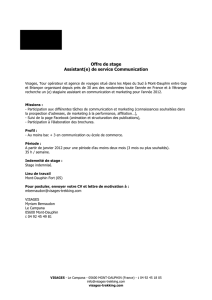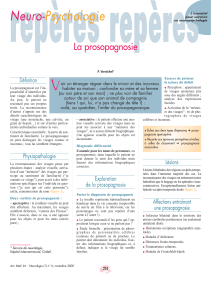Document attach

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNE ÉTUDE UCL ET ULB CIBLE LES RÉGIONS DU CERVEAU RELATIVES
À LA RECONNAISSANCE DES VISAGES ET DES VOIX
Bruxelles, le 17 mars 2011
Des chercheurs de l’ULB et de l’UCL montrent par imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle les régions cérébrales actives pour reconnaître des
visages et des voix, séparément et conjointement.
Les visages et les voix humaines sont deux attributs majeurs nous permettant d’identifier
les personnes que nous connaissons. Si les mécanismes neuronaux permettant
d’identifier ces visages et ces voix sont de mieux en mieux connus, en revanche, la
manière dont le cerveau opère pour créer des représentations unifiées à partir de
représentations visuelles et auditives distinctes reste à découvrir.
Cette capacité est fondamentale dans notre existence quotidienne, non seulement parce
que nous l’utilisons quotidiennement dans toutes nos interactions sociales, mais aussi
parce qu’un déficit de l’un ou l’autre aspect de ces processus d’identification entraîne des
pathologies lourdes, comme la prosopagnosie (c’est-à-dire un déficit de reconnaissance
des visages) ou la phonagnosie (l’incapacité à reconnaître les voix). On peut dès lors
s’étonner de la relative méconnaissance de ces mécanismes associatifs, tant du point de
vue fondamental au vu de leur importance écologique, que du point de vue pathologique
puisqu’on ne peut espérer d’action thérapeutique efficace sans compréhension des
processus à l’œuvre à l’état normal.
Des chercheurs de l’UCL – Centre de Neuroscience Cognition et Système, Frédéric
Joassin, Mauro Pesenti, Pierre Maurage, Emilie Verreckt et Raymond Bruyer – et de
l’ULB – Laboratoire de psychologie médicale, alcoologie et toxicomanie, Salvatore
Campanella - ont étudié cette question.
Un des postulats de base de leur recherche publiée en mars dans la revue Cortex est que
la création de représentations multimodales des personnes est plus que la simple somme
des activités cérébrales liées au traitement de chaque information. Pour mener leur
recherche, ils se sont appuyés sur l’imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf).

Dans cette étude d’IRMf, les chercheurs montrent que l’identification d’associations
visages-voix entraine non seulement l’activation de régions uni-modales
visuelles et auditives, liées au traitement des visages et des voix seuls, mais aussi de
régions hétéro-modales intégratrices, telles que le gyrus angulaire gauche et
l'hippocampe.
Il semble donc que l’intégration cross-modale de visages et de voix en vue d’identifier les
personnes familières requiert l’activation de régions cérébrales particulières.
Une meilleure connaissance de ces phénomènes permet aux chercheurs d’avoir une
meilleure représentation des processus cérébraux utilisés pour lier les informations
visuelles et auditives au travers desquelles nous reconnaissons les personnes qui nous
sont familières.
Informations scientifiques :
• Salvatore Campanella, Chercheur qualifié au Laboratoire de psychologie
médicale, alcoologie et toxicomanie de l’ULB : 0495 79 35 51 ou
salvatore.campanella@ulb.ac.be
• Mauro Pesenti, professeur au Psychological Sciences Research Institute de
l’UCL : 010 47 88 22, [email protected]
• Pierre Maurage, professeur au Psychological Sciences Research Institute de
l’UCL : 010 47 92 95, 0479 96 08 21, Pierre.Ma[email protected]
1
/
2
100%