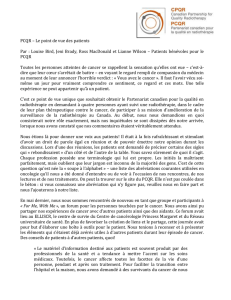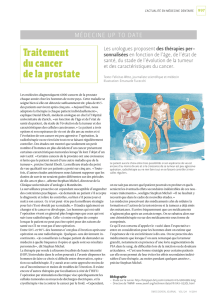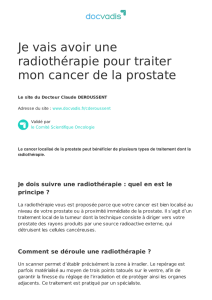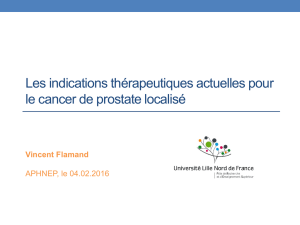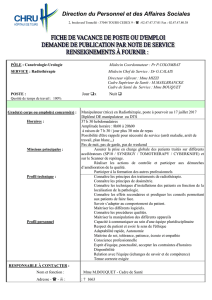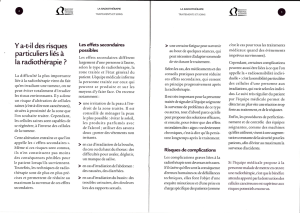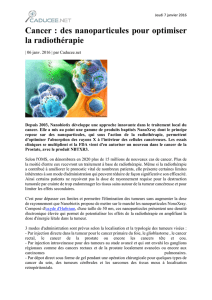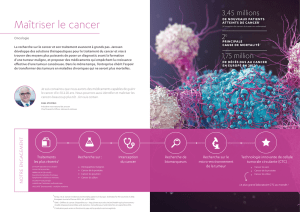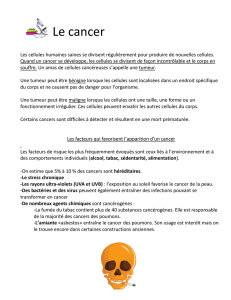Tumeurs induites après irradiation pour cancer de

En France, 80% des cancer de la prostate sont découverts à un stade
encore localisé de la maladie alors qu'un traitement curateur peut
être proposé. Que la chirurgie ou la radiothérapie aient été choisies,
une probabilité de survie sans récidive décelable à 10 ans de
l'ordre de 75% peut être espérée. Aussi, paraît-il important de
connaître les effets secondaires de ces thérapeutiques, notamment
ceux d'apparition tardive dont la survenue risque de venir grever le
pronostic.
L'apparition d'une deuxième tumeur, celle ci radio induite, en fait
partie [1].
Le but de ce travail est de faire le point sur les tumeurs induites
après radiothérapie externe pour cancer de la prostate, d'en préciser
la fréquence, la nature et le délai de survenue, de rechercher l'in-
fluence des nouvelles techniques d'irradiation et de tenter de déga-
ger des conclusions sur les modalités de surveillance de ces
patients.
DONNEES DE LA LITTERATURE
Radiothérapie et induction tumorale
Dans la littérature récente, l'augmentation de fréquence des tumeurs
après radiothérapie est très nette, et, cette hausse semble directe-
ment liée à la dose délivrée.
Dans le cadre du traitement des tumeurs gynécologiques, le lien
entre l'irradiation et l'apparition d'une seconde lésion, celle ci radio
induite, a depuis longtemps été fait. Ainsi, après radiothérapie pour
cancer du col, le risque de tumeur de vessie est de 2 à 4 fois supé-
rieur dans la population irradiée [2].
De la même manière, après irradiation en mantelet pour maladie de
Hodgkin, l'incidence des cancers du sein augmente. La radiothéra-
pie à une dose de plus de 40 grays est directement corrélée à cette
observation, le risque relatif de développer alors un cancer du sein
étant alors 8 fois supérieur [3].
Enfin NEGLIA [4] a récemment publié une série rapportant une aug-
mentation de second cancer comme des tumeurs du système ner-
veux central chez des enfants traités pour un premier cancer. Il
montre en particulier que le risque de deuxième tumeur augmente
avec la dose délivrée.
L'apparition d'une seconde tumeur est donc clairement un effet
secondaire possible de la radiothérapie.
Radiothérapie prostatique et induction tumorale
Pour la pathologie néoplasique prostatique, il semble cependant que
le lien entre l'irradiation et l'apparition d'une seconde lésion,
celle-ci radio induite, ait été plus difficile à établir.
Une recherche sur Medline croisant les mots clés radiothérapie,
tumeur radio induite et cancer de prostate a permis de trouver les
différents articles cités.
Ainsi CHOUSER [5] en reprenant la série de la Mayo Clinic, ne met
pas en évidence parmi les 1743 patients ayant bénéficié d'une radio-
thérapie entre 1980 et 1998 pour cancer de la prostate d'élévation de
l'incidence des tumeurs de vessie avec un recul moyen de 7 ans.
Dans cette expérience, lorsque la tumeur ne paraît pas avoir une
histoire naturelle différente des lésions vésicales habituelles.
Cependant, dans cette étude plus de la moitié des patients étant
◆
ARTICLE DE REVUE Progrès en Urologie (2007), 17, 1302-1304
Tumeurs induites après irradiation pour cancer de prostate localisé
Emmanuel ROLLAND, Marc-Olivier BITKER, François RICHARD
Service d'urologie et de transplantation rénale, Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, 47-83 boulevard de l'Hôpital, 75651 Paris Cedex 13
RESUME
L'augmentation de la fréquence des cancers de la prostate découverts au stade localisé, dont environ 20% seront
traités par radiothérapie, incite à apprécier les effets secondaires de cette modalité de traitement.
Les risques d'impuissance et les troubles irritatifs digestifs et urinaires après radiothérapie sont bien connus.
Le but de cet article a été de faire le point sur les risques moins bien établis de tumeurs radio induites au vu des
données de la littérature et de discuter de modifications éventuelles des modalités classiques de surveillance.
Le risque d'induction tumorale par la radiothérapie est bien connu en gynécologie. Le lien a été difficile à établir
après radiothérapie pour cancer de prostate. Les séries les plus récentes, ont rapporté une élévation du risque
relatif de tumeurs vésicales (RR=1,63) et rectales (RR=1,6 à 1,7). A 5 ans le risque d'apparition d'une seconde
tumeur est de 15% dans la population irradiée et il atteint 34% à 10 ans. Bien que le recul soit encore insuffisant
les nouvelles techniques de radiothérapie conformationnelles ne semblent pas faire diminuer ce risque.
Ces données incitent à la prudence chez les patients cumulant les facteurs de risque tel que le tabac pour la ves-
sie et à proposer une surveillance endoscopique vésicale et rectale au-delà de 5 ans chez les patients traités par
radiothérapie pour cancer de prostate.
Mots clés :cancer de la prostate, radiothérapie, lésions radio induites.
1302
Manuscrit reçu : mars 2007, accepté : août 2007
Adresse pour correspondance : Dr.E. Rolland, Service d'urologie et de transplantation
rénale, Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, 47-83 boulevard de l'Hôpital, 75651 Paris
Cedex 13, France
e-mail : [email protected]
Ref : ROLLAND E., BITKER M.O., RICHARD F. Prog. Urol., 2007, 17, 1302-1304

décédés avant le recul maximum, un biais peut être introduit par un
recul insuffisant. En effet, en terme de lésions radio induites, il est
prouvé, notamment par le suivi des patients victimes de l'exposition
aux radiations atomiques, que les tumeurs peuvent apparaître plus
de 15 ans après l'exposition.
En 2006, MOON [6] a publié une série analysant le devenir des
patients au moins 5 ans après le traitement initial pour adénocarci-
nome prostatique. Il a ainsi pu comparer 39805 patients traités par
radiothérapie externe à 94541 patients qui n'ont pas eu de radiothé-
rapie. Dans la population irradiée, il note un risque relatif plus élevé
de développer un second cancer au niveau vésical (1,63) ou rectal
(1,6)]. Il note également une élévation significative du risque de
lymphome non hodgkinien, de leucémie myéloïde, et également de
cancer du caecum, du colon transverse, du cerveau, de l'estomac, du
poumon des bronches et de mélanome. Cette élévation du risque
relatif de second cancer en zone non irradiée est surprenante, et, les
auteurs n'en donnent pas d'explication claire. Les sources de biais
sont en effet multiples. La population irradiée peut en effet présen-
ter des facteurs de co-morbidité les prédisposant plus à la survenue
d'une autre tumeur.
NEUGUT [7] a étudié 141761 patients pour lesquels un diagnostic de
cancer de prostate a été posé entre 1973 et 1990 et inscrits dans le
registre nord américain SEER. Parmi ces patients, 24,6% ont eu une
radiothérapie externe. Durant les cinq premières années, il n'y a pas
d'élévation du risque d'apparition d’une deuxième tumeur (vessie,
rectum, ou leucémie). Par contre, au-delà de ce délai, il y a une élé-
vation du risque relatif pour les tumeurs de vessie, atteignant 1,5
après 8 ans dans le groupe radiothérapie.
Apartir du même registre SEER, BAXTER [8] a comparé les
30552 patients irradiés aux 55263 patients ayant été traités par
chirurgie exclusive pour leur cancer de prostate sur la période
1973-1994.
Dans les 2 groupes, l'incidence des cancers colorectaux a été étu-
diée en distinguant les zones irradiées sans aucun doute (rectum),
les zones potentiellement irradiées (charnière rectosigmoïdienne,
sigmoïde, caecum) et les zones non irradiées (reste du colon).
Après 5 ans, il existe dans le groupe irradié, une élévation signifi-
cative du nombre de cancer du rectum alors que le nombre de can-
cer des zones potentiellement irradiées et non irradiées est le même
dans les 2 groupes. Le risque relatif de développer un cancer du rec-
tum dans le groupe irradié est de 1,7.
BRENNER [9] enfin, a comparé sur la période 1973-1993, 51584
patients traités par radiothérapie externe à 70539 autres malades
traités par chirurgie sans radiothérapie pour un adénocarcinome
prostatique. Le risque de développer une deuxième tumeur solide
est plus élevé dans le groupe irradié. De plus, ce risque augmente
avec le temps ; il est de 15% supérieur après 5 ans et de 34% supé-
rieur après 10 ans. Pour les patients ayant plus de 10 ans de recul,
c'est un patient sur 70 traités par radiothérapie qui présentera une
deuxième tumeur. BRENNER relève notamment une augmentation du
risque relatif de cancers du rectum et de la vessie. Il note également
un risque relatif de sarcome de 2,5 à 5 ans. Mais la rareté de ces
lésions rend peu valide l'analyse statistique.
L'ensemble de ces données accrédite donc le fait qu'il existe un
risque de deuxième tumeur radio induite après radiothérapie pour
cancer de prostate. Celles-ci surviennent à distance de la radiothé-
rapie initiale, le délai minimum d'apparition étant de 5 ans. Les
principaux sites concernés sont le rectum et la vessie. Pour les sar-
comes, il pourrait exister un lien mais moins significatif. Néan-
moins, ces analyses reposent sur des séries où les premiers patients
ont été traités il y a plusieurs dizaines d'année.
Influence des modalités de radiothérapie
La question est de tenter de déterminer l'influence sur l'induction
tumorale des nouvelles modalités de radiothérapie.
Ainsi, pour ce qui est des techniques d'escalade de dose, SACHS [10]
acréé un modèle mathématique mettant en évidence une corréla-
tion directe entre l'augmentation des doses délivrées et l'élévation
du risque de deuxième tumeur.
KRY [11] a observé les effets de seconde lésion radio induite après
les techniques de modulation d'intensité. Là encore il estime que le
risque de tumeur secondaire est plus élevé avec ces nouvelles tech-
niques, puisqu'il s'établit entre 2,1 et 3,7% contre 1,7% en utilisant
des techniques de radiothérapie conventionnelle. De même pour
HALL [12] le risque de deuxième tumeur radio induite 10 ans après
le traitement initial, passe de 1% pour une radiothérapie classique à
1,75% avec une radiothérapie à modulation d'intensité. Pour ces
auteurs cette élévation du risque s'explique par le fait que un plus
grand volume se trouve irradié, même si les doses délivrées en
dehors du volume cible sont plus faibles.
Pour les techniques de radiothérapie conformationnelle, KRY estime
qu'elle devrait diminuer le risque de seconde tumeur, mais il n'a-
vance aucune donnée pour étayer cette hypothèse.
Il apparaît donc que les nouvelles techniques d'irradiation ne per-
mettent pas de diminuer le risque de deuxième tumeur radio indui-
te pour la modulation d'intensité, et, que pour la radiothérapie
conformationnelle, les données de la littérature ne sont pas suffi-
santes pour conclure.
CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS
L'analyse de ces différentes données de la littérature incite à penser
qu'après radiothérapie externe pour adénocarcinome prostatique, le
risque d'apparition d'une seconde localisation tumorale, en particu-
lier rectale et vésicale, soit augmenté, et ce à partir de 5 ans après
l'irradiation initiale. A10 ans le risque de développer une deuxième
tumeur solide serait de 34% supérieur.
Il ne semble pas actuellement prouvé que les protocoles actuels de
radiothérapie diminuant le volume d'irradiation puissent réduire le
nombre de cas de lésions radio induites. Par ailleurs le risque serait
un peu plus élevé chez les patients traités par techniques de modu-
lation d'intensité.
Al'heure où on dépiste les cancers de prostate à des stades le plus
souvent localisés chez des patients ayant une longue espérance de
vie, ces données pourraient plaider en faveur d'une modification des
indications, de l'information, et surtout, des modalités de sur-
veillance. La littérature ne donne aucune indication quant au rôle de
la multiplication des facteurs de risque liés par exemple à une pro-
position d'irradiation chez un patient fumeur : cette hypothèse méri-
terait probablement d'être étudiée.
Les modalités de surveillance après radiothérapie pour carcino-
me de prostate devraient probablement inclure au-delà de cinq
ans une rectoscopie et une cystoscopie à un rythme restant à pré-
ciser.
E.Rolland et coll., Progrès en Urologie (2007), 17, 1302-1304
1303

REFERENCES
1. AUDET J.F., RUIZ L., SEBE P., TOTOBENAZSARA J.L., PAULE B.,
LAGRANGE J.L., ABBOU C.C., DE LA TAILLE A. : Néoplasies induites
par la radiothérapie pour cancer de la prostate : présentation d'un cas de sar-
come pelvien. Prog. Urol., 2004 ; 14 : 420-422.
2. BOICE J., ENGHOLM G., KLEINERMAN R., BLETTNER M., STO-
VALL M., LISCO H. : Radiation dose and second cancer risk in patients
treated for cancer of the cervix. Radiat. Res., 1988 ; 116 : 3.
3. TRAVIS L., HILL D., DORES G., GOSPODAROWICZ M., VAN LEEU-
WEN F., HOLOWATY E. : Breast cancer following radiotherapy and
chemotherapy among young women with hodgkin disease. JAMA, 2003 ;
290 : 465-475.
4. NEGLIA J., ROBISON L., STOVALL M., LIU Y., PACKER R., HAM-
MOND S. : New primary neoplasms of yhe central nervous system in sur-
vivors of childhood cancer. J. Natl. Cancer Inst., 2006 ; 98 : 1528-1537.
5. CHOUSER K., LEIBOVICH B., BERGSTRAHL E., ZINCKE H., BLUTE
M. : Bladder cancer risk following primary and adjuvant external beam
radiation for prostate cancer. J. Urol., 2005 ; 174 : 107-111.
6. MOON K., STUKENBORG G., KEIM J., THEODORESCU D. : Cancer
incidence after localized therapy for prostate cancer. Cancer, 2006 ; 107 :
991-998.
7. NEUGUT A., AHSAN H., ROBINSON E., ENNIS R. : Bladder Carcinoma
and other second malignancies after radiotherapy for prostate carcinoma.
Cancer, 1997 ; 79 : 1600-1604.
8. BAXTER N., TEPPER J., DURHAM S., ROTHENBERGER D., VIRNING
B. : Increased risk of rectal cancer after prostate radiation : a population
based study. Gastroenterology, 2005 ; 128 : 819-824.
9. BRENNER D., CURTIS R., HALL E., RON E. : Second malignancies in
prostate carcinoma patients after radiotherapy compared with surgery. Can-
cer, 2000 ; 88 : 398-406.
10. SACHS R., BRENNER D. : Solid tumor risks after high doses of ionizing
radiation. Proc. Natl. Acad. Sc. USA, 2005 ; 102 : 13040-13045.
11. KRY S., SALEHPOUR M., FOLLOWILL D., KUBAN D., WHITE R.,
ROSEN I. : The calculated risk of fatal secondary malignancies from inten-
sity-modulated radiation therapy. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2005 ;
62: 1195-1203.
12. HALL E., WUU C. : Radiation-induced second cancers : the impact of 3D-
CRT and IMRT. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys., 2003 ; 56 : 83-89.
____________________
SUMMARY
Radiation-induced tumours after irradiation for localized prostate
cancer : review and proposals for long-term follow-up
The growing frequency of prostate cancer discovered at a localized
stage, about 20% of which are treated by radiotherapy, justifies an ana-
lysis of the adverse effects of this treatment modality. The risks of impo-
tence and gastrointestinal and urinary irritative disorders after radio-
therapy are well known. The objective of this article is to review the less
well known risks of radiation-induced tumours based on the data of the
literature and to discuss possible modifications of the conventional
modalities of follow-up. The risk of radiation-induced tumours is well
known in gynaecology, but the link is more difficult to establish after
radiotherapy for prostate cancer. The most recent series report an
increased relative risk of bladder cancer (RR = 1.63) and rectal cancer
(RR = 1.6 to 1.7) : the risk of second tumour is 15% at 5 years in the
irradiated population and 34% at 10 years. Finally, although follow-up
is still too short, new conformal radiotherapy techniques do not appear
to decrease this risk. These data indicate the need for caution in patients
combining several risk factors, such as smoking for bladder cancer, and
bladder and rectal endoscopic surveillance for more than 5 years should
be proposed in patients treated by radiotherapy for prostate cancer.
Key words : prostate cancer, radiotherapy, radiation-induced lesions.
E.Rolland et coll., Progrès en Urologie (2007), 17, 1302-1304
1304
____________________
1
/
3
100%