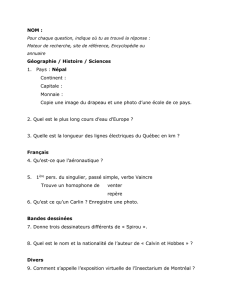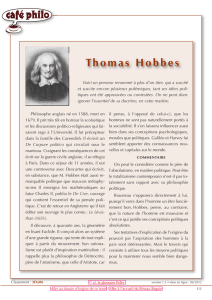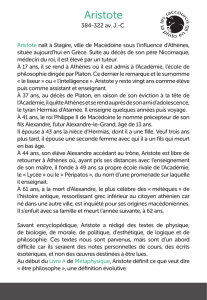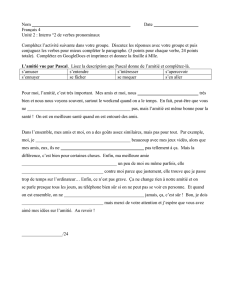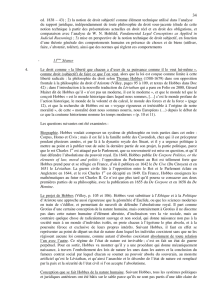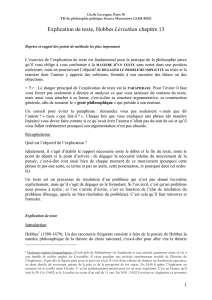La Responsabilité sociale de l`entreprise un retour à la

Arnaud Pellissier-Tanon
Maître de conférences,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Prism ISO
novembre 2008
Communication
au 6
ème
congrès de l’ADERSE
Pau, 22 et 23 janvier 2008
La Responsabilité sociale de l’entreprise,
un retour à la vision aristotélicienne
de la société politique ?
*
Résumé : L’élargissement du cercle de leurs parties prenantes transforme
tacitement la responsabilité sociale des entreprises ainsi que le rôle qui leur est
dévolu au sein de la société : de plus en plus, elles prennent part au débats sur les
questions de sociétés et peuvent légitimement contribuer de leur propre initiative à
leurs solutions. Ce faisant, la vision de la politique change : l’Etat, conçu comme
un artifice de représentation apte à fonder le pouvoir souverain et à légitimer la
législation qu’il édicte, cède la place à un forum d’organisations qui, par leurs
libéralités, agissent d’une façon subsidiaire et contribuent au bien commun. La
RSE consacre ainsi un retour à la vision aristotélicienne de la société politique.
Mots clés : Aristote, bien commun, contrat social, libéralité, responsabilité sociale
de l’entreprise, société politique, subsidiarité
*
Prenons Milton Friedman au sérieux : lorsqu’il affirma, le 13 septembre 1970, dans un
article fameux, que « la responsabilité sociale de l’entreprise est d’augmenter ses
profits », il ne faisait que rappeler une vision des choses répandue dans la société
américaine de son temps, vision qu’il avait développée dans Capitalism and Freedom
(1962) : les entreprises ont pour mandat de faire fructifier les fonds que leurs
actionnaires leur apportent, en menant une concurrence libre et ouverte, exempte de
tromperie et de fraude ; elles ne peuvent se substituer à eux pour décider du bon usage
des profits qu’elles réalisent ; leur imputer une responsabilité sociale, tout en leur

2
laissant l’initiative, reviendrait à subvertir l’économie de liberté mais aussi le caractère
individualiste de la société. Et de poser la question suivante, fondamentale à ses yeux :
« des individus privés peuvent-ils décider par eux-mêmes de ce qu’est l’intérêt de la
société ? » (1962, p. 133, traduction par nos soins)
Comprenons bien sa position. Il ne s’opposait pas à l’idée de stewardship selon
laquelle les propriétaires sont investis du devoir moral de faire bénéficier la société
tout entière des richesses dont ils disposent : le mécénat est trop profondément ancré
dans les mœurs américaines pour qu’il en méconnaisse les racines et la portée. Il ne
niait pas que l’entreprise se doit d’obtenir la license to operate que l’opinion publique
délivre aux firmes qui font preuve de respect pour les intérêts de leurs diverses parties
prenantes : ce serait une bonne stratégie, comme Freeman (1984) l’a établi, si ce
n’était une obligation précontractuelle, bien connue des juristes, comme la loyauté ou
la bonne foi. Il s’étonnait seulement qu’on attribue à l’entreprise une mission
ressortissant, d’après lui, à l’Etat : définir l’intérêt de la société tout entière. Il était
attaché à une vision de la société, prégnante depuis les temps modernes, où la politique
est l’affaire de l’Etat, mais le profit, celle des entreprises.
Prendre Milton Friedman au sérieux conduit à se demander si la thématique de la
responsabilité sociale des entreprises est bien sous-tendue par une vision de la société
politique, une vision qui remettrait en cause la vision admise jusqu’alors du lien qui
unit les citoyens entre eux ou, autrement dit, le contrat social lui-même. Cette question
n’est pas nouvelle à l’ADERSE : Jean-Jacques Rosé en a fait le sous-titre du recueil
dont il a dirigé la publication en 2006 : Responsabilité sociale de l’entreprise, Pour un
nouveau contrat social. Et dans le même ouvrage, François Lépineux affirme, à propos
du modèle socio économique émergent, qu’ « il est de moins en moins vrai que […] la
question du bien commun [est] la prérogative de l’Etat : d’autres acteurs, au premier
rang desquels les multinationales, deviennent coresponsables avec l’Etat de la
recherche du bien commun » (Lépineux, 2006, p. 331). Pouvons nous y voir une
confirmation de l’évolution que Milton Friedman dénonce ?
Cette communication se propose de reprendre à nouveau frais la question de la vision
de la société politique qui sous-tend la thématique de la responsabilité sociale des
entreprises. Nous allons nous appuyer sur la distinction, courante en philosophie du
droit et en philosophie politique, des modernes d’avec les classiques, notamment au
regard du droit naturel (Villey, 1975, 1976, Strauss, 1953). L’opposition, pertinente
pour notre propos, porte sur la nature des sujets de la société politique et sur la façon
dont ils participent à la vie politique, à savoir la définition et à la réalisation du bien ou
du projet qui les unit. La thématique de la responsabilité sociale des entreprises
consacre, nous semble-t-il, une vision de la société politique comme un forum
d’organisation concourant, chacune selon ses moyens, à la réalisation d’un bien
commun dont la définition émerge de leur débats. Cette vision est en rupture avec celle
du contrat par lequel des individus abdiquent leur souveraineté et la remettent à un
pouvoir qui les protégera les uns des autres. A l’opposée des modernes, elle trouve ses
racines chez les philosophes classiques. Aussi pensons-nous que la thématique de la
responsabilité sociale des entreprises consacre un retour à la vision aristotélicienne de
la société politique.

3
Nous commencerons par présenter une synthèse de la vision de la société politique que
présentent les philosophes classiques, notamment la genèse de la cité, à savoir un
élargissement des relations d’échange, et l’entraide utile ou vertueuse que les
concitoyens se donnent. Nous rencontrerons au passage les trois notions clefs de
libéralité, du bien commun et de subsidiarité. Nous pourrons alors nous pencher sur la
vision moderne de la société politique, celle initiée par Hobbes, empreinte
d’hédonisme et de positivisme juridique, et analyser en quoi la responsabilité sociale
des entreprises, dans le contexte de l’effacement des idéologies et de la faillite des
Etats-providence, s’écarte de la vision moderne de la société politique et retrouve, sans
forcément en avoir conscience, la vision classique.
1) La vision de la société politique des philosophes classiques
Consacrant La République à l'analyse de la justice, Platon y décrit, au livre II, la
genèse de la cité. On trouve à son origine le besoin des hommes de se prêter
mutuellement une aide pour faire face aux nécessités de la vie : "ce qui donne
naissance à une cité (...) c'est (...) l'impuissance où se trouve chaque individu de se
suffire à lui même et le besoin qu'il éprouve d'une foule de chose" (369-b)1. De là naît
la société politique, d'abord rudimentaire, puis différenciée selon les métiers que
remplissent ses membres. Par le fait même qu'elle permet de satisfaire aisément les
besoins primordiaux de l'existence, la différenciation des métiers ouvre des champs
nouveaux à l'activité humaine. Des besoins jusqu'alors inconnus font leur apparition et,
de la sorte, la cité primitive qui ne se composait guère que de laboureurs et de
quelques artisans, s'accroît en population et en étendue.
Le commerce ne tarde pas à s'y développer. Il a d'abord son siège sur un marché public
mais, dès que la production augmente et que des matières premières de toutes sortes
deviennent nécessaires, ce cadre se révèle trop étroit. Il faut multiplier les relations qui
existent déjà avec les pays voisins et, pour cela, construire des vaisseaux. De nouvelles
classes sociales, telles les commerçants ou les marins, se constituent ainsi dans la cité.
Si on y ajoute la classe des manoeuvres non qualifiés, on a décrit, sous sa forme la plus
simple, une cité complète (cf. 369-b - 372-c). La vie du commun des citoyens dans une
telle cité sera aussi facile qu'heureuse : satisfaits d'une nourriture saine et frugale, sans
désirs et sans souci, ils jouiront des bienfaits de la paix et chanteront les louanges des
dieux. Ainsi, selon Platon, la cité ayant pour origine le besoin d'entraide qu'éprouvent
les hommes, sa genèse consiste en la différenciation de ses fonctions.
11) La genèse de la cité : un élargissement des relations d’échange
Aristote présente, au premier livre de La Politique, la genèse de la cité comme un
mouvement d'élargissement des relations d'échange : des familles se regroupent en
villages puis en cités pour s'offrir mutuellement les services qu'elles ne peuvent
s'assurer elles-mêmes. Les familles utilisent depuis toujours leurs patrimoines pour
1 Les références des citations de Platon suivent la numérotation continue de ses oeuvres selon l'édition
Estienne : La République couvre les n° 328-a à 621-d inclus.

4
satisfaire les besoins de tous les jours. Et pour les autres besoins, les chefs de famille
en vinrent à pratiquer le troc (cf. 1257-a 25)2. Ainsi "une communauté d'intérêts naît"
(1133-a 17) entre les chefs de famille qui ont recours à l'échange. Aristote relève que
"c'est en vue de l'avantage de ses membres, pense-t-on généralement, que la
communauté politique s'est constituée à l'origine et continue à se maintenir" (1160-a
10). Il constate ainsi que, du point de vue économique, "une famille se suffit davantage
à elle-même qu'un individu, et une cité qu'une famille, et une cité n'est pas loin d'être
réalisée quand la communauté devient assez nombreuse pour se suffire à elle même"
(1261-b 5).
Mais à l’instar de Platon, Aristote a adopté un point de vue éthique : l'achèvement de
la Cité doit être entendu certes, comme nous l'avons vu, du point de vue économique,
par l'autarcie, mais aussi du point de vue moral, par la vie vertueuse et heureuse, tant il
est vrai qu' "il est impossible, ou du moins malaisé, d'accomplir les bonnes actions
quand on est dépourvu des ressources pour y faire face" (1099-a 30). Aristote peu
conclure que "la communauté formée de plusieurs villages est la cité, au plein sens du
mot ; elle atteint dès lors... la limite de l'indépendance économique : ainsi, formée au
début pour satisfaire les seuls besoins vitaux, elle existe pour permettre le bien vivre"
(Pol. 1252-b 25). Aristote peut consacrer tout le reste de La Politique à discuter du
bien fondé des thèses de Platon, à analyser les constitutions des cités grecques de son
temps, à rappeler la finalité de la cité, à dresser une typologie des différents régimes
possibles, à comparer leurs avantages et inconvénients. C’est à juste titre qu’on peut le
considérer comme le fondateur des sciences politiques.
12) Le premier bien de la cité : se rendre service mutuellement
C’est à un titre non moins juste que l’on considérera la portée sociologique de ses
observations : l’importance accordé à la division du travail dans la genèse de la cité ne
doit pas masquer la spécificité des communautés qui la compose ni celle des amitiés
qui les rassemblent. Car "les espèces particulières d'amitiés correspondent aux espèces
particulières de communautés" (1160-a 30). Au risque d'être schématique, retenons-en
trois types, a) l'amitié utile qui unit, au sein de la communauté domestique, des
hommes inégaux en raison, cas paradigmatique du maître et de son esclave, b) l'amitié
utile qui unit, au sein de la communauté politique, des hommes égaux en raison, cas de
l'échange entre chefs de famille, et c) l'amitié vertueuse qui unit, au sein de la
communauté politique, des hommes inégaux en justice, les concitoyens de la cité
autarcique. Et concentrons nous sur les deux derniers types.
Nous avons vu dans la première partie que la genèse de la cité consiste en un
élargissement des relations d’échange : les familles se regroupent en villages puis en
cités pour s'offrir mutuellement les services qu'elles ne peuvent s'assurer elles-mêmes :
"les deux parties retirent les mêmes avantages l'une de l'autre et se souhaitent les
2 Les références des citations d’Aristote suivent la pagination de l'édition de Bekker (Berlin, 1831).
L'Ethique à Nicomaque, les n° 1094-a à 1181-b, l'Ethique à Eudème, les n° 1214-a à 1249-b (notons
que cette numérotation continue exclut de l'Ethique à Eudème les livres IV, V & VI, identiques aux
livres V, VI & VII de l'Ethique à Nicomaque) et La Politique, les n° 1252-a à 1341-b. Nous utilisons
les traduction de J. Tricot.

5
mêmes biens, ou encore échangent une chose contre une autre" (1158-b 2). Ainsi,
"chacun des deux amis, à la fois aime son propre bien et rend exactement à l'autre ce
qu'il en reçoit, en souhait et en plaisir : on dit, en effet, que l'amitié est une égalité"
(1157-b 35). Aristote peut affirmer que la justice est à l’amitié ce que le moyen est à la
fin :
"l'amitié semble aussi constituer le bien des cités, et les législateurs paraissent y
attacher un plus grand prix qu'à la justice même : en effet la concorde, qui paraît
bien être un sentiment voisin de l'amitié, est ce que recherchent avant tout les
législateurs, alors que l'esprit de faction, qui est son ennemi, est ce qu'ils
pourchassent avec le plus d'énergie. Et quand les hommes sont amis il n'y a plus
besoin de justice, tandis que s'ils se contentent d'être justes, ils ont en outre besoin
d'amitié, et la plus haute expression de la justice est, dans l'opinion générale, de la
nature de l'amitié." (1155-a 22-28)
L'amitié utile qu'éprouvent les membres de la communauté politique se parachève par
la pratique de la vertu de libéralité. Critiquant la communauté des biens que Platon
prône dans La République pour la caste des guerriers, Aristote affirme que "les
propriétés doivent en un sens être communes mais d'une façon générale être possédées
à titre privé. D'une part, les intérêts étant distincts ne donneront pas lieu à des plaintes
réciproques et permettront de constants progrès, du fait que chacun s'appliquera à ce
qui est proprement à lui ; et, d'autre part, le sentiment désintéressé sera satisfait si
l'usage des fruits est rendu commun, conformément au proverbe qu'entre amis tout est
commun" (1263-a 25-30). La libéralité est cette vertu qui conduit chaque chef de
famille à considérer les éléments de son patrimoine comme étant communs avec
autrui, bien sûr les membres de sa famille, mais aussi ses concitoyens qui deviennent
ainsi des amis : il procédera à des échanges ou, mieux encore, si son patrimoine le lui
permet, il en donnera les éléments que lui-même et sa famille n'utilisent pas. La
pratique de la libéralité joue ainsi un rôle fondamental dans la distribution des biens
extérieurs nécessaires à la vie et parachève l’amitié utile qui unit les membres de la
cité.
13) Le bien ultime de la cité : s’entraider dans la vertu
L’amitié utile ne suffit pas à parfaire la communauté rassemblée en cité par l’échange
des biens extérieurs nécessaires à la vie. "Il n'y a en effet, précise Aristote, qu'une
chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux : le fait que seuls ils
aient la perception du bien et du mal, du juste et de l'injuste et des autres notions de ce
genre. Avoir de telles notions en commun, c'est ce qui fait une famille ou une cité."
(1253-a 12) Il faut donc à la communauté des hommes une amitié plus parfaite que
l’amitié utile, "celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu, car ces
amis-là se souhaitent pareillement du bien les uns aux autres en tant qu'ils sont bons
par eux-mêmes" (1156-b 7). Et loin de se contenter de se souhaiter du bien, les
véritables amis s’entraident dans la vertu.
Il importe, pour ce faire, que chacun puisse "recevoir une éducation et des habitudes
d'hommes de bien, et ensuite passer son temps dans des occupations honnêtes et ne
rien faire de vil" (1180-a 15-22). La loi est d’un réel secours car elle est investie de "la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%