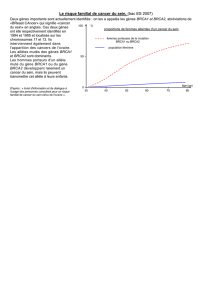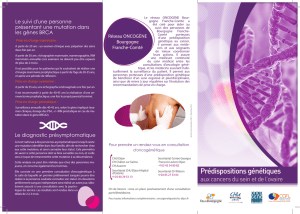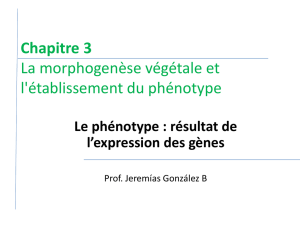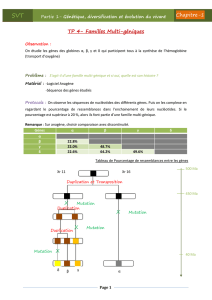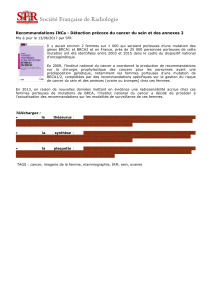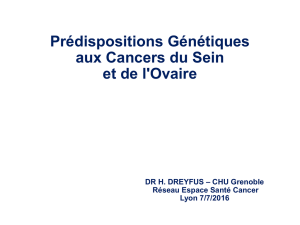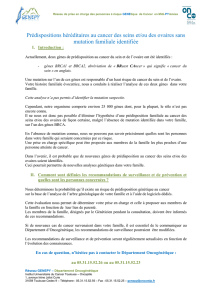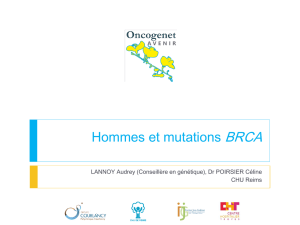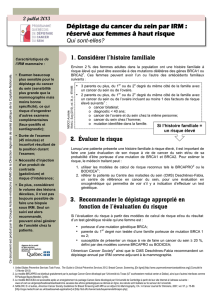Détection d’une mutation incidente PALB2 d’une recherche de mutations BRCA

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 3 - juillet-août-septembre 2013
144
Cas clinique
Détection d’une mutation incidente
du gène PALB2 à l’occasion
d’une recherche de mutations
constitutionnelles des gènes BRCA
par séquençage de nouvelle génération
Next generation sequencing for BRCA germline mutation screening
with incidental finding of PALB2 mutation
D. Lafon1, F. Bonnet1,2, M. Longy1,2, N. Sévenet 1,2*
Contexte clinique et diagnostic
moléculaire des gènes BRCA1 et BRCA2
Histoire de la maladie, arbre généalogique
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 52 ans,
adressée à la consultation d’oncogénétique de l’institut
Bergonié par sa radiothérapeute, pour un avis sur une
récurrence familiale de tumeurs malignes. La patiente a
récemment développé une tumeur du sein correspon-
dant à un carcinome canalaire infiltrant moyennement
différencié de grade II, RH−, diagnostiqué lors d’une
mammographie systématique. Le traitement, conser-
vateur, a associé une tumorectomie, un prélèvement
des ganglions sentinelles, une chimiothérapie et une
radiothérapie. À l’interrogatoire, aucun antécédent per-
sonnel n’a été noté. Sur le plan généalogique, la patiente
a un fils en bonne santé et fait partie d’une fratrie de 5
au sein de laquelle 1 de ses frères est décédé durant
l’adolescence de cause autre que tumorale, et 2 de ses
sœurs, âgées de 52 et 56 ans, qui ont chacune développé
un cancer du sein (figure 1). En ce qui concerne la lignée
paternelle, 3 personnes ont présenté une pathologie
tumorale maligne, à savoir le père de la patiente, décédé
à 75 ans d’une rechute de maladie de Hodgkin diagnos-
tiquée 25 ans plus tôt, un oncle paternel, également
décédé d’une maladie de Hodgkin, et enfin un cousin
germain de la patiente, décédé à 53 ans d’un cancer
bronchopulmonaire diagnostiqué 2 ans auparavant. En
ce qui concerne la lignée maternelle, 2 personnes ont
présenté une pathologie tumorale maligne, à savoir la
mère de la patiente, décédée à 65 ans de l’évolution d’une
tumeur ovarienne correspondant à un adénocarcinome
à cellules claires, diagnostiqué 1 an plus tôt, et le même
cousin germain que précédemment. Il est donc possible
d’individualiser 2 lignées familiales caractérisées par
une importante récurrence de tumeurs malignes ; c’est
à la branche maternelle qu’il faut s’intéresser en priorité
dans l’hypothèse diagnostique d’un syndrome sein-
ovaire, la plupart de ces syndromes étant en rapport
avec la transmission d’une mutation des gènes BRCA1
ou BRCA2. Le conseil génétique est effectué auprès de
la patiente, qui confirme sa décision de s’engager dans
une démarche de recherche de mutation.
Recherche première
La recherche première de mutation constitutionnelle
des gènes BRCA est effectuée par une technique de
Figure 1. Arbre généalogique de la famille de la patiente. L’âge au diagnostic est indiqué en rouge.
Hodgkin
60 ans
P : première consultation ; CS : cancer du sein ; CP : cancer du poumon; COv : cancer de l’ovaire ;
Hodgkin : maladie de Hodgkin.
Hodgkin
50 ans
COv
64 ans
3
CS
55 ans CP
51 ans
CS
52 ans
CS
51 ans
?
P
Cas index
1. Laboratoire de géné-
tique moléculaire, unité
d’oncogénétique, institut
Bergonié, Bordeaux.
2.Inserm U916, université
Bordeaux-Ségalen, institut
Bergonié, Bordeaux.
* Rédacteur et corres-
pondance : N. Sévenet
(n.sevenet@bordeaux.
unicancer.fr) ; observation
clinique et relecteur :
M.Longy.

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 3 - juillet-août-septembre 2013
145
Détection d’une mutation incidente du gène PALB2 à l’occasion d’une recherche de mutations
constitutionnelles des gènes BRCA par séquençage de nouvelle génération
1.
Caux-Moncoutier V, Castera
L, Tirapo C et al. EMMA, a cost-
and time-effective diagnostic
method for simultaneous
detection of point mutations
and large-scale genomic
rearrangements: applica-
tion to BRCA1 and BRCA2 in
1,525 patients. Hum Mutat
2011;32:325-34.
2. Chirurgie prophylactique
des cancers avec prédis-
position génétique. Coll.
Recommandations & référen-
tiels. Boulogne-Billancourt :
INCa, décembre 2009.
3. Walsh T, Lee MK, Casadei
S et al. Detection of inherited
mutations for breast and
ovarian cancer using geno-
mic capture and massively
parallel sequencing. PNAS
2010;107:12629-33.
4.
Sevenet N, Lafon D, Dupiot-
Chiron J et al. Targeted
resequencing in oncogenetics:
developing a new approach
for molecular diagnostics.
San Antonio Breast Cancer
Symposium 2012, Cancer Res
2012;72(24, Suppl. 3):abstr.
PD05-04.
5. Houdayer C, Caux-
Moncoutier V, Krieger S et al.
Guidelines for splicing analysis
in molecular diagnosis derived
from a set of 327 combined in
silico/in vitro studies on BRCA1
and BRCA2 variants. Hum
Mutat 2012;33:1228-38.
6. Southey MC, Teo ZL,
Winship I. PALB2 and breast
cancer: ready for clinical
translation! Appl Clin Genet
2013;6:43-52.
Références
criblage des mutations ponctuelles appelée “EMMA”
(Enhanced Mismatch Mutation Analysis), dont le principe
et la mise en œuvre sont proches de ceux de la tech-
nique HRM (High-Resolution Melting), à savoir la détec-
tion automatisée d’espèces multiples en PCR, et donc de
variants nucléotidiques, confirmés en séquençage par
la méthode de Sanger (1). Aucune mutation ponctuelle
constitutionnelle délétère n’est caractérisée. Seul un
variant faux-sens situé dans l’exon 10 du gène BRCA2 et
nomenclaturé c.1460C>A ; p.Ala487Glu est caractérisé.
Ce variant, rapporté 6 fois au niveau national (base
UMD BRCA2 : www.umd.be/BRCA2) et 12 fois au niveau
international (base BIC : research.nhgri.nih.gov/pro-
jects/bic/Member/index.shtml) est considéré comme
un variant de signification inconnue. Il est décrit dans
la base dbSNP (rs56390402), mais aucune fréquence
allélique ne lui est associée. Les logiciels de prédiction
de pathogénicité (Align GVGD, SIFT, Mutation Taster,
PolyPhen-2) prédisent qu’il serait dénué d’implication
pathogénique. Le résultat est présenté à la patiente ;
le variant de BRCA2 caractérisé n’est pas impliqué dans
la récurrence familiale de tumeurs malignes de cette
famille. Le maintien d’une surveillance annuelle systé-
matique par mammographie et échographie mammaire
est indiqué. La poursuite des investigations moléculaires
est recommandée par l’analyse des gènes BRCA chez
une des 2 sœurs atteintes.
Exploration du cas de la sœur atteinte
d’un cancer du sein
Cette femme âgée de 52 ans a présenté, à l’âge de
51 ans, une tumeur du sein droit correspondant his-
tologiquement à un carcinome canalaire infiltrant peu
différencié de grade III, RH+. Un traitement conserva-
teur par tumorectomie et prélèvement du ganglion
sentinelle a été effectué, suivi d’une chimiothérapie
puis d’une radiothérapie.
La recherche première de mutation constitutionnelle
des gènes BRCA entreprise chez la sœur du cas index
ne détecte aucune mutation délétère des gènes BRCA.
Seul le variant faux-sens de l’exon 10 du gène BRCA2
identifié précédemment chez la sœur est retrouvé.
Malgré l’absence de mutation délétère prouvant un
syndrome de prédisposition héréditaire, l’implica-
tion d’autres gènes que BRCA1 et BRCA2 est suspec-
tée, et la recommandation d’une prise en charge des
risques tumoraux mammaire et ovarien est proposée
à la patiente du fait du contexte généalogique. Pour
prévenir le risque ovarien, une annexectomie bilaté-
rale prophylactique postménopausique est indiquée.
Concernant le risque mammaire, une surveillance
annuelle par mammographie et échographie mam-
maire est indiquée, qui pourra être complétée d’une
IRM mammaire 1 an sur 2 (2).
Séquençage de nouvelle génération en
phase diagnostique. Analyse du cas index
L’implantation en mai 2012 au laboratoire de génétique
moléculaire de l’institut Bergonié du séquençage de
nouvelle génération (Next-Generation Sequencing [NGS])
à visée diagnostique en oncogénétique a nécessité une
phase expérimentale de validation, pendant laquelle
202 échantillons d’ADN constitutionnel des patient(e)s
pris(es) en charge en consultation d’oncogénétique
ont fait l’objet d’une recherche de mutation consti-
tutionnelle des gènes BRCA par une technique de cri-
blage EMMA et par NGS en parallèle (3). Dans ce cadre,
l’échantillon d’ADN constitutionnel du cas index a été
étudié par NGS (cf. Fiche technique, p. 139). La banque
de capture génomique couvre les 451 exons et régions
juxta-exoniques de 25 gènes. Ces gènes ont été groupés
en 2 catégories selon les syndromes de prédisposition
héréditaire dans lesquels ils sont le plus impliqués (cf.
Fiche technique, p. 139) : 14 gènes pour les syndromes de
prédisposition héréditaire au cancer du sein et/ou des
ovaires (groupe HBOC) et 11 gènes pour les prédisposi-
tions héréditaires aux cancers colorectaux (polyposiques
et non polyposiques), le syndrome de Gorlin et d’autres
gènes de la cascade de transduction du signal (groupe
OTHER) [4]. L’alignement et l’analyse des données
brutes de séquençage de l’ADN constitutionnel du cas
index ont permis de détecter un total de 24 270 variants
nucléotidiques sur les 25 gènes étudiés. Les étapes
de filtrage de ces variants ont porté tout d’abord sur
la qualité et la quantité des séquences obtenues, puis
sur la restriction aux régions génomiques cibles avec
exclusion des variants intergéniques et des séquences
profondes en amont et en aval des séquences codantes,
et, enfin, sur leur fréquence allélique et la sélection
des transcrits de référence. Ces étapes ont permis de
restreindre le nombre de variants d’intérêt inter-
prétables biologiquement au nombre de 45 pour
les gènes du groupe HBOC et de 43 pour les gènes
du groupe OTHER. Ainsi, pour BRCA1, 7 variants sont
caractérisés, correspondant tous à des polymorphismes
en déséquilibre de liaison et, pour BRCA2, 6 variants,
correspondant tous à des polymorphismes connus, à
l’exception du variant faux-sens de l’exon 10 de BRCA2
précédemment caractérisé. Ces résultats confirment
donc les variants détectés en EMMA. Parmi les variants
détectés sur les autres gènes, il est noté une substitu-
tion nucléotidique sous forme de transversion G>T,

Correspondances en Onco-Théranostic - Vol. II - n° 3 - juillet-août-septembre 2013
146
Cas clinique
Publi-Communiqué
Vers une amélioration de la classification des gliomes
et l’aide à l’orientation thérapeutique
En France, chaque année 6 000 cas de tumeurs cérébrales primaires sont diagnostiqués, le gliome malin représentant la
moitié d’entre elles avec 5 cas pour 100 000 habitants. Le diagnostic conventionnel repose sur des techniques d’imagerie
et la classification OMS basée sur une évaluation histopathologique. Cette classification demeure néanmoins limitée de part
une large variabilité inter- observateurs en microscopie et une forte hétérogénéité clinique au sein de chaque sous-groupe
histologique.
Le traitement des gliomes est basé sur une combinaison de chirurgie, radiothérapie, et chimiothérapie.
La résection maximale, quand elle ne présente pas un risque trop élevé, demeure la première option
de traitement. Les cliniciens sont à la recherche de nouveaux outils moléculaires qui améliorent
le diagnostic et permettent des thérapies plus personnalisées face à cette maladie hétérogène.
Plusieurs biomarqueurs permettant une meilleure classification des gliomes ont été identifiés, tels que
la co-délétion 1p/19q, la méthylation du promoteur du gène MGMT, et plus récemment les gènes
codant pour une enzyme du métabolisme, l’isocitrate déshydrogénase, IDH1 et IDH2. De plus, ces
biomarqueurs pourraient apporter une information permettant un diagnostic histomoléculaire plus
reproductible et précis, et améliorer le pronostic. Ces biomarqueurs ont aussi un potentiel pour orienter
la thérapie dans la prise en charge clinique délicate des gliomes. La méthylation du promoteur MGMT
a été corrélée au résultat de patients atteints de glioblastome traités par chimiothérapie alkylante. La
trousse de QIAGEN, therascreen® MGMT Pyro Kit (réf. 971061) marquée CE-IVD, fournit la mesure
quantitative en temps-réel du niveau de méthylation du promoteur du gène MGMT humain, en utilisant
la technologie du pyroséquençage sur le système PyroMark® Q24 MDx. Utilisé en adjonction à
d’autres facteurs pronostiques, ce test moléculaire fournit aux cliniciens une information les assistant
dans la sélection des patients les plus susceptibles de bénéficier de chimiothérapies.
La fréquence importante des mutations dans les gènes IDH1/2 et leur distribution spécifique au sein
des tumeurs cérébrales font du statut mutationnel IDH1/2 un outil diagnostique de choix pour les
gliomes, et un marqueur pronostique solide. Les mutations d’IDH1 ont été associées à une meilleure
survie des patients atteints de gliome, mettant en évidence la relevance clinique du statut mutationnel.
QIAGEN est fier d’annoncer sa nouvelle trousse marquée CE-IVD therascreen IDH1/2 RGQ PCR
Kit CE (réf. 873011) permettant la détection rapide, sensible et fiable de 12 mutations d’IDH1 et
IDH2 à partir d’ADN provenant d’échantillons de tumeurs cérébrales fixés et inclus en paraffine,
selon une technologie de PCR en temps-réel sur l’instrument Rotor-Gene® Q MDx. En une seule
étape, le test permet de détecter 7 mutations d’IDH1 (au niveau des codons 132 et 100) et
5 mutations d’IDH2 (au niveau du codon 172), et d’identifier 3 mutations majeures, IDH1 R132H,
IDH1 R132C, et IDH2 R172K. Ce test moléculaire supporte la classification des gliomes ainsi que
l’identification des patients de pronostique favorable.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter au 0800 912 965.
Les produits therascreen Pyro sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro validés pour la détection et/ou la quantification en biologie
moléculaire de biomarqueurs impliqués dans la sélection de patients atteints de cancer pour un traitement personnalisé. Les produits therascreen
RGQ PCR sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro validés pour la détection et/ou la quantification en biologie moléculaire de
biomarqueurs impliqués dans la sélection de patients atteints de cancer pour un traitement personnalisé.
Fabricant : QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, Allemagne.
Pour obtenir les dernières informations sur la licence et les clauses de responsabilité spécifiques aux produits, lire attentivement la notice du
kit ou le manuel d’utilisation respectif. Les manuels des kits et manuels d’utilisation QIAGEN sont disponibles à l’adresse www.qiagen.com
ou peuvent être demandés auprès des Services techniques QIAGEN ou du distributeur local.
Marques déposées : QIAGEN®, therascreen®, PyroMark®, Rotor-Gene® (Groupe QIAGEN).
1077459 09/2013 © 2013 QIAGEN, tous droits réservés.
QIAGEN France SAS n 3 avenue du Canada n LP 809 n 91974 Courtaboeuf Cedex n Tel 01 60 920 930
Sample & Assay Technologies
1077459_Advertorial_FR_therascreen2.indd 1 04.09.13 17:04
située en +1 de l’intron 7 du gène PALB2, au niveau du
site donneur d’épissage (figure 2). Cette mutation abolit
le site donneur d’épissage de l’intron 7, conformément à
ce que prédit, notamment, le logiciel MaxEntScan. Cette
mutation d’épissage peut donc être considérée comme
délétère (5). Dans le cadre d’un séquençage exploratoire
à visée informative, cette mutation incidente de PALB2
a été recherchée chez la sœur atteinte du cas index qui
avait fait l’objet d’une recherche première de mutation
des gènes BRCA et a été retrouvée. La co-ségrégation de
cette mutation chez 2 sœurs atteintes est compatible
avec son implication dans la pathologie tumorale
présentée par ces 2 patientes.
Pathogénicité de la mutation du gène PALB2
Le gène PALB2 (Partner and Localizer of BRCA2), qui
a été identifié lors des expérimentations liées à la
recherche de partenaires impliqués dans les com-
plexes protéiques contenant BRCA2, code pour une
protéine impliquée dans la réparation de l’ADN par
recombinaison homologue, dont la fonction consiste
essentiellement en la localisation à la chromatine et
le recrutement au niveau des cassures double-brin
de BRCA2 (6). Cette protéine, qui peut également
être recrutée par BRCA1 lors des dommages causés à
l’ADN, assure alors une fonction de lien entre BRCA1
et BRCA2 lors des étapes de la réparation proprement
dite de l’ADN. Rapidement après sa caractérisation, des
mutations de type perte de fonction ont été décrites,
associées à un risque accru de cancer du sein, et des
mutations bialléliques ont été détectées chez des
patients atteints d’anémie de Fanconi, identifiant un
nouveau groupe de complémentation (FANCN), dans
lequel le risque de cancer de l’enfant est très élevé. Le
risque tumoral de cancer du sein induit par une muta-
tion constitutionnelle à l’état hétérozygote de PALB2
est difficile à estimer au regard du faible nombre de
cas porteurs et des histoires familiales documentées
de façon hétérogène (6). Les études de risque fondées
sur les histoires familiales de cancer du sein mettent en
évidence un risque cumulé de cancer du sein de l’ordre
de 45 % chez les femmes porteuses d’une mutation
de PALB2, ce qui est similaire aux mutations délétères
de BRCA2. Suffisamment d’arguments semblent exis-
ter désormais pour considérer que le risque tumoral
associé à une mutation hétérozygote de PALB2 justifie
une prise en charge clinique à type de dépistage
mammaire rapproché et, donc, l’inclusion de l’analyse
de ce gène dans les éléments du conseil génétique
concernant la prédisposition héréditaire au cancer
du sein.
La description de mutations délétères dans des gènes
autres que BRCA pour les formes familiales de cancer du
sein ou les syndromes sein-ovaire nécessite désormais la
création de bases de données nationales collectant les
résultats des analyses par NGS des situations de prédis-
position héréditaire au cancer. Elle requiert également la
mise en place de groupes nationaux pluridisciplinaires
à même de conduire des études épidémiologiques
permettant d’appréhender les risques tumoraux liés
à la présence d’une mutation touchant les nouveaux
gènes de prédisposition au cancer du sein. Une démarche
concertée pourra alors être définie et des recommanda-
tions nationales de prise en charge pourront alors être
rédigées. ■
Figure 2. Visualisation de la mutation d’épissage de l’intron 7 du gène PALB2 au niveau de l’ADN
génomique du cas index et de sa sœur. A. Visualisation des séquences alignées sur la jonction exon
7-intron 7 de PALB2 sous Alamut version 2.3 (Interactive Biosoftware, Rouen). Les séquences alignées
sont situées en dessous de la représentation du gène. Les taux de couverture sont symbolisés par des
colonnes grises et situés entre les séquences alignées et le gène. La flèche rouge montre la substi-
tution G>T en +1 de l’intron 7. B. Modélisation du retentissement sur le site donneur d’épissage
de cette mutation de PALB2. Les scores des différents logiciels de prédiction de retentissement sur
le site donneur (5’) sont présentés pour la séquence sauvage (au-dessus) et la séquence mutée (en
dessous). Le score du site MaxEntScan est de 11,1 pour le site donneur sauvage et de 0 pour le site
donneur muté. C. Confirmation par séquençage selon la méthode de Sanger de la substitution sur le
site donneur d’épissage de l’intron 7 de PALB2 détectée en NGS. D. Détection par séquençage selon
la méthode de Sanger de la mutation d’épissage familiale chez la sœur du cas index.
A
BC
Les auteurs déclarent
nepas avoir de liens
d’intérêts.
1
/
3
100%