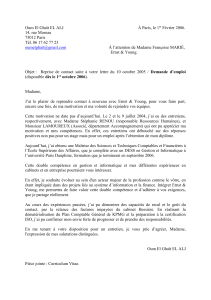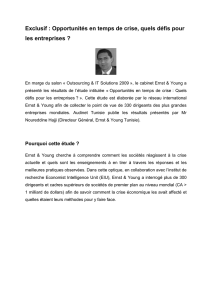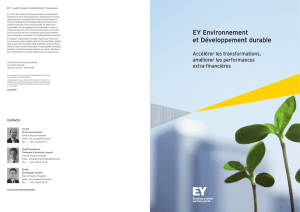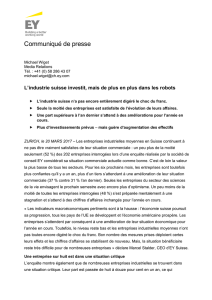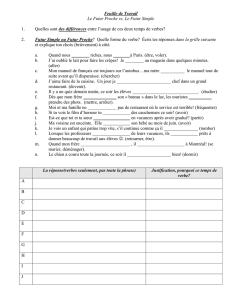Les Défis de la Gestion des Connaissances en Contexte Interculturel

Université LAVAL Faculté des Sciences de l’Administration
Essai de Maîtrise en Administration des Affaires (MBA)
Les Défis de la
Gestion des Connaissances
en Contexte Interculturel
Sous la supervision de
Monsieur Gérard VERNA
Par Romain Tursi (03 262 201)
Québec, le 31 juillet 2006

1
Résumé
Dans l’élan de la mondialisation, les organisations sont plus fréquemment conduites à
opérer dans des contextes multiculturels. Cela conduit nécessairement à mettre en relation
des individus qui ont des valeurs distinctes et qui s’expriment différemment tant à travers
leurs langues que par leurs comportements. Parallèlement, les pratiques de gestion des
connaissances sont en constante diffusion dans les organisations, une présence croissante
qui s’inscrit dans une évolution vers l’économie de la connaissance.
La gestion des connaissances pose un certain nombre de défis qui se trouvent renforcés par
le contexte interculturel qui lui-même vient ajouter ses propres défis. C’est du jumelage de
ces défis que naît la complexité du tout ainsi formé : la gestion des connaissances en
milieu interculturel. Deux principaux types d’obstacles liés aux contextes interculturels et
influençant la gestion des connaissances ont été identifiés : les barrières linguistiques, et
les différences de comportement et de conception des relations humaines.
Chez Ernst & Young, nous avons vu que la standardisation des procédés, des qualifications
et savoirs et des normes, ainsi qu’une approche de codification des connaissances semblent
être deux des pratiques qui permettent à cette firme de faire face aux défis de
l’interculturalité en gestion des connaissances. Il semble que l’on puisse dire qu’elles
permettent de limiter les effets des barrières interculturelles en créant un contexte commun
à tous les collaborateurs. Ainsi, loin d’annihiler les obstacles de l’interculturalité, le but
d’Ernst & Young semble être de les contourner afin de tirer certains profits de sa diversité
culturelle et de la taille de son réseau sans pour autant pâtir des barrières qu’elles
occasionnent en termes de dialogue interculturel.
Mots-clés :
Gestion des connaissances, interculturalité

2
Préface
Pourquoi aborderons-nous la question de la gestion des connaissances en contexte
interculturel ? Ce choix résulte d’une succession d’expériences personnelles qui m’ont
conduit à m’intéresser tour à tour à la gestion des connaissances, puis aux questions du
partage des connaissances en contexte interculturel.
Mon intérêt pour la gestion des connaissances est né en 2002 lorsque je dirigeais Junior
Conseil Provence, entreprise étudiante de conseil en gestion de la Maîtrise en Sciences de
Gestion de l’Université de la Méditerranée (France). Une des particularités de Junior
Conseil Provence en tant qu’organisation est de connaître une rotation permanente de ses
participants et de sa direction. En effet, au rythme des sorties de promotions de la Maîtrise,
elle voit ses membres se renouveler perpétuellement. Ainsi, à chaque vague de départs, ce
sont de nombreuses connaissances qui s’en vont. C’est sur la base de ce constat, et dans
l’amertume de n’avoir pas pu lors de ma prise de fonction m’appuyer sur les deux
précédentes années d’expérience de l’association que, je me suis intéressé à la gestion des
connaissances.
Ce sont ensuite mes expériences personnelles en tant qu’étudiant étranger au Canada, et
plus particulièrement à l’Université Laval (Québec) et à McMaster University (Ontario)
qui ont éveillé ma curiosité sur la dimension interculturelle de la gestion des
connaissances. Outre la très ostensible barrière de la langue lors des cours dispensés en
anglais, une barrière bien plus perturbante et pourtant bien moins visible s’est présentée à
moi : l’absence de référents pour saisir l’intégralité des connaissances enseignées. En effet,
fréquemment le recours aux exemples utilisés par les professeurs pour illustrer leurs
propos ne m’était d’aucun secours. Et pour cause, il s’agissait fréquemment d’exemples
issus d’organisations, ou encore de produits qui m’étaient plus ou moins inconnus, car
propres à l’environnement canadien, voire nord américain.
Ainsi, dans le cadre du programme de MBA Gestion Internationale mon intérêt pour la
gestion des connaissances en contexte interculturel en a fait un sujet d’étude tout désigné
pour cet essai.

3
Remerciements
En préambule à cet essai je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mon Directeur
d’essai, Monsieur le Professeur Gérard Verna pour son encadrement et ses précieux
conseils.
Je remercie aussi Monsieur le Professeur Nabil Amara pour l’aide et les recommandations
méthodologiques qu’il m’a apportés.
Je souhaite saluer la qualité des commentaires de Mademoiselle Julie Ghez tant sur le fond
que sur la forme de cet essai.
Enfin, j’adresse également mes remerciements à Mademoiselle Anne-Aurélie Sappin pour
la minutie de son travail de correction.

4
Table des matières
1. Introduction...................................................................................................................6
2. Les défis inhérents à la gestion des connaissances........................................................9
2.1. Terminologie et définitions ....................................................................................10
2.1.1. Terminologie..................................................................................................11
2.1.2. Définitions.....................................................................................................13
2.2. Les caractéristiques des connaissances organisationnelles ....................................19
2.2.1. Les formes des connaissances organisationnelles ...........................................20
2.2.2. Le processus de création des connaissances organisationnelles.......................22
2.3. La gestion des connaissances.................................................................................26
2.3.1. Raisons d’être de la gestion des connaissances ...............................................27
2.3.2. Le climat collaboratif, condition nécessaire au partage des connaissances ......32
2.3.3. L’arbitrage création / conservation .................................................................35
3. Des défis renforcés par les difficultés intrinsèques à l’interculturel..........................39
3.1. Les a priori de l’interculturalité.............................................................................40
3.1.1. Le choc des cultures.......................................................................................40
3.1.2. La barrière des langues...................................................................................46
3.2. Les dimensions cachées de l’interculturalité ..........................................................57
3.2.1. Les cinq dimensions d’Hofstede.....................................................................57
3.2.2. La communication non-verbale selon Hall et Hall ..........................................63
4. Étude de cas : Ernst & Young.....................................................................................69
4.1. Méthodologie.........................................................................................................69
4.1.1. Observer quoi ?..............................................................................................69
4.1.2. Observer qui : pourquoi Ernst & Young ? ......................................................70
4.1.3. Observer comment : le choix de l’étude de cas...............................................72
4.2. Analyse et interprétations ......................................................................................74
4.2.1. Introduction à Ernst & Young ........................................................................74
4.2.2. Gestion des connaissances et interculturalité chez Ernst & Young..................84
5. Conclusions..................................................................................................................89
5.1. Synthèse.................................................................................................................89
5.2. Limites de l’étude...................................................................................................91
5.3. Ouvertures.............................................................................................................92
6. Bibliographie ...............................................................................................................93
7. Médiagraphie...............................................................................................................99
8. Annexes......................................................................................................................101
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
1
/
108
100%