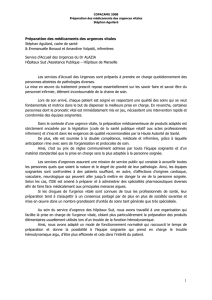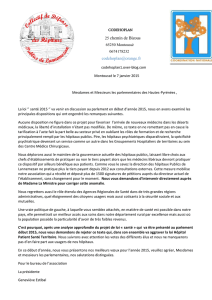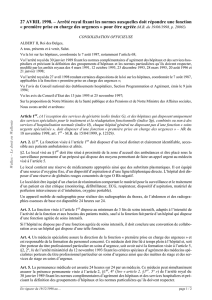Inégalités en santé: ne pas avancer, c'est reculer Étude MC prothèse totale

Inégalités en santé: ne pas avancer,
c'est reculer
La lutte contre les inégalités en santé constitue un grand
dé. Les MC sont prêtes à le relever !
Enquête Énéosport
La mise en mouvement des aînés représente
un des facteurs de protection important per-
mettant d’avancer en âge tout en maintenant
une qualité de vie optimale.
13,8%
21,1%
27,9%
20,0%
21,4%
18,7%
12,6%
26,0%
21,5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Ensemble des
membres MC de l'intervention
majorée
Bénéciaires Bénéciaires
du revenu
d'insertion
sociale
Handicapés Invalides Familles
monoparentales
chômeurs de
longue durée
chômeurs de
longue durée
20-24 ans
chômeurs de
longue durée
25-29 ans
ensemble des membres MC
Proportion de membres de la MC qui ont eu recours aux urgences hospitalières au
moins une fois au cours de l’année 2013 – quelques critères sociaux
Ce sont les jeunes enfants, les personnes âgées, des populations plus préca-
risées ou ayant moins de revenus, comme les bénéciaires de l’intervention
majorée, du revenu d’insertion sociale, les invalides qui ont davantage recours
aux urgences hospitalières.
Étude MC prothèse totale
de hanche
Le département R&D de l’Alliance nationale des
Mutualités chrétiennes (MC) a analysé 85.000
prothèses totales de hanche (PTH) depuis 1990.
Les forces et les limites du modèle d’analyse ont
été analysées avec les chirurgiens, les hôpitaux
et les associations scientiques. Les résultats
ont été présentés dans des congrès et dans les
hôpitaux. Ils ont été publiés dans des revues
scientiques, MC-Informations et sur Internet.
La dernière étape de la démarche est de les présenter
aux patients et au grand public. C’est ce que nous
faisons dans cet article, pas seulement pour les coûts
des soins, mais aussi pour les éléments de qualité des
soins que nous avons pu récolter.
143,2
117,7
104,7
91,7
72,6
132,8
113,2
105,4
92,0
80,0
70
80
90
100
110
120
130
140
150
1. inférieurs 2. bas 3. moyens 4. hauts 5. supérieurs
classes de secteurs statistiques de résidence
Indice standardisé (pour l'âge, le sexe et la région)
devenir invalide - Belgique 2012
devenir invalide - Belgique 2006
population de référence
population de référence (indice =100) :
titulaires MC entre 20 et 64 ans
Pr
oportion de réponses des répondants
afliés à énéoSport, en fonction des
buts à pratiquer une activité sportive
(plusieurs réponses étaient possibles)
- Bien-être : 80%
- Esthétique: 8%
- Santé (sans prescription): 68%
- Santé (avec prescription): 5%
- Créer relations: 53%
Devenir invalide
262
décembre 2015
MC-Informations
Analyses et points de vue
Périodique trimestriel de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes
La
solidarité,
c’est bon pour la santé.
MUTUALITE
CHRETIENNE
Étude urgences hospitalières

2
L’une des principales missions de notre service d’étude
consiste à examiner ce qui « se passe » dans le domaine
complexe des soins de santé et de l’incapacité de travail dans
notre pays, et de le rendre accessible et transparent pour
le lecteur. En 2015, la société n’admet plus qu’un chercheur
protège ses données vis-à-vis du monde extérieur, à moins
que ce ne soit pour des raisons de protection de la vie privée.
C’est ainsi qu’un juge a conrmé, lors d’un procès intenté
par Test-Achats contre l’État belge, que le Service public
fédéral Santé publique est obligé de révéler le résultat de ses
inspections de l’hygiène des mains dans les hôpitaux, plutôt
que de les consigner dans un vague rapport. La transparence
est nécessaire à l’amélioration de la qualité. C’est ainsi que
dans de nombreux pays, on a observé que la qualité dans les
hôpitaux ne s’améliorait qu’après la publication des résultats
hôpital par hôpital. À l’étranger, la «public disclosure» est
acceptée depuis longtemps et L’International Consortium for
Health Outcomes Measurement (ICHOM) indique d’ailleurs
clairement que la transparence est une composante
essentielle de la promotion de la qualité.
Voilà 15 ans, la Mutualité chrétienne publiait pour la première
fois les chiffres concernant la variabilité entre hôpitaux des
résultats des opérations de prothèses de hanche planiées.
La collaboration fut intense avec le secteur et les chiffres
ont été régulièrement actualisés. Nous avons énormément
investi dans le feed-back aux hôpitaux. Mais de nombreuses
personnes nous ont reproché de ne pas révéler les chiffres
nominalement, hôpital par hôpital. Les membres de la MC
pouvaient toutefois contacter leur médecin-conseil pour
demander des informations concernant les hôpitaux de
leur région. Vu la tendance internationale à la transparence
dans les soins de santé et le fait que nous estimons que
non seulement nos membres, mais également les médecins
généralistes, ont droit à ces informations, nous publions
maintenant pour la première fois les données par hôpital de
notre étude sur les prothèses de hanche. La transparence
permet aux hôpitaux de comparer leur résultat à celui des
autres hôpitaux. Espérons qu'elle réduira la variabilité entre
hôpitaux et permettra d’améliorer la qualité, comme c’est le
cas à l’étranger. On parle en anglais à ce sujet de «Sunshine
disinfects».
Dans le présent numéro, nous examinons également le prol
des personnes qui se rendent aux urgences, avec une attention
particulière pour les disparités régionales. Une comparaison
internationale révèle que le recours aux urgences n’est pas
signicativement plus élevé en Belgique. Nous observons que
ce sont surtout les défavorisés, les invalides, les jeunes enfants
et les personnes âgées qui se rendent aux urgences. Dans les
deux tiers des cas, ils le font de leur propre initiative sans y être
envoyé par un médecin. D’autre part, on constate également
que posséder un DMG ou être inscrit dans un centre de santé
de quartier n’inuence pas les résultats. Autre fait marquant,
44% des visites ont lieu la nuit, le week-end ou lors des jours
fériés.
Une autre étude met en lumière les inégalités de santé en 2012,
en les comparant à celles mesurées en 2006. Les résultats
de cette étude se basent sur une analyse des données de
consommation de soins (nos données de remboursement)
par groupes sociaux (déterminés sur base des revenus par
secteur statistique). De nombreux indicateurs sont restés
stables entre 2012 et 2006, avec parfois même une amélioration,
comme l’augmentation du DMG, de l’usage des médicaments
bon marché et du tiers payant social. Pour d’autres indicateurs,
on constate un accroissement des inégalités, comme pour
les admissions en psychiatrie, l’usage des antidépresseurs
et le risque de devenir invalide. Cet accroissement survient
malgré une attention accrue pour la problématique et une
série de mesures positives pour combler le fossé en matière
de santé. Lutter contre les inégalités de santé reste donc un
dé majeur pour les prochaines années, d’autant plus à l’heure
de l’austérité budgétaire.
Outre l’analyse des données de remboursement, interroger
directement de nos membres est certainement une manière
d’accéder à une source d’informations majeure. Par exemple,
tout le monde sait à quel point la prévention des maladies et
le rôle de l’activité physique dans ce contexte est importante.
Chez les personnes âgées aussi, l’activité physique est le
meilleur «médicament» préventif. An de mener des actions
de promotion et d’évaluation de ce constat, il est évidemment
nécessaire de mesurer et de savoir à quel point les ainés font
du sport. Une enquête auprès de nos membres, en collaboration
avec l’UCL et Énéosport, permet de situer le niveau sportif des
seniors et quelles sont les incitations ou les obstacles à leur
pratique. L’aspect santé, le bien-être, la condition physique
et les relations sociales sont des incitants majeurs pour les
personnes âgées, que nous pouvons reprendre dans des
campagnes de promotion.
Michiel Callens
Directeur du département R&D
Éditorial
2MC-Informations 262 • décembre 2015

Étude MC prothèse totale de hanche
24 ans d’analyses : l’étape suivante d’une collaboration
transparente et équilibrée entre soignants et soignés et
entre hôpitaux et mutualités
Xavier de Béthune, Katte Ackaert – Département Recherche et Développement
Résumé
Le département R&D de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (MC) a analysé 85.000 prothèses
totales de hanche (PTH) depuis 1990. Les forces et les limites du modèle d’analyse ont été analysées avec les
chirurgiens, les hôpitaux et les associations scientiques. Les résultats ont été présentés dans des congrès
et dans les hôpitaux. Ils ont été publiés dans des revues scientiques, MC-Informations et sur Internet.
La dernière étape de la démarche est de les présenter aux patients et au grand public. C’est ce que nous
faisons dans cet article, pas seulement pour les coûts des soins, mais aussi pour les éléments de qualité des
soins que nous avons pu récolter.
L’ambition de la MC est que la transparence accrue autour de la qualité des soins encourage les collaborations
responsables entre tous les acteurs du système de santé et renforce la qualité des soins et la sécurité des
patients à travers des relations plus équilibrées et mieux informées entre eux et ceux qui les soignent.
C’est pourquoi nous avons inclus dans l’article les premières réactions que nous avons reçues de la part des
hôpitaux. Le dialogue ne fait que commencer...
Mots-clés : transparence, prothèse totale de hanche, coûts, durée de survie d’une prothèse, révision, qualité
1. Introduction
La MC publie régulièrement les résultats d’études diverses qui
mettent en valeur plusieurs éléments du système de santé de
notre pays. Les mutualités sont en effet les seules organisations
qui disposent de banques de données qui peuvent décrire
les soins aux mêmes patients dans des contextes de soins
différents. L’information proposée est donc souvent nouvelle et
pertinente.
Un des principaux sujets récurrents de ces analyses sont les
pratiques de soins, principalement hospitalières, liées aux
Prothèses Totales de Hanche (PTH). Trois séries d’études
consécutives décrivent à ce stade-ci, 24 années de pratique. La
possibilité de suivre le patient après sa sortie de l’hôpital et à
plus long terme, de savoir si la PTH primaire est révisée, même
quand cela ne se passe pas dans le même hôpital, représentent
deux informations originales de nos études.
Nous avons décidé, à partir de maintenant, de compléter nos
résultats par l’identication des institutions qui dispensent
les soins. Nous revenons en détail sur la justication de ce
choix dans l’article qui suit, qui reprendra aussi, indicateur
par indicateur, les hôpitaux qui se distinguent nettement des
autres, dans les deux sens du terme.
3
MC-Informations 262 • décembre 2015

2. Les études PTH de la MC
C’est au tournant du siècle que la MC organise une première
conférence de presse et publie un rapport circonstancié sur
les soins liés aux PTH électives1 en Belgique. Les résultats de
l’étude sont assez clairs:
• les soins en Belgique sont comparables à ce qu’on trouve
dans la littérature internationale, où les pays scandinaves
occupent néanmoins le haut du pavé;
• comme à d’autres endroits2, la variabilité des soins d’un
hôpital à l’autre est très importante, avec certains domaines
de surconsommation manifeste, comme la transfusion
sanguine;
• parmi les modèles de PTH disponibles, la prothèse totalement
cimentée monobloc présente les meilleurs résultats en
termes de survie et coûte le moins cher.
Dans la mesure où sufsamment de données étaient
disponibles, les résultats par hôpital et par chirurgien
ont ensuite été mis à disposition des intéressés de façon
condentielle à travers un module interactif sur Internet. Une
dizaine d’années plus tard, la MC met à jour ses données3 4 5 6
La variabilité des pratiques reste un dé majeur, mais
certaines
surconsommations ont été réduites. C’est
principalement le cas de la transfusion sanguine dont le
taux est passé de 60% à 25% des patients opérés. La durée
de séjour a été réduite de moitié environ et les coûts pour
l’assurance maladie-invalidité (AMI) n’ont pas augmenté
malgré une ination de 17%. Au
niveau des prothèses, les
prothèses non cimentées ont maintenant une part de marché
de 65%. Les professionnels ont donc globalement nié les
résultats de la première étude au sujet des types de prothèses.
En même temps, la survie des prothèses à dix ans s’est
améliorée de 92% à plus de 93%. Il n’y a donc manifestement
pas péril en la demeure.
En septembre de cette année, nous avons rajouté quatre
années à ces analyses en publiant les résultats d’une nouvelle
mise à jour des données. Ceux-ci montrent que plusieurs
améliorations perçues approchent de leurs limites. La durée
de séjour s’est réduite d’un jour en quatre ans et le taux de
transfusion est à 17%. Les coûts totaux connaissent une hausse
modérée. La survie des prothèses, dont 80% sont aujourd’hui
des modèles non cimentés, a augmenté à 94,58%.
Mais, malgré ces améliorations signicatives en 15 ans,
la variabilité des pratiques reste un phénomène difcile
à maîtriser. Entretemps, plusieurs initiatives ont vu le jour
pour inciter les prestataires de soins à adopter une politique
de qualité systématique des soins et d’harmonisation des
pratiques. Les contrats qualité-sécurité du Service Public
Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
et Environnement (SPF SPSCAE), la création du KCE (Centre
d’expertise fédéral des soins de santé) et de l’Agence
Intermutualiste (AIM-IMA), la mise en place progressive de
e-Health et plus récemment de healthdata.be (qui intègre
le registre Orthpride ®), la création de plusieurs réseaux
hospitaliers, comme le Réseau Itinéraires Cliniques, le
Réseau Santé Louvain, les Initiatives de Qualité de la
Mutualité chrétienne ou les réseaux qualité-sécurité du
SPF Santé Publique font partie d’une première vague. La
déclaration de politique régionale amande7 – qui promeut
l’accréditation, les indicateurs et un rôle spécique pour
l’inspection -, celle plus récente de la Région wallonne8,
le projet Vlaams Indicatorenproject (VIP²) en Flandre9 et la
création de la Plateforme pour l’Amélioration continue de
la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS) 10
en Belgique francophone représentent une deuxième vague
d’initiatives.
Les choses n’en restent certainement pas là. Les déclarations
récentes de la Ministre de la Santé Publique évoquent la
transparence totale des données et des résultats et un
nancement couplé à ces résultats11.
Il est donc logique que la MC continue à impulser ces évolutions
et d’étude en étude rééchisse aux meilleurs moyens de
présenter les résultats aussi bien aux autorités et aux
prestataires qu’au grand public et surtout aux futurs candidats
à une PTH. Les objectifs étaient et restent:
• d’impulser une dynamique d’amélioration continue de la
qualité des soins;
• de faciliter le choix des soins pour les membres de la MC et
de la société en général;
• de garantir l’utilisation optimale des moyens de la sécurité
sociale.
3. Comparaison des deux dernières études
Nous avons donc d’abord comparé de façon détaillée les
résultats actuels à ceux de l’étude précédente
3 4 6
.
Tous les hôpitaux repris dans cette étude avaient reçu dans
le courant de 2009 leurs données concernant les activités de
2006 et 2007 et concernant la survie des prothèses primaires
unilatérales qu’ils avaient implantées entre 1998 et 2007. En
2011, nous avons mis à jour les données des années 2008 et
2009 et pour la survie à 10 ans des prothèses jusqu’en 2009.
Nous avions ensuite visité 35 hôpitaux entre mars 2010 et février
2011, ensemble avec des médecins -conseils de la MC et des
représentants des associations scientiques d’orthopédie
et de traumatologie5. Chaque visite consistait en un exposé
interactif des résultats sur les principaux indicateurs de l’étude.
Nous avions inclus des hôpitaux avec les résultats les plus
4MC-Informations 262 • décembre 2015

favorables dans ces visites, pour pouvoir proposer des options
réalistes d’amélioration de la qualité aux autres hôpitaux.
Nous avons demandé aux hôpitaux de nous communiquer les
actions qu’ils envisageaient de mener en 2011 pour améliorer
ou maintenir leurs résultats.
Nous avons aujourd’hui actualisé notre étude sur la base des
données 2012-201312. Les analyses de survie des prothèses
portent sur les années 2004-2013.
Nous disposons de données en 2008-2009 et 2012-2013 pour 76
hôpitaux qui avaient opéré plus de 30 patients MC pendant les
deux périodes.
Sauf pour la transfusion (-8%) et les soins intensifs (-4%), les
évolutions sont généralement peu marquées. La durée de
séjour diminue globalement d’un jour. Les coûts médians pour
l’assurance maladie-invalidité augmentent de 2% tandis que
ceux à charge du patient diminuent de 17%.
Ce qui ne change pas, est la variabilité d’un hôpital à l’autre,
comme nous l’avons déjà décrit dans notre article de septembre
201512.
Les différences entre les hôpitaux visités et non visités en
2010-2011 sont trop variables pour être analysées de façon
synthétique. Nous avons comparé les résultats dans leur
ensemble et pour les 5 hôpitaux qui avaient les résultats les plus
favorables et les plus défavorables en 2008-2009 pour chaque
indicateur. Nous avons aussi regardé si leurs plans d’action
avaient eu un impact. Les quelques tendances qui semblent
ressortir de cette analyse généralement qualitative, vu les très
petits nombres, sont toujours contredites par les résultats de
quelques hôpitaux.
A Izegem, à la St. Jozefkliniek, la transfusion faisait partie
du plan d’action de l’équipe que nous avions rencontrée. Le
taux de transfusion s’est, réduit des deux tiers, de 75% à 26%.
Dans un contexte général de réduction des durées de séjour,
les Cliniques St. Joseph à Liège ont réduit de 5 jours la durée
médiane de séjour en service aigu, mais ont rallongé la durée
médiane de séjour globale (service aigu et de revalidation)
de 2 jours. Au Algemeen Ziekenhuis d’Audenarde, le taux de
prestations de soins intensifs a chuté de 47%. Par contre, à
l’hôpital de Veurne, que nous n’avons pas pu visiter, ce taux
d’admission est resté stable autour de 80%! Mais ces quelques
exemples paradoxaux ne reètent pas l’impression générale
d’une amélioration, même si celle-ci reste modérée.
4. Faut-il maintenant rendre nos résultats
transparents?
Clairement, aucune approche ou aucun incitant ne peut à lui
seul inuencer de façon signicative des évolutions globales
dans la prise en charge hospitalière de patients qui subissent
une intervention chirurgicale majeure, même si elle est bien
codiée, comme la pose d’une PTH. Nous avons parcouru
en 15 ans les démarches et les incitants qui reposent sur la
transmission condentielle d’informations. Est-il donc temps
d’ajouter une pierre à l’édice en publiant nominativement
les indicateurs dont nous disposons, pour contribuer à
l’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des
patients?
Malgré les nuances très importantes de la littérature13 14, nous
croyons que oui15 pour plusieurs raisons:
• Tout d’abord, c’est un rôle essentiel des mutualités d’informer
le choix de leurs membres. Pour cela, ces membres ont droit
aux données de la meilleure qualité possible, présentées de
la façon la plus compréhensible possible. C’est clairement
aussi une des conclusions du congrès organisé par la MC
en juin 2015.
• Ensuite, il s’agit d’une évolution sociétale généralisée dans
d’autres domaines d’activité également16. On ne compte
plus les classements nationaux ou internationaux d’écoles,
d’universités, ou même de services de police. Les institutions
les mieux classées n’hésitent d’ailleurs pas à se prévaloir
de leurs bons résultats. Notre idée ici n’est toutefois pas de
publier de classement, mais de fournir l’information la plus
complète possible sur les différents éléments des soins dont
nous disposons.
• Dans le domaine de la santé aussi, les choses évoluent.
Le mouvement des consommateurs – dont le pilier le plus
visible est Test-Achats – demande depuis des années la
publication des résultats de soins. Plusieurs enquêtes
ont déjà été réalisées et publiées par Test-Achats et
d’autres17. Et la justice belge s’est prononcée il y a
quelques années en faveur de la diffusion et publication
de données sur l’hygiène des mains en milieu hospitalier.
Les associations de patients prennent un rôle de plus en
plus actif dans ce débat. En Flandre surtout, la Vlaams
Patiëntenplatform18 est devenue un partenaire préférentiel
des autorités, des institutions académiques et de certains
réseaux hospitaliers.
• Des projets concrets voient le jour pour encourager les
hôpitaux à diffuser publiquement leurs résultats. Le plus
visible de ces projets est le Vlaams Indicatorenproject voor
Patiënten en Professionals19 (VIP²) qui développe depuis
quelques années des indicateurs et des benchmarks
comparatifs. Le projet incite les hôpitaux à publier leurs
résultats sur leurs propres sites web et sur un site central.
5
MC-Informations 262 • décembre 2015
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%