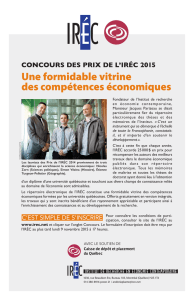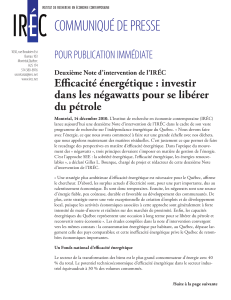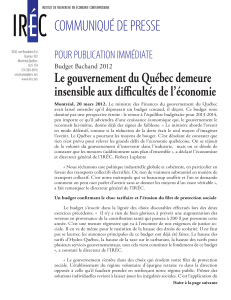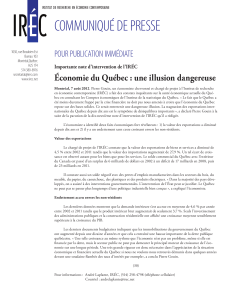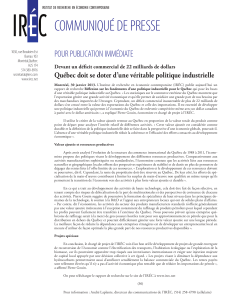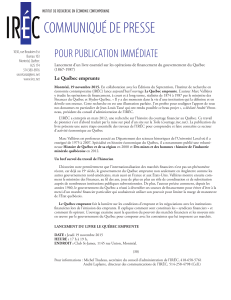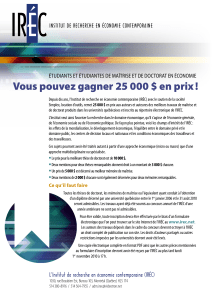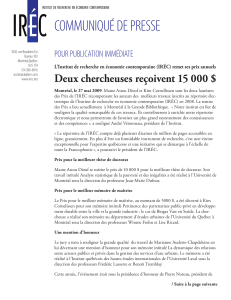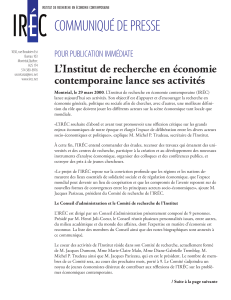BULLETIN DE L’

BULLETIN DE L’
Mensuel publié par l’Institut de recherche en économie contemporaine/Février 2012
SOMMAIRE
À NOTER
❚
Collectif scientifique sur la
question du gaz de schiste
au Québec
Enjeux
écologiques,
sanitaires et
sociaux
Mercredi 14 mars 2012.
collectif-scientifique-gaz-
de-schiste.com
❚
Sommet international des
coopératives Québec 2012
L’étonnant
pouvoir des
coopératives
Du 8 au 11 octobre 2012
se tiendra à Québec le
Sommet international des
coopératives.
www.sommetinter2012.
coop
❚
Revue Vie Économique
Actes du colloque
Le numéro de décembre 2011
de la Revue Vie économique
est entièrement consacré aux
actes du colloque de l’IRÉC
sur le développement minier
au Québec.
www.eve.coop
2/Analyse du CASIQ
3/Rapport de recherche de
l’IRÉC sur les services publics
: un véritable actif pour les
ménages québécois
4/Billets de l’IRÉC sur OIKOS
Blogue
Page Facebook sur le site de
l’IRÉC
Rencontre du 15 mars 2012
pour une planification
triennale
CDP/SUITE À LA PAGE 4
NOS ÉPARGNES ET LE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC
La Caisse de dépôt et placement préfère les
sables bitumineux
La note de recherche de l’IRÉC sur la politique d’investissement de la Caisse de dépôt
et placement du Québec (CDP) a eu des répercussions dans l’univers médiatique.
Non sans raison. En effet, les placements en actions dans trois entreprises du secteur
des sables bitumineux représentent presque le double des placements dans les 45
entreprises québécoises cotées en Bourse présentes dans son portefeuille. « Le bas de
laine des Québécoises et des Québécois est au service du développement des éner-
gies fossiles dans l’Ouest canadien », ont expliqué Éric Pineault et François L’Italien,
chargés de projet à l’IRÉC.
FONDS DE TRAVAILLEUSES ET DE TRAVAILLEURS ET AVANTAGES FISCAUX
Une comparaison avantageuse
Fort bien documentée, la note d’intervention numéro 13 rédigée par l’économiste
Gilles L. Bourque montre que les dépenses fiscales pour les fonds de travailleuses
et de travailleurs ont un impact positif sur l’économie et les emplois qui est sans
commune mesure avec celui lié à ce que les deux ordres de gouvernement octroient à
titre de déductions et d’exemptions sur les gains en capital.
FONDS/SUITE À LA PAGE 2
Les chiffres
sont très
clairs : au 3 août
2011, les place-
ments directs
de la CDP en
actions dans
des entreprises
cotées en bourse
et actives dans
le secteur des
sables bitumineux
représentaient un
investissement de
5,425 milliards
$, soit plus de 14% du portefeuille de la CDP en
actions d’entreprises cotées en bourse. Parmi les dix
En effet, les données de 2005 à 2010 indiquent
que pour un coût de 636 millions $ pour
chaque ordre de gouvernement, les fonds de tra-
vailleuses et de travailleurs ont investi 4,2 milliards
$ directement dans les entreprises québécoises en
plus de placer un montant à peu près équivalent
sur les marchés financiers, majoritairement sous la
forme d’obligations. « En fait, soutient le chercheur
de l’IRÉC, l’analyse coût/bénéfice du crédit d’impôt
pour les
fonds de
travailleuses
et de tra-
vailleurs est
bénéfique
sur le plan
d’une plus
premiers place-
ments en actions
de la CDP, quatre
sont des entrepri-
ses au cœur du
secteur des sables
bitumineux, dont
Enbridge Inc.,
Enbridge LLP
(une filiale de la
précédente), Sun-
cor, et finalement
Canadian Natural
Resources. À
eux quatre, ces
placements représentent plus de 10% du portefeuille
Photo:CDP

Au cours du mois de janvier 2012,
l’IQ-30 a connu une hausse de 2,45%
pour se situer à 1333,13. Vingt-six titres ont
augmenté alors que neuf titres ont baissé.
Cinq des sept secteurs de l’IQ-30 ont connu
une hausse au cours du mois. Le secteur des
Matériaux a connu la plus forte variation
positive soit 10,37%.
Le secteur des Télécommunications a
connu une légère baisse de -3.74%. Durant
le dernier mois, le titre de Bombardier a aug-
IQ-30: Les plus fortes hausses depuis le début de l'année
Prix ($) Prix ($) Variation Pondération (%) Variation
31 déc. 30 janv. du titre au 31 déc. pondérée
Société 2011 2012 % 2011 %
Bombardier 4,06 4,64 14,29 4,62 0,66
Banque Nationale du Canada 72,14 75,22 4,27 8,91 0,38
Transforce 12,95 16,20 25,10 1,49 0,37
Corporation minière Osisko 9,84 11,96 21,54 1,72 0,37
CAE 9,89 11,06 11,83 2,43 0,29
menté de +14,29%. Celui de BCE a affiché
une diminution de - 3.74%.
Depuis le début de l’année, sept des dix
secteurs du TSX composé ont connu une
croissance positive alors que la variation
totale a été de 4,16%. La plus forte variation
positive provient du secteur des Matériaux
avec une croissance de 10,34% depuis le
début de l’année.
Pour des informations plus complètes, voir
l’URL: http://www.iq30-iq150.org/
FONDS/SUITE DE LA PAGE1
2
Tableau comparatif des secteurs
Depuis le vendredi 30 décembre 2011 au mardi 30 janvier 2012
IQ-30 (%) TSX Composé (%)
10–Énergie - 4,92
15– Matériaux 10,37 10,34
20– Industrie 5,36 5,35
25– Consommation discrétionnaire -0,11 3,25
30– Biens de consommation de base 1,15 -0,17
35 – Santé - 8,45
40– Finance 2,57 2,38
45– Technologies de l’information 5,47 4,54
50– Télécommunications -3,74 -1,58
55– Services aux collectivités - -1,20
Variation 2,45 4,16
N.B. Le secteur de l’énergie, de la santé et des services aux collectivités ne sont pas représentés dans l’IQ-30.
ANALYSE DU CASIQ AU 31 JANVIER 2012
L’IQ-30 connaît une hausse de 2,45%
Tableau comparatif des secteurs de l’IQ-30 avec les secteurs de
l’Indice composé S & P/TSX
Depuis le début de l’année au mardi 31 janvier 2012
IQ-30 (%) TSX composé (%)
10– Énergie - 4,92
15– Matériaux 10,37 10,34
20– Industrie 5,36 5,35
25– Consommation discrétionnaire -0,11 3,26
30– Biens de consommation de base 1,15 -0,17
35 – Santé - 8,45
40– Finance 2,57 2,38
45– Technologies de l’information 5,47 4,54
50– Télécommunications -3,74 -1,58
55– Services aux collectivités - -1,20
Variation 2,45 4,16
N.B. Le secteur de l’énergie, de la santé et des services aux collectivités ne sont pas représentés dans l’IQ-30.
grande accessibilité à l’épargne-retraite et de
création d’emplois. L’avantage fiscal est bien
adapté à une “épargne entreprenante” prove-
nant de travailleuses et de travailleurs de la
classe moyenne, car il compense le risque plus
élevé et pour la durée de détention ».
En vingt ans d’existence, ces fonds ont
transformé l’industrie de la finance au Québec.
« Il n’y a pas une seule politique de développe-
ment économique au Québec à laquelle ils ne
sont pas associés en tant qu’institutions propo-
sant du capital patient », soutient le chercheur.
Enfin, les gouvernements recouvrent les
coûts du crédit pour les fonds de travailleuses
et de travailleurs dans un délai de moins de
trois ans, chose qui est loin d’être démontrée
lorsqu’il s’agit des déductions pour gains en
capital ».
Objectifs nébuleux des dépen-
ses fiscales pour gain de capital
Les retombées des gains en capital sont plus
difficiles à quantifier. « Comme le précise la
loi fiscale dans le cas de l’imposition partielle,
dit Gilles L. Bourque, lorsqu’un contribuable
se départit de placements et que ces place-
ments ont fait un rendement, le contribuable
réalise un gain en capital. Dans la très grande
majorité des cas, ces placements ne sont pas
des investissements dans des entreprises. Ils
ne le sont que lorsqu’il s’agit de premier appel
public à l’épargne. Pour sa part, la mesure
de la déduction pour gain en capital vise, en
principe, à favoriser l’investissement dans des
petites entreprises canadiennes et québécoises.
Nous n’avons pas trouvé d’études permettant
d’évaluer les retombées de cette mesure ».
D’autres données troublantes
Les données recueillies par Gilles L. Bour-
que sont encore plus troublantes. Il a quantifié
de façon précise à qui profite la déduction pour
gains en capital. Les trois dernières catégories
de revenu des contribuables les plus riches
ayant des revenus de plus de 100 000 $ soit 1/8
de 1% des contribuables profitent de 676 mil-
lions $ d’avantages fiscaux qui équivalent à 3%
de l’impôt des particuliers au gouvernement
fédéral soit 21 milliards $. En comparaison, le
crédit pour les fonds de travailleuses et de tra-
vailleurs profite à 6,5% des contribuables, issus
des catégories de faible revenu ou de la classe
moyenne. Les avantages fiscaux équivalent à
moins de ½ de 1% de l’impôt des particuliers.
Pour télécharger la note d’intervention
de l’IRÉC, voir l’URL suivante : http://
ww.irec.net/index.jsp?p=76

3
LA VALEUR REDISTRIBUTIVE DE L’OFFRE ET DE LA CONSOMMATION DES SERVICES PUBLICS
Les services publics : un véritable actif pour
les ménages québécois
L’IRÉC a produit un rapport de recherche pour le compte du Secrétariat
intersyndical des services publics (SISP) qui établit la valeur des services
consommés par les ménages et les entreprises et mesure l’effet de redistribu-
tion de ces services et les impacts sur la réduction des inégalités. En 2007-
2008, la population québécoise bénéficiait d’avantages tirés des services
publics d’environ 17 000 $ par individu ou de 37 000 $ par ménage.
L’étude de l’IRÉC donne ainsi
un contrepoids rigoureux à ce
que l’on doit appeler une véritable
lutte idéologique concernant le
coût des services publics. En effet,
les partisans de la privatisation et
du retrait de l’État laissent souvent
entendre que ces services sont trop
coûteux. Les uns affirment qu’ils
sont inefficaces et qu’en consé-
quence, les contribuables n’en
auraient pas pour leur argent. Les
autres laissent entendre que l’offre
de services publics est trop large et
que le Québec vivrait au-dessus de
ses moyens.
Il manquait un autre éclairage
sur la place des services publics
dans l’activité économique.
Les chercheurs Pierre Gouin et
Gabriel Ste-Marie ont pu établir
qu’en 2007-2008, la population qué-
bécoise bénéficiait d’avantages tirés
des services publics d’environ 17
000 $ par individu ou de 37 000 $ par ménage.
On estime qu’un ménage moyen reçoit pour
37 312 $ en services de l’État, ce qui représente
68% du revenu moyen gagné (54 682 $). « Les
services publics contribuent grandement au
bien-être d’une majorité de Québécoises et de
Québécois », ont souligné les auteurs de l’étude.
Effet redistributif
Les chargés de projet de l’IRÉC ont voulu
raffiner davantage l’analyse. Ils ont divisé les
ménages québécois en cinq quintiles selon le
revenu et ils ont constaté que tous bénéficient
des services publics. Les individus des quintiles
inférieurs bénéficient tout de même de plus de
services, ce qui permet à l’État de redistribuer
la richesse.
« Les services publics, indiquent les cher-
cheurs, ont un effet redistributif surtout pour le
premier quintile ».
Progressivité de l’impôt
L’étude confirme aussi la progressivité de
l’impôt québécois. Le taux global de taxation
À propos du SISP
Le Secrétariat intersyndical des services publics (SISP) regroupe 335 000
membres issus de cinq organisations syndicales (CSQ, FIQ, SFPQ, APTS et
SPGQ), dont 265 000 proviennent des secteurs public, parapublic et péripu-
blic. La mission première du Secrétariat s’articule autour de la défense et de
la promotion des services publics offerts à la population québécoise. Par leurs
actions concertées, la CSQ, la FIQ, le SFPQ, l’APTS et le SPGQ souhaitent favo-
riser l’accès à des services publics de qualité pour tous, et ce, sur l’ensemble
du territoire québécois. Voir www.sisp.qc.net
augmente d’un quintile à l’autre. Plus on est
riche, plus on paye des impôts et des taxes.
Effet des baisses d’impôt
Les baisses d’impôts et de services publics
des dix dernières années ont amené l’État à
redistribuer de moins en moins. Elles ont per-
mis de compenser les baisses
de services seulement pour le
cinquième quintile, et pour
le quatrième dans une faible
proportion. Les trois premiers
quintiles y ont perdu.
Les femmes
Un autre aspect intéressant
de la recherche est celui d’une
meilleure répartition de la
richesse entre les sexes. Les
femmes représentent 50,4%
de la population et reçoivent
52,3% des services publics. En
moyenne, les femmes obtien-
nent 1 200$ de plus annuel-
lement en services publics que
les hommes. Cette différence
s’explique principalement
par les transferts en services
sociaux et en santé.
Les entreprises
Enfin, l’étude s’est inté-
ressée aux services reçus
par les entreprises. Les deux chercheurs ont
cité notamment les études des firmes comme
KPMG, PricewaterhouseCoopers ou la Banque
mondiale qui montrent clairement les avan-
tages concurrentiels qu’offre le Québec aux
entreprises. Le ratio entre les services publics
et le nombre d’entreprises donne un montant
d’environ 520 000 $ par entreprise.
D’autres mythes fiscaux
En terminant, soulignons que les cher-
cheurs ont découvert que l’on croit à tort que
plus de la moitié des dépenses du gouverne-
ment du Québec relève du secteur de la santé.
En 2007-2008, ce secteur représentait 17%
des dépenses publiques totales, tous niveaux
de gouvernement confondus. Comme c’est le
Québec qui assume la plus grande part des
dépenses en santé, c’est près de 31% de son
budget qui y est consacré et non pas la moitié.
Pour télécharger le rapport de recherche de
l’IRÉC, voir l’URL suivante : http://www.
irec.net/index.jsp?p=33
Les participants et les participantes à la conférence de presse du Secrétariat intersyndi-
cal des services publics (SISP) tenue à Montréal le 26 février 2012. De gauche à droite,
nous apercevons Gabriel Ste-Marie, chargé de projet à l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IRÉC), Réjean Parent, président de la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ), Régine Laurent, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du
Québec (FIQ), Lucie Martineau, présidente du Syndicat de la fonction publique du Québec
(SFPQ), Dominique Verreault, présidente de l’Alliance du personnel technique et profes-
sionnel de la santé et des services sociaux (APTS) et Gilles Dussault, président du Syndicat
des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).
Photo:AndréLaplante

Bulletin d’information
de l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IRÉC) à l’intention des Amis
de l’IRÉC/Numéro 22
1030, rue Beaubien Est, bureau 103
Montréal, Québec H2S 1T4
Tél. 514 380-8916/Télécopieur: 514 380-8918
secretariat@irec.net/ www.irec.net
Directeur général de l’IRÉC: Robert Laplante
Responsable du bulletin: André Laplante
514 380-8916 poste 21
andrelaplante@irec.net
Collaboration: Frédéric Farrugia (CASIQ),
Frédéric Hanin, Mathieu St-Onge (IRÉC)
Graphisme(grille): Anne Brissette
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du
Québec
BULLETIN DE L’
4
CDP
/SUITE DE LA PAGE2
RENCONTRE DU 15 MARS
Planification triennale
Le 15 mars, les membres du conseil d’ad-
ministration, du comité scientifique et
de l’équipe des chercheurs se réuniront afin
de faire le point et de planifier les travaux des
trois prochaines années.
LA PAGE FACEBOOK DE L’IRÉC
Très dynamique
Depuis quelque temps déjà, nous obser-
vons un achalandage accru sur la Page
Facebook de l’IRÉC. Comptant près de 325
Amis, les échanges et les commentaires sont de
plus en plus nombreux et indiquent un intérêt
accru pour les travaux de l’IRÉC. Soulignons
qu’une nouvelle présentation dynamique a
aussi été introduite. Pour joindre cette page,
cliquer sur l’icône de Facebook sur la page
d’accueil du site de l’IRÉC.
en actions d’entreprises cotées en bourse de la
CDP. En outre, trois de ces quatre entreprises
bénéficient d’un placement total de près de
quatre milliards $ (3,995 milliards $), ce qui
veut dire que 10% du portefeuille en actions
de la Caisse est exposé à trois entreprises d’un
même secteur ».
Un exemple
En additionnant la détention directe
d’actions Enbridge Inc. par la Caisse avec sa
détention indirecte via Noverco, on constate
que la Caisse contrôle virtuellement près de
20% des actions de l’entreprise de transport de
pétrole des sables bitumineux Enbridge. Cela
n’est plus un investissement financier «passif»
de type «portefeuille», mais un investisse-
ment «actif» et planifié dans une entreprise
dont la Caisse désire avoir le contrôle. Les
perspectives de revenus et d’accroissement de
la valeur financière d’Enbridge sont satisfai-
santes selon les normes du marché financier;
non pas spectaculaires, mais acceptables. Or,
la défunte Alcan, pour ne nommer que cette
compagnie, avait somme toute des caractéris-
tiques financières assez similaires. De plus,
l’entreprise était un employeur majeur au Qué-
bec; Enbridge, non. « Pourquoi l’engouement
pour la dernière et pas pour la première? », se
demandent les chercheurs
Politique d’investissement
La politique d’investissement de la CDP
dans le développement des sables bitumineux
de l’Ouest canadien est en contradiction avec
les engagements qu’a pris le gouvernement du
Québec à l’égard de la lutte aux changements
climatiques et à la « décarbonisation » de
l’économie. Le critère de la rentabilité finan-
cière évoqué par les dirigeants de la CDP pour
justifier ces placements escamote toute une
série de variables économiques plus fondamen-
tales qui devraient intervenir dans l’évaluation
globale de ces investissements. À commencer
par celle du poids grandissant exercé sur l’éco-
nomie du Québec de la dépendance au pétrole
et aux énergies fossiles. Selon une estimation
des chercheurs de l’IRÉC, les importations
de pétrole et de gaz seraient passées de sept
milliards $ en 2000 à 18 milliards $ en 2008,
soit une augmentation de près de 257% en huit
ans seulement.
Changements climatiques
« La CDP est en complet porte-à-faux avec
la stratégie de développement durable adoptée
par le gouvernement du Québec en 2007 qui
vise à diminuer l’émission des gaz à effet
de serre. La politique de “placements sales”
qui prévaut à la Caisse constitue un obstacle
majeur au développement du Québec : non seu-
lement bloque-t-elle sa capacité à faire face de
manière stratégique à la maîtrise du développe-
ment économique du Québec par la coordina-
tion des flux d’investissements touchant son
territoire, mais elle accroît sa dépendance à ce
dont il faut précisément se déprendre, soit les
énergies fossiles et les politiques de placement
dictées par les marchés financiers », ont conclu
les chercheurs.
OIKOSBLOGUE
Billets de l’IRÉC
Nous avons introduit une autre
nouveauté. Désormais, vous
retrouverez sur OIKOS Blogue et dans
les Actualités du site de l’IRÉC un billet
hebdomadaire écrit par un chercheur
de l’IRÉC.
C’est dans le numéro 18 du Bulletin
de l’IRÉC publié en octobre 2011 que
nous annoncions qu’il y aurait désor-
mais sur le site de l’IRÉC des nouvelles
économiques quotidiennes grâce à la
collaboration des Éditions Vie économi-
que (EVE).
Ces nouvelles sont regroupées dans
un bulletin hebdomadaire. Rappelons
que vous pouvez vous abonner en écri-
vant son adresse de courriel dans une
case prévue à cet effet à l’URL suivante:
http://www.oikosblogue.coop/
formes institutionnelles variées, diverse-
ment capitalisées, qui agissent en règle
générale en complémentarité avec les
orientations des politiques économiques
des États nationaux.
Ce fonds souverain doit renouer avec
sa vocation initiale. Concrètement, cela
signifie de mettre la CDP au service de
la reconversion écologique de la base
industrielle et énergétique du Québec.
Selon les chercheurs de l’IRÉC, la CDP
doit préalablement se sortir d’une
stratégie de placement dans les sables
bitumineux de l’Ouest canadien.
LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
Un fonds souverain au sens fort du terme
Chargée de maîtriser les circuits de
financement public entre l’épargne et
l’investissement et de structurer l’écono-
mie québécoise en agissant sur le finan-
cement des activités sur son territoire, la
Caisse de dépôt et placement du Québec a
été conçue au départ comme une insti-
tution visant à assurer la souveraineté
économique du Québec.
Ces liaisons institutionnelles et finan-
cières exclusives entre l’État québécois
et la CDP font de cette dernière un fonds
souverain, au sens fort du terme. Cette
catégorie d’investisseurs renvoie à des
1
/
4
100%