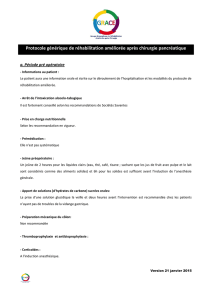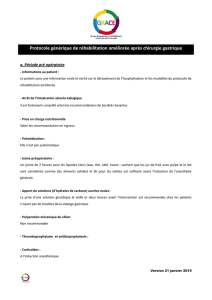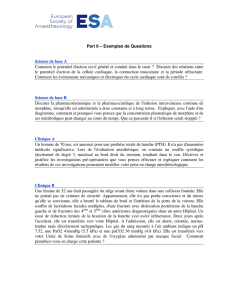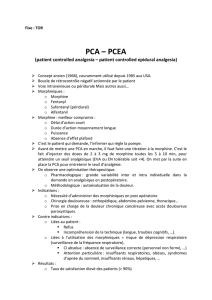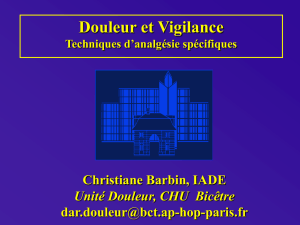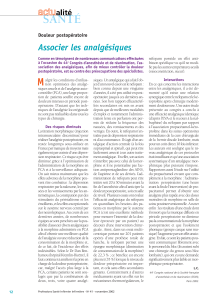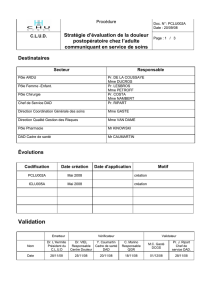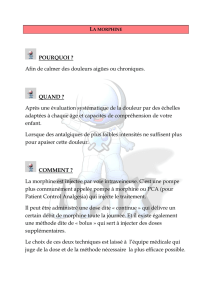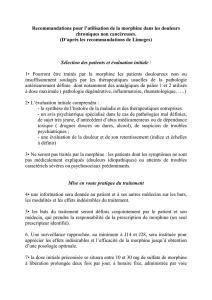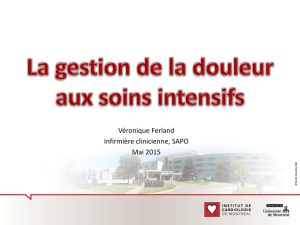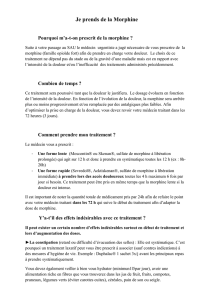quelle analgesie en chirurgie de la hanche

DOULEUR 283
QUELLE ANALGESIE EN CHIRURGIE
DE LA HANCHE ?
D. Morau, Y. Ryckwaert, X. Capdevila, Département d’Anesthésie Réanimation A -
Hôpital Lapeyronie - CHU Montpellier. France.
INTRODUCTION
La chirurgie de la hanche regroupe principalement la chirurgie prothétique, la repri-
se d’arthroplastie, la mise en place de butées osseuses, les ostéosynthèses du cotyle et
les ostéotomies de dérotations de la partie proximale du fémur. L’analgésie après mise
en place d’une prothèse totale de hanche (PTH) a conduit à une masse conséquente de
travaux dans la littérature. Il s’agit d’une chirurgie fonctionnelle ciblée et codifiée,
concernant une population de plus en plus avancée en âge et en classe ASA. La techni-
que analgésique doit avant toute chose prendre en compte le rapport bénéfice/risque
pour le patient.
De la technique anesthésique utilisée en peropératoire dépendront le choix et la
gestion de l’analgésie postopératoire. Ainsi une anesthésie périmédullaire pour chirur-
gie de la hanche peut être utilisée pour l’analgésie postopératoire. Selon l’enquête des
«3 jours d’anesthésie en France» en 1996 [1], 70 % des PTH sont réalisés sous anesthé-
sie générale. Les PTH réalisées sous locorégionale bénéficient presque exclusivement
d’une rachianesthésie.
Quelle que soit l’anesthésie pratiquée la douleur postopératoire est sévère au repos
chez 50 % des patients, et à la mobilisation chez 80 % des patients [2]. Cette douleur
est maximale entre les 3e et 6e heures postopératoires et décroît à partir de la 36e heure.
L’administration par voie systémique de morphiniques en postopératoire est la métho-
de d’analgésie la plus fréquemment employée sans qu’aucune étude méthodologiquement
irréprochable ne justifie ce choix.
Les différents travaux disponibles dans la littérature se sont principalement intéres-
sés à l’analgésie périmédullaire et très peu à l’analgésie périplexique ou périneurale. Il
paraît licite de faire une mise au point sur les différentes méthodes dont dispose l’anes-
thésiste-réanimateur pour assurer une analgésie postopératoire efficace après chirurgie
de la hanche dans le but de faciliter la rééducation fonctionnelle, seule garante d’une
pleine efficacité de l’acte chirurgical.

MAPAR 2000284
1. RAPPEL ANATOMIQUE[3-4]
Lors de la chirurgie de hanche, les douleurs sont liées à la zone d’incision cutanée,
au délabrement, à la traction des muscles fessiers et à l’abord de l’articulation coxo-
fémorale, en particulier de la capsule et de la synoviale, enveloppes richement innervées.
La chirurgie de hanche peut bénéficier de voies d’abord variées. Les butées et certaines
ostéosynthèses du cotyle sont le plus souvent réalisées par un abord antérieur dit «ilio-
fémoral». La chirurgie prothétique peut dans certains cas s’effectuer par un abord
antérieur, dit «de Hueter», ou par voie antéroexterne, dite «de Watson Jones». Dans les
abords antérieurs, les territoires nerveux concernés sont les branches perforantes des
nerfs sub costaux, les nerfs ilio-inguinal, ilio-hypogastrique, génito-fémoral et cutané
latéral de la cuisse. Ces nerfs sont issus des racines D12, L1, L2 et L3. La voie d’abord
la plus classique pour la chirurgie prothétique de la hanche reste la voie postéro-externe
qui dépend des nerfs ilio-inguinal, ilio-hypogastrique, cutané latéral de la cuisse (L2-
L3) ainsi que de rameaux cutanés fessiers du petit sciatique (S2). L’articulation
coxo-fémorale est sous la double dépendance des plexus lombaire et sacré. Il existe des
variations anatomiques individuelles imprévisibles. Les branches provenant du plexus
lombaire sont issues :
• Du nerf fémoral (L2-L3-L4), par des rameaux nés du nerf du muscle droit fémoral,
du nerf du muscle musculo-cutané interne qui assurent l’innervation de la face an-
térieure de la capsule de l’articulation coxo-fémorale et de l’extrémité supérieure du
fémur.
• Du nerf obturateur (L2-L3-L4). Des rameaux collatéraux et terminaux assurent eux
aussi l’innervation de la partie antérieure de l’articulation. Dans 10 % des cas, on
retrouve un nerf obturateur accessoire (L3-L4) qui participe à l’innervation de la
capsule articulaire ; le contingent obturateur semble jouer un rôle prépondérant dans
l’innervation de l’articulation.
• Par ses afférences communes issues des plexus lombaire et sacré, le plexus sacré
participe à l’innervation de l’articulation coxo-fémorale. Le nerf du muscle carré
fémoral (L4-L5-S1), le nerf glutéal supérieur (L4-L5-S1) et le nerf petit sciatique
(L4-L5-S1-S2-S3) assurent l’innervation de la partie postérieure de la capsule et
celle des muscles fessiers et pelvitrochantériens largement intéressés par les voies
d’abord.
Une récente étude anatomo-clinique [5] a confirmé cette innervation complexe. Les
auteurs rapportent que la partie antéro-médiane de la capsule est sous la dépendance de
branches issues du nerf obturateur. La partie antérieure de la capsule est sous la dépen-
dance de branches issues du nerf fémoral. La partie postérieure et postéro-interne est
sous la dépendance de nerfs issus du petit sciatique. La partie postéro-supérieure reçoit
une innervation sensitive de branches provenant du nerf glutéal supérieur.
2. EVALUATION RATIONNELLE DE LA DOULEUR POSTOPERATOIRE
L’échelle visuelle analogique (EVA) est un moyen d’évaluation fiable, validé, re-
productible et sensible d’appréciation de la douleur [6]. Cependant la compréhension
de l’EVA, en particulier chez le sujet âgé, est parfois difficile. D’où l’intérêt porté aux
échelles verbales simples (EVS) pour coter l’intensité douloureuse.
Les évaluations comportementales sont difficilement reproductibles. L’apprécia-
tion de la consommation de morphiniques lors de l’administration de morphine de
manière auto-contrôlée par le patient (ACP) est un bon reflet de l’intensité du phéno-
mène douloureux.

DOULEUR 285
La possibilité par le patient d’effectuer la rééducation fonctionnelle avec efficacité
est un bon témoin de la qualité de l’analgésie postopératoire et est actuellement sous
utilisée dans les travaux.
3. LA CHIRURGIE DE LA HANCHE EST-ELLE DOULOUREUSE ?
Après chirurgie orthopédique majeure la douleur est très intense [7]. Elle est pré-
sente au repos et elle est exacerbée par des spasmes musculaires réflexes. Elle prend
son origine dans les délabrements osseux, musculaires et tendineux peropératoires. La
rééducation fonctionnelle (mobilisation passive de la hanche opérée sur arthromoteur)
débute habituellement à la 24e heure postopératoire et pourrait être à l’origine d’une
exacerbation des stimulations nociceptives. Il est probable que le niveau de la douleur
préopératoire participe à l’intensité de la douleur postopératoire. Ainsi en comparant
3 groupes de patients opérés d’une PTH, Slappendel et coll [8] ont constaté que les
patients qui avaient une douleur préopératoire qualifiée de sévère avaient une consom-
mation de morphine en postopératoire 50 % plus élevée que celle des patients pour qui
la douleur préopératoire était qualifiée de modérée ou faible.
Il n’est pas évident que la maîtrise des phénomènes douloureux postopératoires
puisse avoir un impact sur la convalescence et sur la durée du séjour hospitalier contrai-
rement à ce qui est actuellement démontré après arthroplastie de genou [9]. Moiniche
et coll [10] ont obtenu des scores d’EVA très inférieurs lors d’une analgésie périmédul-
laire (bupivacaïne 0,25 % + morphine) par rapport à une analgésie par voie systémique
mais les auteurs n’ont pas mis en évidence de diminution du séjour hospitalier.
Notre groupe a rapporté dans une étude prospective récente [11] comparant 3 grou-
pes de patients opérés de PTH sous anesthésie générale pour lesquels l’analgésie
postopératoire était soit l’administration systémique de morphine par PCA, soit le bloc
du plexus lombaire par voie antérieure [12], soit le bloc du plexus lombaire par voie
postérieure [13], que l’analgésie était équivalente dans les 3 groupes dès la 4e heure
postopératoire, après que la titration en morphine trouve son efficacité. La consomma-
tion de morphine rapportée à l’heure dans le groupe PCA était de 1,2 mg.h-1 pendant les
4 premières heures postopératoires puis se stabilisait à moins de 0,5 mg.h-1. La réédu-
cation fonctionnelle débutait à H24 et n’était pas à l’origine d’un regain douloureux.
Ces résultats sont conformes à ceux d’Armitage [14] qui retrouvait une consommation
d’antalgiques quasiment nulle dès le deuxième jour après arthroplastie de hanche.
Concernant les autres chirurgies de la hanche en dehors de la PTH, peu d’études
fiables ont évalué précisément l’intensité du stimulus douloureux postopératoire.
4. ANALGESIE PAR VOIE SYSTEMIQUE
4.1. PROPACETAMOL
En orthopédie, le paracétamol et ses dérivés sont utilisés de façon systématique en
France sans que son efficacité n’ait été étudiée de manière précise dans ce type de
chirurgie. La posologie habituelle consiste en l’administration de 2 g de propacétamol
toutes les 6 heures par voie intraveineuse. Son efficacité n’est pas remise en question
dans les chirurgies les moins douloureuses, en particulier si la réaction inflammatoire
est peu importante. Aucune étude récente n’a réellement validé son utilisation dans la
chirurgie de la hanche même si cela est régulièrement fait.
4.2. AINS
Les AINS ont une efficacité majeure sur l’analgésie postopératoire après chirurgie
de la hanche. Une action synergique entre les AINS et les morphiniques est bien docu-
mentée par les travaux de Dahl et Kehlet [15]. Que ces AINS soient administrés par

MAPAR 2000286
voie orale [16] ou intraveineuse [17], il apparaît dans tous les cas une diminution de la
consommation de morphine de l’ordre de 40 % par rapport à un groupe placebo avec,
parallèlement, une diminution des scores d’EVA. Une administration intrarectale d’in-
dométhacine [18] après mise en place d’une PTH permet une épargne morphinique très
intéressante par rapport à un groupe placebo (34,8 ±21,8 mg vs 89,6 ±43,7 mg sur
une période de 42 heures postopératoires).
L’administration d’AINS en postopératoire de chirurgie prothétique de hanche ap-
paraît aussi efficace que l’administration extradurale de morphine [19]. La remarque
méthodologique essentielle est que toutes ces études ont évalué l’efficacité de l’analgé-
sie postopératoire au repos. Il n’est pas évident que ces résultats, concernant l’efficacité
des AINS, soient extrapolables à la douleur lors de la rééducation de la hanche opérée,
qui, on l’a vu, débute de plus en plus précocement. L’efficacité des différents AINS
semble identique après chirurgie prothétique de la hanche [20]. Le choix se fait donc en
fonction des habitudes de prescriptions de chaque équipe. Dans cette indication, le site
d’action des AINS est périphérique et indépendant des récepteurs morphiniques [18]. Il
est probable que les AINS contribuent à diminuer les ossifications péri-articulaires post-
opératoires. Leur utilisation est toutefois limitée chez les patients à risque par leurs
effets secondaires potentiels [21] en particulier en cas de pathologie gastroduodénale,
d’insuffisance rénale, de troubles de l’hémostase. L’arrivée des AINS anti COX2 va
probablement donner un envol supplémentaire à cette classe thérapeutique dans le post-
opératoire.
4.3. DERIVES MORPHINIQUES
La buprénorphine et la nalbuphine [22] ont été largement utilisées en analgésie post-
opératoire. Pourtant leur effet plafond, leur faible réversibilité et les troubles dysphoriques
qui leur sont souvent associés limitent leur utilisation. La morphine reste le produit le
plus maniable. Son mode d’administration consiste le plus souvent en une titration
intraveineuse par bolus de 2 mg espacés de 3 à 5 minutes, débutée en salle de réveil
jusqu’à l’obtention d’une EVA inférieure à 30 mm.
Après la titration, l’administration postopératoire de morphiniques, de manière sys-
tématique toutes les 4 à 6 heures ou à la demande par voie intramusculaire, sous cutanée,
n’est pas adaptée à une prise en charge efficace de la douleur en raison des grandes
variabilités interindividuelles concernant la demande d’antalgiques. Ce mode d’admi-
nistration ne prend pas en compte la demande supplémentaire d’antalgiques
nécessitée par la rééducation fonctionnelle de l’articulation opérée. La pharmacocinéti-
que des morphiniques est également très variable entre individus.
Austin et coll [23] ont montré qu’après administration intramusculaire de morphine
en postopératoire les pics de concentrations varient de 2 à 5 fois et le temps nécessaire
pour atteindre ces pics de 3 à 7 fois aussi bien chez un même individu dans le temps
qu’en comparant les patients. L’administration de morphine intraveineuse en fonction
de la demande du patient (mode ACP) a prouvé son efficacité après remplacement
prothétique de la hanche. Ainsi Weller et coll [24] ont retrouvé une efficacité compara-
ble de l’analgésie postopératoire après PTH, que la morphine soit administrée en ACP
ou par voie péridurale. Les effets secondaires (prurit, dépression respiratoire) étaient
majorés dans le groupe «péridurale». Sur une série de 104 patients dont l’analgésie
était assurée par une ACP morphine, Singelyn [7] retrouve une consommation de mor-
phine de 47 mg (4 à 132) sur 48 heures. Cette technique n’était appliquée qu’à 10 %
des patients opérés de PTH. La principale restriction à l’utilisation de la morphine par
mode ACP tient à la survenue possible d’une dépression respiratoire. Ce risque est

DOULEUR 287
pourtant très faible puisque sur une série de 4 000 ACP [25] 9 cas de dépression respi-
ratoire (essentiellement de bradypnées) ayant nécessité l’administration de naloxone,
ont été rapportés. Les facteurs favorisants étant dans chaque cas l’association à une
administration de dérivés morphiniques ou une interaction avec d’autres
produits potentiellement dépresseurs respiratoires comme les benzodiazépines.
Les posologies de morphine préconisées en orthopédie varient de 1 à 2 mg pour la
dose de bolus, 6 à 10 min pour les périodes d’interdiction et 20 mg par 4 h en dose
maximale cumulée [26]. Cette technique semble adaptée au contrôle de la douleur de
fond, mais peut se révéler insuffisante en cas de mobilisation de la hanche opérée en
postopératoire. L’indice de satisfaction des patients après utilisation d’une ACP mor-
phine en chirurgie orthopédique est identique à celui de la péridurale analgésique [27].
La seule restriction concerne les toutes premières heures postopératoires. Une titration
suffisante en morphine dans la majorité des travaux en postopératoire immédiat aurait
sensiblement pu modifier ces résultats.
L’association d’analgésiques par voie systémique (paracétamol, AINS, morphini-
ques) basée sur le concept d’analgésie «multimodale» [28] est efficace après chirurgie
de la hanche. Ce mode analgésique permet d’autre part de diminuer les effets secondai-
res propres à chaque classe thérapeutique.
5. ANALGESIE INTRATHECALE ET PERIDURALE
5.1. ANALGESIE INTRATHECALE
L’injection intrathécale d’un opiacé lors de l’induction anesthésique a montré à de
multiples reprises son efficacité sur la douleur postopératoire en chirurgie orthopédi-
que lourde et plus précisément après arthroplastie de hanche [29-31]. La morphine est
très utilisée dans cette indication. Drakeford et coll [32] rapportent sur une série de
60 patients une analgésie d’excellente qualité dans le groupe de patients recevant 0,5 mg
de morphine associée à de la tétracaïne 1 % intrathécale par rapport à un groupe de
patient qui ne recevait que la tétracaïne et pour lesquelles l’analgésie postopératoire
était qualifiée de médiocre. Les effets secondaires ne diffèrent pas significativement
entre les groupes. La durée moyenne d’analgésie lors de l’administration de morphine
intrathécale varie de 12 à 20 heures.
L’utilisation de diamorphine en intrathécal fournit des résultats similaires [33]. En
comparant une série de 30 patients ayant reçu de la diamorphine en intrathécal par
rapport à un groupe témoin, les auteurs retrouvent une consommation moyenne de mor-
phine intraveineuse administrée par PCA de l’ordre de 12 ±11,4 mg dans le groupe
diamorphine versus 31 ±18,7 mg dans le groupe témoin sur une période de 24 heures.
La dose optimale pour la morphine se situe entre 0,2 et 0,8 mg [34, 35].
Slappendel et coll [36] rapportent toutefois une dose idéale de 0,1 mg après arthro-
plastie totale de hanche. Une dose supérieure est responsable de plus d’effets adverses
(prurit et épisodes hypotensifs). Il est important de noter que même dans les groupes
pour lesquels la dose de morphine intrathécale était de 0,025 mg ou de 0,05 mg, les
EVA (tout en étant significativement supérieure à celle du groupe 0,1 mg de morphine)
restaient inférieure à 30 mm pour les douleurs de repos.
L’administration concomitante de clonidine (75 µg) ne semble pas potentialiser
l’action analgésique de 0,5 mg de morphine [37]. Les épisodes hypotensifs sont plus
fréquents dans le groupe clonidine. L’utilisation de la morphine par voie rachidienne
est limitée par la possible survenue d’épisodes de dépression respiratoire qui sont dose-
dépendants [38]. L’ascension rostrale de la morphine, hydrosoluble, au sein du liquide
cérébrospinal en est directement responsable [39].
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%