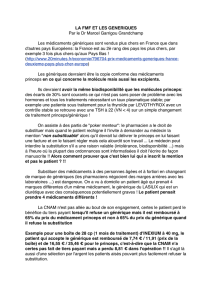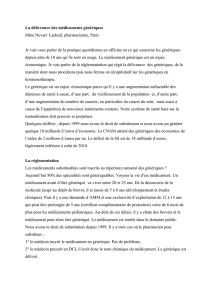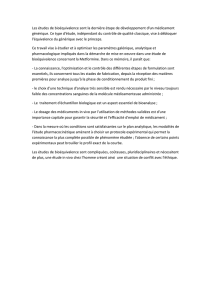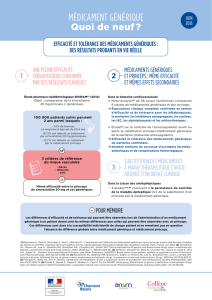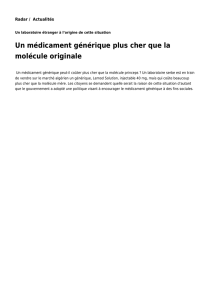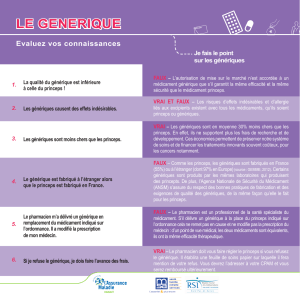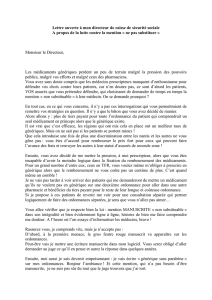Génériques des médicaments antiépileptiques

48 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIV - n° 2 - Février 2010
MISE AU POINT
Génériques des médicaments
antiépileptiques :
doit-on se méfier des OGM
(ordonnances génériquement modifiées) ?
Generic of the antiepileptic drugs, is there any risk
with substitution?
A. Biraben*
N
otre santé coûte de plus en plus cher, et
si la médecine permet de régulièrement
prolonger la vie, c’est au prix de dépenses qui
augmentent de façon presque exponentielle… C’est
pourquoi les autorités de santé recherchent toutes les
solutions possibles pour réaliser des économies. Ces
mêmes autorités prennent par ailleurs de plus en plus
de décisions médico-économiques, débordant sur les
prérogatives habituelles des médecins, on s’en rend
bien compte actuellement. Les médicaments géné-
riques sont issus de ces programmes d’économie : il
s’agit des seuls médicaments approuvés par l’Afssaps
sans amélioration du service médical rendu.
Parmi ces décisions récentes, de fortes incitations à
utiliser les médicaments génériques sont exercées
auprès des médecins et surtout des pharmaciens.
Qu’en est-il en épileptologie ?
Le médicament générique
est-il identique au médicament
princeps ?
Pharmacologiquement
Le médicament générique d’une spécialité pharma-
ceutique est censé être la copie du médicament
princeps ; sa bioéquivalence doit être démontrée
(encadré).
En pratique, certains médicaments génériques sont
strictement identiques aux médicaments princeps,
puisque issus des mêmes chaînes de fabrication, mais
revendus par un génériqueur appartenant au labo-
ratoire fabriquant le médicament princeps. Certains
sont de composition et de forme semblables, quand
ils sont fabriqués par des laboratoires différents mais
avec les mêmes excipients ; les seules différences
sont alors des résidus, des traces de solvants ou des
impuretés liées aux processus de fabrication, qui
peuvent être différents. Certains sont essentielle-
ment similaires, contenant le même principe actif
mais pas les mêmes excipients. C’est dans cette
classe que l’on retrouve la plupart des génériques
des médicaments antiépileptiques.
La présence d’un excipient différent peut entraîner
des différences de taux de dissolution, des diffé-
rences d’absorption, des différences de stabilité de
la molécule active. Pour cette raison, les autorités
demandent que l’on vérifie la bioéquivalence.
Le laboratoire du générique doit ainsi apporter
la preuve de la bioéquivalence par des études de
biodisponibilité. Pour cela, on teste l’évolution de la
concentration en principe actif après la prise unique,
en double aveugle, d’une dose de médicament prin-
ceps et de médicament générique chez des individus
adultes sains (âgés de 18 à 55 ans) ne prenant aucun
traitement, censés représenter la population cible
du médicament. Sur les courbes de concentration
obtenues au cours du temps, on note la concentra-
tion maximale (Cmax), le délai avec lequel est obtenue
cette concentration maximale (Tmax), et l’aire sous
la courbe (ASC) représentant la quantité de principe
actif disponible au cours du temps. La Cmax et l’ASC
* Service de neurologie, hôpital
Pontchaillou, CHRU de Rennes.
• Un médicament générique
est la “stricte copie” d’un
médicament original dont le
brevet de commercialisation
exclusive par un laboratoire
pharmaceutique a expiré et
appartient au domaine public.
• Cette copie est certifiée par
l’Afssaps (AMM).
• Le générique d’une spécia-
lité de référence a la même
composition qualitative et
quantitative en principe actif
et la même forme pharma-
ceutique, et sa bioéquivalence
avec la spécialité de référence
a été démontrée par des
études de biodisponibilité
“appropriées” (directive euro-
péenne 2004/27).
Encadré. Textes légaux.

150
A
100
Concentration plasmatique (µmol/l)
50
0
0 2 4 6 8 10
10
10
20
40
Jours
Cinétique linéaire
150
B
100
Concentration plasmatique (µmol/l)
50
0
0 2 4 6 8 10
10
15
25
Jours
Cinétique non linéaire
Bras thérapeutique Dose (µmol/kg)
20
30
Figure 1. Courbes de pharmacocinétique en fonction de la répétition des prises de
médicaments.
© Elsevier. Rang et al. Pharmacology 6e www.studentconsult.com
La Lettre du Neurologue • Vol. XIV - n° 2 - Février 2010 | 49
Points forts
du médicament générique doivent être situées entre
– 20 % et + 25 % de celles du médicament princeps
pour que la bioéquivalence soit reconnue (avec un
intervalle de confiance de 90 %). On notera que
chaque générique est bien comparé avec le princeps,
mais que les génériques d’un même produit ne sont
pas comparés entre eux, alors qu’un patient peut
recevoir un premier générique d’un princeps un jour
puis un autre générique du même princeps un autre
jour. La variation théorique de la Cmax et de l’ASC
entre deux génériques du même produit pourrait
atteindre alors – 36 % à + 56 %.
Enfin, la figure 1 permet de voir que les écarts entre
les concentrations peuvent se creuser au fil du temps
avec la répétition des prises. C’est encore plus net
si la cinétique du produit n’est pas linéaire (courbe
de droite).
Peut-on étendre ces résultats de bioéquivalence aux
malades ? À ceux qui sont en polythérapie ? Aux
personnes âgées, aux enfants ? Aux fumeurs, aux
alcooliques, aux femmes susceptibles d’être enceintes ?
Pour le patient, les différences de fabrication et d’ex-
cipients peuvent se traduire par une modification
de couleur, de consistance, de goût, de sécabilité,
de forme du comprimé ; nous verrons que cela n’est
sans doute pas sans conséquences.
En conclusion, quand il s’agit d’un autogénérique
(le même laboratoire fabriquant le même produit
sur les mêmes chaînes de fabrication, mais en le
commercialisant sous deux noms différents), il s’agit
du même médicament. Dans tous les autres cas, il
y a des différences. Elles sont certainement, d’après
les experts, infimes, mais on ne peut exclure ni la
survenue d’une allergie par sensibilité à un nouvel
excipient à effets notoires ni la survenue de variations
des taux plasmatiques cliniquement significatives
(sous- ou surdosage). Les pharma cologues ne sont
pas tous d’accord sur les critères de mesure à utiliser
pour prouver l’équivalence d’efficacité biologique.
Est-ce pareil pour le patient
épileptique ?
Plusieurs questions se posent : y a-t-il un risque
de récidive ou de multiplication des crises après
substitution ?
De nombreux cas de récidive ont été publiés avec
tous les produits génériqués. Ces cas n’ont pas de
valeur statistique, dans la mesure où ils ne font
pas référence à une population donnée mais sont
rapportés de façon anecdotique. Néanmoins, aucune
étude d’ampleur n’a été à ce jour conduite pour
connaître l’existence d’un risque. Le risque étant
sans doute faible, il faudrait une importante popula-
tion traitée par médicament princeps puis par géné-
rique… ce qui coûterait cher et ne permettrait plus
de réaliser des économies. À moins que ces médica-
ments génériques ne subissent les mêmes essais que
les autres médicaments nouveaux, mais leur prix s’en
ressentirait d’autant. Les cas publiés ont toutefois
valeur d’alerte. Il faut parfois de nombreuses années
pour avoir la preuve de ce que l’on suspecte. Il a fallu
plus de 25 ans pour être scientifiquement certain
de l’effet tératogène de certains médicaments anti-
épileptiques après les premières alertes publiées.
En 2008, M.J. Berg et al. ont publié les résultats
d’une série de 50 patients ayant récidivé lors de la
substitution de leur médicament antiépileptique (1).
Chez la plupart de ces patients, les taux sanguins des
médicaments antiépileptiques sont disponibles avant
substitution, lors de la récidive après substitution, et
après le retour au médicament princeps. Il apparaît
»
La similitude entre génériques et princeps n’est pas absolue, et des changements d’excipients peuvent
entraîner des variations de paramètres pharmacologiques.
»La substitution peut générer du stress, or les crises peuvent être favorisées par le stress ou le manque
de sommeil.
»
La substitution semble entraîner une augmentation paradoxale des dépenses de santé par les patients
(consultations, hospitalisations, consommations médicamenteuses, etc.).
Mots-clés
Génériques
Substitution
Médicaments
antiépileptiques
Épilepsie
Dépenses de santé
Highlights
The generic drug is not a perfect
copy of the princeps drug and
some pharmacological param-
eters may be affected.
The drug substitution may
stress the patients and stress or
insomnia may trigger seizures.
The generic substitution seems
to paradoxically increase the
health care cost of the patients
(consultations, hospitalisations,
drugs consumption, etc.).
Keywords
Generic
Substitution
Antiepileptic drugs
Epilepsy
Health care cost

Figure 2. Évaluation des taux sanguins avant substitution, lors de la récidive des crises,
puis après le retour à la molécule princeps.
30
120
12
140
16
14
Patient 5
Patient 21
Patient 8*
Patient 31*
Patient 15
Patient 3
Patient 10
Patient 23
Patient 13*
Patient 49
Patient 57
Patient 47
Patient 6
Patient 22
Patient 9
Patient 38
Patient 37
Patient 34*
Patient 66
Patient 16
Patient 4*
Patient 27
Patient 24
Patient 28*
Patient 64
Patient 69
25
100
10
20
80
8
15
60
6
10
40
4
5
20
2
0
0
0
Pre-switch level
Pre-switch level
Pre-switch level
Level at time
of breakthrough
Level at time
of breakthrough
Level at time
of breakthrough
Phenytoin levels
Valproic acid levels
Carbamazepine levels
Level (after switch
back to brand)
Level (after switch
back to brand)
Level (after switch
back to brand)
* Brand Extended Release
* Brand Extended Release
50 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIV - n° 2 - Février 2010
Génériques des médicaments antiépileptiques:
doit-on se méfier des OGM ?
MISE AU POINT
que, globalement, les taux sanguins sont plus bas
sous génériques que sous princeps, avec retour au
taux de base quand le patient reprend la spécialité
princeps (figure 2). Il ne s’agit que de patients ayant
récidivé, mais certains sont, comme ici, sensibles à
la substitution.
Y a-t-il un risque d’apparition d’effets indésirables
nouveaux ?
Il existe un risque lié aux excipients dits “à effets
notoires” de type hypersensibilité ou autres. La
présence d’excipients à effets notoires est signalée
sur l’emballage du médicament.
Là aussi, plusieurs publications font état de l’ap-
parition d’effets secondaires nouveaux ; le plus
souvent, il s’agit de signes de surdosage, d’intolé-
rance digestive, de céphalées… et tous les médica-
ments antiépileptiques génériques sont cités. Mais la
valeur statistique est encore une fois nulle, puisque
ce sont des cas non référencés à une population.
Pour les mêmes raisons économiques, la preuve
de la responsabilité de la substitution sera difficile
à apporter.
◆Qu’en pensent les patients ?
L’exercice de l’épileptologie permet d’apprendre
que tout n’est pas rationnel. La plupart des patients
sont sensibles aux variations d’humeur, d’anxiété, de
sommeil, etc., et même sans variation de traitement,
des crises sont susceptibles d’apparaître. En dehors de
quelques syndromes de l’enfance dont le pronostic
est connu, les patients prennent leur traitement de
façon chronique. Deux tiers environ sont sans crise
sous traitement et sont particulièrement attachés au
produit qui leur permet d’avoir une vie quasi normale.
Ils savent que la survenue d’une seule crise peut avoir
des conséquences sociales et professionnelles très
graves (perte du permis de conduire, changement
de travail pour cause d’inaptitude), sans compter
le risque traumatique et la stigmatisation quand la
maladie devient connue… Cette pathologie est par
essence très anxiogène, car les crises ne préviennent
pas et les patients vivent dans l’attente de la crise
suivante, sorte d’épée de Damoclès.
Plusieurs enquêtes, réalisées auprès de patients,
montrent que la substitution entraîne de l’anxiété
chez 35 à 58 % des sujets (sur 974 patients [2] et
sur 1 835 patients [3] substitués). Plus tard, 10,8 %
des patients signalent une recrudescence des crises,
10 % se plaignent de “signes subjectifs” divers, 8,8 %
signalent des effets indésirables nouveaux.
Enfin, des études récentes montrent que les patients
épileptiques préfèrent payer la différence de prix
eux-mêmes, dans 20 à 44 % des cas (suivant le

La Lettre du Neurologue • Vol. XIV - n° 2 - Février 2010 | 51
MISE AU POINT
médicament), alors que ce taux de retour volontaire
au médicament princeps est de 2 % à 5 % pour
d’autres spécialités prises chroniquement (hypo-
cholestérolémiants, antihypertenseurs) [4].
◆Qu’en pensent les médecins ?
Plusieurs enquêtes d’opinion ont également été
menées auprès des médecins prescripteurs de
médicaments antiépileptiques (5-7). Elles montrent
que les médecins signalent des problèmes lors de la
substitution (53 % en France ; 68 % aux États-Unis ;
49,2 % dans les pays germanophones). Il s’agissait
de récidives de crise dans un tiers à deux tiers des
cas et de l’apparition d’effets indésirables nouveaux
dans les mêmes proportions. En France, les médecins
pensent que la prescription leur échappe, car c’est
le pharmacien qui est devenu le principal acteur de
la substitution sans que le médecin soit prévenu.
◆Qu’en pensent les sociétés savantes ?
Pratiquement toutes les sociétés savantes ont émis
des recommandations concernant la substitution
des médicaments antiépileptiques (Ligues française,
espagnole, germanophone, italienne, etc., contre
l’épilepsie, Académie américaine de neurologie ;
la Grande-Bretagne, l’Angleterre et l’Écosse ont
pris des dispositions légèrement différentes). Elles
recommandent de ne pas pratiquer la substitution
chez les patients qui ne font pas de crises, de ne
jamais remplacer un générique d’un médicament
antiépileptique par un autre générique de ce même
médicament. Certaines recommandations insistent
aussi sur le fait qu’il ne faut pas pratiquer la substitu-
tion chez les patients traités par des doses extrêmes,
soit très élevées soit très basses, car des variations
minimes du taux sanguin peuvent être cliniquement
significatives. Enfin, certains pays ont supprimé les
génériques des antiépileptiques (Finlande, Suède).
Il est parfois suggéré que le pharmacien ait le devoir
d’avertir les patients en leur faisant signer un formu-
laire de consentement éclairé ou qu’il soit tenu de
prévenir le médecin de la substitution.
Le médicament générique
fait-il vraiment gagner
de l’argent à la société ?
Finalement, comme c’est sa seule finalité, est-ce
réellement une bonne idée ?
Nous ne nous poserons la question que dans l’in-
dication “épilepsie,” ces médicaments étant main-
tenant prescrits dans de très nombreuses autres
indications. Une enquête réalisée par IMS Health
en 2006 nous apprend que l’épilepsie représente
38 % des indications, les douleurs ostéo-articulaires
15 %, les troubles de l’humeur 12 % et les douleurs
neurologiques 10 %.
D’après les données de Medic’am, la substitution des
antiépileptiques a permis en 2006 une économie de
11 millions d’euros, dont 4,18 millions pour l’indica-
tion épilepsie, ce qui ne représente que 0,00015 %
des 27 milliards d’euros remboursés pour les médi-
caments par l’Assurance maladie.
Le tableau montre les différences de prix et l’éco-
nomie réalisée par la substitution. Il faut remarquer
que les génériques auront eu le mérite de tirer vers
le bas le prix de certaines spécialités, puisqu’il n’y
a plus de différence de prix.
Il existe donc bien une économie en termes de
dépenses de médicaments avec certains génériques,
mais pas avec tous.
Est-ce réellement une économie si les patients ont
une consommation médicale qui augmente par
ailleurs (consultations supplémentaires, passages
aux urgences, hospitalisations…) ? En France, il est
particulièrement difficile de trouver ces chiffres,
mais il a été montré que, en Ontario (Canada),
Tableau.
Coût (euros) Différences
Nombre
de comprimés
par boîte
Princeps Générique Dose Euros/jour Euros/an
Valproate (Dépakine®) 40 13,12 9,47 1g/j 0,24 87,60
Oxcarbazépine (Trileptal®) 50 41,82 33,47 1 200mg/j 0,34 121,91
Gabapentine (Neurontin®) 90 37,71 37,71 1 200mg/j 0 0
Carbamazépine (Tégrétol®) 30 5,96 5,96 800mg/j 0 0
Lamotrigine (Lamictal®) 30 31,60 22,25 200mg/j 0,62 226,30

52 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIV - n° 2 - Février 2010
Génériques des médicaments antiépileptiques:
doit-on se méfier des OGM ?
MISE AU POINT
la substitution coûtait finalement plus cher à la
société (7 902 dollars versus 6 419 dollars) [4, 8].
Ces dépenses supplémentaires sont liées à des
augmentations significatives des doses de médi-
caments antiépileptiques (de 20,4 à 24 boîtes), à
des augmentations du nombre de spécialités prises
après substitution (de 26,4 à 32,8 boîtes d’autres
traitements), au nombre de visites chez le médecin,
qui passe de 8,7 à 9,8 par an, et à des durées d’hos-
pitalisation passant de 3,29 à 4,86 jours par an.
Cette augmentation globale de la consommation
médicale était déjà soulignée, mais non chiffrée dans
les enquêtes allemandes et françaises.
Il existe donc une suspicion forte que la substitu-
tion des antiépileptiques dans l’indication épilepsie
soit une fausse bonne idée, qui fait courir un risque,
même minime, aux patients, pour des raisons ration-
nelles ou non, et qui coûte finalement, indirecte-
ment, plus cher à la société.
L’Afssaps a pris conscience du caractère particulier de
cette maladie et des antiépileptiques. En mars 2008,
elle a adressé aux pharmaciens et aux médecins fran-
çais une lettre dans laquelle il est clairement dit que
le médecin et le pharmacien doivent s’assurer que la
prescription de médicaments génériques ne suscite
pas, après une information approfondie, d’anxiété
particulière chez le patient. La mention manuscrite
“non substituable” apposée par le médecin ne peut
être contournée par le pharmacien, qui doit, en outre,
indiquer sur l’ordonnance ce qu’il a délivré.
Les laboratoires commercialisant des médicaments
princeps et ceux qui commercialisent des médica-
ments génériques font des bénéfices et ont des
actionnaires à rémunérer. Les premiers assument
le coût de la recherche et du développement de
nouveaux produits (16 à 25 % des bénéfices), et ce
coût augmente. Les laboratoires de médicaments
princeps assurent également la visite médicale, dont
le rôle est de promouvoir des médicaments, mais
aussi de proposer certaines missions de formation,
de faire remonter des effets indésirables, de rappeler
régulièrement aux prescripteurs certaines règles (par
exemple, les précautions d’instauration de la lamo-
trigine, ses possibles interactions avec le valproate),
ce que ne font pas les laboratoires des médicaments
génériques.
Conclusion
En épileptologie, la substitution des médicaments
antiépileptiques pourrait entraîner, dans de rares
cas, des récidives de crises, que ce soit du fait des
petites différences pharmacologiques, de l’anxiété
du patient ou de troubles du sommeil dus au traite-
ment. Les rares études médico-économiques à notre
disposition indiquent que le bilan est négatif dans
certains pays en termes de dépenses de santé. Toute-
fois, nous ne savons pas ce qu’il en est en France ;
or, la raison d’être des génériques est de permettre
de faire des économies. ◾
1. Berg MJ, Gross RA, Tomaszewski KJ et al. Generic subs-
titution in the treatment of epilepsy: case evidence of
breakthrough seizures. Neurology 2008;71:525-30.
2. Haskins LS, Tomaszewski KJ, Crawford P. Patient and
physician reactions to generic antiepileptic substitution in
the treatment of epilepsy. Epilepsy Behav 2005;7(1):98-105.
3. Goodwin M. The importance of brand continuity in
epilepsy drugs. Nurs Times 2005;101(25):26-7.
4. LeLorier J, Duh MS, Paradis PE et al. Clinical consequences
of generic substitution of lamotrigine for patients with
epilepsy. Neurology 2008;70(22 Pt 2):2179-86.
5. Biraben A, De Toffol B, Semah F, Rouaud T. Utilisa-
tion des médicaments génériques des anti-épileptiques
en France : résultats d’une enquête auprès des neuro-
logues et revue de la littérature. Rev Neurol (Paris)
2007;163(4):455-61.
6. Wilner AN. Therapeutic equivalency of generic
antiepileptic drugs: results of a survey. Epilepsy Behav
2004;5:995-8.
7. Kramer G, Dennig D, Schmidt D et al. Generics in antiepi-
leptic drug therapy: what has to be considered? Akt Neurol
2005;32:275-8.
8. Andermann F, Duh MS, Gosselin A, Paradis PE. Compulsory
generic switching of antiepileptic drugs: high switchback
rates to branded compounds compared with other drug
classes. Epilepsia 2007;48(3):464-9.
Références bibliographiques
1
/
5
100%