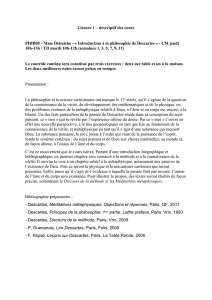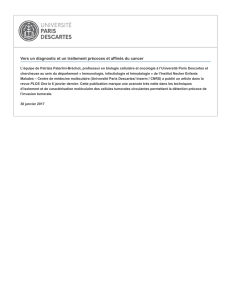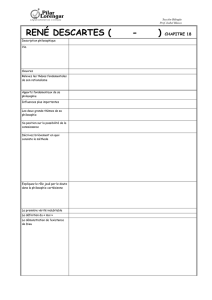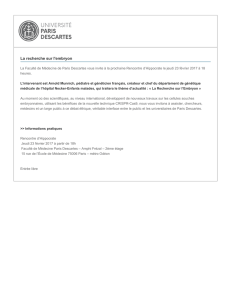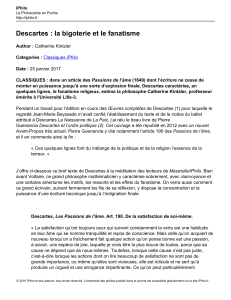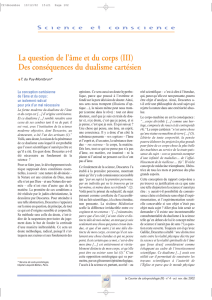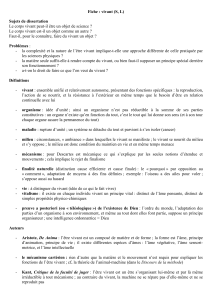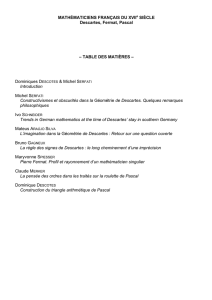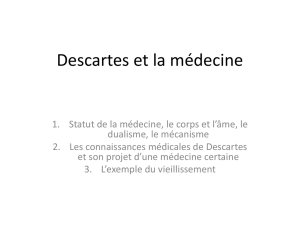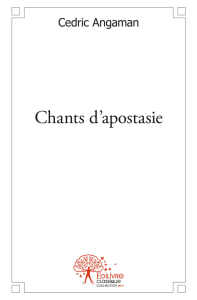JE PENSE DONC JE SUIS D`abord, il s`agit bien d`une méditation

JE PENSE DONC JE SUIS
D’abord, il s’agit bien d’une méditation. On entend par là un exercice spirituel, pratiqué dans la
solitude, par un esprit faisant retour sur lui-même pour se pénétrer d’une vérité. Il s’agit donc d’une
expérience philosophique qu’il faut sans doute faire, au moins une fois dans sa vie.
Quel est l’objet de sa méditation ? Le projet de trouver une certitude susceptible de résister aux
plus extravagantes objections des sceptiques. Au fond, Descartes veut savoir si le doute généralisé
est notre destin ou s’il est possible de fonder certains énoncés dogmatiques. « Qu’est-ce que je peux
tenir pour absolument certain ? » se demande-t-il.
Certes, j’ai été instruit dans le plus grand collège d’Europe, j’ai appris tout ce qu’un honnête
homme peut savoir. Comme tout le monde je fais confiance aux informations que me donnent mes
sens. Ainsi je suis certain qu’il y a un monde et que j’ai une tête, des mains, des pieds. J’ai même
une vénération toute particulière pour les mathématiques et je ne doute pas que la somme des angles
du triangle vaut deux droits. Pourtant en toute rigueur, suis-je bien avisé d’être certain ?
La méditation cartésienne commence par là. Il ne s’agit pas de nier que mes certitudes immédiates
sont bien suffisantes pour la conduite de la vie mais puis-je considérer qu’il s’agit de certitudes
absolues ? Rappelons qu’on appelle certitude, l’état d’un esprit qui adhère à un contenu de pensée
qu’il croit ou qu’il sait être vrai.
Comme il va de soi que je ne peux pas passer en revue tous les contenus de mon esprit, je vais
procéder méthodiquement.
A bien y regarder, la plus grande partie de mes certitudes sont des certitudes sensibles. Elles
portent sur des objets dont j’ai l’idée par le véhicule de mes sens. Or puis-je me fier absolument aux
informations données par les sens ? Non, répond Descartes car « j’ai quelquefois éprouvé que ces
sens étaient trompeurs, et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont
une fois trompés ».
L’argument cartésien n’a ici aucune originalité. On n’a pas attendu Descartes pour douter de la
fiabilité des impressions sensibles. Cependant il tire de cette observation une règle de prudence ou
de sagesse. Puisque nos sens nous trompent parfois, il est sage de ne jamais leur faire totalement
confiance.
La certitude sensible est ainsi révoquée en doute. Je ne peux pas être absolument certain qu’il y
a un monde, que j’ai un corps. Au fond je suis peut-être abusé par mes sens comme je le suis
lorsque je rêve. Souvent pendant mon sommeil, alors que je suis tout nu dans mon lit, je m’imagine
assis auprès de ma cheminée, en robe de chambre. Comment puis-je être certain que la réalité n’est
pas un songe ? Certes les images diurnes semblent plus claires et plus distinctes, plus cohérentes
que les images oniriques, mais au niveau sensible, il n’y a pas de critères absolument solides pour
distinguer le rêve de la réalité.
Il y a là un thème baroque dont Pascal se fera l’écho : « Si un artisan était sûr de rêver toutes les
nuits, douze heures durant, qu’il est roi, je crois qu’il serait presque aussi heureux qu’un roi qui
rêverait toutes les nuits, douze heures durant qu’il serait artisan » Pensée B 386.
Avec l’argument du rêve, Descartes établit avec force que si l’on devait s’en tenir aux seules
données sensibles, nous n’aurions aucune possibilité décisive de tracer la frontière entre
l’imaginaire et le réel. Il s’ensuit qu’il faut rejeter comme douteux, tout ce que nous savons par le
canal de nos sens.
Reste un autre type de certitudes. Par exemple la certitude mathématique. Ici, l’objet n’est pas
donné extérieurement à l’esprit et « que je veille ou que je dorme, deux et trois joints ensemble
formeront toujours le nombre cinq ». Il s’agit d’une certitude purement rationnelle. Ne dois-je pas

avouer que celle-ci résiste au doute méthodiquement conduit ?
Descartes va aussi révoquer en doute les certitudes rationnelles à l’aide d’un argument pouvant
paraître fantaisiste. Et si, se dit-il, un mauvais génie se plaisait à me tromper lorsque je raisonne ?
Le doute cartésien devient, à cet instant, hyperbolique. En réalité, Descartes pose un vrai problème.
Qu’est-ce qui peut nous assurer que la raison soit une faculté plus fiable que les sens pour fonder la
certitude ? Il se peut qu’elle nous abuse tout autant qu’eux.
Les certitudes rationnelles ne semblent donc pas plus solides que les certitudes sensibles. Elles
aussi sont laminées par le doute. Il faut faire le vide et admettre que tout ce que je sens et ce que je
conçois rationnellement est douteux.
Or, c’est précisément au moment où Descartes a fait le vide le plus intégral qu’il découvre qu’il
peut douter de tout sauf de lui-même en tant qu’il doute. Pour que le mauvais génie me trompe,
il faut que je pense. Je peux douter de tout mais je ne peux pas douter du fait que moi qui doute je
suis. « Je suis, j’existe » dit la Seconde Méditation Métaphysique ; « je pense, donc je suis » dit le
Discours de la méthode.
Etienne Gilson commente : « Je voulais penser que tout était faux et il se pouvait en effet que tout
fût faux (monde, Dieu, corps). Mais il ne se pouvait pas que moi, du moins, qui pensais cela ne
fusse pas quelque chose. Donc, moi qui pense, j’existe ».
Telle est la première certitude, modèle de toutes les autres, fondement de l’édifice du savoir que
Descartes par la seule force de sa pensée a su établir.
On ne rendra jamais assez hommage à cette clarification. Car que fait-on, quand la frontière entre
le réel et le rêve se brouillant, on dit que l’on se pince ? En fait on s’assure de sa propre existence,
on revient à soi comme point fixe sans lequel aucune expérience ne serait possible, pas même celle
du vertige, du brouillage des ordres ou des illusions.
I) Le sens du cogito.
Réponse à la question : « Qu’est-ce que je peux tenir pour certain ? » le cogito est à la fois
l’affirmation d’une existence et d’une essence.
L’existence c’est le fait d’être. L’existence s’éprouve, se constate, se rencontre, elle ne se prouve
ni ne se déduit. Il y a bien une dimension existentielle du cogito. Au moment où je pense, je me sens
exister. « Je suis, j’existe : cela est certain, mais combien de temps ? A savoir autant de temps que je
pense ; car peut-être se pourrait-il faire, si je cessais de penser, que je cesserais d’être ou d’exister ».
Méditation seconde.
L’essence d’un être c’est sa nature, ce qui fait qu’il est ce qu’il est. C’est ce quelque chose que
Descartes va nous demander d’examiner avec attention. Car dans l’état actuel de la méditation, je ne
peux pas me définir par ce que je sais de moi-même par l’intermédiaire de mes sens, la certitude
sensible ayant été suspendue. Je ne puis donc point prétendre être « cet assemblage de membres que
l’on appelle le corps humain (…) puisque j’ai supposé que tout cela n’était rien, et que, sans
changer cette supposition, je trouve que je ne laisse pas d’être quelque chose ». Méditation seconde.
Que suis-je donc ? « Je connus de là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature
n’est que de penser, et qui, pour être, n’a besoin d’aucun lieu, ni ne dépend d’aucune chose
matérielle. En sorte que ce moi, c’est-à-dire l’âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement
distincte du corps, et même qu’elle est plus aisée à connaître que lui, et qu’encore qu’il ne fût point,
elle ne laisserait pas d’être tout ce qu’elle est ». Discours de la méthode IV.
Je me découvre un être, une réalité ontologique. C’est ce que connote la notion de substance. Une
substance c’est ce qui existe en soi, ce qui sert de substrat à des qualités accidentelles, ce qui ne

dépend pas d’autre chose que de soi pour exister.
Cette substance est une chose qui pense. Voilà l’attribut essentiel du sujet. « Je trouve que la
pensée est un attribut qui m’appartient. Elle seule ne peut être détachée de moi ». Je peux me mettre
à distance de mon corps, des contenus de ma pensée, je ne peux pas me séparer de ce qui rend
possible cette opération. Ce qui m’appartient en propre réside dans ce pouvoir. Ce qui est
absolument mien reflue avec Descartes dans la seule opération d’une chose pensante. Le philosophe
donne ici au mot pensée une extension bien plus grande que ce que nous entendons d’ordinaire par
là. « Une chose pensante est une chose qui doute, qui conçoit, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui
imagine aussi et qui sent ». Méditation seconde. La pensée, dans le vocabulaire cartésien est ce que
nous appelons le psychisme. Les émotions, les sentiments, les désirs aussi bien que le jugement ou
la méditation sont des opérations psychiques, c’est-à-dire ce qu’il faut rapporter à la substance
pensante comme à leur condition de possibilité.
Avec la substance pensante, Descartes établit le dualisme de l’âme et du corps, de l’esprit et de la
matière. Il affirme l’existence de deux réalités ontologiquement différenciées, la séparation
anthropologique, l’amputation du sujet de sa dimension corporelle n’étant qu’une manière pour lui
de tirer les conséquences de ce que signifie se réfléchir comme un sujet. Néanmoins, les
malentendus peuvent être tels sur ce point qu’il convient de bien préciser le sens de cette
séparation anthropologique, de ce dualisme des substances ; la substance pensante et la substance
étendue.
On peut affirmer sans ambiguïté que son sens est purement spéculatif. Le dualisme de l’âme et du
corps n’a aucune pertinence sur le plan existentiel car l’homme n’est pas la juxtaposition d’une
intériorité spirituelle et d’une extériorité matérielle. Il est l’union d’une âme et d’un corps, union
si inextricable que concevoir l’homme concret, « le vrai homme » dit Descartes, c’est concevoir
les deux substances comme une seule. Mais cette unité est confuse, opaque à l’entendement, on ne
peut que la vivre. A la princesse Elisabeth, lui demandant de s’expliquer sur la nature de cette union,
Descartes répond que si elle veut quelque lumière sur cette question « il faut s’abstenir de méditer,
il faut vivre ».
« La nature m’enseigne aussi par ces sentiments de douleur, de faim, de soif, etc., que je ne suis
pas logé en mon corps ainsi qu’un pilote en son navire, mais outre cela, que je lui suis conjoint très
étroitement et tellement confondu et mêlé, que je compose comme un seul tout avec lui. Car, si cela
n’était, lorsque mon corps est blessé, je ne sentirais pas pour cela de la douleur, moi qui ne suis
qu’une chose qui pense, mais j’apercevrais cette blessure par le seul entendement, comme un pilote
aperçoit par la vue si quelque chose rompt dans son vaisseau ; et lorsque mon corps a besoin de
boire ou de manger, je connaîtrais simplement cela même, sans en être averti par des sentiments
confus de faim et de soif. Car en effet tous ces sentiments de faim, de soif, de douleur etc., ne sont
autre chose que de certaines façons confuses de penser, qui proviennent et dépendent de l’union et
comme du mélange de l’esprit avec le corps ». Méditation sixième.
Toute la vie affective (plaisir, douleur, désir, aversion etc.) témoigne de l’unité psychosomatique.
Cependant cette donne existentielle ne nous dispense pas de faire l’effort de séparer théoriquement
ce qu’il faut rapporter à l’une ou à l’autre des dimensions nous constituant. Le dualisme cartésien
est donc une distinction de méthode dont les enjeux sont à la fois épistémologiques et moraux.
II) Les enjeux du cogito.
A) Enjeux épistémologiques.

1) Premier enjeu.
Il s’agit pour Descartes de fonder les sciences de la matière et la connaissance de l’esprit, à partir
des deux idées claires et distinctes de pensée et d’étendue dont notre entendement a l’intuition dès
qu’il pense. Ainsi pourront être évitées les confusions qui, par le passé, ont fonctionné comme de
véritables « obstacles épistémologiques ». Bachelard appelle ainsi ce qui empêche la science de se
constituer ou de progresser. De fait, avant la clarification cartésienne, on a eu tendance à projeter
sur la matière des opérations n’ayant de sens que pour une réalité psychique et à bâtir sous le nom
de physique une psychologie de la matière. Pensons au finalisme aristotélicien, à l’idée d’une
âme nutritive et d’une âme sensitive pour rendre compte des fonctions du vivant. La confusion
symétrique consiste à penser le psychisme sur le modèle de la matière et à bâtir sous le nom de
psychologie une physique de l’âme. Le dualisme méthodologique nous détourne de ces
inconséquences. Par là, Descartes est le vrai fondateur de la science moderne. Il expurge la matière
de toute profondeur psychique et impose le modèle mécanique comme modèle d’intelligibilité des
phénomènes matériels.
2) Deuxième enjeu.
Il s’agit aussi de comprendre que « l’âme est plus aisée à connaître que le corps ». Véritable
paradoxe, tant il nous semble que ce qui est étalé dans l’espace, ce qui a une visibilité (les corps) est
plus facilement connaissable que ce qui n’en a pas (l’âme ou l’intériorité psychique). Or Descartes
énonce ici une idée d’une grande profondeur. Que veut-il dire ? Que ce qu’il appelle l’âme ou le
sujet pensant a l’intuition de lui-même. Je ne peux pas sentir sans savoir que je sens, vouloir sans
savoir que je veux. La conscience est claire à elle-même par définition. « Par le nom de pensée,
j’entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l’apercevons immédiatement par nous-
mêmes » Principes de la philosophie I, 9.
On rencontre ici le thème de la transparence de la conscience à elle-même. Ce thème ne signifie
pas que la conscience comprend toujours ce qui se passe en elle, comme s’il n’y avait pas
d’obscurité psychique. Il signifie simplement que même lorsqu’elle est traversée par quelque chose
qui l’étonne, qu’elle ne peut pas reconnaître comme procédant de sa spontanéité, elle en a
conscience. Ma pensée et l’idée de ma pensée sont une seule et même chose. La conscience a
l’intuition de ses états et de ses actes. Une telle intuition du corps est impossible. Ce qui a lieu dans
le corps n’est pas forcément connu de la conscience. Il y a un rapport d’extériorité entre le corps et
l’idée du corps. L’esprit ne saisit le corps que par la médiation d’images, de concepts dont on peut
toujours se demander s’ils sont adéquats à l’objet auquel il renvoie. Voilà pourquoi la connaissance
de la matière est paradoxalement moins aisée que la connaissance de l’âme.
B) Enjeu moral.
Avec le dualisme de l’âme et du corps, Descartes délie ce qui en nous doit être rapporté à l’âme et
ce qui doit l’être au corps. Il identifie le sujet à ce qui le rend possible, à savoir au sujet pensant. Par
là, Descartes le purifie de son épaisseur charnelle et le convoque à une tâche éthique.
De fait, dès lors que je suis une chose qui pense, j’ai le savoir de tout ce qui se passe en moi.
Souvenons-nous que cela ne signifie pas que je peux toujours me l’expliquer. Mais je ne peux pas
éprouver un désir, fùt-il obscène ou être traversé par un fantasme sans m’en apercevoir. Simplement
je ne peux pas considérer que ces vécus s’originent dans l’activité de ma conscience. Alors
comment les rendre intelligibles ?

Là où Freud invitera à lire la manifestation d’un inconscient psychique, Descartes propose de lire
l’effet dans l’âme d’un mécanisme qui est celui de la matière. « On doit attribuer au corps tout ce
qui peut être remarqué en nous qui répugne à notre raison » Passions de l’âme. Art. 47.
C’est que, ce sujet pensant que je suis est lié à un corps et à travers lui à l’extériorité. Tout ce qui
est confus dans mon expérience psychique s’explique dans le cadre du dualisme comme
l’expression de la passivité de l’âme subissant les effets des mécanismes corporels. Ceux-ci excitent
en l’âme des pensées (Descartes les appellent des pensées confuses ou des pensées d’imagination)
ou des mouvements (des volitions, des désirs) se produisant indépendamment de la spontanéité ou
de l’activité du sujet pensant. Il distingue ainsi : les passions de l’âme et les actions de l’âme. Si
une pensée d’imagination est une passion de l’âme, une pensée d’entendement est une action. De
même si la volonté est une action, désirer n’est souvent qu’une passion.
Là où Freud discernera une intentionnalité psychique inconsciente, un autre moi qui pense, parle,
désire (ça parle, ça pense dit Freud), Descartes demande héroïquement de pointer la passivité de
notre âme. (Passions, affections de l’âme dit Descartes).
Il faut bien comprendre que toute anthropologie a des enjeux pratiques, que toute psychologie
engage une morale.
Si le dévoilement freudien de notre réalité psychique fait le fonds de commerce des psychanalystes
et transforme en tâche thérapeutique ce que la philosophie a traditionnellement défini comme une
tâche spirituelle et morale; le dévoilement cartésien s’inscrit dans le droit fil de cette tradition. Car
il est clair qu’une analyse pointant une passivité de l’âme contient par là même une exhortation à
rompre avec cette passivité et à nous réapproprier par l’action de penser, de juger et de vouloir la
maîtrise de notre être.
Descartes fonde ainsi une morale de la liberté et de la responsabilité s’accomplissant dans la
vertu de générosité.
A méditer : « Descartes est dans les faits le vrai fondateur de la philosophie moderne en tant qu’elle
prend la pensée pour principe. L’action de cet homme sur son siècle et sur les temps nouveaux ne
sera jamais exagérée. C’est un héros. Il a repris les choses par le commencement et il a retrouvé le
vrai sol de la philosophie auquel elle est revenue après un égarement de mille ans » Hegel. Leçons
sur l’histoire de la philosophie.
1
/
5
100%