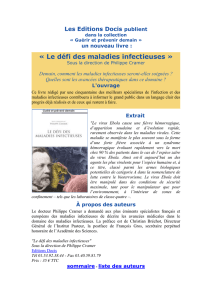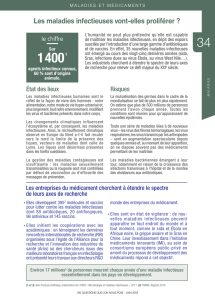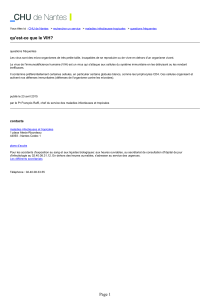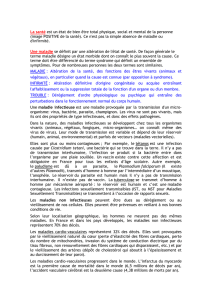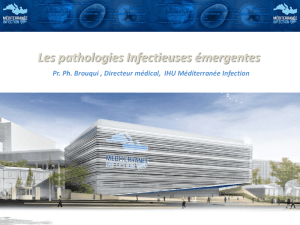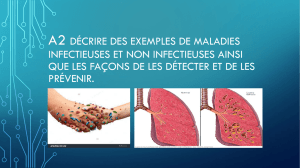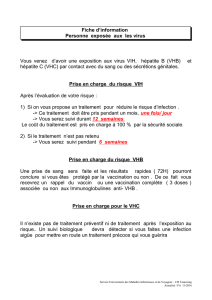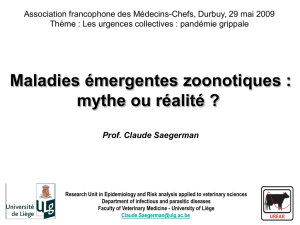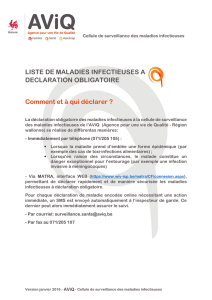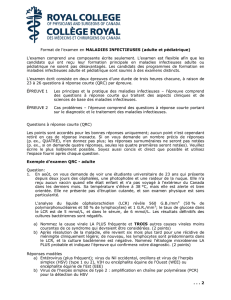Maladies - GLOBE Network

Emergence
maladies
infectieuses
des

Poster n°1
Emergence
maladies
infectieuses
des Hommage
visionnaire de l’infectiologie
à Charles Nicolle
Un hommage particulier et une pensée reconnais-
sante doivent être apportés au Dr Charles Nicolle
en traitant aujourd’hui des « maladies émergentes ».
Il s’agit d’un concept déjà développé, mais qui
bénéficie d’une appellation plus « moderniste »
et d’une amplification médiatique de notre
présent !
Rapportons des extraits très succincts des
écrits de Charles Nicolle dans son ouvrage :
« Destin des Maladies infectieuses »
de 1933.
Origine des inframicrobes
Je ne crois pas que l’on puisse mettre en doute l’opinion
commune que les microbes pathogènes, c’est-à-dire les
agents visibles des maladies infectieuses ont leur origine
dans les microbes inoffensifs ou saprophytes. L’ensemble
des microbes pathogènes constitue un groupe bien restreint
à côté de la notion immense, illimitée des microbes sans
virulence.
Quelques-uns de ceux-ci ont acquis, au cours des siècles,
soit par adaptation lente et progressive, soit par un
phénomène brusque de mutation l’aptitude à se développer
dans les organismes supérieurs. Ces microbes ont été la
souche des germes pathogènes visible.
L’avenir, c’est à dire des observations plus nombreuses et
des progrès nouveaux dans nos connaissances, pourront
mieux fixer (nous l’espérons) la part de chacun des
phénomènes dans la transformation d’un germe saprophyte
en agent de maladie.
C’est un fait fatal et nous ne saurons jamais les dépister
dés leur origine !
Charles Nicolle
Dr Gilles CHAPPUIS

Poster n°2
Emergence
maladies
infectieuses
des Emergence-
Réémergence
NB : la réémergence d’une maladie infectieuse sur un territoire où elle
avait été contrôlée est souvent la conséquence de l’abandon d’un
programme de vaccination (exemple : rougeole en Suisse) ou d’un
défaut de surveillance aux frontières (exemple : fièvre aphteuse).
La légionellose, la maladie de Lyme et le SIDA
sont des maladies nouvelles, émergentes. Toutefois
la perception de nouveauté est toujours relative.
En effet, lorsqu’une maladie connue, apparaît ou
réapparait sur un territoire après une longue
éclipse, elle est perçue par les populations locales
comme nouvelle. Le terme de maladie émergente
peut s’appliquer aux cas suivants :
• Une maladie totalement nouvelle due à un
germe nouveau : le SIDA, l’ESB (vache folle), le
SRAS…
• Une maladie connue dont l’agent infectieux est
nouveau (c’est le cas des fièvres hémorragiques
virales dues à des virus nouveaux (Lassa, Ebola,
Marburg) ou encore la grippe pandémique.
• Une maladie non reconnue jusqu’alors mais qui
le devient à la suite de modifications quantitatives
ou qualitatives par exemple : la dengue hémorra-
gique apparue en 1954 en Asie.
• Une maladie qui apparait dans une région
nouvelle : West Nile aux Etats-Unis, dengue hémor-
ragique en Amérique du Sud et aux caraïbes.
• Une maladie connue due à un germe connu qui
réapparait dans une région : le choléra en Amérique
du sud dans les années 1980.
• Une maladie qui existait chez l’animal dont le
germe a franchi la barrière d’espèce et s’est
adaptée à l’homme. Par exemple : grippe aviaire.
Le concept de maladie émergente a été établi en 1989 à Washington lors d’une réunion sur le thème des
maladies nouvelles. L’apparition du SIDA au début des années 1980 avait soulevé trois questions :
- aurait-on pu prévenir cette maladie ?
- d’autres germes pourraient-ils reproduire une situation semblable ?
- quels moyens devait-on se donner pour prévenir de telles épidémies ?
Dans le domaine vétérinaire pour les épizooties,
on applique également les critères du concept
d’émergence tels que définis précédemment ;
quelques exemples :
• En Europe, la parvovirose canine dans les
années 1980.
• La maladie de Carré pourtant connue depuis
longtemps ailleurs est apparue en Islande ou
encore la maladie de la langue bleue dans le nord
de l’Europe.
• En Europe occidentale, l’encéphalite spongi-
forme bovine (vache folle).
• En Europe, des épisodes de fièvre aphteuse
apparaissent, on parle alors de réémergence de
cette maladie.
Dr Jean-François SALUZZO
Dr Yves MOREAU
©
P
h
o
t
o
F
o
n
d
a
t
i
o
n
M
é
r
i
e
u
x

Poster n°3
Emergence
maladies
infectieuses
des « Une seule
médecine »
CHAUVES-SOURIS :
Ebola, rage, SRAS,
Hendra, Nipah…
SINGES :
paludisme,
fièvre jaune,
SIDA,…
CERVIDÉS :
maladie
de Lyme…
BOVINS :
encéphalopathie
spongiforme
(vache folle)
CARNIVORES :
rage (chien
et renards)
OISEAUX :
grippes (canards
et oies),
West Nile…
MOUSTIQUES :
- Anophèles : Paludisme…
- Aedes : fièvre jaune,
Dengue, Chikungunya
- Culex : West Nile
PHLÉBOTOMES :
leishmaniose…
PUCES :
peste…
TIQUES : maladie
de Lyme,
rickettsioses,
piroplasmoses…
CULICOIDES :
fièvre catarrhale
ovine, fièvre
hémorragique
de Machupo…
POUX :
typhus
hexanthematique…
MURINS
(souris et rats) :
peste, leptospirose,
fièvres
hémorragiques,…
Cette expression aujourd’hui à la mode traduit
pourtant un concept ancien. Il y a deux siècles et
demi, un certain C. Bourgelat, fondateur de
la première école vétérinaire du monde (1761)
préconisait de s’intéresser à la pathologie comparée
de l’homme et des animaux.
Plus tard au XIXe siècle, des professeurs de cette
école, J-B. Chauveau, S. Arloing et P. Galtier
publièrent des travaux précurseurs de ceux de
L. Pasteur, sur la tuberculose, le charbon, la
rage…
Un peu plus tard, d’autres vétérinaires, E. Nocard
puis E. Leclainche ont aussi fait leur cette doctrine.
Enfin le Dr C. Mérieux dès les années trente
estimant que la médecine de l’homme et celle
des animaux voguaient sur la même arche
d’Hippocrate adopta à son tour ce concept qui
devint une sorte de colonne vertébrale de son
action : « Sans frontière entre les deux médecines »
répétait-il à ses équipes. Les historiens de la
médecine estiment vraisemblable que des maladies
infectieuses animales sont devenues humaines
pendant le néolithique (10 000- 7 000 ans av. J-C)
lorsque l’homme est passé du statut de chasseur-
cueilleur à celui d’agriculteur-éleveur. Ainsi la
tuberculose, la rougeole, la lèpre, la variole…
d’origine animale ont aboli la barrière d’espèce et
ont concerné des populations de plus en plus
rassemblées.
Depuis des siècles donc, mais aujourd’hui encore
un fort pourcentage (70 %) d’épidémies humaines
notamment celles qui émergent sont reconnues
d’origine animale.
Les insectes vecteurs hématophages
jouent également
un rôle princeps :
Lorsque l’animal communique à l’homme la maladie dont il souffre on parle de zoonose :
• Virale : rage, grippe…
• Bactérienne : la fièvre de Malte (Brucellose), charbon, tuberculose, tularémie….
• Parasitaire : toxoplasmose, trichinellose, taeniasis, schistosomiase, fasciolose…
Enfin, les animaux s’ils sont souvent à l’origine des maladies infectieuses humaines, ont été et resteront
très utiles pour la préparation de sérums thérapeutiques et pour la production de vaccins (sur lignées
cellulaires ou œufs embryonnés) et leur contrôle.
Les réservoirs animaux
sont nombreux, citons :
« Pas de frontière entre la médecine humaine
et la médecine vétérinaire… »
Dr Yves MOREAU
(Dr Charles Mérieux)
© Photo Fondation Mérieux

Poster n°4
Emergence
maladies
infectieuses
des Guerres & conquêtes
génératrice de
maladies infectieuses
LA CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN
Les zones situées autour de Rome étaient
cernées par des marais impaludés dans lesquels
proliféraient les anophèles. Au cours des premiers
siècles de l’ère actuelle, beaucoup de paysans
romains durent quitter ces terres insalubres et
délaisser la culture pour se réfugier à Rome. Ceci
eut pour conséquence de faire dépendre encore
plus l’approvisionnement de l’Empire de l’apport
des colonies extérieures. Ces mouvements de
population participèrent ainsi à la déstabilisation
de l’Empire qui verra sa fin en 476 ap. J-C.
LA PESTE NOIRE DU MOYEN-AGE :
DEUXIÈME PANDÉMIE
La seconde pandémie de peste trouve très certai-
nement son origine en Asie centrale. Caffa, située
sur la côte orientale de la Crimée (maintenant
Feodossia ou Feodosiya), était un comptoir Génois.
A l’intersection de la route de la soie, grande
route caravanière allant jusqu’en Chine, et de la
route des épices reliant l’Inde, c’était un centre
économique prospère. La Crimée était alors habitée
par les Tartares venus de la steppe sèche et
déboisée. La peste frappe l’armée tartare qui
perdit plusieurs milliers de ses membres. En 1347,
leur chef Khan Djanisberg fit jeter par-dessus
les murailles plusieurs centaines de cadavres de
soldats morts de la peste, « afin que les chrétiens
fussent anéantis par la puanteur ». Les marchands
génois chargèrent leurs bateaux en toute hâte et
prirent la direction de l’Italie.
« Les soldats ont rarement gagné des
guerres. Ils doivent plus souvent rebrousser
chemin lorsque les épidémies leur font
barrage. Et le typhus, avec ses frères et
sœurs appelés peste, choléra, fièvre,
typhoïde et dysenterie ont gagné plus de
campagnes que César, Hannibal, Napoléon,
et tous les généraux de l’histoire.
Les épidémies sont blâmées pour les
défaites, les généraux crédités pour les
victoires. Cela devrait être le contraire. »
Hans Zinsser (1935)
La maladie aborda la ville de Marseille à la
Toussaint 1347 dont toute la population fut
atteinte en quelques semaines. En cinq années,
on estime entre 17 et 28 millions le nombre de
morts en Europe qui comptait alors 50 à 60 millions
d’habitants. Au niveau mondial, c’est le tiers de la
population qui fut décimé par la peste. Plusieurs
générations ont été nécessaires pour corriger les
effets désastreux de cette terrible « peste noire »
(le nom provient des taches foncées formées par
les petites hémorragies qui couvraient le corps du
malade).
LA DIFFUSION AU NOUVEAU MONDE
Entre le XVe et le XIXe siècle, on estime qu’entre
12 et 20 millions d’Africains furent l’objet de trafic
d’esclaves vers le Nouveau Monde. Les régions
concernées portaient surtout sur l’Afrique de
l’Ouest où sévissaient le paludisme et la fièvre
jaune. Les populations de ces régions, habituées
depuis des siècles à ces maladies, étaient relati-
vement protégées, contrairement aux populations
blanches européennes et surtout indigènes
d’Amérique qui furent très largement exterminées.
Au XVIIIe siècle, l’île de St Domingue, aujourd’hui
Haïti, était sous la dépendance de la France. La
fièvre jaune qui était endémique dans le pays
anéantit 23 000 soldats de Napoléon dont son
propre beau-frère, le général Leclerc. Complètement
découragés, les français se retirèrent définitivement
de l’île et le 1er janvier 1804 fut créé le premier
état indépendant d’Amérique avec un président
noir à sa tête, Toussaint Louverture. Quelques
temps après, les émissaires du Président américain
Thomas Jefferson furent envoyés à Paris auprès
du ministre de la Guerre, Talleyrand, pour étudier
la possibilité d’acheter quelques villes de Floride
qui étaient sous dépendance française. Ils furent
étonnés d’apprendre que Napoléon, qui avait
complètement perdu l’espoir de s’installer dans
cette région du monde, et qui avait besoin de ses
troupes pour les conflits européens à venir leur
offrit, pour une somme dérisoire, une superficie
équivalente à un tiers des Etats-Unis et elle
permit aux colons d’effectuer leur migration vers
l’Ouest au cours de ce qu’on appelle « la conquête
de l’Ouest ».
Pr Jean FRENEY
Représentation de la peste blanche
sur le retable de St Jean-Baptiste
et St Jean l'Évangéliste.
Détail de l'Apocalypse
©
M
u
s
é
e
d
e
M
e
m
l
i
n
g
B
r
u
g
e
s
-
P
h
o
t
o
:
H
.
M
a
e
r
t
e
n
s
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%