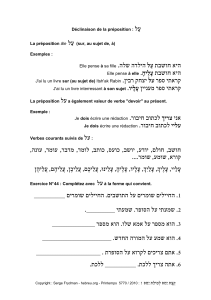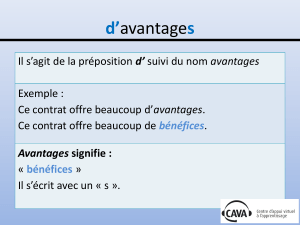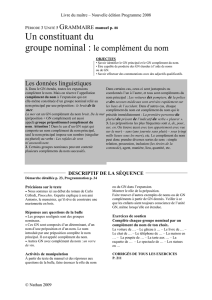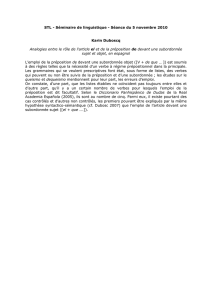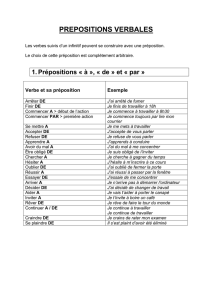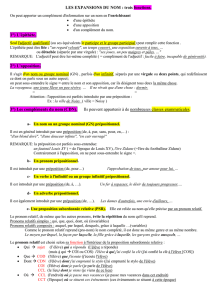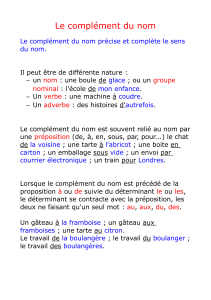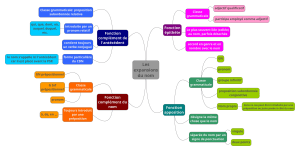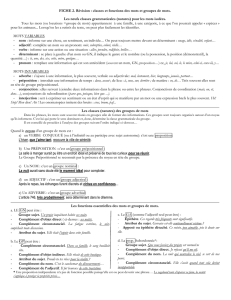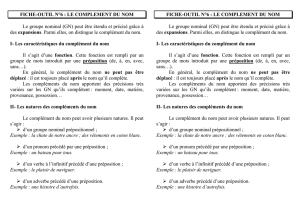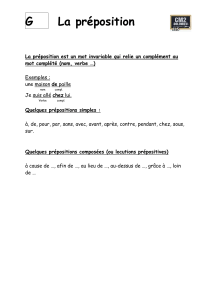NOTES SUR L``ACCUSATIF PRÉPOSITIONNEL` EN SARDE1

NOTES SUR L'‘ACCUSATIF PRÉPOSITIONNEL’ EN SARDE1
RÉSUMÉ. — Cet article aborde la question de l’accusatif préposi-
tionnel en sarde (variété logoudorienne). Cette variété connaît,
comme bien d’autres langues, une stratégie de ‘marquage différen-
tiel’ qui repose sur le caractère plus ou moins individué du référent
auquel renvoie le SN en fonction d’objet. D’une manière plus spéci-
fique, l’article attire l’attention sur le rôle de l’opération de thémati-
sation et des phénomènes de cliticisation dans la genèse du mar-
quage de l’objet. Il montre en même temps que le choix du marquant
prépositionnel ‘a’ en sarde s’éclaire dès que l’on prend en compte sa
valeur spatiale originelle qui affleure également dans d’autres struc-
tures syntaxiques que connaît cette langue.
0. Le problème de la prédication recouvre un champ d’investiga-
tion immense qu’il n’est évidemment pas question d’étudier ici en
détail. L’objectif de cette contribution est d’une part de présenter les
données qu’offre le sarde au regard de problèmes qui mettent en jeu
l’actance, et surtout d’aborder certains aspects particuliers de cette
dernière. La question de l’accusatif prépositionnel est à cet égard
d’autant plus intéressante qu’en dépit d’une littérature abondante sur
la problématique générale du marquage de l’objet, elle n’a pas beau-
coup suscité l’intérêt des spécialistes du sarde. Rappelons qu’il s’agit
d’une construction qui, dans un certain nombre de contextes que nous
aurons l’occasion d’examiner, exige la présence de la préposition a
devant l’objet direct∞∞∞: d’où la désignation d’accusatif prépositionnel.
1. Certaines parties de cette étude ont fait l’objet de présentations orales aux Jour-
nées de Syntaxe organisées par l’ERSS (Bordeaux, 26-27 octobre 2001), et au Work-
shop Predicative Morphosyntax∞∞∞: parameters of Variation in Romance (Palerme, 23-
24 novembre 2001). Je tiens à remercier pour leurs commentaires et observations les
organisateurs et les participants de ces conférences, et en particulier Delia Bentley,
Ignazio Mirto, Claude Muller, Injoo Choi-Jonin et tout particulièrement Lucia
Molinu, que j’ai mis à contribution aussi bien comme linguiste que comme locuteur
natif∞∞∞; qu’elle soit ici remerciée, de même que mes informateurs du village de Bud-
dusò qui ont patiemment répondu à mes questions. Je dois enfin au Professeur Denis
Creissels des observations particulièrement éclairantes sur la problématique du mar-
quage différentiel∞∞∞; qu’il soit également assuré de ma plus vive reconnaissance.
Franck Floricic Bulletin de la Société de linguistique
de Paris, t. XCVIII (2003), fasc. 1, p. 247-303

Précisons que cette désignation reprend simplement ici l’usage qui en
est fait dans la littérature sur le marquage différentiel de l’objet, mais
n’implique aucune prise de position concernant la pertinence de la
notion de cas dits «∞∞∞profonds∞∞∞». Après avoir présenté les données
qu’offre le sarde au regard de la problématique de l’accusatif prépo-
sitionnel, nous procèderons à un bref panorama dont l’unique ambi-
tion est de placer le cas du sarde dans le contexte plus général des
langues qui connaissent ce que l’on désigne comme «∞∞∞marquage dif-
férentiel de l’objet∞∞∞».
1. L’accusatif prépositionnel∞∞∞: données du problème
Comme nous le disions plus haut, l’accusatif prépositionnel
désigne un phénomène commun à un certain nombre de langues
romanes où l’expression en fonction d’objet direct requiert, dans un
certain nombre de contextes, la présence d’une préposition. Précisons
d’ailleurs que la préposition est requise devant une expression nomi-
nale dans des situations plus ou moins variées, et notamment devant
le second terme d’une comparaison. Dans ce qui suit, on s’intéressera
plus particulièrement à la construction objectale telle qu’elle se mani-
feste en sarde.
1.1. L’analyse de Jones (1995)
L’une des rares études consacrées à ce phénomène en sarde est
celle de Jones (1995)2. Ce dernier observe tout d’abord que les condi-
tionnements qui régissent ce phénomène sont complexes et ne se lais-
sent pas saisir à partir de simples dichotomies. En particulier, Jones
souligne à juste titre qu’il est possible d’identifier, à côté des cas où
l’accusatif prépositionnel est soit obligatoire, soit exclu, toute une
série de contextes où l’usage semble plus fluctuant, et où la préposi-
tion qui introduit le NP semble pouvoir être facultative (v. également
Bossong (1982, p. 581)). Les exemples 1a-f, 2a-c et 3a-e empruntés à
Jones illustrent cette tripartition∞∞∞:
1a Appo vistu a Juanne
J’ai vu Jean
1b Appo vistu solu a isse
Je n’ai vu que lui
248 FRANCK FLORICIC
2. Cf. Jones M. A. (1995), «∞∞∞The prepositional accusative in Sardinian∞∞∞: its distri-
bution and syntactic repercussions∞∞∞», in Smith J. C. & Maiden M. (eds.), Linguistic
Theory and the Romance Languages. Coll. Current Issues in Linguistic Theory, 122.
John Benjamins, Amsterdam / Philadelphia, pp. 37-75

1c Appo vistu a frate tuo
J’ai vu ton frère
1d Appo vistu a babbu
J’ai vu papa
1e Appo vistu a duttore Ledda
J’ai vu docteur Ledda
1f Appo vistu a Nápoli
J’ai vu Naples
2a Appo vistu (* a) su frore / su cane / sa mákkina
J’ai vu la fleur / le chien / la voiture
2b Appo vistu (* a) unu pastore
J’ai vu un berger
2c Appo vistu (* a) metas sordatos
J’ai vu de nombreux soldats
3a Appo vistu (% a) su mere / su duttore / su re3(= (5a) in Jones
(1995))
J’ai vu le patron / le docteur / le roi
3b Appo vistu (% a) su duttore de Rosaria (= (5b) in Jones
(1995))
J’ai vu le docteur de Rosaria
3c Appo vistu (%∞∞∞? a) cudd’ómine (= (5c) in Jones (1995))
J’ai vu cet homme-là
3d Appo vistu (%∞∞∞?? a) s’ómine k’at iscrittu cussu libru (= (5d)
in Jones (1995))
J’ai vu l’homme qui a écrit ce livre-là
3e Appo vistu (%∞∞∞? a) sas pitzinnas (= (5e) in Jones (1995))
J’ai vu les filles
La première série d’exemples (1a-f) illustre une corrélation entre la
présence obligatoire de la préposition adevant l’objet et la propriété
/ humain /, / défini / et / animé / du référent associé au NP. Lorsque
en effet le référent en question est non humain (2a) ou non défini (2b-
c), la préposition semble alors exclue devant le NP. Dans la dernière
série (3a-e), l’omission de la préposition est soit possible, soit même
préférable, et ce en dépit du fait que la tête du NP est déterminée par
un ‘article défini’ ou un démonstratif. Jones observe donc en premier
lieu que la prise en compte des propriétés sémantiques du référent
associé au NP ne suffit pas à rendre compte de l’accusatif préposi-
tionnel. Des exemples tels que 1f (i.e. Appo vistu a Nápoli) montrent
NOTES SUR L'‘ACCUSATIF PRÉPOSITIONNEL' EN SARDE 249
3. Le symbole % utilisé par Jones indique que l’énoncé est acceptable pour cer-
tains locuteurs seulement.

d’ailleurs que le trait [+ humain] n’entre pas seul en ligne de compte,
ce que confirme l’exemple 4, où le nom Kira a pour référent un
chien∞∞∞:
4Unu cazzadore at moltu a Kira
Un chasseur a tué Kira
Jones avance donc l’hypothèse que l’accusatif prépositionnel est
régi par les propriétés structurales du NP en fonction d’objet∞∞∞: partant
en effet de l’observation selon laquelle les expressions en 1 sont
dépourvues de déterminant, il suggère que la préposition serait obli-
gatoire devant l’objet dans tous les cas où le NP serait dépourvu de
position de déterminant, alors qu’elle serait exclue dans les cas où la
position de déterminant serait au sein du NP occupée par un détermi-
nant nul (cf. Jones (1995, p. 41)). Cette dernière condition rendrait
compte du fait que des exemples tels que 5a-c (qui correspondent aux
exemples 7a-c de Jones), refusent la préposition alors même que l’ob-
jet est un bare NP∞∞∞:
5a Appo vistu (* a) dzente (= (7a) in Jones (1995))
J’ai vu des gens
5b Appo bitu (* a) latte (= (7b) in Jones (1995))
J’ai bu du lait
5c Appo mandicatu (* a) meleddas (= (7c) in Jones (1995))
J’ai mangé des pommes
Les deux schémas suivants illustrent donc les contraintes structu-
rales auxquelles obéirait la syntaxe de l’accusatif prépositionnel en
sarde∞∞∞:
5d NP NP
N’ Det N’
N (POSS) N
Ø
Juanne dzente
Issos latte
Frate tuo meleddas
Aussi Jones conclut-il qu’il est possible de rendre compte de
l’accusatif prépositionnel en termes strictement syntaxiques et sans
recourir à des propriétés sémantiques telles que la définitude ou
l’humanitude. Si en effet ces propriétés jouaient un rôle aussi cru-
cial, la préposition devrait être exclue (ou pour le moins faculta-
tive) dans des exemples tels que 6 (= 1f), où elle est pourtant obli-
gatoire∞∞∞:
250 FRANCK FLORICIC

6Appo vistu a Nápoli
J’ai vu Naples
Inversement, la préposition devrait être obligatoire dans des exemples
tels que 7, où elle est cependant facultative∞∞∞:
7Appo vistu (% a) su frate de Lukia (= (10b) in Jones (1995))
J’ai vu le frère de Lukia
On remarquera néanmoins qu’une expression telle que Nápoli n’est
absolument pas équivalente à une expression telle que Sa idda inue so
naskidu (La ville où je suis né), même si l’une et l’autre sont suscep-
tibles de renvoyer à la même entité. De la même manière, si le NP su
frate de Lukia désigne une entité qui se trouve être la même que celle
à laquelle réfère par exemple le nom propre Sandro, il n’en demeure
pas moins que les deux expressions visent un objet d’une manière
fondamentalement différente. Tout d’abord, l’expression su frate de
Lukia vise un objet par la mise en relation d’une propriété — / être
frère de / — avec un individu qui se trouve être celui que l’on désigne
comme Lukia. D’autre part – et ceci est pour une part la conséquence
de cela – il est parfaitement possible que l’entité dénommée Lukia ait
plusieurs frères∞∞∞; de ce point de vue, on ne peut absolument pas, au
niveau du mode de construction de la référence, mettre sur le même
plan les deux expressions su frate de Lukia et Sandro, puisque seul
cette dernière vise ‘directement’ son objet. Plus problématiques
encore sont les cas où, comme du reste le signale Jones, la préposi-
tion est exclue alors même que l’objet direct est un nom propre. Un
exemple tel que 8 montre en effet qu’il n’est pas possible ici d’igno-
rer les propriétés sémantico-référentielles du NP objet∞∞∞:
8a Appo leggidu (* a) Platone
J’ai lu Platon
De toute évidence, si * Appo leggidu a Platone est irrecevable,
c’est parce que – pour reprendre la terminologie de Fauconnier
(1984) – le NP identifie une cible à travers la description du déclen-
cheur∞∞∞: la cible est en l’occurrence un objet dont la représentation est
construite à travers la relation qu’il entretient avec l’image de la per-
sonne du même nom4.
8b.
ab
déclencheur cible
‘Platon’ ‘livre’
NOTES SUR L'‘ACCUSATIF PRÉPOSITIONNEL' EN SARDE 251
4. Cf. Fauconnier G. (1984), Espaces mentaux. Aspects de la construction du sens
dans les langues naturelles. Coll. Propositions. Les Editions de Minuit, Paris.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
1
/
57
100%