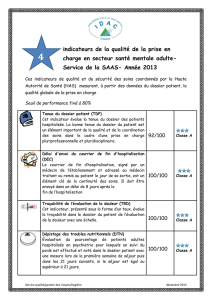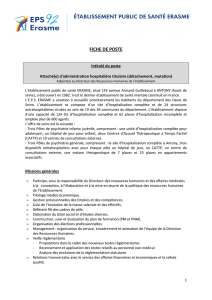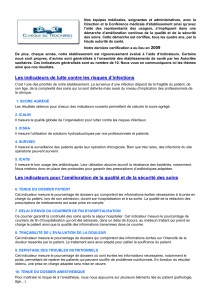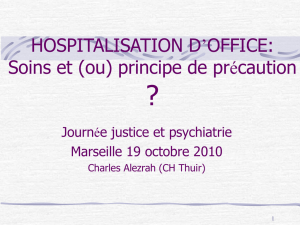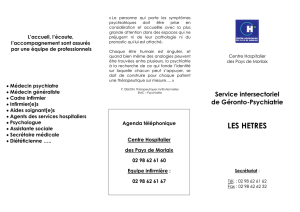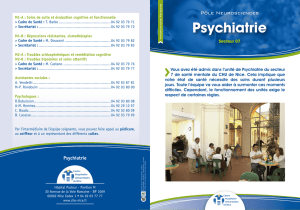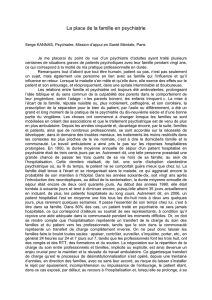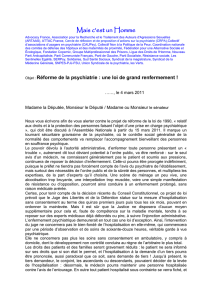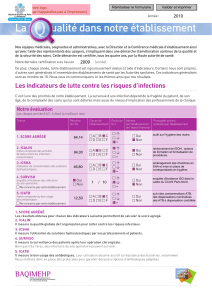Durées d'hospitalisation en psychiatrie : note méthodologique

Journal Identification = IPE Article Identification = 0930 Date: May 24, 2012 Time: 3:41 pm
L’Information psychiatrique 2012 ; 88 : 381–4
QUESTION OUVERTE
Mesurer les durées d’hospitalisation :
note méthodologique
Franc¸ois Chapireau
RÉSUMÉ
Les enjeux méthodologiques sont importants pour l’étude des durées d’hospitalisation en psychiatrie, mais ils sont rarement
discutés. Quatre points sont analysés dans cette note : les règles de calcul d’un indicateur, la signification de l’indicateur,
le choix de l’indicateur et celui du modèle théorique.
Mots clés : durée de séjour, hospitalisation psychiatrique, indicateur de gestion, méthodologie
ABSTRACT
Measuring duration of hospital stay : a methodological note. Methodological issues are important for the study of the
duration of hospital stay in mental hospitals, but they are rarely discussed. Four points are analyzed in this note : rules in
calculating an indicator, the significance of the indicator, choice of the indicator, and choice of a theoretical model.
Key words: length of hospital stay, psychiatric hospitalization, management indicator, methodology
RESUMEN
Medir la duración de la hospitalización. Lo que se juega a nivel metodológico es importante para el estudio de la duración
de la hospitalización en psiquiatría, pero pocas veces se pone a discusión. Cuatro puntos se analizan en esta nota : las reglas
de cálculo de un indicador, el significado del indicador, la elección del indicador y la del modelo teórico.
Palabras claves : duración de estancia, hospitalización psiquiátrica, indicador de gestión, metodología
Les durées d’hospitalisation sont l’objet d’une atten-
tion soutenue. Des indicateurs sont utilisés pour en
suivre l’évolution. Des comparaisons sont effectuées.
L’organisation des soins en tient compte. Or, les indica-
tions méthodologiques disponibles se bornent à formuler le
mode de calcul des indicateurs, comme si leur usage était
dépourvu d’ambiguïté. Ce n’est pas le cas. La mesure des
durées d’hospitalisation peut donner lieu à des malenten-
dus, voire à des contresens. Une réflexion méthodologique
Psychiatre des hôpitaux honoraire, responsable du département
d’information médicale, ASM 13, 11, rue Albert-Bayet, 75013 Paris,
France
Tirés à part : F. Chapireau
est nécessaire. Quatre questions seront évoquées de la plus
pratique à la plus générale : les règles de calcul d’un indi-
cateur, la signification de l’indicateur (ce qu’il indique), le
choix de l’indicateur et celui du modèle théorique. Pour les
rendre aussi claires que possible, le jargon technique sera
évité.
Les règles de calcul de l’indicateur
Le plus souvent, les durées d’hospitalisation sont étu-
diées à l’aide d’une moyenne, calculée en divisant le
nombre annuel de journées d’hospitalisation par le nombre
de séjours observés sur la même période (c’est la durée
moyenne d’hospitalisation par séjour, appelée par abrévia-
tion la durée moyenne de séjour ou DMS) ou bien par
le nombre de patients concernés (c’est la durée moyenne
d’hospitalisation par patient, appelée par abréviation la
durée moyenne d’hospitalisation ou DMH).
doi:10.1684/ipe.2012.0930
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦5 - MAI 2012 381
Pour citer cet article : Chapireau F. Mesurer les durées d’hospitalisation : note méthodologique. L’Information psychiatrique 2012 ; 88 : 381-4 doi:10.1684/ipe.2012.0930
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 0930 Date: May 24, 2012 Time: 3:41 pm
F. Chapireau
Malgré la simplicité apparente du calcul, les erreurs sont
possibles. La plus grave tient à l’omission des patients
déjà présents le premier jour de la période. Elle figure
encore dans certains documents du ministère de la Santé.
De quoi s’agit-il ? Le numérateur comprend la totalité des
journées comptées dans l’année, et inclut donc celles qui
correspondent aux patients déjà présents le premier jour,
c’est-à-dire aux séjours déjà en cours au début de la période.
Quand le dénominateur ne comprend que les séjours ayant
débuté au cours de la période (ou les patients admis), les
deux termes de la division ne portent pas sur les même évè-
nements. Le résultat est trop élevé car il attribue aux séjours
ayant débuté au cours de la période (ou aux patients admis)
des journées qui correspondent en fait à ceux qui étaient
déjà en cours (ou déjà présents) le premier jour. Pour que le
numérateur et le dénominateur portent sur les mêmes évè-
nements, il faut inclure dans le dénominateur le nombre de
patients dont le séjour est déjà en cours au premier jour de
la période. Ces remarques ne sont pas sans conséquence.
Un texte aussi important que le Rapport Massé [5] a basé
ses propositions sur des données officielles nettement sur-
estimées à cause de cette erreur de calcul. Ainsi, ce rapport
cite le chiffre (tiré de l’enquête H80) de 60,9 jours pour
la durée moyenne de séjour par séjour dans l’ensemble
des établissements et services sectorisés en 1989. Si le
calcul avait été effectué comme il aurait du l’être, en comp-
tant aussi les présents au premier janvier, le lecteur aurait
appris que cette DMS était en fait de 52,0 jours. De plus,
l’ampleur de l’erreur n’a pas été la même selon la caté-
gorie d’établissement (CHS, HPP, CHG et cliniques). Dès
lors, les comparaisons proposées dans la publication offi-
cielle et reprises dans le rapport Massé étaient fallacieuses.
À partir de l’activité de 1989, les documents du ministère
consacrés aux secteurs de psychiatrie ont présenté une DMS
par patient (DMH) calculée sur l’ensemble de la file active
hospitalière et incluant donc les présents au 1er janvier. En
revanche, la DMS par séjour publiée dans la Statistique
d’activité des établissements (SAE) continue actuellement
à être calculée sans compter les présents au 1er janvier.
La signification de l’indicateur
La durée moyenne d’hospitalisation est un indicateur.
Il convient de ne pas se tromper sur ce qu’il indique.
Toute erreur sur ce point a des conséquences sur les déci-
sions, puisque l’information supposée ne correspond pas
à l’information effective. Ainsi, il est courant d’entendre
que si dans un hôpital A, la durée moyenne de séjour
est de X jours, cela signifie qu’un patient admis dans cet
établissement va probablement y rester pour une durée
de X jours. Cette affirmation semble être du simple bon
sens. Pourtant, elle est presque toujours fausse. Pour le
comprendre, il faut s’arrêter sur l’effet de répartition produit
par la moyenne. C’est particulièrement net dans l’exemple
suivant : le New York Times du 29 mars 2007 a rendu compte
d’une étude portant sur l’évolution du revenu des Amé-
ricains de 2004 à 2005. D’une année à l’autre, le revenu
moyen a augmenté d’environ 9 %. Cela signifie-t-il qu’en
un an, chaque citoyen américain a vu son revenu s’accroître
en moyenne d’environ un dixième ? On pourrait le croire.
Ce serait une erreur. Le citoyen moyen et le revenu moyen
sont tout à fait distincts. En effet, l’article du New York
Times nous apprend que de 2004 à 2005, le revenu de 90 %
des Américains a légèrement baissé (0,6 %). Si le revenu
moyen a quand même augmenté, c’est parce que le revenu
des 10 %, les plus riches, s’est nettement accru. Lors du cal-
cul du revenu moyen, cet accroissement a été réparti entre
les Américains, puisque (rappelons-le) le revenu moyen est
calculé en divisant la somme de tous les revenus par le
nombre de personnes concernées. Telle est la répartition
produite par les moyennes.
Bien entendu, le même phénomène se produit pour les
durées moyennes de séjour. Qu’il s’agisse de la DMS par
patient (DMH) ou de la DMS par séjour, les valeurs les plus
élevées pèsent beaucoup sur les moyennes. De même, qu’il
ne faut pas confondre revenu moyen et américain moyen, de
même, c’est une erreur d’assimiler séjour moyen et patient
moyen. Ainsi par exemple, c’est une erreur de penser que
si à l’hôpital A, la durée moyenne de séjour est plus élevée
qu’à l’hôpital B, alors les patients admis dans l’hôpital A
vont probablement y rester plus longtemps que s’ils avaient
été admis dans l’hôpital B. Il est même possible que le
contraire soit vrai. En effet, pour que la durée moyenne de
séjour soit plus élevée dans l’hôpital A que dans l’hôpital
B, il suffit que l’hôpital A rec¸oive davantage de patients
de long séjour que l’hôpital B. La DMS n’apporte pas
d’information sur le sort du patient moyen. Elle informe
sur la consommation de ressources.
Le choix de l’indicateur
Quel est l’indicateur qui va nous informer sur le sort
du patient moyen ? C’est la médiane. La médiane est
la valeur qui sépare une population donnée en deux
groupes d’effectif égal de manière à ce qu’il y ait autant
de personnes se trouvant au-dessus et au-dessous de cette
valeur. En France, la durée médiane des séjours révolus
en psychiatrie est devenue inférieure à 44 jours à partir de
1970. Autrement dit, dès 1970, la moitié des malades sortis
dans l’année avait effectué un séjour de 44 jours au plus [3].
En 1978, près de deux patients sur trois (64 %) étaient sortis
avant cette durée [4]. Ces résultats contrastent fortement
avec ceux touchant la durée moyenne de séjour par patient,
qui est descendue à 45 jours en 2000 seulement. Cet écart
montre à quel point il est important de ne pas confondre
durée moyenne et durée médiane. Croire aujourd’hui
qu’une personne admise en service de psychiatrie va
probablement y rester 45 jours, c’est prendre la situation
382 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦5 - MAI 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 0930 Date: May 24, 2012 Time: 3:41 pm
Mesurer les durées d’hospitalisation : note méthodologique
de 1970 pour celle de 2000. Fonder aujourd’hui des
décisions sur cette idée, c’est agir non pas en fonction de
la situation actuelle, mais par rapport à celle de 1970. Il
n’y a plus de donnée nationale sur la durée médiane de
séjour depuis 1978. Une enquête conduite en 2000 par la
Caisse régionale d’assurance maladie dans l’ensemble de
la région Aquitaine a montré que la moitié des patients
admis en service sectorisé de psychiatrie pendant l’enquête
étaient sortis après un séjour de 13 jours au plus [1].
Le choix du modèle théorique
La moyenne et la médiane représentent des situations
typiques. Mais, la mesure des durées d’hospitalisation
s’intéresse aussi aux situations atypiques. C’est le cas
notamment des séjours de longue durée, qui ont occasionné
plusieurs enquêtes et des débats animés. Si les patients
de long séjour suscitent tant d’attention, c’est parce que
parmi eux, une proportion notable est sensée relever non
pas du secteur sanitaire mais du secteur médicosocial (mai-
son d’accueil spécialisée, foyer d’accueil médicalisé, etc.).
Le choix de transférer des personnes du secteur sanitaire
vers le secteur médicosocial est un choix politique qu’on
peut approuver ou non, mais qui ne soulève pas en lui-même
de difficulté méthodologique. La difficulté méthodologique
est ailleurs.
À la base de cette politique se trouve l’idée, selon
laquelle une fois que les patients de long séjour ont quitté
les services de psychiatrie, il est possible de fermer un
nombre de lits analogue au nombre de personnes transfé-
rées, et donc de réduire les coûts. Cette politique reste un axe
majeur de la planification des équipements psychiatriques.
Selon la Mission nationale d’appui en santé mentale, elle
pourrait toucher le quart voire le tiers des lits sectorisés
[6]. Elle repose sur une hypothèse implicite : une fois que
les personnes sont dans le secteur médicosocial, rien ne se
passe dans les services de psychiatrie. C’est une représenta-
tion semblable à celle des vases communicants. Ce modèle
est statique, quasi mécanique. Il est trompeur. Les faits le
contredisent souvent.
En pratique, que se passe-t-il ? Dans de nombreux cas,
et de plus en plus fréquemment, lorsqu’un lit est « libéré »
par la sortie d’un patient de long séjour, ce lit est aussitôt
occupé par un autre patient. Bien plus, parmi ces nouveaux,
certains deviennent à leur tour des patients de long séjour
[2]. Le modèle des vases communicants est trompeur,
car la population hospitalisée est en renouvellement
constant. Son principal caractère n’est pas d’être statique,
mais au contraire d’être dynamique. Cette dynamique est
complexe. Ainsi, il ne faut pas se tromper sur l’effet des
soins psychiatriques qui se déroulent en dehors de l’hôpital.
Selon le modèle des vases communicants, les soins ambu-
latoires ou à temps partiel ont un effet d’« alternative à
l’hospitalisation ». De fait, certaines hospitalisations sont
évitées grâce à des soins mieux adaptés, et d’autres sont rac-
courcies parce que les soins se poursuivent sous une autre
forme. Toutefois, une conséquence du vaste développement
des soins ambulatoires et à temps partiel est l’accroissement
considérable du nombre de personnes ayant accès aux soins
psychiatriques et donc du nombre de celles qui sont suscep-
tibles d’être hospitalisées. D’autres facteurs jouent dans le
même sens, comme la plus grande tendance à se reconnaître
en souffrance psychique, la présence de psychiatres dans les
services d’urgence, etc. Le modèle des vases communicants
ne prend pas du tout en compte ces phénomènes. De plus, en
raison de la disparité des équipements de soins d’un lieu à
l’autre, mais aussi de la diversité des pratiques à l’hôpital et
autour de l’hôpital, ces dynamiques varient elles aussi forte-
ment dans le temps et dans l’espace. Il convient pourtant de
mesurer toutes les dimensions de la situation empirique, si
l’on veut comprendre la variété des dynamiques et dégager
des axes d’amélioration adaptés à la diversité des situations.
À côté des longs séjours, l’autre situation atypique est
celle des séjours très courts. Selon le modèle des vases
communicants, il n’y a pas de raison de s’y intéresser. Pour-
tant, il n’est pas indifférent dans la vie d’une personne d’être
hospitalisée en psychiatrie, même si c’est pour en sortir
presque aussitôt. De plus, les hospitalisations très courtes
font appel à la disponibilité et à l’énergie des soignants
et les restreignent pour les autres patients. Leur fréquence
actuelle n’est pas connue mais elle est sans doute notable,
car en 1978, un malade sorti sur cinq était resté moins
de huit jours hospitalisé en psychiatrie [4]. L’étude des
hospitalisations très courtes sera riche d’enseignements.
Pourvu qu’elle soit conduite selon une méthodologie rigou-
reuse, elle permettra de connaître les cas dans lesquels les
professionnels eux-mêmes pensent que l’admission n’est
pas justifiée et elle éclairera la diversité des facteurs ayant
conduit néanmoins à l’admission, ce qui permettra ensuite
d’agir de manière appropriée à chaque situation. Malgré
tout cela, les séjours très courts suscitent peu d’intérêt :
est-ce parce qu’ils ne concernent qu’un faible nombre de
journées et que par conséquent aucune économie financière
immédiate n’est à attendre de leur côté ?
Conclusion
Que soit formulé le choix politique d’imposer certaines
limites aux soins hospitaliers, c’est un sujet légitime de
débat démocratique. Que ces limites soient décidées sur
la base de méthodes fausses et de théories inappropriées,
c’est une erreur méthodologique qui a deux conséquen-
ces. D’une part, les solutions proposées portent à faux
dans la mesure où elles reposent sur une connaissance
erronée des situations qu’elles visent à modifier. D’autre
part, les préoccupations financières prennent une place
disproportionnée aux dépens du souci du sort des per-
sonnes. Pour mieux connaître le sort des personnes, pour
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦5 - MAI 2012 383
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 0930 Date: May 24, 2012 Time: 3:41 pm
F. Chapireau
mesurer les durées médianes de séjour et pour analyser les
diverses dynamiques des populations soignées, il faudra
apporter quelques adaptations au système actuel de recueil
d’informations en psychiatrie, puis se donner les moyens
d’étudier les données recueillies.
Conflits d’intérêts : aucun.
Références
1. Bénétier M, Dupuy P, Dupouy-Dupon C, et al. Les patients en
hospitalisation complète en psychiatrie dans la région Aqui-
taine. Pratiques et Organisation des Soins 2006 ; 37 : 205-13.
2. Chapireau F. Les nouveaux longs séjours en établissements de
soins spécialisés en psychiatrie : résultats d’une enquête natio-
nale sur un échantillon représentatif (1998-2000). L’Encéphale
2005 ; 31 : 466-76.
3. Inserm. Statistiques médicales des établissements psychia-
triques. Année 1970. Paris : Inserm, 1973.
4. Inserm. Statistiques médicales des établissements psychia-
triques. Année 1978. Paris : Inserm, 1982.
5. Massé G. La psychiatrie ouverte. Rennes : Éditions ENSP,
1997.
6. MNASM. Guide pour une démarche plurielle de conduite du
changement. Paris : MNASM, 2011.
384 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 88, N◦5 - MAI 2012
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 05/06/2017.
1
/
4
100%