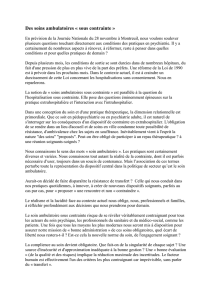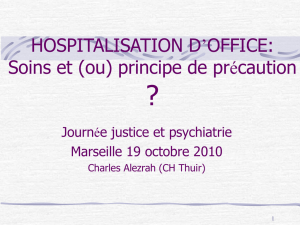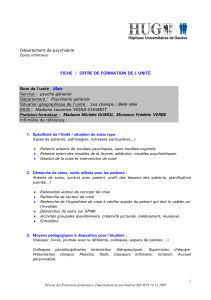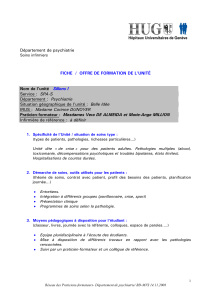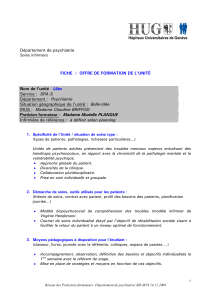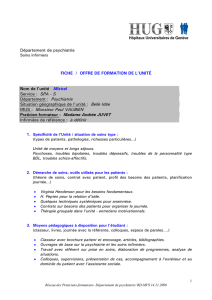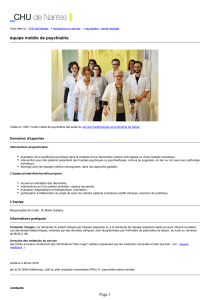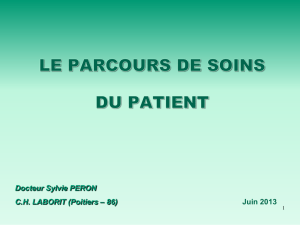La place de la famille en psychiatrie

La place de la famille en psychiatrie
Serge KANNAS, Psychiatre, Mission d’appui en Santé Mentale, Paris
Je me placerai du point de vue d’un psychiatre d’adultes ayant traité plusieurs
centaines de situations graves de patients psychotiques avec leur famille pendant vingt ans,
ce qui correspond à la moitié de ma pratique professionnelle en durée.
Remarquons tout d’abord que tout être humain, patient ou pas, n’est pas seulement
un sujet, mais également une personne en lien avec sa famille qui l’influence et qu’il
influence en retour. Lorsque la maladie s’en mêle et qu’elle dure, elle exerce des effets sur le
patient et son entourage, et réciproquement, dans une spirale interminable et douloureuse.
Les relations entre famille et psychiatrie ont toujours été ambivalentes, prolongeant
l’idée biblique et du sens commun de la culpabilité des parents dans le comportement de
leur progéniture, selon l’adage : « les parents boivent, les enfants trinquent ». La mise à
l’écart de la famille, réputée nuisible ou, plus noblement, pathogène, et son corollaire, la
prescription de la séparation pour le bien du patient, par l’asile ou différemment, a été un
grand et long moment de la pratique de la psychiatrie du dix-neuvième siècle et d’une bonne
partie du vingtième. Les choses ont commencé à changer lorsque les familles se sont
mobilisées en créant des associations et que le traitement psychiatrique est de venu de plus
en plus ambulatoire. Depuis les années cinquante et, davantage encore, par la suite, familles
et patients, ainsi que de nombreux professionnels, se sont accordés sur la nécessité de
développer, dans le domaine des troubles mentaux, les traitements les moins restrictifs dans
les contextes les plus proches de la vie normale, c’est à dire le domicile/la famille et la
communauté. Le travail ambulatoire a ainsi pris le pas sur les réponses hospitalières
prolongées. En 1950, la durée moyenne annuelle de séjour d'un patient hospitalisé en
psychiatrie était de trois cents jours par an. Autrement dit, une telle personne possédait une
grande chance de passer les trois quarts de sa vie hors de sa famille, au sein de
l’hospitalisation. Cette dernière réalisait, de fait, une sorte d'adoption clandestine
psychiatrique où, au fil du temps, le patient ne se comportait guère mieux que chez lui. La
famille était tenue à l'écart et se réorganisait sans le malade, ce qui aggravait encore la
probabilité de son maintien à l'hôpital. Dans les années soixante-dix, soit vingt ans après
l'introduction des neuroleptiques, au début de la sectorisation, la durée moyenne annuelle de
séjour était encore de deux cent quarante jours. Au début des années 1990, elle était
tombée à soixante jours et tend à diminuer encore, puisqu’elle atteint 35 jours actuellement
en incluant, de plus, les patients hospitalisés au long cours. Autrement dit, en 2006, un
patient hospitalisé l’est en moyenne une fois tous les dix-huit mois à deux ans quelques
jours, plus rarement quelques semaines. Il passe l’essentiel de son temps chez lui, c’est à
dire dans sa famille. Dans 80% des cas, un patient traité en psychiatrie ne sera jamais
hospitalisé, ce qui correspond d’ailleurs au souhait de ses représentants, à condition qu’il
reçoive une aide adéquate dans la communauté pendant les moments difficiles. Or, on doit
se rendre compte que l’hospitalisation représente un transfert de la charge du soin des
familles et du patient vers les professionnels, tandis que le soin dans la communauté
représente un transfert de charge complètement inverse. On ne peut donc laisser les
familles faire le boulot toutes seules : apaiser, contrôler, surveiller, s’inquiéter, porter, etc., en
général 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tandis que les professionnels font les trois huit, ont
des congés et des RTT, des formations et du soutien. La négociation sur la répartition de la
charge du soin entre professionnels et familles, implicite ou explicite, est ainsi devenue un
enjeu crucial pour le maintien et la réussite du travail ambulatoire. Ce gigantesque transfert
de charge qu’est le processus de désinstitutionnalisation s’est opéré, depuis une trentaine
d’années, en direction des familles, avec ou sans leur accord, au risque de laisser s’installer
le rejet par épuisement, incompréhension ou impuissance de l’entourage, le patient étant,
dans ce cas exposé, par défaut, au recours à l’hospitalisation et, lorsqu’elle se prolonge, à sa

conséquence délétère : l’évitement de la construction d’une vie normale. Autrement dit, les
principales différences qui peuvent séparer et, parfois, opposer les professionnels de la
psychiatrie, ne portent pas sur la prédominance, dans leur pratique, de tel ou tel modèle,
biologique, psychodynamique comportemental, psychosocial ou systémique, mais sur la
considération plus ou moins importante que les soignants attribuent au rôle des familles
dans les soins à leurs membres malades mentaux, dés lors qu’ils admettent que le
traitement doit être préférentiellement ambulatoire. Cette question est fondamentale, au
cœur de toute pratique de santé mentale. Reconnaissons que si les représentants des
familles ont su conquérir et faire respecter leur place à tous les échelons des représentations
institutionnelles, il reste du chemin à faire pour que cette progression soit équivalente dans la
pratique des équipes soignantes de psychiatrie.
Ma propre pratique s'insère d'approches développées au milieu des années soixante-
dix. Elles semblent exercer des effets positifs sur le processus schizophrénique, au-delà des
résultats obtenus par la médication seule, et elles procèdent d'une extension majeure de la
théorie des systèmes familiaux, parce qu’elles incluent des facteurs extra-familiaux. C'est
pourquoi nous parlons de modèle écosystémique ou éco-familio-systémique plutôt que de
thérapie familiale au sens strict.
Ces approches ne nient pas qu'il existe une vulnérabilité biologique dans l'étiologie
de nombreux troubles mentaux en général et des états psychotiques en particulier, ni que de
tels patients sont accessibles, très utilement, à des traitements individuels
psychothérapiques et aux psychotropes. Elles voient le travail avec la famille comme un
aspect, complémentaire, d'un traitement combiné global plutôt que comme la cure d’une
maladie « fondamentale ». L’orientation générale de ces thérapies bio-médico-psycho-socio-
familiales combinées est de s'adjoindre la famille comme partenaire. Le travail consiste à
compenser, par des interventions ciblées, les difficultés du patient, et l’objectif à atteindre est
la réhabilitation de celui-ci, l'allègement du fardeau des proches, et non la disparition d'un
quelconque dysfonctionnement familial. Il ne s'agit donc pas d'une recherche de la guérison,
et l'on admet généralement que celle-ci est hors de portée de la famille ou de toute thérapie
disponible à l'heure actuelle. La famille est vue, dans cette optique, comme une force
suffisamment puissante pour réduire à néant toute chance de réussite du traitement. Mais
c'est précisément cette force, dont la mobilisation est indispensable, qui permet d'atteindre
les résultats attendus. En fait, notre hypothèse principale est que la famille est la seule
influence extérieure qui dispose de l'impact requis.
1
/
2
100%