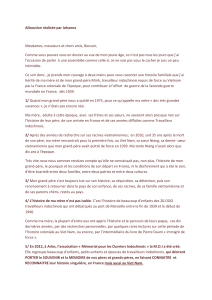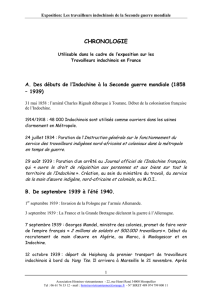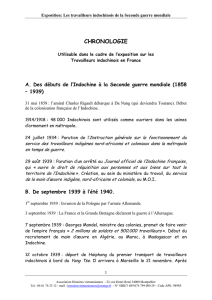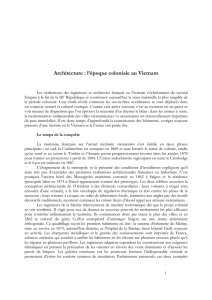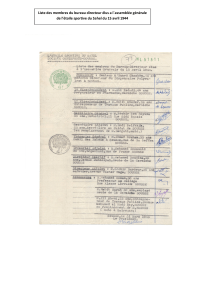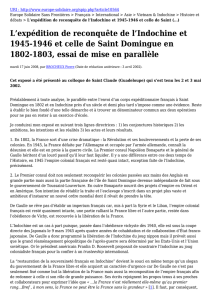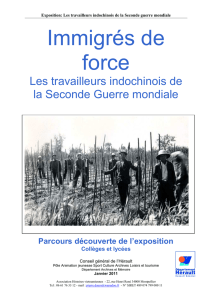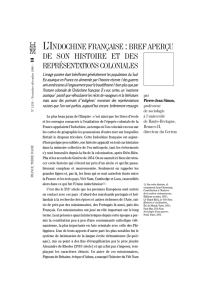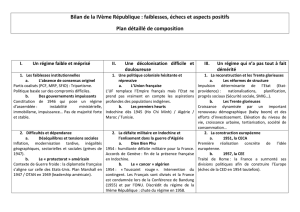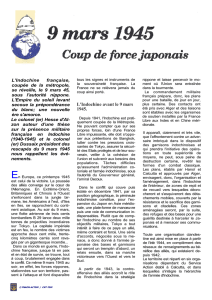LES TRAVAILLEURS INDOCHINOIS EN FRANCE DE 1939 A 1948

Liêm-Khê TRAN-NU (LUGUERN)
LES TRAVAILLEURS INDOCHINOIS
EN FRANCE DE 1939 A 1948
Mémoire de Maîtrise
Sous la direction de Philippe VIGIER
Université Paris X - Nanterre
U.F.R. d’Histoire
Année 1987-88

Table des abréviations
AD Archives Départementales
AN Archives Nationales
ANSOM Archives Nationales - Section Outre Mer
BDIC Bibliothèque de Documentation Internationale contemporaine
CERMTRI Centre d’Etudes et de Recherches sur les Mouvements Trotskystes
et Révolutionnaire
DTI Direction des Travailleurs Indochinois
EMA Etat Major de l’Armé
INF Indochine Nouveau fonds
MOI Main d’œuvre Indigène Nord-Africaine et Coloniale
ONS Ouvrier Non-Spécialisé
RG Renseignements Généraux
SHAT Service Historique de l’Armée de Terre

INTRODUCTION
La Seconde Guerre mondiale a déclenché une mobilisation générale des
ressources humaines et des matières premières des colonies françaises pour
contribuer à l'effort de guerre de la métropole. En décembre 1939, Georges Mandel,
ministre des Colonies, fit part à Edouard Daladier, Président du Conseil, de ses
prévisions concernant l'appoint de combattants et de travailleurs indigènes à l'effort
de guerre: 300.000 coloniaux seraient envoyés en métropole pendant la première
année de guerre (1).
Les événements rendirent le plan Mandel caduc. L'appel aux colonies cessa
promptement avec la défaite de 1940. En avril 1940, 7000 tirailleurs indochinois
sur un total de 41.000 tirailleurs coloniaux étaient présents, sous les drapeaux, en
France. En juin de la même année, près de 20.000 travailleurs indochinois envoyés
en métropole étaient affectés comme ouvriers non spécialisés (ONS) dans les
industries participant à la défense nationale (2).
Comparés à l'effectif fourni par l'Indochine à la France en 1914-1918, ces
chiffres sont moindres: au cours de la Grande Guerre, les Indochinois envoyés en
métropole furent au nombre de 90.000, dont 40.000 comme travailleurs. La rapidité
avec laquelle survint la défaite ne permit pas une mise à contribution plus massive
des colonies. Cela était d'autant plus vrai pour l'Indochine du fait de son
éloignement: 15.000 kilomètres la séparent de la France.
Quoi qu'il en soit, l'arrivée de ces 20.000 travailleurs constitue la seconde
émigration massive des Indochinois vers la métropole. La première vague
migratoire a correspondu, donc, à la guerre de 1914-1918. Dans l'entre-deux
guerres, l'émigration indochinoise devint un phénomène régulier mais elle ne
concernait qu'une minorité, constituée notamment par des étudiants venus
poursuivre leurs études en métropole. En 1939, le pouvoir colonial, répétant le
précédent de la première guerre, décida de prélever dans la paysannerie pauvre de
l'Indochine une main-d'oeuvre appelée à remplacer, dans les usines de guerre
métropolitaines, les hommes envoyés au front. Cette politique se situe dans le
prolongement de l'exploitation des ressources économiques et humaines des
colonies par la métropole, laquelle exploitation s'est particulièrement intensifiée
entre les deux guerres.
Les 20.000 paysans indochinois requis furent massivement affectés dans
le secteur industriel où le taylorisme et le fordisme étaient appliqués de façon
systématique. Cette organisation du travail ( le travail à la chaîne, le travail posté

– les « trois huit » - et l'accélération des cadences), qui repose sur le postulat du
rendement collectif et non individuel, offrait la possibilité de l'utilisation d'une
main d'oeuvre abondante et non qualifiée. Ces hommes furent ainsi confrontés à
une expérience qui les mit en rupture totale avec leur propre vécu: travail industriel
mais aussi confrontation avec le monde occidental, son mode de vie, son
fonctionnement administratif et politique.
Une telle expérience ne pouvait pas constituer une simple parenthèse dans
leur vie, d'autant que leur séjour en métropole s'est prolongé dans le temps. Plus de
14.000 d'entre eux furent contraints de demeurer en France jusqu'à la Libération.
Leur rapatriement s'étira jusqu'en 1950. Pour ces hommes jeunes (la plupart avaient
vingt ans en 1940), c'est une grande partie de leur jeunesse qui s'est écoulée en
métropole. Le sujet de cette étude est bien l'évolution de cette micro-société
immigrée transplantée temporairement hors de son univers traditionnel. Au
processus d'adaptation au travail industriel, de confrontation au modernisme et
d'acculturation s'ajouta une expérience inédite, celle d'une confrontation avec une
puissance coloniale en crise.
Traversée par des contradictions, vaincue, affaiblie et occupée, la
puissance française devenait contestable. L'effondrement du mythe de la France
toute puissante et protectrice de ses sujets coloniaux favorisa l'émergence d'une
prise de conscience d'un rapport de force nouveau qui se dessinait entre les
autorités coloniales et les colonisés. Partis dans un état d'inculture politique totale,
avec pour unique sentiment une haine rentrée contre la France qui les avait
contraints à s'exiler pour une cause qu'ils n'estimaient pas être la leur, ces requis
évoluèrent vers des positions anti-colonialistes fermement affirmées. Ce désir
d 'émancipation de la domination française n'avait pas seulement pour origine
l'affaiblissement du prestige de la France. Il prit racine dans le processus de
prolétarisation rapide de ces paysans, leurs souffrances physiques (faim, froid) et
morales ( nostalgie, racisme des Français). A la Libération, la rencontre de ces
ouvriers avec l'intelligentsia nationaliste et marxiste vietnamienne en France et le
prolétariat français, dont les organisations sortaient renforcées de la guerre, agit
comme un catalyseur du mouvement de contestation de la politique coloniale
française en lien avec les événements dans la colonie elle-même.
En août 1945, l'insurrection du Viêt-Minh avait conduit l'Empereur Bao Daï
à abdiquer et entraîné la proclamation de la République Démocratique du Viêt-
Nam. Pour ces milliers de travailleurs qui, au vue de l'expérience acquise au cours
des années écoulées, se sentaient plus des sujets exploités que des sujets protégés
de la France, surgit l'espoir de devenir des citoyens libres dans un pays
indépendant. L'histoire des travailleurs indochinois en France pendant la seconde
guerre mondiale participait ainsi de l'évolution générale que connut l'empire
colonial français pour lequel le glas avait sonné. Le lent réveil des peuples

colonisés s'inscrivait dans une conjoncture qui ouvrait la voie à la décolonisation.
Bien que le gouvernement français ait appliqué à l'endroit des travailleurs une
politique qui consistait à les isoler du reste de la société civile française en les
enfermant dans une administration qui employait, à bien des égards, les mêmes
recettes coloniales qui avaient fait leurs preuves dans la colonie elle-même, il ne
pouvait pas empêcher des transformations dans la pensée, les connaissances qui
firent avancer les requis vers l'affirmation de leur liberté et de leur dignité. Dans le
même temps, la présence de ces travailleurs coloniaux en France et la façon dont ils
furent traités par le gouvernement agirent comme éléments moteurs dans la prise
de conscience d'une certaine frange de la classe ouvrière française de la réalité
coloniale avec ce qu'elle comporte d'oppression et d'injustice.
A la Libération, le ministère des Colonies adopta à l'égard des requis une
attitude qui s'inscrivait dans la ligne de conduite générale qu'il s'était fixé pour
l'Indochine: il entreprit des réformes pour améliorer les conditions d'existence des
travailleurs et favoriser la participation de ces derniers à la gestion de leurs camps;
en revanche, il resta sourd à la demande de démobilisation des requis qui aspiraient
à devenir des travailleurs libres délivrés de la tutelle de la MOI. Enfin, il recourut à
des mesures répressives lorsque les travailleurs commencèrent à déployer une
propagande active en faveur de l'indépendance du Viêt-Nam. Jusqu'en 1948, la
présence de ces travailleurs mit le gouvernement en difficulté, incapable de voir
que leur évolution et leur prise de conscience avaient un caractère irréversible, et
que le recours à la force ne pouvait qu'y contribuer encore plus. La problématique
de notre sujet s'inscrit donc également dans l'analyse de l'histoire de la politique
coloniale française et, en particulier, des contradictions qu'elle connut au sortir de
la guerre.
L'année 1948 constitue le tournant de notre étude: la plus grande partie des
travailleurs requis rentrèrent dans la colonie ou étaient en instance de rapatriement.
L'histoire des quelque mille travailleurs qui optèrent pour une installation définitive
en France appartient à l'histoire de l'immigration vietnamienne en France de l'après-
guerre.
(1) SHAT - 7N 2471 – note de l'EMA 1er bureau n°67
(2) SHAT - 7N 2471 - note de l'EMA 1er bureau au Ministère de l'Armée
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
1
/
161
100%