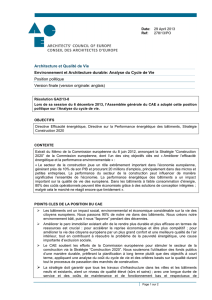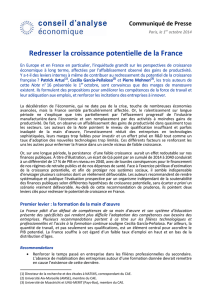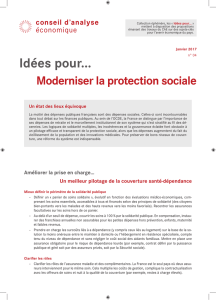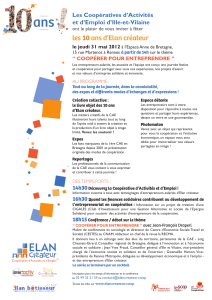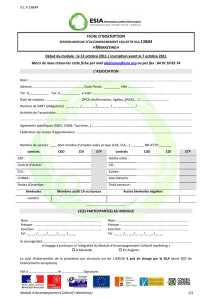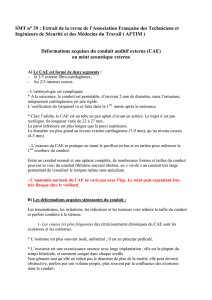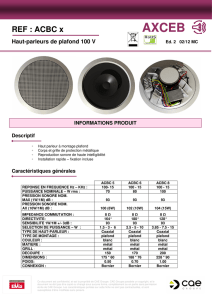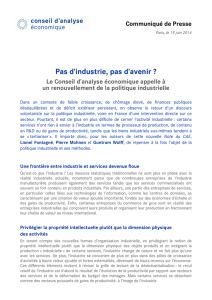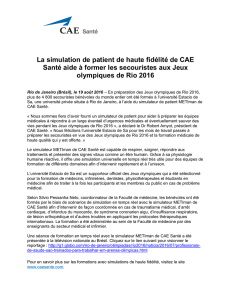Universites Cooperer pour entreprendre Clermont

DES PREMIÈRES UNIVERSITÉS
LES ACTES
Réseau des Coopératives d’Activités et d’Emploi
Universités du réseau
Coopérer Pour Entreprendre
Clermont-Ferrand - 3 et 4 novembre 2011

SE RÉUNIR POUR RÉUSSIR
C’est sous ce slogan simple et ecace que se sont rassemblés dans une ambiance aussi
conviviale que sérieuse près de 200 entrepreneurs-salariés et dirigeants de coopératives
d’activités et d’emploi.
Rendues dynamiques par une judicieuse alternance de tables rondes, conférences et ateliers,
ces deux journées ont permis d’aborder les problématiques spéciques se posant aux CAE
aujourd’hui mais aussi d’ouvrir la réexion à la prospective grâce aux interventions de
chercheurs, experts et universitaires.
UNE ASSISE PLUS FORTE DES CAE
Nées il y a plus de 15 ans sous le sceau de l’expérimentation et fédérées dans le
réseau Coopérer pour Entreprendre, les CAE se sont peu à peu construites et
imposées comme une nouvelle forme d’entrepreneuriat collectif.
Forte d’une structuration en réseau, leur reconnaissance s’accroît non
seulement dans les territoires mais aussi au niveau national. An d’asseoir
davantage ce modèle innovant tout en augmentant sa visibilité, une logique
volontariste est à l’œuvre qui se décline selon deux axes fondés sur une
démarche mutuelle de progrès : renforcer et multiplier les partenariats
d’une part et, d’autre part, systématiser les bonnes pratiques par un travail
de «labellisation».
«Depuis 15 ans nous secouons l’entrepreneuriat, aujourd’hui nous
construisons l’entreprise du 3e type, l’entreprise de bien commun, celle
qui libère, stimule, encourage l’expression et l’expérimentation ; celle
qui renonce à succomber aux prots immédiats pour se projeter sur
le long terme ; celle qui se préoccupe de l’intérêt général»
Félicie DOMÈNE
Réseau des Coopératives d’Activités et d’Emploi
Les Coopératives d’Activités et d’Emploi
au cœur du changement
Construire le monde de demain

Réseau des Coopératives d’Activités et d’Emploi
Des partenariats renforcés
Une convention cadre avec Pôle Emploi
L’ANPE et l’Unedic ont toujours participé au comité de pilotage de Coopérer pour Entreprendre.
Toutefois, le nombre croissant de CAE rend désormais pertinente, au-delà des partenariats noués
localement, la signature d’une convention nationale.
Il s’agit de «valoriser l’action des CAE et uidier les échanges sur les situations locales» estime
Guillaume Augias (Direction Nationale des Partenariats de Pôle Emploi). «Les 26 régions vont
recevoir des instructions relatives à la convention et sa mise en œuvre, la liste des CAE ainsi que
la charte de Coopérer pour Entreprendre».
La convention constitue un cadre général de développement du partenariat entre les CAE et
Pôle Emploi, cadre qu’il appartient aux CAE et aux directeurs régionaux de Pôle Emploi de
faire vivre localement.
Elle permettra d’une part de présenter au sein des agences de Pôle Emploi le modèle
entrepreneurial de la CAE et, plus généralement, le modèle coopératif; d’autre part de
uidier la relation localement. En eet, le modèle CAE demeure inconnu par une partie
des agents de Pôle Emploi ou est assimilé à du portage salarial ce qui suscite des diérends
sur les indemnisations; les changements de personnel entraînés par la fusion n’ont pas
arrangé la situation, ce dont témoigne Daniel Meyer, directeur départemental de l’Allier.
Une avancée avec la Confédération Générale des SCOP
«Les CAE ont toute leur place dans le mouvement Scop et elles y occupent une place
à part entière» arme Alix Margado (CGScop). Cette «alternative positive à l’auto-
entrepreneuriat, source d’émancipation pour les individus» doit être promue et les
unions régionales des Scop orienter les porteurs de projets vers ces entreprises.
Une plateforme commune entre les deux réseaux de coopératives d’activités et
d’emploi (CPE et COPEA) et la CGScop atteste de l’étendue du chemin parcouru et
impulse une dynamique forte pour un développement cohérent des CAE au sein
du mouvement Scop.
Un partenaire historique: la Caisse de Dépôts et Consignations
Voilà 10 ans que la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) se tient aux
côtés de Coopérer pour Entreprendre. Considérée, non comme un secteur à
part, mais au contraire comme un acteur important du développement des
territoires, l’économie sociale en général et les CAE en particulier jouent un
rôle important. Elles apportent une réponse collective et non individuelle
à l’entrepreneuriat. «Ce laboratoire d’idées original et continu, autour de
la mutualisation voire de la mutualité, propose un modèle économique
très intéressant bien qu’encore inachevé. En outre, les CAE, en répondant
à des besoins économiques locaux s’inscrivent comme des acteurs
majeurs des territoires» estime Dominique Picard (CDC).
Encourageant, an d’élargir la mutualisation, la poursuite des
rapprochements entre les deux réseaux (CPE et COPEA) et avec
la CGScop, Dominique Picard insiste aussi sur le renforcement
de la professionnalisation du réseau, gage de crédibilité et de
pérennisation des projets. À cet égard, elle salue le processus de
labellisation impulsé lors de ces Universités.
Guillaume AUGIAS
Alix MARGADO
Dominique PICARD

Jean-Pierre QUAZZA
Dialogue avec les syndicats
Du dialogue social à la négociation nationale, quelle condition pour réussir
la reconnaissance de l’entrepreneuriat salarié ?
«Les CAE n’ont pas vocation à détricoter le droit du travail, mais à contribuer à la démocratie sociale»
arme Olivier Jouan, administrateur de CPE.
Ces termes résument l’incompréhension qui a longtemps présidé aux relations entre les syndicats
de salariés et les Scop d’une manière générale (ce que rappelle Danièle Demoustier, socio-
économiste maître de conférences à l’IEP de Grenoble), et les CAE en particulier.
À une certaine perplexité suscitée par la double qualité de salarié-associé des coopérateurs des
Scop, la CAE ajoute un mode de rémunération des entrepreneurs-salariés qui, aux yeux des
syndicats, les rapproche plus des indépendants que des salariés. De ce fait, ils estiment que le
fonctionnement des CAE participerait du vaste mouvement de déconstruction progressive
du droit du travail. Or, c’est un autre rapport au travail, situé entre le salariat classique et le
statut d’indépendant, que revendiquent les CAE. La loi de 1978 sur les Scop, sur laquelle
s’appuient les CAE, parle d’ailleurs de «travailleurs».
La reconnaissance par la loi d’un statut d’entrepreneur-salarié risque de prendre du temps
estime Jean-Pierre Cressy (CFDT). S’appuyant sur l’expérience du portage salarial, il
prône l’ecacité du dialogue social et de la conclusion d’accords plutôt qu’un lobbying
parlementaire.
L’occasion de nouer ou renouer le dialogue avec les syndicats est donnée, en raison
de la taille de certaines CAE, par l’obligation légale de la mise en place d’Institutions
Représentatives du Personnel (IRP). Une opportunité surtout de s’interroger sur le rôle
des IRP dans ces entreprises originales (Frédéric Ratouit, L’Ouvre boîte 44, rappelle la
perplexité des associés à cette occasion …) et d’en conclure, comme le souligne
Jean-François Bolzinger (CGT), que le dialogue social représente un puissant
vecteur pour changer les choses de l’intérieur et de l’extérieur. Ce qu’appuie
Stéphane Veyer (Coopaname) : « Les CAE participent d’un mouvement contre
l’atomisation du rapport au travail; il s’agit de récréer du collectif. Mais, recréer
du collectif c’est aussi recréer du droit. Or, le dialogue social constitue le lieu par
excellence de la création de droit dans l’entreprise. »
Sous l’angle employeur — les CAE sont aussi des employeurs de l’économie
sociale — Jean-Marc Lagoutte (Usgeres) estime que la démarche
entrepreneuriale des CAE pourrait être mieux reconnue des pouvoirs publics
par la volonté de l’Usgeres de siéger dans davantage d’instances nationales,
notamment au Conseil économique et social. L’objectif est de participer
plus largement aux négociations collectives interprofessionnelles de tous
les secteurs d’activité propres à l’Usgeres.
Jean-Marc LAGOUTTE
Jean-Pierre CRESSY
Jean-François BOLZINGER

Aujourd’hui, les 68 coopératives d’activités et d’emploi (CAE) réunies dans le réseau Coopérer
pour Entreprendre ont dépassé la phase d’expérimentation et sont reconnues sur leur territoire
d’implantation. Toutefois, si leur nombre constitue une force, l’hétérogénéité des pratiques ne favorise
pas leur visibilité auprès des partenaires et nanceurs.
C’est donc dans une logique de cohérence nationale et d’accompagnement des CAE à la pérennité
de leur outil de travail que Coopérer pour Entreprendre souhaite mettre en place un label du réseau.
Ce dernier aura vocation à poser les fondamentaux de la gestion d’une CAE, à garantir les pratiques
professionnelles à l’échelle nationale, à prévenir les dicultés.
An de dégager les principes essentiels et intangibles constitutifs d’une labellisation, Coopérer
pour Entreprendre a engagé un travail de capitalisation des pratiques,avant d’en sélectionner
les meilleures et de les diuser au sein du réseau.
Les quatre axes principaux identiés ont fait l’objet d’ateliers : accompagnement des
entrepreneurs-salariés, juridique, comptabilité et gestion, social/sociétal.
L’axe accompagnement: harmonisation des contenus
Dans toutes les CAE, cinq jalons cadrent le parcours d’accompagnement des entrepreneurs-
salariés : la réunion d’information collective, l’entretien d’accueil, les modalités
d’intégration dans la coopérative, les normes pédagogiques du parcours de formation.
An d’en faire de véritables indicateurs, il convient d’en préciser le contenu minimal.
L’axe juridique: sécurisation du cadre
L’enjeu de la démarche consiste à procurer aux CAE comme aux salariés un cadre
juridique sécurisé. En eet, l’absence de statut d’entrepreneur-salarié engendre parfois
des interrogations, voire des tensions avec certaines institutions (Urssaf, Pôle Emploi,
inspection du travail). La sécurisation du cadre passe-t-elle par la reconnaissance
d’un statut d’entrepreneur-salarié, ou plutôt par celle d’une spécicité au sein du
mouvement Scop?
L’axe comptabilité-gestion: optimisation et transparence
Il s’agit non seulement d’une question technique d’optimisation des outils
comptables et de gestion du résultat (intéressement, participation, etc.), mais
aussi d’un impératif de transparence nancière vis-à-vis des associés. Une
politique active de constitution de fonds propres est préconisée.
L’axe social et sociétal: valeurs, valorisations, coopérations
Le volet social se focalise particulièrement sur trois points ; la politique
salariale des permanents de la structure, et la valorisation de leurs
compétences métier spéciques ; l’élaboration du salaire des
entrepreneurset leur accès aux droits, notamment à la formation; enn,
la représentation des salariés et des entrepreneurs doit être interrogée
dans le cadre du dialogue social.
L’axe sociétal s’articule autour du développement durable et local
(impact de la CAE sur son territoire, richesse créée et retombées
scales) et de l’engagement dans l’économie sociale et solidaire. Cet
axe travaille aussi à favoriser les coopérations entre les entrepreneurs.
Réseau des Coopératives d’Activités et d’Emploi
L’enjeu de labellisation
la démarche mutuelle de progrès
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%