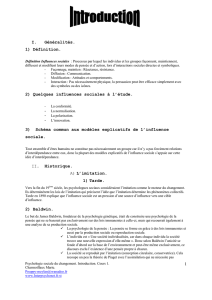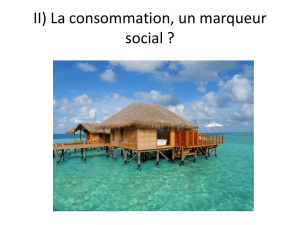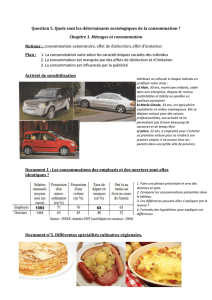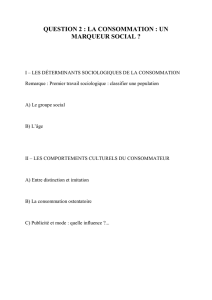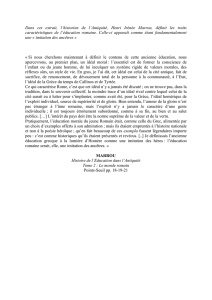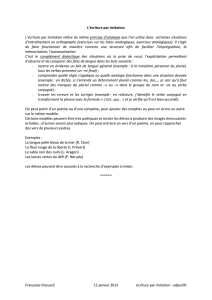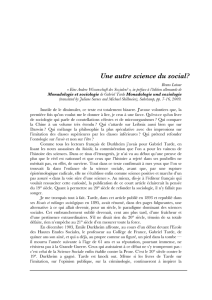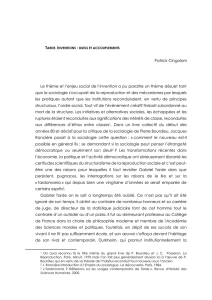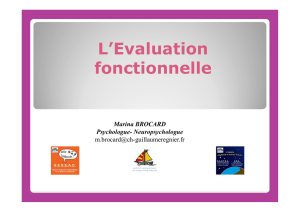Tarde et la sociologie - prepa-bl

Gabriel de Tarde : un fondateur « oublié » de la
sociologie ?
1/ « Les lois de l’imitation » (1890) de Gabriel de Tarde commenté
par Georg Simmel.
(source : Zeitschrift für psychologie und physiologie der
sinnesorgane, 1891).
C’est un livre fécond d’idées et stimulant qui donne des indications tout à fait remarquables
pour la psychologie sociale. L’auteur divise l’ensemble du matériel de l’histoire en deux
groupes : un ensemble de faits et de normes, original et créateur ; et une répétition de ceux-ci
dans des cercles sociaux, lesquels atteignent de par cette répétition leur contenu particulier et
leur forme de vie.
Alors que les premiers, sur la seule base de leur caractère individuel, ne peuvent être l’objet
d’une science propre, laquelle suppose toujours des régularités pour y fonder ses lois ; la
diffusion d’impulsions, l’imitation de modèles donnés par un grand nombre de membres du
groupe obéit quant à elle à des lois très précises, et l’infinie fréquence avec laquelle elle se
produit, se présente comme un matériel pour une induction scientifique.
De manière très intéressante, il est montré que l’imitation est une forme de suggestion
hypnotique, car l’individu à l’intérieur du groupe s’adonne involontairement à des intérêts,
des pulsions, des perceptions, des modes d’agir qui ont d’une certaine manière gagné en
puissance : « L’état social comme l’état hypnotique n’est qu’une forme du rêve, un rêve de
commande et un rêve en action. N’avoir que des idées suggérées et les croire spontanées :
telle est l’illusion propre au somnambule et aussi bien à l’homme social. – Penser
spontanément est toujours plus fatigant que penser par autrui. Aussi, toutes les fois qu’un
homme vit dans un milieu animé, dans une société intense et variée, qui lui fournit des
spectacles et des concerts, des conversations et des lectures toujours renouvelées, il se
dispense par degrés de tout effort intellectuel ; et, s’engourdissant à la fois et se surexcitant
de plus en plus, son esprit se fait somnambule. C’est là l’état mental propre à beaucoup de
citadins. – La société c’est l’imitation et l’imitation c’est une espèce de somnambulisme. »
(Tarde, Les lois de l’imitation).
Les voies que prend l’imitation sociale seront suivies avec une fine compréhension
psychologique et un grand savoir historique ; les imitations dans les domaines de la croyance
et du besoin, les fondements du choix entre divers modèles comparables, la règle qui impose
que le supérieur social toujours construise le modèle, et les conséquences qui en découlent,
pour l’inférieur, finalement la forme imitative de la moralité – où le modèle ancien a toute
faveur – et la forme imitative de la mode – où l’avantage est au nouveau – seront poursuivies
en ce qui concerne la formation de la langue, la religion, les formes politiques, les besoins
spirituels et triviaux.
L’auteur a, comme je le crois, rendu un grand service à la psychologie sociale, dans la mesure
où il délie l’imitation, comme simple forme, des contenus dans lesquels elle se présente, et par
cela rend possible de manière moins problématique de trouver des équivalents fonctionnels,
car sans cela les différences exceptionnelles de contenus dérobent facilement à la vue ce qui
est imité. Comme la concurrence qui prend des formes et des développements typiques,
relativement indépendants des objets, dans lesquels elle se réalise, il doit en aller de même

pour l’imitation. Sa force socialisatrice n’a jamais été portée au même degré de contrainte ; en
effet, ces imitations qui traversent le groupe de part en part et le rassemblent dans une forme
unique de vie veillent à rester inconscientes, parce qu’elles vont de soi pour les individus ;
porter leur étendue et leur influence à la conscience scientifique est une recherche très avisée
et qui peut être riche de conséquences (…).
un des points fondamentaux aura été tout d’abord d’avoir montré de manière profonde et
originale que la psychologie individuelle devra être complétée à travers un mouvement de
régression vers les processus se déroulant dans les groupes sociaux.
2/ Tarde et les débats scientifiques de son temps.
(source : Nélia Dias, « Imitation et Anthropologie », Revue
TERRAIN, n°44, 2005).
Au moment où Gabriel Tarde publie son monumental ouvrage consacré à l’imitation, celle-ci
était déjà au centre des préoccupations d’auteurs aussi divers que Darwin, Le Bon, Letourneau
et Romanes qui, mettant en parallèle singes, enfants, peuples « primitifs » et peuples «
civilisés », avaient cherché à rendre intelligible la « faculté d’imitation » en tant que trait
caractéristique d’une certaine étape du développement mental. C’est dire que, dès la seconde
moitié du XIXe siècle, l’imitation est appréhendée dans sa double dimension cognitive et
sociale.
Curieusement, seule a été retenue par les sciences sociales la deuxième composante de
l’imitation, comme principe explicatif des phénomènes sociaux, avec la célèbre controverse
entre Gabriel Tarde et Emile Durkheim. La première composante, quant à elle, pourtant
ébauchée par Tarde, fin connaisseur des travaux des physiologistes de son temps, lorsqu’il
écrivait que le « système nerveux a une tendance innée à l’imitation », étant délaissée par la
recherche aussi bien anthropologique que sociologique. De même, en insistant sur la façon
dont les pratiques juridiques, artistiques, morales et bien d’autres se propagent par la voie de
l’imitation, Tarde mettait en relief le rôle que joue l’imitation en tant que moyen de
transmission culturelle, aspect complètement négligé par les sciences sociales.
En soutenant que « le caractère constant d’un fait social, quel qu’il soit, est bien d’être
imitatif » (Les lois de l’imitation), Tarde ne pouvait que s’attirer les foudres de Durkheim qui
n’avait eu de cesse d’insister sur la dimension coercitive des faits sociaux. De plus, par sa
définition de l’imitation – « action à distance d’un esprit sur un autre, et d’une action qui
consiste dans une reproduction quasi photographique d’un cliché cérébral par la plaque
sensible d’un autre cerveau » (Les lois de l’imitation) –, Tarde accordait de l’importance à la
dimension interindividuelle, sans pour autant réduire l’imitation à un phénomène
psychologique, comme le soutiendra Durkheim. S’il est vrai que pour Tarde
« l’imitation peut être consciente ou inconsciente, réfléchie ou spontanée, volontaire ou
involontaire », cependant, dans la préface à la deuxième édition, datée de 1895, il rejette
catégoriquement la « séparation absolue », la « discontinuité tranchée, établie entre le
volontaire et l’involontaire, entre le conscient et l’inconscient ». Si l’on se reporte à la
définition que donne Durkheim de l’imitation dans Le Suicide – « Il y a imitation quand un
acte a pour antécédent immédiat la représentation d’un acte semblable, antérieurement
accompli par autrui, sans que, entre cette représentation et l’exécution, s’intercale aucune
opération intellectuelle, explicite ou implicite, portant sur les caractères intrinsèques de
l’acte reproduit » – force est de constater que, pour le fondateur de la sociologie française,

l’imitation n’est pas une « conduite raisonnable et délibérée », mais plutôt un « réflexe
automatique », relevant de ce qu’il appelle la « singerie machinale ». Or, c’est justement cette
supposée « conduite raisonnable » que Tarde s’évertue à démolir, lui qui reprochait à
Durkheim d’être « enclin à juger l’histoire en neptunien, non en vulcanien » et de négliger l’«
irrationnel » et la « face grimaçante du fond des choses ». Rien d’étonnant dès lors à ce que
Tarde ait souligné le caractère paradoxal de l’imitation dans les sociétés occidentales dans
lesquelles « le progrès de la civilisation a pour effet de rendre l’asservissement à l’imitation
de plus en plus personnel et rationnel en même temps ».
D’ailleurs, dans sa recherche des lois de l’imitation, Tarde établit une distinction entre les
causes logiques – relevant de l’utilité des faits imités – et les causes extra-logiques, tributaires
de facteurs tels que le prestige et le charisme des individus et des groupes qui servent de
modèle. Que l’imitation puisse relever de facteurs qui échappent à toute raison logique,
notamment en termes d’utilité, est un aspect qui retiendra, de façon contrastée, l’attention de
Durkheim et de Boas dans les années 1894-1895. Alors que le sociologue français s’insurge
contre l’explication des faits sociaux par « des causes simplement mécaniques, inintelligibles,
et étrangères à toute finalité » (Durkheim, « L’état actuel des études sociologiques en France
»), Franz Boas envisage l’imitation tant d’actions utiles que d’actions qui échappent à toute
raison logique, toutes les deux également présentes à la fois chez l’homme « civilisé » et chez
l’homme « primitif », comme l’exemple même de l’existence de processus mentaux
identiques chez tous les hommes (…).
3/ Tarde : droit et sociologie.
(Source : Laurence SAQUER, « Variations sur la grammaire
différentielle de Gabriel Tarde », Revue SOCIETES, n°96, 2007.
1890 voit la parution de deux ouvrages de Gabriel Tarde : La philosophie pénale d’une part,
Les lois de l’imitation d’autre part. Ces deux volumes ont connu une carrière bien différente et
un parcours qui traduit l’intérêt ambivalent qu’a suscité la réflexion tardienne. La philosophie
pénale fera connaître Tarde aux juristes et Les lois de l’imitation aux sociologues.
La philosophie pénale est à proprement parler un ouvrage juridique qui combine une analyse
d’éléments de procédure pénale avec une réflexion générale du droit dans une perspective
historique. Traitant de « L’École positiviste », de la « Théorie de la responsabilité », du «
Criminel », ou bien de la « Peine de mort » sous le chapeau latent de la question de la
responsabilité et de l’irresponsabilité, Tarde rassemble dans cet ouvrage un ensemble de
considérations qui l’inscriront, dans une certaine mesure, dans le cadre de la doctrine pénale
et plus précisément dans celui de la criminologie, au sein duquel son « rôle a été décisif ».
Les lois de l’imitation est un ouvrage qui se veut « étude sociologique » et connaît un succès
vibrant lors de sa parution. A. Bertrand, commentateur contemporain de Tarde, qualifiera cet
ouvrage comme étant l’« une des plus originales et des plus brillantes études de psychologie
sociale et même de psychologie générale qui aient paru depuis longtemps ». Pourtant,
l’ensemble des recensions qui en sont faites ou les commentaires qu’il inspire suggèrent une
meilleure détermination de la notion d’imitation, suggestions et critiques auxquelles Tarde
répondra, dans la deuxième édition de l’ouvrage, qu’il ne suffit pas de considérer l’imitation
comme une mécanique bornée et répétitive mais qu’il faut lui accorder la souplesse des objets
qu’elle encadre et fait se déployer comme la souplesse et la disponibilité des vecteurs, canaux,
plateaux qui l’enclenchent ou la rendent possible. Ainsi considérée, Tarde entend « par
imitation toute empreinte de photographie inter-spirituelle, pour ainsi dire qu’elle soit voulue
ou non, passive ou active ».

Tarde vise l’étude scientifique des faits sociaux à travers la localisation et la dissection des
motivations de leur traçage, puisque « connaître les causes, dit-il, cela permet de prévoir »
Pour construire cette science, Tarde lance l’hypothèse suivante : « Tout n’est socialement
qu’inventions et imitations » et si les faits, en matière sociale, se répètent de la même manière
qu’ils se répètent en matière physique ou biologique, le détail que Tarde entend rechercher
dans l’observation des faits sociaux est l’application du principe de la répétition universelle
envisagée sous sa forme sociale : l’imitation.
4/ L’actualité de Tarde ou « Tarde à la mode » ?
(Source : Laurent MUCCHIELLI, « Tardomania ? Réflexions sur
les usages contemporains de Tarde », Revue d’histoire des sciences
humaines, n°3, 2000.
L’année 1999 aura été – entre autres – l’année Tarde en histoire des sciences humaines.
Comment en effet ne pas avoir été informé de la réédition en cinq volumes d’une large partie
de ses œuvres, par les éditions Synthélabo ?. Le quotidien Libération (11 mars 1999) y
consacra une pleine page, de même que le magazine La Recherche (mai 1999) et, l’année
suivante, le mensuel Le Monde des débats (février 2000). De surcroît, ces deux derniers textes
étaient signés par Bruno Latour, auteur réputé. « Redécouverte » ou « réhabilitation » d’un «
maître-penseur » qui sortirait soudainement d’un injuste « oubli »… Telle est l’image qui
ressort globalement des commentaires argumentant cette opération éditoriale. Pourtant, avant
même de prendre connaissance de ces commentaires, le chercheur un peu informé de la
bibliographie sur Tarde est d’emblée surpris que l’on puisse présenter comme subite une «
redécouverte » qui ne cesse en réalité d’être faite depuis trente ans.
C’est en 1970 que le philosophe Jean Milet consacre sa thèse d’État à la biographie
intellectuelle à Tarde. Malgré – ou bien, précisément, à cause de – son attitude
hagiographique, ce travail va servir de base documentaire et intellectuelle à la plupart des
travaux postérieurs. Trois ans plus tard, le même auteur introduit un recueil d’extraits de
textes de Tarde, en s’associant avec une psychosociologue, Anne-Marie Rocheblave-Spenlé.
L’année précédente, la librairie Cujas avait réimprimé La philosophie pénale, à l’instigation
du criminologue Jean Pinatel. Ensuite, en 1979, les éditions Slatkine réimprimaient Les lois
de l’imitation sur l’initiative du sociologue Raymond Boudon. Un an plus tard, le même
éditeur réimprimait cette fois le Fragment d’histoire future, préfacé par Raymond Trousson.
Ainsi, on pouvait déjà, au début des années 1980, s’interroger sur cette nouvelle « présence »
et ces nouveaux « retours » de et à Tarde. Et l’histoire continue. En 1989, le politologue
Dominique Reynié fait rééditer, aux Presses Universitaires de France, L’opinion et la foule.
En 1993, les éditions Kimé proposent un second reprint de Les lois de l’imitation, introduite
cette fois par le philosophe Bruno Karsenti. L’année suivante, ce sont les éditions Berg
Internationale qui, dans une collection dirigée par Pierre-André Taguieff, rééditent Les
transformations du droit, avec à nouveau une introduction de J. Milet. En 1998, c’est de
Biarritz, où siège l’éditeur Atlantica, qu’arrive une nouvelle édition du Fragment d’histoire
future, préfacé par le philosophe René Scherer. Enfin, en 1999, la collection « Les
empêcheurs de penser en rond », dirigée par Philippe Pignarre aux éditions Synthélabo,

réussit un « coup » éditorial intéressant en republiant sous la direction d’Éric Alliez,
philosophe, une large partie des œuvres de Tarde en cinq volumes.
Ce bref tour d’horizon éditorial permet immédiatement de relativiser tant l’« oubli » que les «
redécouvertes » successives de Tarde. Mais il amène en retour deux questions. La première :
comment se fait-il que, en si peu de temps et dans un même pays, autant d’intellectuels aient
pu penser « redécouvrir » Tarde comme si, en somme, le travail de leurs prédécesseurs n’avait
servi à rien ? La seconde : pourquoi, après vingt-six ans d’efforts, Gabriel Tarde n’a-t-il
toujours pas provoqué les transformations intellectuelles appelées de leurs vœux par ses
redécouvreurs ?
Disons-le d’emblée : il est probable que, sauf hasard d’une trouvaille surprise de l’historien ou
de l’archéologue et d’une publication au simple titre du document inédit, il n’existe pas de
redécouverte qui ne soit en réalité une façon d’intervenir de façon normative dans un univers
intellectuel donné. En effet, dès lors que l’on ne se situe pas dans une position historienne,
une redécouverte ne vaut que par la nouveauté qu’elle apporte, et cette nouveauté ne peut
s’évaluer que par rapport à un état préexistant. D’un point de vue intellectuel et pour
emprunter quelques expressions à Thomas Kuhn, deux solutions se présentent alors : ou bien
nous sommes dans une situation de « crise paradigmatique » – la pensée bloque dans un
domaine, la redécouverte est censée la débloquer –, ou bien nous sommes dans une situation
de « science normale » – la pensée se développe normalement dans un domaine, la
redécouverte vise à perturber ce développement. Logiquement, l’on doit s’attendre à ce que la
situation la plus fréquente soit la seconde, même si la rhétorique polémique de la «
redécouverte » la conduira souvent à tenter de convaincre que la quiétude apparente cache en
réalité une crise intellectuelle. Mais arrêtons là les déductions et observons les argumentations
des réintroducteurs de Tarde que nous avons regroupés en deux groupes : premièrement les
réappropriations visant à promouvoir un paradigme individualiste en sciences humaines,
deuxièmement les éloges généralistes visant à présenter Tarde comme un précurseur et même
comme un théoricien d’avenir.
A partir des années 1960, Boudon entre en conflit avec la sociologie qu’il baptise « holiste »
(qu’elle soit durkheimienne ou structuraliste en France, fonctionnaliste ou culturaliste en
Angleterre ou aux États-Unis) et à laquelle il oppose le paradigme de « l’individualisme
méthodologique ». Son « Tarde » retrouve alors une dimension théorique primordiale. Il
apparaît tout à coup « contemporain » et la dimension théorique de son œuvre fait de lui un
des plus grands sociologues : « Sans doute les analyses de Tarde sont-elles souvent
sommaires et simplement ébauchées. Mais son axiomatique, sa méthodologie, l’importance
centrale qu’il accorde à l’action individuelle, son souci de donner aux préférences et objectifs
des ‘acteurs’ sociaux une interprétation endogène en font un auteur contemporain. Le charme
vieillot de son style, le ton mondain de certains développements ne doivent pas faire oublier
l’essentiel : Tarde est peut-être un des auteurs qui a défini les bases de la sociologie avec le
plus de clarté ».
Boudon redécouvre un Tarde individualiste. Pourtant, une lecture plus systématique des Lois
de l'imitation amène à découvrir une conception tardienne de l’individu tout aussi
déterministe que la conception durkheimienne, peut-être même davantage.
Tarde, précurseur de la sociologie moderne des réseaux ? Ce n’est pas sans une certaine
surprise que l’on observe, un quart de siècle plus tard, la même présentation d’un Tarde
incarnant l’avenir des sciences humaines chez l’épistémologue Bruno Latour. Découvrant les
textes de Tarde réédités en 1999, il écrit en effet : « On a parfois prophétisé que le XXIème
 6
6
1
/
6
100%