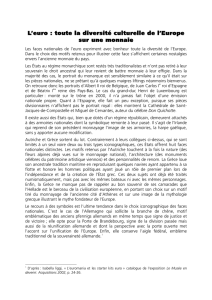pouvoir et théorie économique

1
POUVOIR ET THÉORIE ÉCONOMIQUE :
LA POLYVALENCE DE LA MÉDIATION MONÉTAIRE
JEAN CARTELIER
Université Paris-Ouest
EconomiX
I
INTRODUCTION
Pouvoir et théorie économique ne font pas bon ménage. Non seulement l’hypothèse
de concurrence parfaite, sous laquelle les résultats fondamentaux d’existence et
d’optimalité de l’équilibre général sont démontrés, exclut qu’un quelconque individu
ait capacité de d’influencer les actions d’autrui, mais aussi et surtout, la relation
d’échange, caractérisée par l’équivalence, implique qu’un individu ne peut être
contraint que par le marché, c’est-à-dire par la société dans son ensemble. Réduit à
n’avoir d’existence virtuelle que dans le non-respect des conditions de concurrence
parfaite, la notion de pouvoir ne peut avoir d’existence effective dans la théorie
économique que dans des relations hors marché, telles que la fiscalité et la fourniture
de biens collectifs. Cette incompatibilité entre pouvoir et théorie économique est-elle
consubstantielle à notre discipline ou est-t-elle due à des choix intellectuels qu’il est
possible et souhaitable de remettre en cause ?
En première analyse, il apparaît quela source de l’incompatibilité radicale entre pouvoir et
théorie économique est le mythe du contrat social, mythe fondateur des sciences sociales.
Le cadre intellectuel dans lequel la plupart des économistes théoriciens élaborent
leurs raisonnements et leurs modèles procède de ce mythe : la société est une création
volontaire d'individus qui y trouvent un intérêt. Deux grandes versions du mythe
ont été élaborées. Dans l'une, les individus de la multitude deviennent des citoyens
se donnant des lois et des gouvernements. Se construit ainsi l'idée du politique. Dans

2
l'autre, les individus deviennent des producteurs marchands vérifiant le bien-fondé
de leurs choix d'activité en s'échangeant entre eux leurs produits. Se construit ainsi
l'idée de l'économique. Il n'existe pas, à ma connaissance, de version dans laquelle une
société formée selon ce mythe serait telle que le politique et l'économique y seraient
indistincts. Après la genèse logique d'une société politique (Hobbes, Rousseau)
s'élabore celle d'une économie d'échange généralisé (Locke, Smith). Une science
économique acquiert son autonomie au prix de l'abandon d'une conception
organiciste au sein de laquelle « politique » et « économique » ne pouvaient être
rigoureusement définis en tant que tels1. La séparation entre politique et économique
est inhérente au mythe du contrat social. La constitution des « sciences sociales » est
en fait celle de disciplines radicalement différentes, autant coupées les unes des autres
que spécialisées dans leurs domaines respectifs.
Tel est l'environnement dans lequel se construit la science économique sur des bases
qui lui sont propres, sans liens explicites avec les autres. Plus précisément,
c’estl'échange volontaire qui en forme la base, notion qui exclut lepouvoir,concept
central de la pensée politique. Il est usuel de critiquer la première au nom du second.
Tant que l’on n’a pas réussi à unifier les deux domaines que le mythe du contrat
social a séparés, cette critique demeurevaine et stérile.
C’est pourquoi deux attitudes fondamentales s’observent parmi les économistes
théoriciensen délicatesse avec le savoir académique: la première, largement
dominante, est la tentative, plus ou moins explicitement assumée, de construire une
science sociale unitaire qui transcenderait le fractionnement observable jugé
préjudiciable, la seconde très minoritaire, consiste, à l’intérieur d’une des disciplines
établies, d’en entreprendre une critique plus ou moins immanente avec l’espoir d’en
faire surgir une vision alternative.
À propos de la monnaie, l’exemple de la première attitude est illustrée par les
ouvrages de Michel Aglietta et André Orléan ainsi que par les divers travaux menés
au sein de séminaires pluridisciplinaires animés par ces auteurs, qui ont débouché,
entre autres, sur La monnaie souveraine, ou par Bruno Théret qui a abouti à La monnaie
dévoilée par ses crises; un exemple de la seconde est la collaboration entre Carlo
Benetti& Jean Cartelier à propos de la critique de la théorie économique et de la
défense d’une approche exclusivement monétaire. D’un côté, il y a la promesse d’une
compréhension élargie des relations sociales et de la place qu’y tient la monnaie, la
difficulté étant de construire une théorie dont la cohérence logique soit contrôlable et
la rigueur vérifiable, ce que l’absence de concepts précisément définis rend difficile.
1 Adam Smith rejette d'ailleurs les auteurs qu'il a baptisés "mercantilistes" en raison de la confusion
qui leur fait soutenir que la monnaie est la richesse et que le Prince, qui en assure la direction, est par
ailleurs responsable de la prospérité et de la puissance de la nation.

3
De l’autre, il y a la possibilité d’une critique de la théorie économique qui ne se limite
pas à une critique de l’économisme, la difficulté étant alors d’accepter que la théorie
alternative projetée respecte les contraintes inhérentes à la théorie économique, à
savoir : énoncer des propositions quantitatives démontrées sur les relations sociales.
C’est est en ce point que le diagnostic précédent rendant responsable le mythe du
contrat social peut être affiné. L’incompatibilité entre pouvoir et théorie économique tient à
la domination quasi-exclusive qu’a exercée l’approche dite réelle (ou de la valeur) sur
l’ensemble des économistes tant néoclassiques, néoricardiens que néomarxistes
(auxquels il faut ajouter nombre de keynésiens inconséquents). Au sein de la théorie
économique, seule l’approche de la valeur relève du contrat social, non celle partant
de la monnaie comme postulat La réactualisation de l’opposition approche
monétaire/approche réelle, présentée par Schumpeter comme le clivage majeur de la
discipline, et la réactivation de la première aux dépens de la seconde peuvent mettre
fin à une incompatibilité difficilement acceptable entre pouvoir et théorie
économique.
L’objet de la présente communication est de reprendre une telle démarche en
suggérant que la notion de médiation monétaire offre une voie d’élucidation de cette
question.
ÉCHANGE VOLONTAIRE ET PREDATION: UN RESULTAT PARADOXAL
La construction intellectuelle la plus remarquable édifiée sur l'échange volontaire est
la théorie de l'équilibre général concurrentiel. Cette théorie est quelque peu délaissée
aujourd'hui car offrant de faibles perspectives de réussite académique. Elle n'en reste
pas moins celle qui a fourni aux économistes d'aujourd'hui et à ceux qu'ils
influencent les deux propositions fondamentales suivantes (démontrées comme
théorèmes): (i) une société fondée sur la seule relation d'échange généralisé est
logiquement concevable (théorème d'existence de l'équilibre général concurrentiel)
(ii) l'équilibre général concurrentiel est la meilleure des situations auxquelles peuvent
prétendre des individus qui se pensent comme irréductibles les uns aux autres et qui
se trouvent être en société (premier théorème de bien-être).
L'échange volontaire est, dans cette perspective, la relation sociale fondamentale.
Cette vision générale des relations humaines n'est pas confinée à la sphère
économique. Certains penseurs y voient l'expression d'une tendance générale de
l'espèce humaine à privilégier la réciprocité (voir Binmore, par exemple), ce qui,
potentiellement, ouvre à l'économie tous les aspects du social.
Que ces deux propositions fondamentales aient été abondamment critiquées en
raison de leur validité restreinte (hypothèses jugées trop fortes et irréalistes) a peu
atténué leur impact philosophique. Elles fondent, en dépit de tout, la vision
« spontanée » que se font les individus de la société dans laquelle nous vivons, vision

4
formatée par les intellectuels vulgarisateurs, les médias et « l'esprit du temps ».
Chacun est invité à se concevoir comme un individu commerçant, comme une petite
entreprise ou comme un « capital humain » se valorisant sur un marché. Chacun est
responsable de sa trajectoire sociale, cette responsabilité allant de pair avec la liberté
associée au marché.
Le fait que cette représentation apparaisse trop idyllique au regard de ce que chacun
peut observer, qu'elle ne laisse guère de place aux relations de pouvoir, de force, de
violence pourtant présentes un peu partout dans le monde, a peu entamé son crédit
et n'a pas donné lieu à beaucoup de contestations dans le champ académique. Pour
expliquer ce silence, on peut toujours invoquer les forts « biais
idéologiques »courants dans la profession.
On pourrait aussi justifier cette négligence par une raison aussi fondamentale que
méconnue. C’estun article de Rubinstein et Piccione qui la met en lumière. Ces
auteurs montrent, en utilisant le formalisme Arrow-Debreu, qu'une « économie
d'échange » et une « économie de jungle » admettent toutes deux un équilibre
général et que cet équilibre est Pareto-optimal!
Ces auteurs ont créé une situation à première vue paradoxale. Le résultat qu’ils
obtiennent est troublant en ce qu'il montre que la critique a priori la plus évidente de
la théorie académique - son oubli des rapports de force - manque sa cible :
l’introduction de tels rapports n’invalide pas les deux théorèmes fondamentaux de la
théorie économique mais, au contraire, étend leur domaine de validité !Ce résultat est
par ailleurs subversif puisqu'il laisse soupçonner au lecteur qu'un économiste vivant
dans une économie d'échange ou vivant dans la jungle trouve toujours le moyen de
justifier « scientifiquement » la société qui l'entoure. Ce qui revient à soupçonner que
la théorie économique serait congénitalement atteinte du syndrome du Dr Pangloss
et que les économistes seraient des adeptes de la méthode Coué.
Mais le paradoxe n'est qu'apparent. L'explication de la proposition a priori
surprenante de Rubinstein et Piccione est assez simple. L'économie de la jungle
diffère de l'économie d'échange en ce que, dans cette dernière, les individus sont
rangés par ordre de force décroissante et qu'un individu mieux classé qu'un autre a
la possibilité de lui prendre sans son consentement tout ou partie de son panier de
biens. L'ordre de classement selon la force, dans l'économie de la jungle, joue un rôle
analogue à celui de la répartition des dotations initiales dans l'économie d'échange:
« the distribution of power in the jungle is the counterpart of the distribution of endowments
in the market » (Rubinstein et Piccione, p. 883).
Dans les deux modèles, dotations initiales et rapports de force sont des données
doublement exogènes. Qu’elles soient supposées connues a prioriest admissible car il
faut bien se donner un point de départ mais qu’elles ne s'inscrivent pas dans une

5
logique économique est un défaut sérieux. Il n'est guère possible de relier ces
données exogènes à une quelconque raison économique. Une tradition solidement
ancrée chez les économistes leur fait porter la responsabilité des dotations initiales au
politique (et à la justice distributive), instance précisément exclue et priée de ne pas
interférer avec le libre jeu des échanges (où règne la justice commutative).
L'économiste ne veut rien savoir de son point de départ dont il laisse la
responsabilité à d'autres. Quant à la hiérarchie selon la force, elle trouve difficilement
sa place dans le raisonnement économique, sinon sous une forme très atténuée et
sous-entendue dans les théories de la concurrence imparfaite et dans les modèles
d’agence.
L’insuffisante détermination économique des présupposés qui leur sont associés
(dotations initiales et classement selon la force) nous invite à dépasser l'opposition
entre échange et prédation, moins claire qu'on ne le pense. Ni l'un ni l'autre ne sont
pertinents pour fonder ou décrire les relations économiques qui se présentent comme des
grandeurs.
Les relations entre individus sont toujours médiatisées par une règle ou une
institution. Cette évidence est mal perçue en général par les économistes, même si, de
fait, ils y font droit sans le savoir. La fracture entre les versions politique et
économique du contrat social les empêche d'intégrer à leurs analyses l'ensemble des
dispositifs politiques et législatifs sans lesquels l'échange n'a aucune réalité possible.
Cette même coupure rend virtuelle une société de pure prédation dans laquelle seul
le numéro 1 obtient quelque chose (que signifie précisément une échelle de force ?).
Pour éviter une telle situation de non-société, il faut ajouter des dispositifs
correcteurs2.
Le mythe du contrat social, présent dans la pensée économique orthodoxe comme
hétérodoxe sous la forme de la genèse logique des institutions (ou de la recherche de
leurs micro-fondements), doit être rejeté comme impropre à fonder une pensée de la
société. Il s'agit de reconnaître qu'en amont de toute relation entre personnes il y a un
mode d'organisation, une façon d'être qui la rend possible.De ce mode
d’organisation, aucune genèse logique ne peut être formulée.
LES RELATIONS ECONOMIQUES SONT MONETAIRES
Le trait le plus caractéristique qui distingue les relations économiques de toutes les
autres est qu'elles sont quantitatives. La médiation qui les rend telles n’est ni l’échange
et ses règles, ni la prédation et son arbitraire. Ce sont les modes d’émission, de
circulation et de destruction des moyens de paiement qui conditionnent les relations
économiques. La médiation constitutive des rapports économiques est la monnaie. La
2 Rubinstein et Piccione le font au moyen d'une hypothèse "technique" - les espaces de consommation
sont supposés bornés - difficile à justifier de façon intelligible.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%