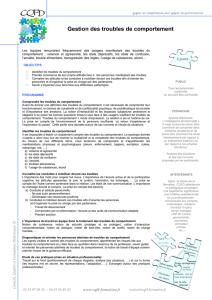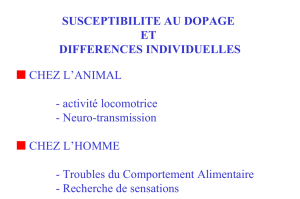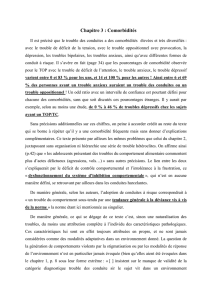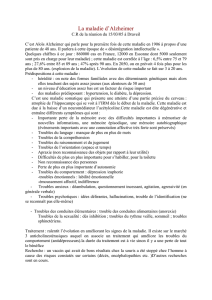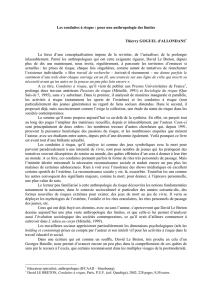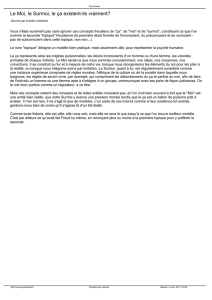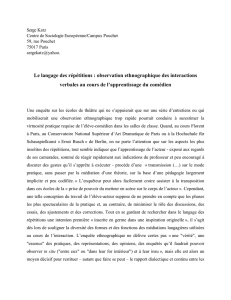Introduction : la demande d`accompagnement TCC Classification ou

Éric GRAFF
psychologue scolaire
Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté
École Émilie du Châtelet
9 avenue de Lyon — 57 070 METZ
CONDUITES ET COMPORTEMENTS — POUR Y VOIR MOINS
« TROUBLE »
Document servant de base à mes interventions dans la formation des auxiliaires de vie
scolaire pour traiter la question des troubles des conduites et des comportements.
Introduction : la demande d’accompagnement TCC
Lorsque vous arrivez pour la première fois dans une école pour un élève qui présente un
trouble des conduites ou des comportements, vous ne connaissez rien ou presque de l’histoire
qui précède.
Vous savez seulement que c’est la MDPH qui a reconnu le besoin et l’Éducation nationale qui
vous nomme sur le poste. Qui dit MDPH dit handicap et compensation. Or les enfants atteints
de TCC se considèrent rarement comme « handicapés ». Leurs parents voient bien les
difficultés. Mais ils sont généralement réticents à les inscrire dans le champ du handicap.
En réalité, le handicap, c’est l’enseignant(e) qui le vit. C’est lui ou elle qui se plaint de la
conduite d’un enfant qui perturbe, c’est-à-dire qui « trouble » littéralement la classe. Au
départ du processus, le trouble et le handicap ne sont donc pas du côté de l’enfant. C’est
l’école qui éprouve le besoin d’une compensation.
Avant la loi de 2005, il était possible à un enseignant de « signaler » son élève difficile à des
instances chargées de traiter le handicap. Aujourd’hui, seuls les parents sont qualifiés pour
déposer une demande.
On arrive de la sorte assez souvent à une situation paradoxale : l’enfant se sent très bien
comme ça, les parents plus ou moins, et c’est l’équipe enseignante qui déploie beaucoup
d’énergie pour les convaincre de contacter la MDPH. Dans certains cas, les parents mettent
longtemps à se décider. Et même quand ils se décident, ils ne s’approprient pas forcément
cette demande qu’ils ont déposée sous la pression.
Au bout de la chaîne, vous pouvez vous retrouver avec un enfant qui, lui, n’a rien demandé du
tout. Vous allez lui dispenser un service qu’il perçoit non pas comme une aide, ni même un
accompagnement, mais comme une entrave.
Pour travailler auprès d’un enfant qui n’a rien demandé, et dont les parents n’ont fait que
céder à la pression de l’école, vous allez déployer des trésors de diplomatie…
Tout ce que vous savez de lui, c’est qu’il présente un « trouble », et que ce trouble, ce n’est
pas lui qui le ressent, mais son entourage. De plus, comme on va le voir, la catégorie
« troubles des conduites et des comportements » (TCC) n’est pas facile à définir.
Classification ou « Nosologie »
Il faut cependant que nous nous accordions sur un minimum. Je vous propose de partir d’une
classification. De la sorte, nous délimiterons les genres.
Il existe différentes classifications, inutile de les détailler. Retenons pour l’exemple celle de la
CFTMEA (Classification Française des Troubles Mentaux de l'Enfance et de L'Adolescence).

2
Procédons par élimination. La classification comporte 9 chapitres :
1. Autisme et troubles psychotiques
2. Troubles névrotiques
3. Pathologies limites
4. Troubles réactionnels
5. Déficiences mentales (arriérations, débilités mentales, démences)
6. Troubles du développement et des fonctions instrumentales
7. Troubles des conduites et des comportements
8. Troubles à expression somatique
9. Variations de la normale
Les troubles des conduites et des comportements sont détaillés au chapitre 7 :
7.0 Troubles hyperkinétiques, avec ou sans troubles de l’attention.
7.1 Troubles des conduites alimentaires : anorexies, boulimies, troubles des conduites
alimentaires du nourrisson et de l'enfant, troubles alimentaires du nouveau né, pica1,
mérycisme2, potomanie.
7.2 Tentatives de suicide
7.3 Troubles liés à l'usage de drogues ou d'alcool
7.4 Troubles de l'angoisse de séparation
7.5 Troubles de l'identité et des conduites sexuelles
7.6 Phobies scolaires
7.7 Autres troubles caractérisés des conduites : pyromanie, kleptomanie,
trichotillomanie, fugues, violence contre les personnes, conduites à risques, errance,
etc.
7.8 Autres troubles des conduites et des comportements
7.9 Troubles des conduites non spécifiés
Vous voyez qu’il s’agit d’un simple catalogue de conduites. À y voir de près, c’est même
franchement du bric-à-brac : quoi de commun entre la potomanie, la phobie scolaire et la
violence contre les personnes ? Comment comprendre ces catégories vagues telles « autres
troubles… » ou « non spécifiés » ? Un peu comme si dans une classification des gastéropodes
on vous mettait les escargots, les limaces et « autres gastéropodes ». La classification s’appuie
sur des faits observables qui ne disent rien de la psychologie des enfants concernés. Par
exemple, que dire d’un enfant qui ingurgite tout ce qui se trouve à sa portée ? Il peut agir ainsi
pour toutes sortes de raisons : provoquer l’entourage, trouver du plaisir à mettre les choses en
bouche, expérimenter des sensations inédites, rechercher une automutilation, etc. Et puis cette
conduite n’a pas la même signification à deux ans qu’à six ans.
1 Pica : du latin pica, la pie. Appétit morbide pour des substances non comestibles.
2 Mérycisme : du grec mêrukismos, rumination) Comportement pathologique de rumination
d'aliments d'abord déglutis, puis régurgités et mastiqués sans arrêt.

3
Nous ne pouvons donc pas nous contenter du simple constat des conduites et comportements
présents dans une liste. Il faut nous donner les outils d’un discernement entre le normal et le
pathologique.
Entre le normal et le pathologique, une frontière floue
Homo homini lupus : « L’homme est un loup pour l’homme
On serait tenté de tracer une ligne entre les gens qui se conduisent bien et ceux qui se
conduisent mal. Ce n’est pas pertinent. Pourquoi ? Pour la simple raison que nous voyons
toutes sortes de gens se conduire très mal — des escrocs, des voleurs, des tortionnaires, des
bureaucrates, des élus politiques, des militaires et toutes sortes d’agités — en excellente santé
mentale. On peut les critiquer au regard de la morale. Mais ils ne relèvent pas du soin
psychologique.
D’ailleurs, ce qu’on appelle « bonne conduite » n’est pas franchement naturel aux être
humains. Je vous conseille la lecture du Malaise dans la culture de Sigmund Freud. Il faut
une grande naïveté pour voir en l’homme « un être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour ».
Rien de plus naturel au contraire que la tentation « de satisfaire son besoin d'agression aux
dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagements, de l'utiliser
sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger
des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Homo homini lupus : qui aurait le courage, en
face de tous les enseignements de la vie et de l'histoire, de s'inscrire en faux contre cet
adage ? »
Tout l’effort de la civilisation consiste à contenir dans des limites raisonnables « cette hostilité
primaire qui dresse les hommes les uns contre les autres ». Considérez l’énormité de cet
arsenal de morales, de religions, de psychologies, etc. visant à nous imposer cet idéal
vertigineux « d'aimer son prochain comme soi-même, idéal dont la justification véritable est
précisément que rien n'est plus contraire à la nature humaine primitive ».
Critères de bon sens : fréquence, gravité, adéquation aux circonstances,
âge…
Ce n’est donc pas la bonne conduite qui peut nous servir de norme. Il nous faut rechercher
d’autres critères. Certains sont évidents. Une conduite problématique mais occasionnelle est
normale. Une cuite de temps à autre, ce n’est pas l’alcoolisme (même si l’alcoolique est
quelqu’un de convaincu qu’il ne l’est pas, qu’il prend juste une cuite de temps à autre), une
colère occasionnelle, ce n’est pas la psychopathie, etc. On parlera de trouble si ça se répète
trop souvent. On peut également se baser sur la gravité. Un enfant de six ans qui tape sur le
dos d’un camarade qui l’embête, cela n’a rien de préoccupant. S’il le menace avec la pointe
des ciseaux, on va s’inquiéter. On peut également prendre en compte le rapport entre la
mauvaise conduite et les circonstances. Ce n’est pas la même chose de taper son camarade
dans le cadre d’une dispute que comme ça, sans motif. On relativisera aussi les conduites
selon l’âge. Des crises de colère quotidienne à deux ans, c’est normal, à six ans ça l’est moins.
Des caprices à six ans, c’est normal, à quarante ans aussi !
Ces données du bon sens sont généralement suffisantes. Cependant je voudrais vous rendre
attentifs à une évolution récente. Il y a moins de dix ans encore, les enfants atteints de TCC
étaient accueillis soit dans des établissements appelés « Instituts de Rééducation », les I.R.,
soit dans des « Centres d’Observation ». Les termes de rééducation et d’observation sont
certes moins violents que ceux que l’on utilisait encore auparavant : maisons de correction ou
de redressement. C’est moins violent, mais cela reste centré sur la conduite de l’enfant ou du
jeune. En quelque sorte, on avait du mal à savoir si ces établissements avaient pour fonction

4
de soigner la personne ou de protéger la société contre leur présence indésirable. Le
changement de dénomination (ce sont les mêmes établissements, avec le même personnel)
vise un but : que l’on se centre sur l’enfant. Que l’évaluation s’abstraie au moins en partie des
plaintes de la société pour tenter de comprendre la psychologie de l’enfant ou du jeune.
Quelle signification donner à la conduite décrite ? Et la finalité du soin est plus affirmée
qu’elle ne l’était avant. Mais cela suppose désormais qu’on se donne d’autres critères, ce
qu’on appelle des données cliniques.
Critères cliniques (basés sur l’observation, l’écoute et l’inteprétation)
Prenons l’exemple de Pierre. Il a cinq ans. Il vient de baisser la culotte de Déborah dans les
toilettes. On est tous d’accord pour dire que ce n’est pas bien. Du point de vue de la morale, il
va falloir lui apprendre à respecter les filles. Il y a au minimum un travail éducatif à assurer.
Pour autant, faut-il emmener Pierre en consultation chez un psychologue ? Pour répondre à
cette question, nous devons trancher non pas au regard du bien et du mal, mais du normal et
du pathologique. Pour évaluer cette conduite, nous allons nous appuyer sur cinq critères :
l’image de soi, la capacité d’introspection, la capacité d’empathie, le sens moral et l’ouverture
au dégagement.
Image de soi
Le premier critère, c’est l’image que se fait l’enfant de lui-même. Pierre se considère-t-il déjà
comme une sorte de vicelard programmé à se conduire de la sorte ? Ou bien s’agit-il, de son
point de vue, d’un moment d’égarement dont il se sent capable de se ressaisir ? Au passage,
vous saisissez l’importance des mots qui vont être utilisés pour lui reprocher sa conduite. Si
on lui dit : « Tu es un sale petit cochon, ça commence dans les toilettes des filles et ça finit
aux assises pour viol », on lui suggère une identité définitive dont il n’a aucune chance de
sortir. Un destin tracé. Si, au contraire, on ne pointe que le geste — ce que tu as fait n’est pas
bien — on préserve l’image qu’il a de lui-même et on lui donne des chances de s’amender.
Et s’il s’agit d’un moment d’égarement, il est peut-être capable de remonter le fil de sa petite
histoire. Est-il en mesure de dire quelque chose sur ce qui a motivé son geste ? Comment une
telle envie lui est-elle venue ? Qu’a-t-il éprouvé ?
Introspection
C’est ce qu’on appelle la capacité d’introspection, voir en soi-même, connaître les
mouvements psychiques qui se passent en nous. C’est le second critère. Les enfants atteints de
véritables troubles du comportement sont souvent comme aveugles à eux-mêmes. Ils
éprouvent des sentiments, des désirs, mais sont incapables de les identifier et, a fortiori, d’en
dire quelque chose. Ils sont étrangers à leur propre monde intérieur. Le fait que l’enfant se
taise quand vous lui demandez ce qui lui a pris de faire la vilaine chose ne signifie pas
nécessairement qu’il soit incapable d’introspection. Cela peut venir d’un sentiment de honte,
surtout si vous le regardez d’un air méchant. Si l’enfant a honte, encore une fois, du point de
vue psychologique, rien n’est perdu.
Récemment, la petite Laura, 10 ans, me raconte ceci : « L’autre, là, elle arrêtait pas, elle
m’énervait exprès. Alors je lui ai fichu un coup de poing. Ça m’a fait du bien. C’est comme
mon père quand il était en pension, il a appris à se défendre. » La conduite de Laura est
inacceptable du point de vue moral et réglementaire. Mais reconnaissons que du point de vue
de l’introspection, il n’y a rien à redire. Elle est capable de décrire exactement ce qu’elle a
ressenti. Je note, en plus, le petit élément d’identification à son père, qui me semble également
de bon pronostic. Rassurez-vous, je ne l’ai pas encouragée à recommencer, je ne vous fais
part que des réflexions qui me venaient en l’écoutant.

5
Dans nos examens cliniques, nous évaluons cette capacité en demandant à l’enfant de raconter
librement des histoires à partir d’images. Dans une des épreuves utilisées par les
psychologues cliniciens, il y en a une qui représente un enfant accoudé à une table, l’air
songeur avec un violon posé devant lui. Voici deux exemples de récit. Le premier, Arthur,
sept ans. « C’est un petit garçon. Il a pas envie de jouer du violon… ses parents l’obligent…
Il en a marre. » Arthur prête au personnage des sentiments qui correspondent bien à ce qu’on
voit sur la planche. Voici maintenant Adeline, même âge : « C'est un enfant... Ben il
téléphone… J'ai rien à dire, il y a un papier et un sac, et c'est tout. Et il va au lit (rire) au
dodo ! » Aucun sentiment n’est prêté au personnage, aucune vie intérieure n’est exprimée.
Peut-être aussi, peut-on déceler dans le rire gêné et la dérision quelque chose de défensif. On
dirait qu’Adeline s’interdit d’entrer dans son propre monde intérieur de peur d’y faire de
mauvaises rencontres. Adeline est en voie d’être orientée en Itep (Institut thérapeutique,
éducatif et pédagogique) en raison de ses nombreuses colères démesurées et ses crises
d’insolence. Entre deux crises, c’est une fillette sérieuse, trop sérieuse, qui semble se
contrôler. Elle raconte ses crises comme des anecdotes qui ne la concernent pas. J’ai traité la
maîtresse de pute, je lui ai donné un coup de pied. Point. Tout se passe comme si son monde
intérieur était soigneusement relégué dans l’ombre et le silence, entre deux explosions.
Mieux l’enfant est au clair avec ce qui se passe en lui, mieux il est capable de sentir aussi ce
qui se passe chez les autres.
Empathie
C’est ce qu’on appelle l’empathie, troisième critère. Oui, Pierre a compris que Déborah était
mal à l’aise quand il lui a descendu la culotte, qu’elle a eu très peur. Ou bien ça lui échappe
complètement. Se mettre à la place de l’autre. Voir dans ses expressions des analogies avec ce
qu’on peut ressentir soi-même. Si Pierre est doué d’empathie, il comprend que Déborah
éprouvait une peur analogue à la sienne quand Théo, Tom et Jules l’avaient serré dans un coin
de la cour…
L’introspection et l’empathie sont des facultés indispensables à la vie sociale. Elles ne
garantissent pas une bonne conduite. Supposons que Pierre soit conscient de l’excitation
sexuelle qu’il ressent face à la nudité de Déborah. Il est donc sain au regard de notre second
critère. Imaginons que de surcroît, il soit capable de se mettre à la place de sa victime. Il
comprendrait qu’elle souffre, qu’elle a peur, qu’elle est impressionnée. Il le comprendrait si
bien que ça ne serait pas loin de l’exciter un peu. Donc rien à redire au regard de l’empathie,
notre troisième critère.
Sens moral
Vous avez deviné ce qui lui fait défaut. C’est le sens moral. Le fait qu’il trouve du plaisir à
déculotter Déborah, et plus encore à l’affoler, ne suffit pas. Il faut qu’il assume cette réalité
supplémentaire : ça ne se fait pas. Ce n’est pas bien. On n’a pas le droit de forcer une
camarade à des jeux pareils. Nous développerons plus loin la question de la morale. Mais je
vous donne tout de suite un aperçu. Quatre possibilités se présentent. Première possibilité :
Pierre se fiche de la morale comme d’une guigne. Cela existe. On voit des enfants et des
adultes de tous âges afficher une superbe indifférence aux conséquences de leurs actes sur les
autres. Certains justifient leurs actes par des circonstances extérieures. Ce n’est pas de ma
faute si Déborah portait un short échancré… Cela peut motiver une consultation chez un
psychologue, lequel n’aura pas la partie facile. Seconde possibilité : Pierre s’auto accuse des
pires infamies. Je suis un misérable, etc. La complaisance dans les délices du masochisme
moral pourrait également motiver une consultation. Troisième possibilité : Pierre comprend
que ce qu’il a fait n’est pas bien. Il promet de ne plus recommencer. Ensuite, il recommence
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%