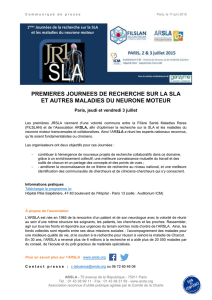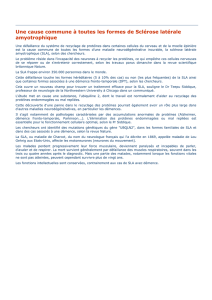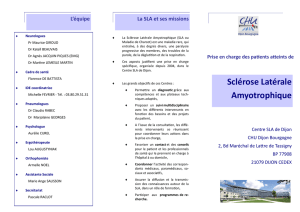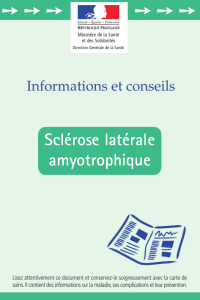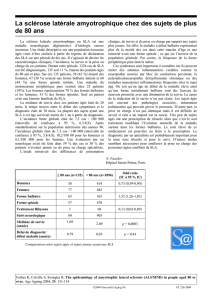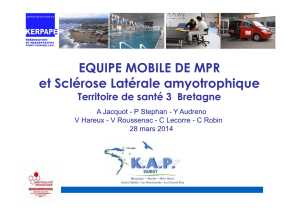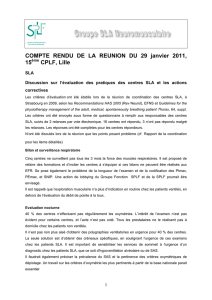SLA - Antadir

La sclérose latérale amyotrophique (SLA)
et la prise en charge paramédicale des maladies
neuro-musculaires
Journée du Groupe de Travail des Paramédicaux
Dans le cadre des travaux de la Commission Médico-Technique
et Sociale de l’Antadir et à l’initiative du groupe de travail des
paramédicaux, une réunion sur le thème de la sclérose latérale
amyotrophique (SLA) et la prise en charge paramédicale des
maladies neuro-musculaires s’est tenue le 9 octobre dernier.
La SLA est une affection neurologique au pronostic grave et
nécessite une prise en charge multidisciplinaire.
La matinée a été consacrée à une revue des aspects médicaux et
sociaux de la SLA, avec l’intervention de plusieurs spécialistes.
L’après-midi a été réservé à des ateliers thématiques, animés par
les membres du groupe de travail. Il nous est apparu intéressant
de vous présenter les temps forts de cette manifestation, à travers
les résumés qui suivent.
Pr Boris Melloni
Flash Info
www.antadir.com
Docteur Thierry Perez Page 2
Docteur Jésus Gonzalez-Bermejo Page 3
Professeur Philippe Couratier Page 4
Professeur Jean-Claude Desport Page 5
Françoise Fontenaille Page 6
Christophe Coupé Page 6
Gilbert Dragar, Henriette Letellier, Michèle Paget Page 7
Jacqueline Brisson, Chantal Kéré Page 7
Arnaud Colin, Françoise Jeanne Page 7
Dans ce numéro les résumés des interventions :
Flash Info
F É D É R A T I O N A N T A D I R — 6 6 B D S T M I C H E L — P A R I S 6 - 0 1 5 6 8 1 4 0 6 0
Année 2008 Numéro 14
Février 2008

Page 2 FLASH INFO
La SLA est une maladie dégénérative des
motoneurones responsable de paralysies
extensives des membres et/ou de la sphère
labio-glosso-pharyngée. Cette dégéné-
rescence progressive des motoneurones de la
corne antérieure, des noyaux bulbaires et du
cortex est d’étiologie inconnue, avec une
prévalence de 2,6 à 6,4/100000 habitants.
L’atteinte respiratoire par atteinte musculaire
et atteinte bulbaire aboutit à un
encombrement bronchique et pharyngé, des
infections respiratoires et une insuffisance
respiratoire grave.
Au début de la maladie, la dyspnée d’effort
est évaluée par l’échelle de Borg en
comparant la position assise et couchée. Les
signes d’alerte de l’atteinte respiratoire sont
l’apparition d’une fatigue, d’une somnolence
inhabituelle avec céphalées matinales, ou des
troubles du sommeil témoignant d’une
hypoventilation alvéolaire. Une dyspnée en
position assise ou orthopnée et un
e n c o m b r e m e n t b r o n c h i q u e o u
pharyngolaryngé doivent alerter.
Les explorations complémentaires reposent
sur la spirométrie, la gazométrie artérielle, la
mesure de la force musculaire et une
exploration du sommeil.
La spirométrie permet de rechercher un
syndrome restrictif avec abaissement de la
capacité vitale, élément pronostic si
inférieur à 50%.
La gazométrie artérielle va permettre de
détecter une hypercapnie diurne, reflet
d’une hypoventilation nocturne, indication
d’une ventilation non invasive (VNI)
La mesure de la force musculaire est plus
sensible que la spirométrie. La force
inspiratoire peut être évaluée par une
mesure simple de la pression nasale (SNIP)
ou « pression sniff nasale ». Ce test évalue
indirectement la force du diaphragme,
muscle inspiratoire essentiel, par la mesure
de la pression nasale du reniflement. On
peut également mesurer la pression
inspiratoire maximum ou PImax.
Le débit de pointe à la toux permet
simplement d’évaluer la force expiratoire et
la fonction de la glotte.
L’exploration du sommeil est importante.
L’oxymétrie nocturne, réalisable au
domicile du patient, permet de dépister des
désaturations nocturnes. La
polysomnographie a pour but de détecter
des apnées du sommeil versus une
hypoventilation.
Le consensus de la Haute Autorité de Santé
de Novembre 2005 recommande à chaque
évaluation trimestrielle de :
rechercherdes signes cliniques de
dysfonction du diaphragme, des troubles du
sommeil et un encombrement bronchique.
réaliser les examens suivants :
* une spirométrie (Capacité Vitale CV et
DEP à la toux)
* une gazométrie artérielle initiale et en
fonction de la clinique
* une évaluation musculaire : SNIP test
et PImax
* une oxymétrie nocturne semestrielle.
SLA : atteinte respiratoire, approche clinique et para-clinique.
Intervention du Dr Thierry Perez,Centre SLA, CHRU de Lille et Coordonnateur du
Groupe SLA de la Société de Pneumologie de Langue Française

ANNÉE 2008 NUMÉRO 14
Page 3
Deux points clefs caractérisent la maladie :
la dysfonction diaphragmatique et
l’atteinte de la toux.
Pour la dysfonction diaphragmatique, le
seul traitement efficace est la ventilation
mécanique. Des études récentes qui ont
débuté en 1995 ont démontré que la VNI
améliorait la survie et la qualité de vie des
patients. Aucune étude n’a démontré qu’un
mode de ventilation barométrique ou
volumétrique était supérieur à l’autre. La
seule difficulté est celle parfois de ventiler
avec succès des patients avec atteinte
bulbaire. En pratique, il faut d’abord
proposer une VNI, puis préparer et
discuter une ventilation mécanique sur
trachéotomie en respectant le choix
éthique du patient. En cas de VNI, il faut
préparer la prise en charge et l’éducation
du patient et de son entourage. Il faut
systématiquement prévoir :
*un ventilateur avec une batterie
*un ventilateur de secours
*un jeu de masque nasal et bucco-nasal
*des conseils en cas de lésions nasales
dues au masque.
La prise en charge par VNI nécessite une
coordination étroite entre le centre de
référence SLA, le prestataire et les acteurs
de soins à domicile.
Le mécanisme de la toux nécessite une
inspiration profonde, une fermeture
efficace de la glotte et une contraction
efficace des muscles expiratoires. Pour
améliorer la défaillance de la toux du
patient SLA, on dispose de plusieurs
techniques selon la gravité de la
défaillance :
Accélération de la toux par aide
manuelle du kinésithérapeute
Hyperinsufflation par « Air-Stacking »
Technique instrumentale par aide à la
toux (Cough assist®)
Le problème de la fin de vie sous
ventilation doit être abordé tôt avec le
patient et son entourage.
Prise en charge respiratoire de la SLA : ventilation non-invasive (VNI),
trachéotomie, aide à la toux. Intervention du Dr Jésus Gonzalez-Bermejo,
Centre de Référence SLA de Paris, Service de Pneumologie et Réanimation Respiratoire,
Hôpital La Pitié Salpêtrière, Paris.

La SLA est sur le plan épidémiologique
une affection grave dont la prévalence
augmente avec l’âge. On estime en France
environ 6500 cas avec 5-10% de formes
familiales. La présentation clinique est
hétérogène en fonction du siège des
lésions et de la vitesse de progression. Les
principaux facteurs pronostiques sont :
le délai entre le diagnostic et le début
des symptômes
l’âge du début
le siège initial de l’atteinte (spinal et
bulbaire)
l’importance de l’atteinte pyramidale
la sévérité de l’atteinte respiratoire la
présence ou non d’une dénutrition
Une prise en charge précoce diminue
l’incidence des complications, améliore les
répercussions psychologiques et la qualité
de vie. La prise en charge au sein d’un
centre de référence permet au patient et à
sa famille une aide pour la prise en charge
clinique, sociale et psychologique.
Les mécanismes physiopathologiques de
la maladie sont à ce jour mieux connus.
Pour expliquer la mort neuronale,
plusieurs mécanismes ont été décrits : les
troubles du métabolisme du calcium avec
activation des récepteurs au glutamate, les
anomalies du stress oxydant, les anomalies
des neurofilaments, les inclusions
intraneuronales et enfin l’apoptose ou mort
cellulaire programmée.
Le principal essai thérapeutique positif
concerne un agent anti-glutamate, le
riluzole ou Rilutek® qui augmente la
durée de vie des patients et retarde la
nécessité de mise en place d’une
trachéotomie. D’autres agents anti-
glutamates proposés, comme la
gabapentine, n’ont pas permis de
confirmer ces résultats.
Plusieurs voies thérapeutiques sont
actuellement étudiées avec des essais
cliniques :
les agents neurotrophiques, facteurs de
croissance pour les neurones
les anti-oxydants
les traitements favorisant le
métabolisme mitochondrial
les anti-inflammatoires
les agents inhibant l’apoptose.
Tous ces essais, à ce jour, n’ont pas
démontré une efficacité clinique, mais
d’autres essais sont en cours. La meilleure
connaissance des mécanismes
physiopathologiques fait espérer
l ’ é me rg e n c e d e t r a i t e me n t s
neuroprotecteurs.
Le traitement médical de la SLA et les protocoles de recherche.
Intervention du Pr. Philippe Couratier,Centre de Référence SLA,
service de Neurologie, CHU Dupuytren, Limoges.
Page 4 FLASH INFO

En Limousin, un réseau de nutrition a été
mis en place, réseau de suivi et de prise en
charge nutritionnelle des personnes âgées
(LINUT). Ce réseau travaille en
collaboration avec les médecins traitants et
le centre régional SLA pour réaliser des
bilans nutritionnels à domicile, après
accord du patient. Ces bilans sont réalisés
en cas d’alerte et tous les 3 à 6 mois pour
maintenir une surveillance ; les résultats
sont transmis au médecin traitant et au
centre SLA.
SLA: prise en charge dans le cadre d’un réseau « ville-hôpital »
Intervention du Pr. Jean-Claude Desport,Nutritionniste, CHU Limoges
L’état nutritionnel est un facteur
pronostique majeur de la SLA.
La dénutrition entraîne une perte
musculaire préjudiciable. On estime que
13-55% des patients sont dénutris.
La dénutrition est expliquée par
l’insuffisance respiratoire sévère, les
facteurs psychologiques et les états
infectieux. Les troubles de déglutition
sous-tendue par l’atteinte bulbaire et
l’hypotonie faciale aggravent la
dénutrition. L’hyper sialorrhée fréquente
est également une gêne pour
l’alimentation.
Au cours du suivi des patients, il est donc
capital de suivre les variations de poids (5-
10%), l’indice de masse corporelle (P/T2).
La mesure de l’impédancemétrie permet
d’évaluer la masse maigre. La biologie
n’est pas nécessaire.
La prise en charge nécessite :
une adaptation de l’environnement au
handicap
un traitement des troubles de déglutition
un traitement des troubles de salivation
un traitement de la constipation
une prise en charge des aspects
psychologiques.
Pour le traitement de la dénutrition, on
peut proposer :
des suppléments oraux avec textures
une nutrition entérale si perte de poids
< 5-10% ; par sonde de gastrotomie mise
en place par voie radiologique, avec des
apports caloriques importants
nécessaires.
La fin de vie nécessite un respect des
volontés du patient, une discussion avec
l’entourage et les soignants, en cas de non
possibilité du patient pour s’exprimer.
SLA: la prise en charge nutritionnelle.
Intervention du Pr. Jean-Claude Desport,Nutritionniste, CHU Limoges
ANNÉE 2008 NUMÉRO 14
Page 5
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%