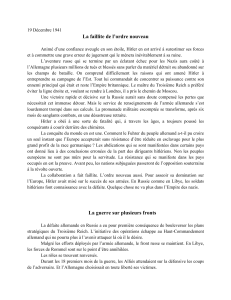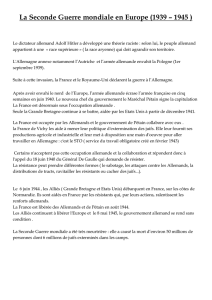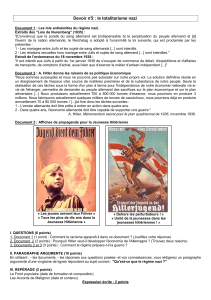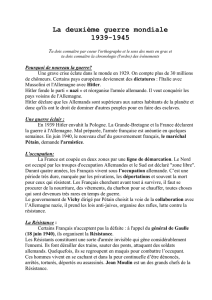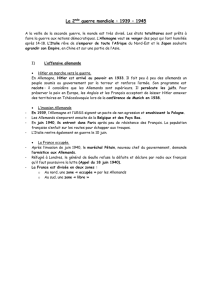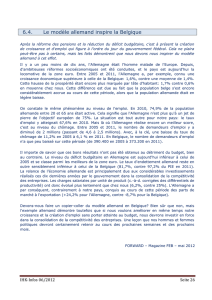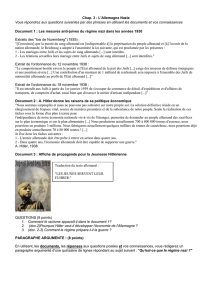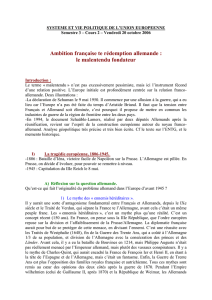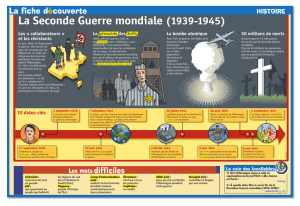Comment peut-on être allemand

Comment peut-on être
allemand ?
JACQUES DEWITTE
J’aborderai ici la question de l’identité européenne par un biais particulier, celui de
l’Allemagne et de l’identité allemande. J’ai choisi un titre provocant : « Comment peut-
on être allemand ? » qui ne doit pas être compris comme un étonnement méprisant
(celui des Parisiens envers le Persan dans les Lettres persanes de Montesquieu), mais
bien comme un encouragement amical. Car, s’il est vrai qu’existe quelque chose comme
une identité européenne – l’identité étant une notion certes problématique mais non
fantomatique – mais que prévaut actuellement une difficulté à l’assumer, cette diffi-
culté se manifeste de manière différente chez chaque peuple européen (ou nation), et
elle me semble demeurer particulièrement aiguë en Allemagne. J. D.
Sortir du dilemme identificatoire
MON livre L’Exception européenne (1)
peut se lire notamment comme une
contribution pour aider l’Europe à
sortir de sa crise morale qui rend difficile la
construction politique. Cette crise, liée à l’ex-
périence du XXesiècle : les deux guerres
mondiales, Auschwitz, la décolonisation, tient
à ce que l’on demeure figé, collé à une
« posture dépressive » et à un sentiment de
repentir ou de culpabilité devenu exclusif,
interdisant tout sentiment positif, toute estime
de soi, toute fierté. C’est évident chez les Alle-
mands et de plus en plus chez les Français.
Cette crise est également liée à une impasse
intellectuelle, à un dilemme dont on est
prisonnier : on n’aurait le choix qu’entre deux
attitudes extrêmes : d’une part l’auto-exalta-
tion chauvine et, d’autre part, la culpabilité,
l’autodénonciation, l’autoflagellation maso-
chiste, qui semble la seule issue. Il importe de
sortir de cette crise en surmontant le dilemme
et en mettant en avant un troisième terme
(exclu dans le dilemme). Je l’appelle de diffé-
rents noms : une juste fierté, une estime de soi,
une réconcilation avec soi-même.
Quelques mots pour préciser le cadre
général dans lequel je pose le problème. Ma
démarche consiste à distinguer entre deux
dimensions que l’on peut appeler respective-
ment « identitaire » et « identificatoire » –
entre une identité représentée comme donnée
et positive et une identité qui, bien que
préexistante, demeure en quelque façon à
confirmer et, jusqu’à un certain point, à
constituer.
COMMENTAIRE, N° 129, PRINTEMPS 2010 125
(1) L’Exception européenne. Ces mérites qui nous distinguent,
Michalon, 2008.

Elle consiste d’autre part à constater que,
dans ce processus identificatoire, nous
sommes prisonniers d’une alternative, d’un
«ou bien… ou bien ». « Sujet exalté, sujet
humilié, c’est toujours, semble-t-il, par un tel
renversement du pour et du contre qu’on s’ap-
proche du sujet », écrivait Paul Ricœur
souhaitant dépasser l’« alternative du cogito et
de l’anticogito (2) ». Cela peut être transposé
à mon propos, qui ambitionne de dépasser,
cet autre « renversement du pour et du
contre », celui, de nature existentielle mais
aussi politique, où l’on oscille constamment
entre l’auto-exaltation et l’auto-humiliation.
Cela conduit, à un certain moment, à
admettre tout de même une estime de soi
foncière (voire une « affirmation originaire »),
à distinguer de l’auto-exaltation, qui n’exclut
pas mais rend possible l’autocritique. Il faut
admettre qu’il existe, comme condition de
possibilité de tout le reste, un certain senti-
ment de soi positif, quelque chose comme une
fierté. Elle constitue une sorte de socle qui
n’exclut pas, mais rend au contraire possible
l’esprit critique. Faute de cette souche, l’on en
vient à scier la branche sur laquelle on est
assis.
En articulant une telle conception croisée,
et en mettant en évidence cette souche exis-
tentielle, on contribue à surmonter une situa-
tion assez courante, dans la sphère indivi-
duelle comme dans la sphère collective, à
savoir une alternative tranchée où se font face
deux conceptions extrêmes : soit l’amour de
soi exacerbé, poussé jusqu’à l’autocélébration
chauvine, soit la haine de soi poussée jusqu’à
l’autodestruction et l’autoflagellation maso-
chiste. Ou bien encore, phénomène très
courant, une oscillation cyclothymique, un va-
et-vient incessant entre ces deux « thumoi ».
En avançant un tiers terme qui dépasse l’al-
ternative, la conception croisée propose un
remède allant dans les deux directions. Contre
une autoglorification chauvine qui écarte
toute distance réflexive et critique, elle pose
l’exigence d’un regard critique sur soi-même.
Mais à cette autoflagellation destructrice elle
oppose un sentiment positif de soi-même, une
« estime de soi », laquelle – c’est là la pointe
de mon argumentation – est la condition de
possibilité de l’esprit critique (« qui aime bien
châtie bien ») et non pas son opposé.
Ce cadre général étant posé, il faut se deman-
der dans quelle conjoncture particulière on se
trouve. Car, selon les situations personnelles ou
historiques concrètes, on devra rééquilibrer la
balance dans un sens ou dans un autre : en s’en
prenant soit à l’autoglorification chauvine, soit
à l’autoflagellation destructrice. Dans l’Alle-
magne des années 1930, le premier remède
aurait été de mise afin de rétablir une juste
mesure ; dans l’Allemagne d’après les
années 60, une fois effectuée la nécessaire prise
de conscience des fautes, il devient nécessaire
de mettre l’accent sur le sentiment positif. Mon
jugement est que l’Europe actuelle se trouve
également dans une telle période où, pour
retrouver une juste mesure mais aussi pour
retrouver une appréciation réelle des choses, il
convient de retrouver une juste fierté. À mes
yeux, l’Allemagne a quelque chose d’« emblé-
matique » : car c’est dans ce pays que la crise
identitaire – ou identificatoire – européenne
apparaît avec la plus grande netteté.
Dans cet effort pour sortir du blocage onto-
logique et existentiel, dû notamment à une
conscience exacerbée de la responsabilité
pour les fautes commises, à une réduction de
sa propre histoire aux crimes dont elle est
entachée, je mets en avant la notion de récon-
ciliation avec soi-même. Non plus comme chez
Hegel la perspective d’un simple retour sur
soi, d’une « coïncidence » retrouvée avec son
« identité » (ce qui nous ramènerait à une
« métaphysique de la présence » que je
récuse), mais une identification globalement
positive avec ce que l’on est ou a été. La
réconciliation ainsi comprise permet à la fois
de puiser les ressources d’une créativité
retrouvée et de maintenir un esprit critique :
elle est la condition à la fois d’une estime de
soi raisonnable et d’une autocritique de bon
aloi – qui dépasse les extrêmes de la haine de
soi et de l’exaltation de soi chauvine – que
l’on trouve, en tant que structure psycholo-
gique, aussi bien dans le psychisme individuel
que dans l’existence collective – des peuples,
des communautés, des nations ou des civilisa-
tions.
L’Allemagne et la Russie
Dans le cadre général que je propose : dépas-
ser le dilemme entre deux positions extrêmes,
l’Allemagne et la Russie constituent, dans la
JACQUES DEWITTE
126
(2) Soi-même comme un autre, Seuil, 1990, p. 27.

conjoncture actuelle (le début du XXIesiècle),
deux figures radicalement opposées.
Dans la République fédérale a été prati-
quée, non certes sans résistances, une attitude
consistant à admettre ses fautes, à se confron-
ter à son propre passé immédiatement anté-
rieur. En Allemagne, j’aperçois la concrétisa-
tion de cette attitude double, de ces deux
« dispositions » que j’ai mises en évidence
dans mon livre comme étant toutes deux
essentielles à l’esprit européen : « battre sa
coulpe » et « s’incliner devant les faits »;
d’une part une attitude morale, de l’autre une
attitude permettant l’histoire objective (3). Ce
qui a été pratiqué dans ce pays après 1945
m’apparaît, je l’ai maintes fois souligné,
comme exemplaire, et comme une manifesta-
tion de l’esprit européen des temps modernes,
s’il est vrai, pour ne citer qu’un exemple, que
l’Europe (ou l’Occident), à la différence de
toutes les autres cultures (c’est l’un des
aspects de ce que j’appelle l’« exception euro-
péenne »), s’interroge sur les méfaits qui ont
été commis dans le passé colonial, ce qui est
unique dans l’histoire de l’humanité. Comme
l’a écrit Cornelius Castoriadis : « Je ne dis pas
que tout cela efface les crimes commis par les
Occidentaux, je dis seulement ceci : que la spéci-
ficité de la civilisation occidentale est cette capa-
cité de se mettre en question et de s’autocriti-
quer. Il y a dans l’histoire occidentale, comme
dans toutes les autres, des atrocités et des
horreurs, mais il n’y a que l’Occident qui a créé
cette capacité de contestation interne (4). »
Sans cette double disposition, l’Europe unie
n’aurait pas pu s’édifier (il n’y aurait pas eu
tout d’abord la « réconciliation franco-alle-
mande »). Pourtant, si l’Allemagne est à cet
égard emblématique de l’esprit européen, elle
est aussi symptomatique de ce qui, à mes yeux,
est un problème : que l’Europe a été trop loin
dans cette attitude, devenue une « repen-
tance » obligatoire et unilatérale (puisque la
part de culpabilité des autres parties n’est pas
prise en compte, comme on le voit avec l’his-
toire des traites esclavagistes où l’Europe seule
bat sa coulpe, les autres parties accablant les
seuls Européens impliqués dans ce trafic).
En Russie, la situation est tout autre. Elle
a toujours été partagée entre les tendances
dites occidentaliste et slavophile, entre l’atti-
rance pour l’Europe et son rejet, avec la pola-
rité des deux villes : Saint-Pétersbourg et
Moscou. Il semble hélas évident que dans la
Russie poutinienne c’est la seconde tendance
qui s’est imposée. Si on admet les traits que
j’ai mis en avant comme caractéristiques de
l’esprit européen, la Russie manifeste son
étrangeté à l’Europe par le fait même que la
mémoire, la confrontation critique à son
propre passé, à l’histoire du communisme et
de ses crimes, que tout cela soit une dimen-
sion complètement exclue et que la disposi-
tion mentale et morale nécessaire à cet effet
semble absente. Au contraire, c’est la
tendance opposée, l’auto-exaltation chauvine
qui domine. Récemment, un « vote télévisé »
(« Un nom pour la Russie ») effectué en
Russie dans le courant de l’année 2008 pour
déterminer qui était le plus grand Russe de
l’histoire a donné le résultat suivant : Alexan-
dre Nevski, Stolypine et, en troisième posi-
tion, Staline. Ce sondage, sans doute effectué
de manière biaisée, révèle quand même un
état d’esprit et une situation impensables en
Allemagne (dans un vote analogue, les
personnalités retenues étaient Bismarck et
Adenauer).
Cela confirme différentes choses que l’on
savait déjà : que ni en Russie ni d’ailleurs en
Europe il n’y a eu de « travail de mémoire »
comparable à celui qui a été fait pour le
nazisme. Selon l’expression très juste d’Alain
Besançon, il y a une hypermnésie du nazisme
et une amnésie du communisme. À l’époque
de Gorbatchev (comme l’a également écrit
Alain Besançon), le cercueil de Dracula a été
entrouvert, mais il fut rapidement refermé. Le
crime de Katyn a été reconnu par Gorbatchev,
mais la version officielle est une interprétation
déformante. Les historiens du groupe
« Mémorial » sont complètement marginali-
sés (5). Cela tient notamment à ce que, pour
beaucoup, il reste scabreux de comparer le
nazisme et le communisme et de les envisa-
ger comme deux formes de totalitarisme. Cela
a pour effet, globalement, qu’il n’y a eu aucun
procès en Russie ou dans les autres pays
communistes à l’encontre des crimes du
communisme, alors que, récemment, on a
COMMENT PEUT-ON ÊTRE ALLEMAND ?
127
(3) L’Exception européenne, op. cit., p. 174 et s.
(4) La Montée de l’insignifiance, Seuil, 1996, p. 94.
(5) Toutefois, je relève que Stéphane Courtois semble manifes-
ter un plus grand optimisme. Dans Communisme et totalitarisme
(Perrin, coll. Tempus, 2009), il salue la « révolution documentaire »
qui a ouvert aux historiens des archives insoupçonnées et permis
de mieux comprendre la nature criminelle du régime communiste.

ramené en Allemagne sur une civière un vieil
homme grabataire pour lui faire un procès ;
c’est une disproportion flagrante. Il est
évident qu’en Russie, le KGB est toujours au
pouvoir. Le Président russe fut un KGBiste et
il l’est resté. Qu’aurait-on dit si, dans la Répu-
blique fédérale des années cinquante et
soixante, un ancien gestapiste était devenu
Chancelier ou Président ? Il y a deux poids,
deux mesures.
Si l’Allemagne a développé une attitude à
cet égard exemplaire et même outrancière, de
sorte qu’il n’existe aucun culte potentiel ou
refoulé de Hitler (au point que ses réussites
indéniables dans les années trente peuvent à
peine être reconnues), on a affaire à une
situation diamétralement opposée en Russie.
Par cette absence d’une mémoire historique,
d’une attitude critique portant sur les crimes
du communisme, ce grand pays se met lui-
même en dehors de l’Europe, il répond à
l’avance à la question de savoir s’il n’en ferait
pas partie.
L’Allemagne et la Russie sont, à cet égard,
deux figures radicalement opposées : d’une
part une autocritique poussée jusqu’à l’auto-
négation ; d’autre part, une absence de regard
critique et un retour de l’auto-exaltation chau-
vine. Pour une réflexion sur l’identité euro-
péenne portée par le souci d’un retour à une
fierté raisonnable, à un sentiment de soi
positif, ces deux figures constituent les deux
formes extrêmes qui doivent être évitées. La
Russie représente le sentiment « identaire
brut » excluant la dimension autocritique, le
chauvinisme nationaliste ; l’Allemagne repré-
sente l’autocritique poussée jusqu’à l’auto-
reniement et l’autodestruction – ou, forme en
quelque sorte soft, privilégie une gestion sans
sentiment d’exaltation et de grandeur. Car il
y a, à mes yeux, un autre démon qui menace
l’Europe : le démon de l’autoreniement et du
pacifisme qui, paradoxalement, résulte de la
peur de ses propres démons.
Pour une réconciliation
germano-allemande
À bien des égards, l’Allemagne est emblé-
matique de la crise identitaire (ou identifica-
toire) européenne, du piège par lequel toute
forme de sentiment de soi ou de fierté est assi-
milée à un chauvinisme étroit – assimilation
intériorisée et pour ainsi dire adoptée à
l’avance : on prend les devants pour éviter
l’accusation. Si la tâche politique et existen-
tielle consiste à dépasser le dilemme de l’exal-
tation chauvine et de la haine de soi, ce pays
est aux premières loges. C’est là que le bât
blesse : dans cette assimilation erronée de
l’estime de soi ou même de toute idée d’iden-
tité et de chauvinisme, de l’auto-affirmation
brutale et bornée.
L’attitude consistant à se confronter à son
passé a été pratiquée et quasiment institu-
tionnalisée outre-Rhin. Les Allemands, même
ceux de la plus jeune génération, doivent
constamment se justifier, à l’avance, avant
toute critique explicite, du fait même d’être
allemands. Ils ont complètement intériorisé
l’accusation globale qui leur a été adressée et
sont continuellement sur la défensive. Je
considère que cette attitude en soi noble et
louable a été poussée trop loin, et que ce n’est
pas une bonne chose pour l’Europe.
On peut interpréter différents phénomènes
de la vie culturelle allemande des années
cinquante et soixante comme autant de
« fuites devant soi-même » – non pas de fuites
devant son passé, mais des fuites devant sa
propre identité, devant sa vocation, son
charisme, son génie propre. Les exemples sont
nombreux : dans les arts plastiques et en
architecture, une fuite vers l’avant-gardisme
proche de l’Amérique (s’accompagnant d’une
destruction des villes dans le prolongement
des bombardements afin de faire table rase).
Les écrivains polonais invités à Berlin-Ouest,
comme Zbignew Herbert et Adam Zaga-
jewski, découvraient, comme l’écrit ce dernier,
« une ville amnésique », où les artistes et
hommes de lettres berlinois optaient pour les
attitudes de « l’avant-garde radicale, comme
s’ils voulaient oublier le Mur, la honte de l’his-
toire récente. Ils préféraient croire que
Berlin-Ouest était un quartier de New
York (6) ». En philosophie, cette fuite se mani-
feste dans la suspicion qui continue à peser
sur la philosophie allemande (idéalisme,
phénoménologie), avec une entrée en force de
la philosophie analytique anglo-saxonne et des
penseurs français « postmodernes ».
Il y a eu ce moment décisif dans l’histoire
européenne contemporaine : la réconciliation
franco-allemande, l’une des pierres de la
construction européenne de l’après-guerre.
JACQUES DEWITTE
128
(6) Adam Zagajewski, Éloge de la ferveur, Fayard, 2002, p. 139.

Mais il serait grand temps qu’ait lieu un autre
événement politique et moral également
susceptible d’influer grandement sur la
conscience européenne : une réconciliation
germano-allemande. Je veux dire par là : une
réconciliation des Allemands avec eux-
mêmes, un dépassement de la méfiance et de
la haine de soi qui ont été exigées d’eux ou
qu’ils se sont imposées à eux-mêmes. Une
capacité – qui s’amorce dans certains
domaines mineurs comme le sport – à retrou-
ver une fierté, un sentiment de soi positif. À
s’identifier à nouveau à leur propre histoire,
dans ce qu’elle a eu de glorieuse, de brillante
et de géniale, sans avoir à se demander à
chaque instant s’ils ne sont pas en train de
céder à nouveau aux vieux démons nationa-
listes ; sans que cette histoire ne soit considé-
rée rétrospectivement, dans sa globalité,
comme un simple « prélude à Hitler », et pas
davantage en « passant l’éponge » sur les
douze années sombres de la dictature nazie et
de ses crimes. Et ainsi de retrouver leur élan,
leur propre créativité et leur propre charisme
à l’intérieur de la culture européenne, sans se
réfugier dans des courants intellectuels qui
ont en commun de nier cette spécificité.
Étant donné que l’on a affaire au pays euro-
péen le plus peuplé, que l’histoire contempo-
raine reste dominée par le souvenir de Hitler,
que le repentir allemand fut l’un des modèles
de la repentance européenne, nul doute que
cela ne serait pas sans incidence sur la
conscience européenne. Ce serait un bel
exemple de la manière d’allier l’esprit critique
– y compris la conscience des fautes passées
– et le sentiment positif de soi-même.
Relation immédiate ou médiate
à Hitler ?
Mais comment faire ? Comment œuvrer en
vue de cette « réconcilation avec soi-même »,
de cette « réconcilation germano-allemande »
que j’appelle de mes vœux ? L’impasse iden-
tificatoire tient notamment à ceci : toute l’his-
toire allemande, non seulement celle des XIXe
et XXesiècles, a été interprétée rétrospective-
ment à partir d’Hitler, et donc, si j’ose dire, a
été éclairée à la lumière de cette tache
obscure. De proche en proche, c’est toute
l’histoire et la culture qui ont été contaminées,
à quelques exceptions près, rares sanctuaires
non pollués.
L’historien Thomas Nipperdey a bien décrit
ce processus, en montrant qu’on a affaire là
à une réduction téléologique inversée. Un histo-
rien, dit-il, doit certes admettre une continuité
historique, en vertu de laquelle l’ultérieur
peut être expliqué par l’antérieur, mais la
direction ne peut être inversée. On ne peut
expliquer l’antérieur par l’ultérieur, « comme
s’il existait une quasi-téléologie (7) ». Sinon,
on procède à une simplification et à une unila-
téralisation du passé – de ce présent que fut
le passé.
Cette téléologie inversée, dans laquelle toute
l’histoire allemande devient une sorte de
« prélude à Hitler (8) », a une incidence
évidente sur la question identificatoire. Certes
un peuple – comme une personne – n’a pas
une « identité » toute faite (ce qui correspond
à l’« identitaire »), elle est en partie un proces-
sus de constitution (que j’appelle « identifica-
toire »). Mais cette identification – au sens actif
du terme – n’est pas une pure « construction »
en l’air, succédant à une opération de table
rase. Elle a besoin de repères, de figures
auxquelles on s’identifie, parfois extérieures et
légendaires, mais provenant aussi de son
propre passé (ou de sa propre famille), identi-
fication à ce qui, dans ce passé, fait sens, appa-
raît comme méritant d’être admiré et imité.
L’identité est liée à un passé au moins de
deux manières : de manière factuelle parce
que l’on est issu d’une histoire, et de manière
imaginaire (ou mieux : identificatoire) parce
que l’on ne cesse de se rapporter, en pensée,
à travers des récits et légendes, à une histoire
que l’on perçoit comme étant sienne et
comme ce qui vous porte. Or, comment faire
lorsque, dans ce passé, tout est contaminé par
l’épisode infamant ? En pareil cas, il est
impossible de s’identifier à quoi que ce soit
de positif ; les identifications ne peuvent être
que négatives. Une voie possible est alors de
s’identifier de manière globale et unilatérale
aux victimes (ou supposées telles), en déniant
entièrement sa propre identité. Une autre
voie est d’envisager une identification à une
identité vide, non historique, qui serait entiè-
rement à construire et ne reposerait que sur
COMMENT PEUT-ON ÊTRE ALLEMAND ?
129
(7) Nachdenken über die deutsche Geschichte, Munich, 1986,
p. 248. Il existe une traduction française de cet ouvrage : Réflexions
sur l’histoire allemande, Gallimard, 1992, à laquelle je ne me suis
pas référé.
(8) J’emprunte cette expression à l’historien américain Peter Gay,
qui reprend à son propre compte la démarche de Nipperdey.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%