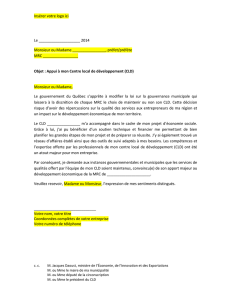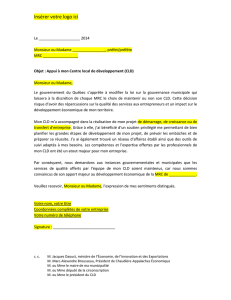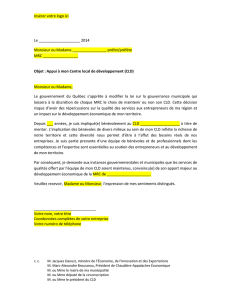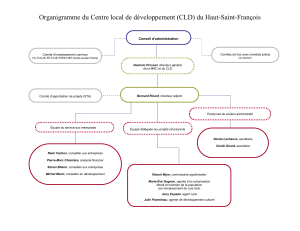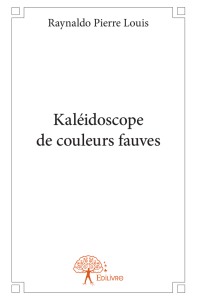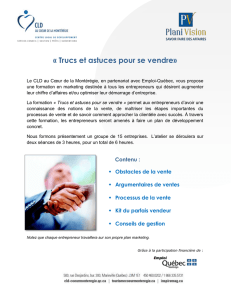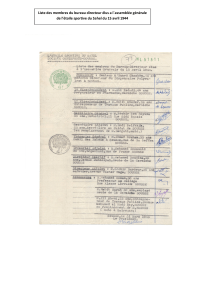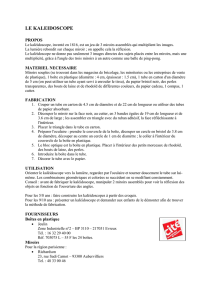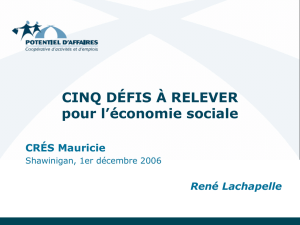L`élan brisé? - Kaléidoscope

TOUTE UNE HISTOIRE
Les Québécois et les oléoducs
DOSSIER
Développement collectif :
L’élan brisé?
K
Kaléidoscope
Le développement collectif
dans tous ses états
TERRITOIRES NUMÉRIQUES
Le socio nancement:
porte de sortie temporaire ?


MOT DE LA RÉDACTION - 1
Le chaudron au bout de l’arc-en-ciel
Gabrielle Brassard-Lecours
Cette citation d’un ancien journaliste et roman-
cier des années 1970 me semble plus que jamais
d’actualité.
Nous avons plusieurs raisons aujourd’hui de penser
que l’avenir n’est pas rose. Compressions dans pra-
tiquement tous les domaines (santé, éducation,
développement local et régional) disparition totale
d’organismes… le pessimisme a lieu d’être. Mais à
travers toute cette noirceur, et comme Fournier le
dit si bien, il y a des éclaircies. C’est souvent en
temps de crise que des initia-
tives de solidarité, des projets
créateurs et des idées innovantes
voient le jour.
Plusieurs organismes dont la
contribution majeure au déve-
loppement collectif est indé-
niable, tels les Corporations de
développement économique com-
munautaire (CDEC), les Centres
locaux de développement (CLD),
les Conférences régionales des
élus (CRÉ), et Solidarité rurale du Québec, pour n’en
nommer qu’eux, voient leur avenir menacé, voire
anéanti par les mesures gouvernementales. En tant
que média dédié à ce secteur d’intervention, nous
voulons braquer les projecteurs sur lui, non seule-
ment en proposant un état des réexions et des in-
quiétudes, mais en essayant de dégager certaines
pistes de solution et possibilités d’avenir. Car il y
en a. Même Solidarité rurale du Québec, qui s’est vu
forcée de mettre à pied la totalité de ses employés
à l’automne, semble ne pas vouloir disparaître.
Présente à l’assemblée générale extraordinaire, suite
à cette triste annonce avant les fêtes, j’ai assisté à
une journée sous le signe de l’espoir, où la soixan-
taine de personnes présentes à Trois-Rivières dis-
cutaient des façons de sauver l’organisme, de se le
réapproprier et de travailler à le reconstruire avec
une autre structure. De nouvelles avenues sont pos-
sibles. Il s’agit d’y croire, d’étudier d’autres modèles
de nancement ou d’organisation. À travers le ma-
rasme, s’unir, discuter, agir ensemble est es-
sentiel aujourd’hui, plus que
jamais. C’est dans une période
comme celle-ci que le terme
«développement collectif» prend
tout son sens.
Malgré les vents contraires,
Kaléidoscope maintient le cap,
déterminé à poursuivre sa mis-
sion d’être à l’écoute des acteurs
du développement collectif par-
tout à travers le Québec et de les
interpeler. Par une grande cam-
pagne de d’adhésion qui s’ébranle, un virage multi-
média et la sortie de ce numéro thématique, Kaléi-
doscope veut s’inscrire comme le véritable média
indépendant entièrement dédié au développement
collectif.
En somme, malgré la période austère que nous
traversons, le développement collectif continue sa
marche. C’est à travers la solidarité, la concertation
et l’innovation qu’il faut nous tourner résolument.
Après la pluie vient le beau temps. Accrochons-nous
pendant que les vents soufent fort ! /
L’avenir, lorsqu’on
y songe,
est toujours noir.
Mais il y a des
éclaircies
Guy-Marc Fournier,
L’Autre Pays
KALÉIDOSCOPE - VOL. 2 NUMÉRO 3 - HIVER 2015

23. Points de repères
Par Georges Letarte
24. La n de la concertation
régionale au Québec?
Par Mickaël Bergeron
27. Des impacts régionaux de
la fermeture des CRÉ
Par Louis-André Lussier
28. L’héritage saccagé des CLD
Par Jacques Fiset et André Fortin
30. Dans le rétroviseur
Par Geneviève Huot, Vincent van
Schendel et Lynn O’Cain, du TIESS
31. Et si le développement
collectif rebondissait?
Par Alexandra Viau
Seul média indépendant destiné aux
publics spécialisés et aux citoyens
intéressés par le développement col-
lectif, Kaléidoscope a pour mission de
les informer, de les interpeler et de
soutenir l’innovation. K, le développe-
ment collectif dans tous ses états est
le lieu où les différents acteurs peu-
vent partager et enrichir leurs expé-
riences et leur réexion.
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
COORDONNATEUR
Marcelo Solervicens
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION
Gabrielle Brassard-Lecours
COMITÉ DE LECTURE
Alain Ambrosi, Mélanie Loisel,
Dominique Payette, Ariane
Émond, Georges Letarte, Marcelo
Solervicens.
RÉDACTION
Mickaël Bergeron, Gabrielle
Brassard-Lecours, Mãdãlina
Burtan, Sophie Clerc, Anabel
Cossette-Civitella, Karine Dubé,
Jacques Fiset, Ariane Émond,
André Fortin, Geneviève Giasson,
Daphné Hacker-Bousquet,
Widia Larivière, Geneviève
Huot, Gérald Lemoyne, Martin
Léon, Georges Letarte, Louis-
André Lussier, Lynn O’Caïn,
Marcelo Solervicens, Alexandra
Viau, Yanic Viau, Vincent van
Schendel.
PHOTO DE COUVERTURE
Charles Briand
DESIGN ET MISE EN PAGE
SCommunications
RÉVISION LINGUISTIQUE
Lili-Marion Gauvin Fiset.
IMPRIMEUR
JB Deschamps
DÈPÔT LÉGAL:
Bibliothèque nationale du Québec,
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1929-6878 (imprimé)
ISSN 1929-6886 (en ligne)
KALÉIDOSCOPE
190, boulevard Crémazie Est, Mon-
tréal (Québec) H2P 1E2 514 864-
1600 [email protected] /mediaK.ca
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ariane Émond, présidente,
journaliste indépendante et
animatrice
Jacques Fiset, secrétaire-trésorier,
formateur en développement
collectif
Geneviève Giasson, vice-
présidente, coordonnatrice générale
Communagir
Georges Letarte, consultant en
développement collectif
Louise Rondeau, ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS)
Denis Sirois, directeur général
CDEC-Centre-Nord
Louis-André Lussier, conseiller CRÉ
Vallée-du-Haut-St-Laurent
Réal Morin, Directeur, Développe-
ment des individus et des
communautés INSPQ
Kaléidoscope s’inspire du Guide
de déontologie des journalistes du
Québec et du Conseil de presse du
Québec pour prendre ses décisions
en matière d’éthique et de déontolo-
gie. Les textes publiés sont sous la
responsabilité de leur signataire et
n’engagent aucunement les parte-
naires de K. Les textes publiés dans
K peuvent être reproduits, à condition
d’en citer la source. /
RUBRIQUES
01. MOT DE LA RÉDACTION
Le chaudron au bout de l’arc-en-ciel
Par Gabrielle Brassard-Lecours
03. POLITIQUES PUBLIQUES
L’indispensable dialogue entre acteurs
locaux et chercheurs!
Par Geneviève Huot et Vincent van Schendel, en
collaboration avec Lynn O’Cain
05. PRATIQUES CITOYENNES
Quand une protestation donne
naissance à un festival
Par Gabrielle Brassard-Lecours
07. TERRITOIRES NUMÉRIQUES
Le socionancement ; porte de
sortie temporaire ?
Par Daphnée Hacker-Bousquet.
10. INTERNATIONAL
Le modèle français de l’économie
sociale et solidaire, inspirant ?
Par Sophie Clerc
34. SOCIALE FICTION
Bonne année 2015
Texte de Martin Léon
36. TOUTE UNE HISTOIRE
Les Québécois et les oléoducs : quelle
place pour l’environnement?
Par Yanic Viau
39. ÉTUDES DE K
Par Gérald Lemoyne, Karine Dubé et Widia Larivière
43. RADAR CULTUREL
Par Madalina Burtan
DOSSIER
INTRODUCTION
15. Développement collectif:
L’élan brisé?
Par Ariane Émond et Marcelo
Solervicens
HAUT PARLEUR
17. Lettre de solidarité aux
acteurs du développement
collectif québécois
Par Geneviève Giasson
REGARDS CROISÉS
18. Sur le terrain, l’impact de
l’austérité
Par Sophie Mangado, Marcelo
Solervicens
20. Manifeste de DYNAMO
21. Genèse d’une rigueur
annoncée
Par Anabel Cossette Civitella
Retrouvez-nous sur
mediakaleidoscope.org
SOMMAIRE
KALÉIDOSCOPE - VOL. 2 NUMÉRO 3 - HIVER 2015
Dans ce numéro nous
sommes alles à:
Trois pistoles, Lebel-sur-
Quévillon, Lac-Mégantic,
Trois-Rivières, Saint-Siméon
de Bonaventure, East Angus,
Nord du Québec, Abitibi-
Temiscamingue, Sherbrooke,
Attawapiskat, Montréal,
Québec, Rimouski, Valleyeld
et à d’autres endroits encore.
COUVERTURE :
Photo: Charles Briand.
Denis Sirois (DG) et
quelques collegues de
la CDEC-Centre-Nord
de Montréal.

POLITIQUES PUBLIQUES - 3
L’indispensable dialogue entre
acteurs locaux et chercheurs!
Depuis des décennies, le Québec a connu une véritable mobilisation territoriale qui a
donné des résultats tangibles en termes de développement. Celle-ci a des racines
profondes qui ne demandent qu’à donner naissance à de nouveaux projets
et à s’élargir, mais les récents changements dans les politiques publiques du
gouvernement l’ont fragilisée.
Par Geneviève Huot et Vincent van Schendel, en collaboration avec Lynn O’Cain
Il apparaît alors essentiel de préserver les appren-
tissages réalisés, notamment en ce qui concerne
l’importance de la participation de la société civile au
développement. Pour y arriver un véritable dialogue
entre le terrain et la recherche est nécessaire.
Des craintes liées aux
transformations en cours
Depuis une trentaine d’années, le Québec a connu de
nombreuses expériences de développement territorial,
comme les Opérations Dignité visant à empêcher les fer-
metures de villages dans l’Est du Québec ou encore les
initiatives communautaires des quartiers centraux de
Montréal. Ces expériences, qui ont été appuyées par des
politiques publiques (voir encart à la page 30), ont sou-
vent été mises sur pied par des communautés qui ont
fait le choix de prendre en charge collectivement leur
développement. Des entreprises collectives (coopératives
ou OBNL) ou de petites entreprises privées ont alors vu
le jour, mobilisant ainsi les citoyens. Fruits de l’initiative
d’acteurs de la société civile, ces expériences avaient des
caractéristiques communes : la
volonté de freiner le déclin, de
stimuler la vitalité, de construire
un avenir, de bénécier collec-
tivement des retombées du dé-
veloppement et de travailler en
partenariat, le tout en collabora-
tion avec les élus municipaux et
les pouvoirs publics.
Au-delà de la disparition des organismes de développe-
ment et de concertation (CRÉ, CLD, etc.) et des pertes
d’emplois qui y sont rattachées, les récents changements
dans les politiques publiques du gouvernement Couillard
font naître des inquiétudes importantes. Ces inquiétudes
concernent, au premier chef, l’abolition d’un modèle de
concertation impliquant les acteurs socioéconomiques
locaux et les élus municipaux, et faisant participer la so-
ciété civile aux décisions concernant la planication et
le développement territorial. Ces échanges entre les
communautés et les élus permettaient des appren-
tissages collectifs. Les changements imposés par le gou-
vernement font aussi craindre la perte d’une expertise
en accompagnement des promoteurs (notamment pour
les projets d’entreprises collectives), l’effritement d’une
culture d’innovation découlant de la concertation entre
acteurs de milieux diversiés, la disparition de fonds
pouvant soutenir les projets d’entreprises locales et,
finalement, l’impossibilité de mettre sur pied des projets
reposant sur une vision régionale du développement et
réunissant divers acteurs régionaux.
Le transfert des connaissances
et des expériences
Plusieurs études montrent que les organismes de déve-
loppement et de concertation, comme ceux touchés par
les décisions gouvernemen-
tales, permettent aux acteurs
d’origines diverses d’entrer en
relation et éventuellement de
collaborer. Ils ont leur impor-
tance, car la concertation doit
être un processus organisé : il
faut identier les forces de chacun
et les capacités à mettre en commun, puis établir un cli-
mat de conance qui favorise les apprentissages collec-
tifs, l’amélioration, l’innovation, mais aussi la création de
synergies entre les parties prenantes.
Cette façon d’envisager la concertation, qui a fait ses
preuves par le passé, doit être préservée. C’est un enjeu
Les changements imposés
par le gouvernement
font craindre l’effritement d’une
culture d’innovation
KALÉIDOSCOPE - VOL. 2 NUMÉRO 3 - HIVER 2015
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%