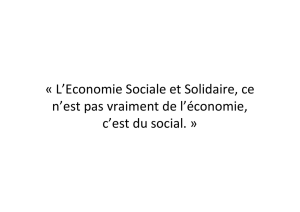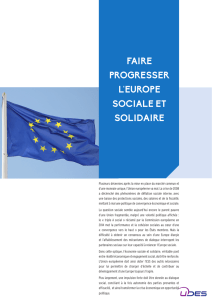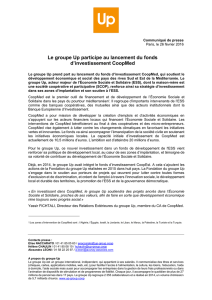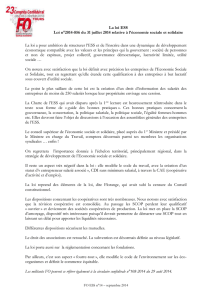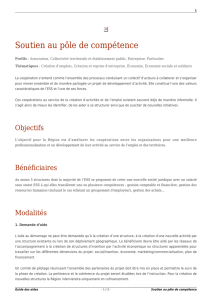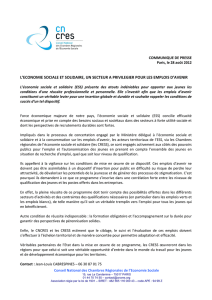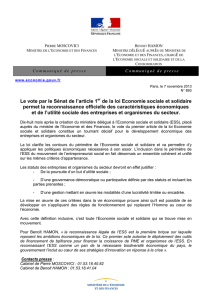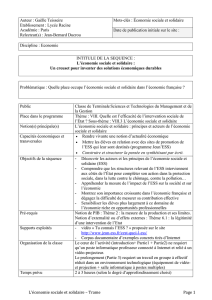Annexe 4 - LDD solidaire : « Il faut que ce soit un choix

1
Exemples sujets partie Économie –
Sujet 1
1.Définissez le terme de croissance économique.
2.Quelle est l’influence (ou le poids) de l’ESS (Économie sociale et solidaire) pour les
institutions non financières (les entreprises) ?
3. Montrez que les associations complètent le rôle des pouvoirs publics.
4. Vous répondrez à la question (ci-dessous) de manière argumentée en vous appuyant sur
vos connaissances et les documents en annexe.
« En quoi l’ESS est-elle bénéfique pour l’État et pour les ménages ? »
Annexe 1 - Sondage IFOP pour l’UDES : l’ESS est-elle un relais de croissance ? 80 % des dirigeants
d’entreprise répondent oui !
Les résultats du sondage mené par l’IFOP pour l’UDES confortent le rôle que
peuvent jouer les employeurs de l’économie sociale et solidaire dans les nouveaux
gisements d’activités - économie collaborative, économie numérique, économie
circulaire, silver économie1 - dans un contexte de relance encore timide de
l’investissement. Ces résultats ont été présentés à l'occasion de la Convention
nationale de l'UDES le 1er octobre dernier.
Quand on interroge les Français sur leur niveau de connaissance de l’ESS et de ses principes, voici ce qu’ils
répondent :
Notoriété de l’ESS. Plus des 3⁄4 des Français et 70 % des dirigeants en ont déjà entendu parler. La
marge de progression se situe dans la qualité de cette connaissance : la proportion déclarant savoir
précisément de quoi il s’agit demeure en effet minoritaire auprès du grand public (26 %) comme des
dirigeants (27 %). Les principes propres à l’ESS, notamment le fait que les bénéfices de ses entreprises
soient consacrés au maintien de l’activité, au développement d’emplois non délocalisables, sont
connus par moins de la moitié des Français.
Image de l’ESS et de ses employeurs. Grand public et dirigeants d’entreprise s’accordent à leur
reconnaître une image très positive et volontariste. L’ESS est majoritairement perçue comme
dynamique (74 % des Français et 61 % des entreprises), audacieuse (73 % et 64 %), en phase avec les
évolutions de la société française (71 % et 56 %). Par ailleurs, une large majorité des Français (78 %) et
des dirigeants d’entreprise (71 %) ont une bonne image des employeurs.
Caractéristique majeure de l’ESS : Consensus autour de la capacité du secteur à créer de la cohésion
sociale. Le grand public met à la fois en avant les bénéfices économiques et sociaux de l’ESS là où les
dirigeants soulignent principalement son action dans le domaine du social. Ainsi, 84% des Français et
82% des dirigeants d’entreprise considèrent que l’ESS est en capacité de renforcer le lien social. 67%
des Français considèrent que l’ESS a la capacité de créer de nombreux emplois contre 50% des
dirigeants d’entreprise interrogés.
Quand on interroge les Français sur la crise économique actuelle, les nouveaux gisements d’emplois et la
contribution de l’ESS, voici ce qu’ils répondent :
1. Crise économique en France : Un pessimisme encore important mais qui tend à s’estomper. 49 % des
dirigeants d’entreprise et 59 % du grand public considèrent que nous sommes encore en pleine crise
économique. Au sein du grand public, ce pessimisme élevé est néanmoins en recul depuis janvier
2012, date à laquelle 79 % des Français considéraient que l’économie était en pleine crise.
2. Modèles économiques de demain : économie collaborative et économie numérique considérées
comme les plus créatrices d’emplois. Les opinions des deux cibles divergent lorsqu’il s’agit de désigner
le modèle économique émergent créant le plus d’emplois : si les Français placent l’économie
collaborative juste devant l’économie numérique (respectivement 30 % et 27 %), les dirigeants
d’entreprise se prononcent de façon plus nette en faveur de l’économie numérique (33 %), au
détriment de l’économie collaborative (23 %).
3. Rôle de l’ESS dans les secteurs émergents. Les dirigeants d’entreprise (en particulier dans les
structures de plus de 100 salariés et en région parisienne) considèrent que les employeurs de l’ESS ont
un rôle à jouer dans le développement de secteurs émergents, qu’il s’agisse de l’économie
collaborative (88 %, dont 45 % tout à fait), l’économie circulaire (83 % dont 32 % tout à fait), la Silver

2
économie (81 % dont 36 % tout à fait) et dans une moindre mesure l’économie numérique (67 %, dont
24 % tout à fait).
4. Raison principale pour laquelle l’ESS doit jouer un rôle important : sa capacité à créer des emplois de
proximité non délocalisables selon 44 % des dirigeants d’entreprise interrogés.
Le 13 novembre 2015 - http://www.udes.fr/
1 La Silver économie est l’économie au service des âgés.
Annexe 2 - La prime à l'embauche bénéficiera aussi aux PME de l'ESS
L'aide de 4.000 euros sur deux ans attribuée aux entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent en 2016
concerne bien aussi les organisations de l'économie sociale et solidaire (ESS) - associations, mutuelles,
coopératives, fondations et sociétés commerciales d'utilité sociale. C'est ce qu'a tenu à préciser Martine
Pinville, secrétaire d'Etat en charge de l'ESS, dans un communiqué du 4 février. "D'ici 2020, on estime à 700 000
le nombre de recrutements nécessaires au sein de l'économie sociale et solidaire", a rappelé Martine Pinville,
estimant que la prime peut constituer "un vrai coup de pouce" pour l'emploi dans l'ESS.
L'aide s'applique à "toute embauche en CDI ou en CDD de 6 mois et plus comprise entre le 18 janvier 2016 et le
31 décembre 2016, avec un salaire jusqu'à 1,3 fois le Smic", y compris dans les cas particuliers des groupements
d'employeurs et des contrats de professionnalisation.
Le mardi 9 février 2016 - C. Megglé - http://www.localtis.info
Annexe 3 - Du remède à la crise à l’alternative permanente
Face aux politiques d’austérité menées un peu partout en Europe, l’ESS a fait front en offrant dans les territoires des
solutions au démentèlement des services publics.
[…]
« Nous inventons une société qui n’existe pas encore »
Aucun de ces acteurs de l’économie sociale et solidaire ne se connaissait avant le forum européen de l’ESS fin janvier.
Certains même n’avaient qu’une conscience naissante d’appartenir à cette famille de pensée et de faire. Venus des quatre
coins de l’Union, tous partagent pourtant le même projet politique à travers leurs expériences de terrain. « Ce que nous
faisons, c’est une forme de résistance à l’économie de marché, une forme de dépassement de la nostalgie de l’État
providence affaibli par les politiques libérales et d’austérité. Nous inventons une société qui n’existe pas encore », résume
Marie-Caroline Collard qui, avec SAW-B, fédère une centaine d’entrepreneurs sociaux belges.
« Contre la casse de la sécurité sociale et de l’éducation »
Développer l’ESS, c’est d’abord répondre aux urgences sociales délaissées par les États, singulièrement dans les pays du sud
de l’Europe où les politiques d’austérité imposées par la troïka ont été les plus violentes. « En Espagne, tous les services
publics ont été décimés. Dans de nombreux endroits, nos coopératives de travail ont repris ces missions et se développent
(+ 23 % de création entre 2012 et 2013 – NDLR). Elles créent du travail de qualité et fournissent une solution au million trois
cent mille Espagnols en état de dépendance », estime Paloma Arroyo, de la Confédération espagnole des coopératives de
travail associé (Coceta). Au Portugal, Animar, association pour le développement local, milite pour l’établissement d’une
économie des communs, « contre les politiques d’austérité, contre la casse de la sécurité sociale et de l’éducation, pour
l’accès à la culture et contre la privatisation de l’énergie, des transports ou de l’eau », énumère Maria do Carmo Bica. Dans
la région de Madrid aussi, les communs sont aussi à l’honneur. Terrativa permet aux habitants de s’approprier les terres
périurbaines en friche pour les mettre en culture. Les coopératives Andina et Agresta valorisent de petits massifs forestiers
privés ou communaux. « Le plus compliqué pour nous est de faire comprendre aux gens nos spécificités, explique Felix
Manuel Jimenez Lopez. Nos services ressemblent à ceux de compagnies privées. Mais, chez nous, tout profit est réinvesti
dans la société dont la gestion est démocratique. En promouvant notre façon de faire, on veut casser le modèle libéral et
l’isolement des entrepreneurs. »

3
Pour Skevos Papaioannou, professeur de sociologie grec, l’ESS offre des outils pour affronter de nouvelles réalités : « On
parle de crise comme si, grâce aux solutions libérales qu’on nous promeut, nous allions revenir aux jours heureux d’avant.
C’est une illusion. Pour affronter cette crise devenue permanente, les solutions à trouver doivent être radicalement
différentes. L’économie sociale et solidaire offre des alternatives concrètes à explorer face à l’économie de marché qui nous
maintient dans cette situation. »
Le Mardi 2 Février 2016 – S. Guérard - http://www.humanite.fr
Annexe 4 - LDD solidaire : « Il faut que ce soit un choix délibéré de l’épargnant »
François Hollande a indiqué qu'une partie de l'épargne déposée sur les Livrets de développement durable
(LDD) serait prochainement affectée au financement d'entreprises solidaires. La directrice de l'association
Finansol Sophie des Mazery nous explique l'impact d'une telle annonce sur la finance solidaire.
Toutsurmesfinances.com : François Hollande a promis le 12 janvier « une affectation du Livret de
développement durable (LDD), notamment du côté des banques, au financement de l'économie sociale et
solidaire ». Cette annonce vous a-t-elle surprise à Finansol ?
Sophie des Mazery, directrice de l'association Finansol : Cela fait 3 ans que Finansol travaille à l'émergence d'un LDD
solidaire, nous avons porté ce projet auprès de tous les décideurs politiques jusqu'au ministère des Finances à Bercy. Ce
travail de plaidoyer, nous l'effectuons de façon soutenue depuis toutes ces années. Par ailleurs, un certain nombre de ces
décideurs s'étaient montrés intéressés par ce projet, nous savions que le sujet n'était pas enterré.
Pour vous, comment se traduira dans les faits cette annonce ?
Le discours du président de la République ne permet pas de savoir précisément en quoi consistera le projet. Celui que nous,
nous portons, c'est que l'épargnant ait la possibilité lorsqu'il va souscrire un LDD de choisir une option solidaire. A savoir,
qu'il peut soit prendre un LDD « classique » soit cocher une case qui implique que 5 à 10% des sommes déposées sur le
livret puissent financer des entreprises solidaires. On retrouve ce projet en filagrane dans ce qu'a dit François Hollande
puisqu'il parle de la partie décentralisée de l'épargne règlementée, en évoquant « du côté des banques ».
« L'épargne solidaire, c'est reprendre la responsabilité sur son argent »
Pouvez-vous expliquer ce que signifie l'expression « du côté des banques » ?
Je la comprends de la façon suivante : les dépôts effectués sur les livrets réglementés sont en partie (65%) centralisés à la
Caisses des dépôts et consignations (CDC), quand l'autre partie (35%) reste dans le bilan des banques, avec cet objectif de
financer du développement durable.
C'est donc avec la partie décentralisée des dépôts que les réseaux bancaires vont financer des entreprises de l'économie
sociale et solidaire (ESS). La démarche est vertueuse puisque concrètement, les épargnants vont déposer leurs économies
sur un LDD solidaire et la banque aura ensuite l'obligation d'affecter une partie de ces dépôts au financement d'entreprises
solidaires. C'était l'un de nos objectifs, que les entreprises solidaires bénéficient d'une ressource supplémentaire au travers
de financements en provenance des banques.
Comment à votre avis cela va-t-il se passer : le choix d'épargner solidaire sera-t-il laissé à l'épargnant ou une partie des
dépôts sera-t-elle directement affectée à l'économie sociale et solidaire ?
Nous militons pour cette première solution. Il faut que ce soit un choix délibéré de l'épargnant car l'épargne solidaire c'est
ça, c'est reprendre la responsabilité sur son argent en choisissant l'affectation qui va en être faite par l'établissement
financier qui gère les produits d'épargne que l'on a souscrits. Je pense qu'il est plus judicieux que ce produit solidaire soit
choisi en toute conscience plutôt que ce soit un fléchage qui échappe à l'épargnant. L'intérêt est moindre s'il s'agit
d'épargner solidaire sans le savoir.
Pour quoi le LDD et non le Livret A par exemple ?
Il me semble que le livret d'épargne qui est le plus légitime pour porter une option solidaire est le LDD, qui initialement
avait pour but de financer les investissements de développement durable des entreprises, un objectif plus ou moins rempli.
Redonner demain son véritable objectif à ce livret en faisant en sorte qu'une partie des dépôts réalisés par les épargnants
aillent financer des entreprises solidaires, il me semble que c'est une bonne chose.
« C'est une véritable vitrine pour démocratiser la finance solidaire »
Le fait que le LDD devienne solidaire, en quoi cela va-t-il aider la finance solidaire ?
François Hollande l'a rappelé, il y a 60 millions de livrets réglementés ouverts aujourd'hui ; on voit bien que c'est le produit
le plus facilement accessible et compréhensible à tout épargnant. Le fait qu'il y ait un LDD solidaire au guichet de toutes les
banques, c'est une grande promotion. Nous pensons à Finansol que si cette vitrine est effective dans les banques, elle va
mobiliser un certain nombre d'épargnants et permettre une démocratisation de l'épargne solidaire.
Pensez-vous qu'avec un tel geste, le 1% solidaire se rapproche ?
Incontestablement ! Aujourd'hui, 100 milliards d'euros sont en dépôt sur des LDD. A terme, on va évidemment faire un
bond d'encours d'épargne solidaire et donc se rapprocher du 1% solidaire.
Alors même que les taux de rendement des livrets bancaires sont au plus bas et que la décollecte augmente au fil des
mois ?
Je pense que la transformation du LDD en un produit solidaire est un projet de long terme. Effectivement, les taux bas ne
constituent pas les éléments les plus positifs pour booster la collecte. Ceci dit quand on regarde la collecte des livrets
d'épargne de partage, dont le taux est aligné sur celui des livrets réglementés, on voit que la collecte ne diminue pas. Au
contraire, 10.000 souscripteurs sont venus s'ajouter en 2014 alors que les taux étaient déjà très bas. Nous ne sommes pas
inquiets lorsque nous voyons l'évolution des livrets de partage, qui se portent très bien.

4
Ce que nous constatons, c'est que lorsque l'on présente aux Français un produit d'épargne solidaire dont la rentabilité est
proche de ce qu'ils pourraient obtenir sur un autre produit, l'argument de « l'épargne utile » prend le dessus. Les
souscripteurs de livrets solidaires y restent fidèles, y compris quand les taux sont bas. Par ailleurs, l'épargne réglementée a
aussi une fonction d'épargne de précaution, le taux est un élément pris en considération mais ce n'est pas le seul.
Par Solenne Dimofski - vendredi 15 janvier 2016 - https://www.toutsurmesfinances.com
Sujet 2
À partir de vos connaissances et de la documentation fournie en annexe :
1. Commentez l’évolution du commerce extérieur de la France.
2. Présentez les handicaps du commerce extérieur de la France par rapport à celui
de l’Allemagne
3. Présentez les mesures protectionnistes mises en place par certains pays depuis
2008.
4. Rédigez une argumentation qui vous permette de répondre à la question suivante
:
Des mesures protectionnistes permettraient-elles de réduire
le déficit du commerce extérieur de la France ?
Annexes :
Annexe 1 : Évolution du commerce extérieur français.
Annexe 2 : France, la dérive incessante de la balance commerciale.
Annexe 3 : Les pays les plus protectionnistes.
Annexe 4 : L’OMC met en garde contre une hausse du protectionnisme.

5
Annexe 1 : Évolution du commerce extérieur français.
S1 : semestre 1, S2 : semestre 2
D’après Douanes et Banque de France.
Les échelles de droite et de gauche sont exprimées en milliards d’euros.
Annexe 2 : France, la dérive incessante de la balance commerciale
En 2013, la France affichait un commerce extérieur déficitaire tandis que celle de l'Allemagne
s'établissait à un niveau excédentaire record de 198,9 milliards d'euros.
[...] La France, dont les deux tiers des échanges s'effectuent avec les pays de l'Union européenne, a
en particulier pâti d'une conjoncture européenne dégradée. Une stratégie de diversification des
zones d'exports semble donc s'imposer avec notamment un développement vers l'Asie, région qui ne
constitue que 12,6 % du commerce français.
[...] Pour comprendre les clés de la réussite du modèle allemand, il convient d'observer la structure
des partenaires commerciaux du pays.
En effet, si de nombreux échanges sont effectués avec la France et les Pays-Bas, Berlin a cherché
pendant plusieurs années à intensifier ses relations avec la Chine, qui progressivement, est devenue
son troisième partenaire commercial. Une stratégie qui s'avère payante. [...]
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%