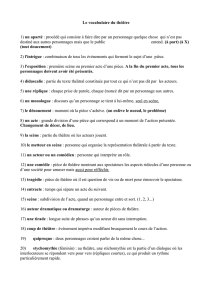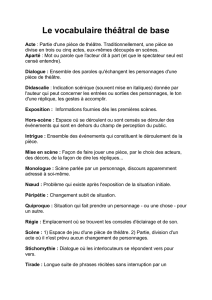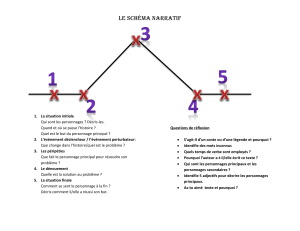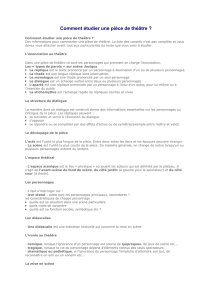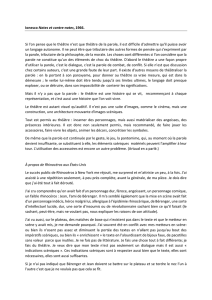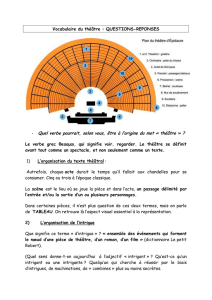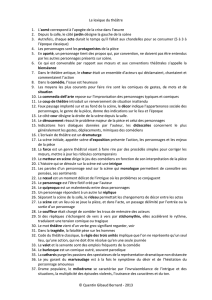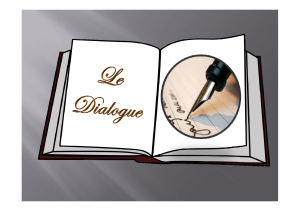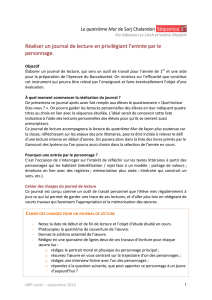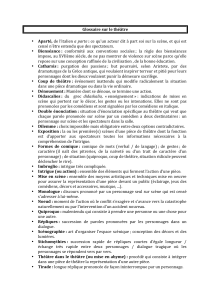Télécharger le fichier - Fichier

116
Français 1re – Livre du professeur
CHAPITRE 2 – Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours
Repères littéraires
p. 146 (ES/S et Techno) p. 148 (L/ES/S)
Les pages « Repères littéraires » présentent le genre théâtral dans une perspective diachronique et s’at-
tachent à expliquer l’évolution des formes. La lecture de ces pages peut être effectuée avant l’étude des
textes des quatre séquences qui suivent, mais on peut également l’envisager au fur et à mesure de la décou-
verte des textes, afin de les situer dans leur époque et mieux comprendre leur originalité. L’évolution du
genre est ainsi mise en relation avec l’histoire littéraire.
PISTES D’EXPLOITATION
• L’huile sur toile intitulé Farceurs français et italiens
(p. 147 ES/S et Techno / p. 149 L/ES/S) peut être
l’occasion de repérer certains personnages typiques
pour réfléchir à la façon dont ils ont évolué dans le
genre de la comédie. On pourra ensuite étudier
comment d’un personnage de farce, stéréotypé
comme le valet, on passe à des personnages beau-
coup plus « humains », qui ont des rapports particu-
liers avec leurs maîtres, en étudiant la séquence 2
(p.169 ES/S et Techno / p.171 L/ES/S).
On invitera les élèves à réfléchir aux constantes du
texte théâtral, et à réfléchir aux constantes et aux
évolutions des problématiques de représentation.
• Des extraits de scène lus par des comédiens sont
disponibles dans le manuel enrichi:
SÉQUENCE 1 – Le « théâtre dans le théâtre » du
XVIIe siècle à nos jours
• Pierre Corneille, L’Illusion comique (p. 150
ES/S et Techno / p.152 L/ES/S)
SÉQUENCE 2 – Maîtres et valets dans la comé-
die du XVIIIe siècle
• Alain-René Lesage, Turcaret (p.170 ES/S et
Techno / p.172 L/ES/S)
• Marivaux, Le Jeu de l’amour et du hasard
(p.172 ES/S et Techno / p.174 L/ES/S)
• Victor Hugo, Ruy Blas (p. 182 ES/S et
Techno / p.184 L/ES/S)
SÉQUENCE 3 – L’aveu sur scène du XVIIe au XXe
siècle
• Beaumarchais, Le Mariage de Figaro (p.190
ES/S et Techno / p.192 L/ES/S)
• Alfred de Musset, On ne badine pas avec
l’amour (p.194 ES/S et Techno / p.196 L/ES/S)
Une vidéo permet de réfléchir à la mise en scène
de Rhinocéros d’Eugène Ionesco (p.203 ES/S
et Techno / p.205 L/ES/S)
• Il pourra être utile, lors de la lecture de ces pages,
de relever les termes propres au genre théâtral
(« représentation », « tragédie », « comédie »,
« chœur », …) et d’en vérifier systématiquement la
définition, dans les fiches « Outils d’analyse » (p.434-
554 ES/S et Techno / p.437-557 L/ES/S).
Les élèves pourront se reporter aux photographies
de mises en scène des œuvres citées dans les
« Repères littéraires »et consulter les dossiers « Mise
en scène ». En confrontant ces éléments avec les
documents proposés par les pages « Repères », ils
pourront s’interroger sur l’évolution des représenta-
tions théâtrales (choix des costumes, décors, acces-
soires).
2210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 1162210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 116 08/07/11 11:2908/07/11 11:29

117
2 – Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours –
Paragraphes des
Repères littéraires
Textes et entrées dans le chapitre
« Le texte théâtral et sa représentation,
du XVIIe à nos jours »
Textes et entrées dans les
autres chapitres du manuel
L’Antiquité:
la naissance du
théâtre
SÉQUENCE 3– L’aveu sur scène du XVIIe au
XXe siècle
• Sophocle, Œdipe Roi (p.200 ES/S et
Techno / p.202 L/ES/S)
CHAPITRE 4
SÉQUENCE 3– La question de la
femme au XVIIIe siècle
• Aristophane, L’Assemblée des
femmes (p.363 ES/S et
Techno / p.365 L/ES/S)
Série L
CHAPITRE 6
SÉQUENCE 1– Le dénouement
dans Médée
• Euripide, Médée (p.465 L/
ES/S)
• Sénèque, Médée (p.468 L/
ES/S)
Le XVIIe siècle: l’âge
d’or du théâtre SÉQUENCE 1– Le « théâtre dans le théâtre »,
du XVIIe à nos jours
• Pierre Corneille, L’Illusion comique (p.150
ES/S et Techno / p.152 L/ES/S)
• Molière, L’Impromptu de Versailles (p.154
ES/S et Techno / p.156 L/ES/S)
SÉQUENCE 3– L’aveu sur scène du XVIIe au
XXe siècle
• Jean Racine, Phèdre (p.188 ES/S et
Techno / p.190 L/ES/S)
• Pistes de lecture– William Shakespeare,
Hamlet (p.221 ES/S et Techno / p.223 L/
ES/S)
CHAPITRE 1
SÉQUENCE 5– Visages de la folie
dans les romans du XVIIIe au XXe
siècle
• William Shakespeare, Hamlet
(p.136 ES/S et Techno / p.138 L/
ES/S)
Série L
CHAPITRE 6
SÉQUENCE 1– Le dénouement
dans Médée
• Pierre Corneille, Médée (p.470
L/ES/S)
SÉQUENCE 2– La fin de Don
Juan
• Tirso de Molina, Le Trompeur
de Séville et l’invité de pierre
(p.482 L/ES/S)
• Molière, Dom Juan ou le Festin
de Pierre (p.484 L/ES/S)
SÉQUENCE 3– Le mythe de Pro-
gné et Philomèle
• William Shakespeare, Titus
Andronicus (p.511 L/ES/S)
Le XVIIIe siècle: une
apparente légèreté SÉQUENCE 1– Le « théâtre dans le théâtre »,
du XVIIe à nos jours
• Denis Diderot, Paradoxes sur le comédien
(p.164 ES/S et Techno / p.166 L/ES/S)
SÉQUENCE 2– Maîtres et valets dans la
comédie du XVIIIe siècle
SÉQUENCE 3– L’aveu sur scène du XVIIe au
XXe siècle
• Beaumarchais, Le Mariage de Figaro
(p.190 ES/S et Techno / p.192 L/ES/S)
• Pistes de lecture– Marivaux, Le Jeu de
l’amour et du hasard (p.221 ES/S et
Techno / p.223 L/ES/S)
Série L
CHAPITRE 6
SÉQUENCE 2– La fin de Don
Juan
• Lorenzo Da Ponte, Don Gio-
vanni (p.486 L/ES/S)
2210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 1172210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 117 08/07/11 11:2908/07/11 11:29

118
Français 1re – Livre du professeur
Le XIXe: rupture et
renouveau SÉQUENCE 2– Maîtres et valets dans la
comédie du XVIIIe siècle
• Victor Hugo, Ruy Blas (p.182 ES/S et
Techno / p.184 L/ES/S)
SÉQUENCE 3– L’aveu sur scène du XVIIe au
XXe siècle
• Alfred de Musset, On ne badine pas avec
l’amour (p.194 ES/S et Techno / p.196 L/
ES/S)
• Corpus bac (Séries générales) – Victor
Hugo, Ruy Blas (p.222 ES/S / p.224 L/ES/S)
• Corpus bac (Séries technologiques)–
– Alfred de Musset, Les Caprices de
Marianne (p.222 Techno)
– E. Labiche et A. Lefranc, Embrassons-
nous, Folleville ! (p.223 Techno)
– Alfred Jarry, Ubu Roi (p.224 Techno)
Série L
CHAPITRE 6
SÉQUENCE 2– La fin de Don
Juan
• Lenau, Don Juan (p.492 L/
ES/S)
Les XXe et XXIe
siècles: modernités SÉQUENCE 1– Le « théâtre dans le théâtre »,
du XVIIe à nos jours
• Jean Giraudoux, L’Impromptu de Paris
(p.156 ES/S et Techno / p.158 L/ES/S)
• Jean Anouilh, La Répétition ou l’amour
puni (p.158 ES/S et Techno / p.160 L/ES/S)
• Jean-Luc Lagarce, Nous, les héros (p.160
ES/S et Techno / p.162 L/ES/S)
• Olivier Py, Les Illusions comiques (p.162
ES/S et Techno / p.164 L/ES/S)
• Bertold Brecht, Petit Organon pour le
théâtre (p.166 ES/S et Techno / p.168 L/
ES/S)
SÉQUENCE 2– Maîtres et valets dans la
comédie du XVIIIe siècle
• Jean Genet, Les Bonnes (p.184 ES/S et
Techno / p.186 L/ES/S)
SÉQUENCE 3– L’aveu sur scène du XVIIe au
XXe siècle
• Jean Anouilh, Antigone (p.196 ES/S et
Techno / p.198 L/ES/S)
• Bernard-Marie Koltès, Roberto Zucco
(p.198 ES/S et Techno / p.200 L/ES/S)
SÉQUENCE 4– Eugène Ionesco, Rhinocéros
• Eugène Ionesco, Notes et contre-notes
(p.216 ES/S et Techno / p.218 L/ES/S)
• Samuel Beckett, Fin de partie (p.218 ES/S
et Techno / p.220 L/ES/S)
• Pistes de lecture– Jean Genet, Les
Bonnes (p.221 ES/S et Techno / p.223 L/
ES/S)
• Corpus bac (Séries générales)–
– Albert Camus, Caligula (p.223
ES/S / p.225 L/ES/S)
– Eugène Ionesco, Le Roi se meurt (p.224
ES/S / p.226 L/ES/S)
CHAPITRE 4
SÉQUENCE 4– Les passions et
l’aspiration au bonheur
• Jean-Paul Sartre, Les Mouches
(p.384 ES/S et Techno / p.386 L/
ES/S)
Série L
CHAPITRE 6
SÉQUENCE 1 – Le dénouement
dans Médée
• Jean Anouilh, Médée (p.474 L/
ES/S)
• Max Rouquette, Médée (p.476
L/ES/S)
• Laurent Gaudé, Médée Kali
(p.478 L/ES/S)
SÉQUENCE 2– La fin de Don
Juan
• Henry de Montherlant, La Mort
qui fait le trottoir (p.488 L/ES/S)
– Eric-Emmanuel Schmitt, La
Nuit de Valognes (p.490 L/ES/S)
SÉQUENCE 3– Le mythe de Pro-
gné et Philomèle
• Philippe Minyana, La Petite
dans la forêt profonde (p.510 L/
ES/S)
2210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 1182210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 118 08/07/11 11:2908/07/11 11:29

119
2 – Le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours –
QUESTIONS
1. Quelles passions sont particulièrement représen-
tées sur scène dans les tragédies ? S’agit-il seule-
ment de la passion amoureuse ? Aidez-vous de la
séquence sur « Les passions et l’aspiration au bon-
heur » pour comprendre ce terme.
2. Combien de pièces participaient aux concours de
tragédies et de comédies dans l’Antiquité ? Com-
ment se déroulaient-ils ?
3. Trouvez des exemples de réécritures de pièces
antiques. Le chœur a-t-il été conservé ? Aidez-vous
du manuel.
4. Indiquez les noms des personnages de la com-
media dell’arte. Quels rôles leur sont dévolus ? Quels
costumes portent-ils ? Cherchez des représenta-
tions de ces personnages.
5. Décrivez le tableau (p.147 ES/S et Techno / p.149
L/ES/S): qu’est-ce qui prouve qu’il représente une
scène de théâtre ? Quels personnages reconnais-
sez-vous ? A quels genres de théâtre appartiennent-
ils ?
6. Retrouvez les noms des dramaturges et des
comédiens qui se sont représentés au théâtre du
Marais, à l’Hôtel de Bourgogne et au Théâtre-Fran-
çais.
7. Expliquez en quoi a consisté la « querelle du Cid ».
8. Quelles fonctions particulières le théâtre a-t-il pu
remplir au XVIIIe siècle ?
9. Que s’est-il passé lors de la première représenta-
tion d’Hernani de Victor Hugo ?
10. Quels bouleversements dans le genre théâtral
les XXe et XXIe siècles traversent-ils ?
EXPOSÉS
Le drame romantique
Les caractéristiques principales du drame roman-
tique sont la rupture avec les trois unités classiques
(temps, lieu, action), ainsi que le mélange des genres
et des registres: il prend souvent, notamment, un
caractère épique. Victor Hugo définit ce genre dans
la Préface de Cromwell en 1827: selon lui, le théâtre
doit mêler l’épopée et la poésie pour montrer « la
nature et la vérité ». Le drame romantique, en parti-
culier, selon sa formule, accueille « le grotesque et le
sublime, le terrible et le bouffon, la tragédie et la
comédie » afin de « peindre la vie ». On trouve, dans
le manuel, différents extraits de drames roman-
tiques : Victor Hugo, Ruy Blas (p. 182 ES/S et
Techno / p. 184 L/ES/S) ; Alfred de Musset, On ne
badine pas avec l’amour (p. 194 ES/S et
Techno / p.196 L/ES/S); Corpus bac (Séries géné-
rales): Victor Hugo, Ruy Blas (p.224 ES/S / p.226 L/
ES/S); Corpus bac (Séries technologiques): Alfred
de Musset, Les Caprices de Marianne (p. 222
Techno). D’autres auteurs de drames romantiques:
Alexandre Dumas (Antony); Gérard de Nerval (Léo
Burckart) ; Alfred de Vigny (Chatterton). Ce genre
appelle une réflexion importante autour de la mise
en scène, qui a conduit Victor Hugo, par exemple, à
travailler avec des peintres, des décorateurs (on a
conservé les dessins proposés par l’auteur pour ses
mises en scène) ou à utiliser des machines.
2210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 1192210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 119 08/07/11 11:2908/07/11 11:29

120
Français 1re – Livre du professeur
Séquence 1
Le « théâtre dans le théâtre », du XVIIe siècle à nos jours p. 149 (ES/S et Techno)
p. 151 (L/ES/S)
Problématique : Qu’est-ce que l’illusion théâtrale ? Quels sont les rapports entre illusion et réalité
au théâtre ? Quels sont les rôles de l’auteur, du metteur en scène et des comédiens dans la création
de cette illusion ?
Éclairage : Il s’agira de définir ce qu’est une représentation théâtrale, et ainsi de préciser la place de l’illu-
sion et celle de la réalité. Il conviendra aussi de distinguer le personnage du comédien et d’en saisir toutes
les conséquences. Enfin, nous pourrons définir le genre de l’« impromptu » et en dégager les enjeux.
Texte 1 – Pierre Corneille, L’Illusion comique
(1636)
p. 150 (ES/S et Techno) p. 152 (L/ES/S)
OBJECTIFS ET ENJEUX
– Définir les conditions de la représentation théâtrale.
– Montrer en quoi consiste l’illusion théâtrale.
– Dégager les enjeux de ce procédé qu’on appelle
« le théâtre dans le théâtre, et ses rapports avec le
baroque.
LECTURE ANALYTIQUE
Dans l’Examen (1660) de la pièce, Corneille écrit :
« Le cinquième (acte) est une tragédie assez courte
pour n’avoir pas la juste grandeur que demande
Aristote et que j’ai tâché d’expliquer. Clindor et Isa-
belle, étant devenus comédiens sans qu’on le sache,
y représentent une histoire qui a un rapport avec la
leur et semble en être la suite. Quelques-unes ont
attribué cette conformité à un manque d’imagina-
tion, mais c’est un trait d’art pour mieux abuser par
une fausse mort le père de Clindor qui les regarde, et
rendre son retour de la douleur à la joie plus surpre-
nant et plus agréable ». Le « trait d’art » consiste donc
à créer l’illusion pour mieux la dissiper en suscitant
une émotion fondée sur la surprise et le plaisir. La
formule classique qui mêle l’instruction et le divertis-
sement est donc déjà bien présente dans cette pièce
éminemment baroque de Corneille.
La magie du théâtre
On remarquera d’abord que le rideau se « relève »
(l. 1) au moment où l’illusion va se dissiper ! On
attendrait plutôt l’inverse : l’illusion se dissipe quand
le rideau se baisse et que la représentation théâtrale
cesse ! N’y aurait-il pas là, par un retournement qui
caractérise le baroque, l’idée que le théâtre, fondé
sur l’illusion, est le genre qui la dissipe le mieux ;
mais si le rêve est la réalité, la réalité peut se révéler
un songe, tout aussi bien ! L’étonnement (au sens du
XVIIe siècle, c’est-à-dire comme frappé par le ton-
nerre) de Pridamant est d’abord marqué par la ques-
tion initiale : « Que vois-je ? » (v.3). Cette interroga-
tion partielle est immédiatement suivie par sa
réponse, elle-même sous forme de question : « Chez
les morts compte-t-on de l’argent ? ». L’étonnement
est traduit par ce fort contraste entre deux « mondes »
opposés : celui des morts, et celui des vivants méto-
nymiquement représenté par l’argent. La seconde
réplique du père le souligne encore plus : trois excla-
mations se succèdent dans un même alexandrin :
« Je vois Clindor ! ah Dieux ! quelle étrange surprise ! »
(v.5). La remarque ironique d’Alcandre devrait rame-
ner Pridamant à la réalité (v.4) puisqu’elle marque
une rupture de registre et souligne la réalité quasi
sordide du comptage de la recette. Mais Pridamant
est si étonné que cette illusion ne se dissipera vrai-
ment qu’au vers 21, marqué lui aussi encore par
l’exclamation et un alexandrin réduit à l’hémistiche :
« Mon fils comédien ! ». Pridamant parle de «charme»
au vers 7 (voir le sens de ce mot au XVIIe siècle dans
«Vocabulaire»). Comment se traduit ce sortilège ?
D’abord, on voit des morts qui se livrent à des tâches
de vivants. Leurs « discords » (v. 7) sont effacés
en « un moment », comme par magie. D’où cette
« étrange surprise » (v.6), étrange au XVIIe siècle ayant
un sens plus fort qu’aujourd’hui et signifiant : hors
des conditions où l’on vit habituellement, extraordi-
naire. Tout cela est impossible dans la réalité, alors
que c’est justement la réalité (parce que l’illusion a
été prise pour la réalité avant). Ainsi si on se laisse
prendre par l’illusion théâtrale, on se retrouve inca-
pable de reconnaître la réalité, la réalité devient
« étrange », après. Serait-ce une mise en garde ?
(Mise en garde d’ailleurs démentie ensuite dans le
discours d’Alcandre, le faux magicien dont l’ironie
mordante ramène les choses à leur juste propor-
tion). Le quiproquo cesse quand Pridamant com-
prend que son fils est comédien (v.21), autrement
dit quand le père comprend qu’il faut dissocier le
comédien du personnage : le comédien n’est pas le
personnage, il le joue (cette distinction conduira aux
réflexions de Diderot (p. 164 ES/S et Techno / p.166
L/ES/S) et Brecht (p. 166 ES/S et Techno / p.168
L/ES/S) sur l’art du comédien. Alcandre s’acharne à
détruire l’illusion, la magie (voir le vers 10, où
« poème », dans le premier hémistiche, entre en
résonance avec « pratique », dans le second). Jouer
sur le théâtre est d’abord un moyen de gagner sa
2210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 1202210441163_116-179_Ch2_LDP_Fr1.indd 120 08/07/11 11:2908/07/11 11:29
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
1
/
64
100%