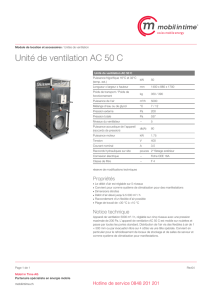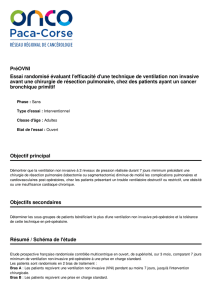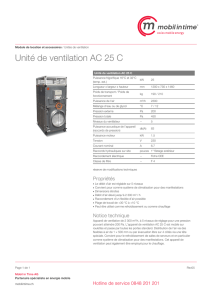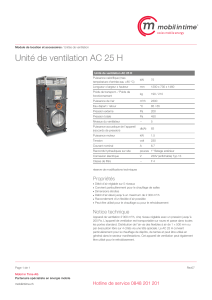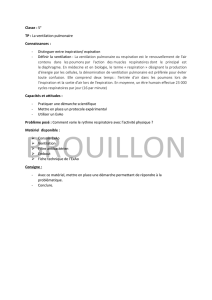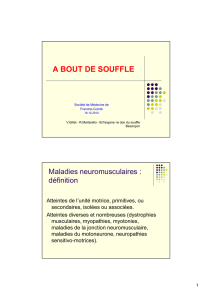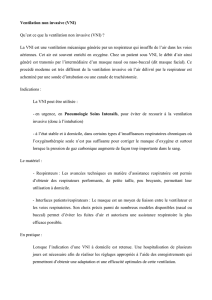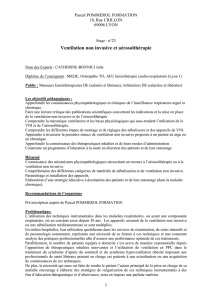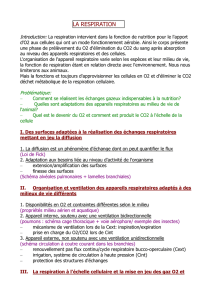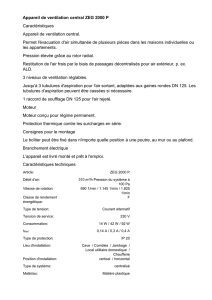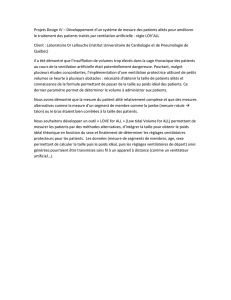Problèmes respiratoires chez les patients atteints de sclérose

RARE MAIS IMPORTANT Forum Med Suisse No39 26 septembre 2001 972
Introduction
Le groupe de travail pour la ventilation à do-
micile est une institution permanente de la
Ligue pulmonaire suisse et de la Société suisse
de pneumologie. Il a été fondé en 1985 par le
Dr Rodolphe de Haller, PD. En sa qualité d’an-
cien président de la Ligue pulmonaire suisse et
avec Rolf Sutter, directeur de la Fédération pour
les tâches communes des assureurs maladie
suisses (gestionnaire de la CLM = Caisse pour
les longues maladies), il a posé les bases pour
le financement de la ventilation à domicile. Au
début, celle-ci resta longtemps figée sur ses pré-
mices et sa condition de mise en œuvre était une
trachéotomie préalable; seuls les visionnaires
pouvaient à l’époque pressentir qu’en l’espace
de deux décennies elle allait devenir un des
traitements les plus florissants en médecine in-
terne. Le groupe de travail pour la ventilation à
domicile (dont le premier président fut le Dr
Jean-Claude Chevrolet) fixa des standards de
qualité, rédigea des lignes directrices [1] et
ses membres exercèrent la fonction de méde-
cin-conseil à l’égard de la CLM. La signification
pratique de cette mission réside encore aujour-
d’hui dans le fait que toute indication à une
ventilation à domicile doit être expertisée et
confirmée quant à sa conformité avec les lignes
directrices pour donner lieu à une prise en
charge financière par la CLM. En conséquence,
toute indication douteuse ou nouvelle est sou-
mise à l’expertise du groupe de travail qui en
discutera dans les détails avec le prescripteur.
En raison d’expériences problématiques vé-
cues dans divers centres suisses avec des pa-
tients atteints de sclérose latérale amyotro-
phique (SLA) ventilés à long terme, le groupe de
travail pour la ventilation s’est, dès sa fonda-
tion, penché à plusieurs reprises sur la ques-
tion de la ventilation à domicile de patients at-
teints de SLA. Ces dernières années, le nombre
de demandes de prise en charge des frais de
ventilation à domicile pour les patients atteints
de SLA a considérablement augmenté, raison
pour laquelle le thème «problèmes respira-
toires en relation avec la sclérose latérale
amyotrophique» a été mis prioritairement à
l’ordre du jour de l’assemblée annuelle 2000 à
Lucerne. Le but de cette discussion était de don-
ner en Suisse accès à une prise en charge opti-
male à nos patients atteints de SLA (environ 75
nouveaux cas chaque année). Le groupe de tra-
vail avait pour objectif d’introduire l’élément
qualité dans le traitement respiratoire palliatif
de cette maladie sévère et de garantir cette qua-
lité si possible sur toute l’étendue du territoire
helvétique. C’est dans cette optique que nous
publions ici sous forme résumée le procès ver-
bal des exposés et discussions de cette réunion.
La ventilation invasive au stade précoce de la
maladie lorsqu’un sevrage est encore ultérieu-
rement possible, par exemple dans le cadre
d’une pneumonie, n’est pas concernée par cette
prise de position.
Gestion du risque pulmonaire
Les patients atteints de SLA souffrent d’une fai-
blesse progressive de la musculature respira-
toire, dont les conséquences sont une dé-
faillance respiratoire mécanique et le décès à
l’occasion d’une pneumonie. Le groupe de tra-
vail s’est penché de manière itérative sur la
situation des patients atteints de SLA qui, en
Problèmes respiratoires
chez les patients atteints de
sclérose latérale amyotrophique:
options thérapeutiques
Le maladies neuromusculaires ont souvent besoin d’un «environnement» respiratoire
spécifique, particulièrement la sclérose laterale amyotrophique.
Prise de position du groupe de travail pour la ventilation à domicile.
A. Knoblauch, M. Gugger, R. Keller, S. Eychmüller, M. Baumberger, J.W. Fitting
et le groupe de travail pour la ventilation mécanique à domicileaLPS / SSPb
aF. Bacchetto, K. Bloch,
O. Brändli, J.-P. Janssens,
L. Junier, J. Nielsen, M. Pfister,
T. Rochat, M. Solèr, J. Wacker,
W. Karrer, J. Hammer, F. Michel,
M. Pons, W. Bauer.
bLigue pulmonaire suisse /
Société suisse de pneumologie.
Correspondance:
Dr A. Knoblauch
Pneumologie
Kantonsspital
CH-9007 St. Gallen

RARE MAIS IMPORTANT Forum Med Suisse No39 26 septembre 2001 973
raison d’une défaillance respiratoire, étaient
soumis à des procédés invasifs de ventilation en
urgence et ne purent plus être sevrés à cause
d’une progression de la maladie. L’intubation
pratiquée dans une situation d’urgence ne
laisse souvent pas le temps d’expliquer au pa-
tient qu’il est possible qu’un sevrage ne puisse
plus être réalisé par la suite. On peut dès lors
se trouver dans une situation de dépendance to-
tale à l’égard de l’appareil de ventilation et des
soins en rapport, pour une durée indéterminée
et sans que le patient lui-même ou ses proches
n’aient souhaités cette situation ni même ne
soient en mesure de l’influencer.
C’est pourquoi le groupe de travail recom-
mande au médecin traitant de discuter avec le
patient et ses proches du comportement à
adopter dans une telle situation et de le faire
prioritairement et au moment où il est encore
temps. Selon l’expérience des membres du
groupe de travail, lorsque les patients atteints
de SLA sont confrontés à la réalité qu’au stade
terminal de leur maladie parler, déglutir et res-
pirer n’est plus possible et que l’expression se
réduit à quelques mouvements infimes (p.ex.
avec les yeux), la majorité d’entre eux se déci-
dent nettement pour des mesures palliatives
sans ventilation invasive de nature à prolonger
la vie. Si le patient a été au préalable correcte-
ment instruit du pronostic de sa maladie, que
la situation décrite ci-dessus a pu être discutée
de manière approfondie et répétée avec lui et
que, conformément à sa décision éclairée, il a
été décidé, le cas échéant, de renoncer à une
ventilation invasive, on peut alors envisager
une mort digne et paisible. Une disposition
écrite du patient peut être d’une grande utilité
dans une telle situation.
Ci-dessous, nous discutons les possibilités de
traitement respiratoire préventif et palliatif, y
compris la ventilation non invasive. Puis nous
parlerons de la problématique inhérente à la
ventilation invasive à long terme chez les pa-
tients atteints de SLA.
Monitorage respiratoire
La mesure régulière des paramètres respira-
toires permet une surveillance adéquate de
l’évolution et de mettre en œuvre au bon mo-
ment les mesures préventives susceptibles
d’éviter certaines complications respiratoires.
Pour les patients atteints de SLA, il est pertinent
de mesurer les paramètres suivants:
Capacité vitale (CV): elle permet d’évaluer la
probabilité d’une hypercapnie. Le risque d’hy-
percapnie augmente dès que la CV chute en-
dessous de 60% de la valeur prédite et ce risque
est très élevé pour des valeurs de CV inférieures
au 30% de la valeur prédite. Lorsque la CV
chute en-dessous de 1,5 litre, l’inspiration ne
permet plus de générer un coup de toux efficace
et le moment est alors venu d’introduire des
techniques de toux assistée [2].
Capacité d’insufflation maximale: le volume
maximum qui peut être retenu glotte fermée
puis expiré après insufflation d’air par un bal-
lon Ambu ou un appareil de ventilation méca-
nique. En cas d’intégrité de la fonction bulbaire,
cette valeur peut rester élevée (2–3 litres) même
lorsque les valeurs de CV sont très basses en
raison d’une atteinte de la musculature respi-
ratoire. Une toux assistée efficace est alors pos-
sible [3].
Peak flow à la toux: le peak flow est mesuré
durant un coup de toux. Il faut un peak flow à
la toux non assistée de >160 L/min pour géné-
rer un coup de toux efficace. Les patients at-
teints de SLA qui, dans un état stable, ont une
valeur inférieure à 270 L/min courent le dan-
ger qu’à l’occasion d’une infection respiratoire
la valeur chute en-dessous de 160 L/min et de-
vraient donc être instruits aux techniques de
toux assistée [4].
Pressions respiratoires maximales (PE max
et PI max): la pression statique expiratoire
maximale (PE max) et la pression statique ins-
piratoire maximale (PI max) sont des indica-
teurs précoces de faiblesse de la musculature
respiratoire lorsque la CV est encore normale.
Tableau 1. Prophylaxie respiratoire
chez les patients atteints de SLA.
«Incentive spirometry» (p.ex. 10 fois matin et soir,
avec 1 minute de pause après chaque fois).
Insufflation mécanique jusqu’à la capacité pulmo-
naire totale par une tierce personne (p.ex. avec
ballon Ambu ou appareil de ventilation) [21],
p.ex. 2–3 fois par jour. Maintient une légère
compliance thoracique et pulmonaire.
Toux assistée:
«Air stacking» (emmagasinage d’air): inspira-
tions répétées sans expiration (fermeture de
la glotte). L’inspiration se fait spontanément,
par insufflation au moyen d’un ballon Ambu
ou par respiration glossopharyngienne [22,
23]. Appareillage d’assistance de la toux [24]
(p.ex. Emerson Cough-Assist-Insufflator-
Exsufflator).
Apprentissage de la respiration glosso-
pharyngienne (respiration de la grenouille).
Pression sur l’abdomen par une personne
auxiliaire.
Dispositif d’aspiration.
Vaccination anti-pneunococcique et contre la
grippe.

RARE MAIS IMPORTANT Forum Med Suisse No39 26 septembre 2001 974
Tableau 2. Mesures palliatives respiratoires en cas de sclérose latérale amyotrophique.
Sialorrhée
Bromure de butylscopolamine (Buscopan®) supp. à 10 mg une à plusieurs fois par jour. Administration s.c. aussi possible, une à plusieurs
fois par jour 1 ml à 20 mg, au maximum 100 mg/j.
Amitryptiline (Saroten®retard), caps. à 25 mg, 50 mg. 25 mg peuvent suffire, adapter la dose individuellement.
Trihexyphénidyle (Artane®), cp. à 2 mg, 5 mg. Apparenté à l’atropine mais avec moins d’effets indésirables. Dose initiale 1 mg.
Adapter la dose individuellement. Délire possible chez les personnes âgées.
Scopolamine (Scopoderm®TTS), 1 patch pour 3 jours (cave: avertir les patients que le médicament n’est pas utilisé ici contre le mal de voyage,
contrairement à l’indication du prospectus). Chez les patients âgés délire possible surtout si administration concomitante d’autres psycho-
leptiques. Dans ce cas, enlever le patch et antagoniser avec 1 mg de physostigmine i.v. ou s.c. Disponible dans les pharmacies avec relations
internationales ou auprès des pharmacies d’hôpitaux.
Chez des patients non atteints de SLA mais souffrant de sialorrhée médicamenteuse rebelle, on a pratiqué avec succès l’irradiation unilatérale
de la parotide (3–30 Gray en 3–10 fractions [25]).
L’injection de toxine botulinique dans les glandes salivaires peut réduire efficacement la production de salive pour une durée s’étendant
jusqu’à 6 mois [26–28].
Viscosité du mucus augmentée
Propranolol (Inderal®), metoprolol (Lopresor®ou Beloc®) [29]. Un titrage est nécessaire.
Dysphagie
Nourriture tendre; aspiration de nourriture en purée à travers un tuyau de diamètre convenable. Conseil et instruction dans le cadre d’une
consultation spécialisée.
La scopolamine (Scopoderm®TTS, cf. posologie supra), en supprimant la production de salive, restreint la fréquence du besoin de déglutir.
Sonde de gastrostomie mise en place par endoscopie percutanée [30]. Mise en place si possible tant que la capacité vitale est supérieure
à 50% de la valeur prédite. Elle empêche les fausses routes mais pas la pneumonie par aspiration. Si le risque de pneumonie par aspiration
doit être combattu ou si l’endoscopie révèle la présence d’une œsophagite: administrer par la sonde du cisapride (Prepulsid®) sous forme
de suspension 3 à 4 fois 5 à 10 mg (3 à 4 fois 5 à 10 ml) [31].
Aussi: nifédipine 10 mg, myotomie du muscle cricopharyngien; laryngectomie conservatrice [32]; diversion laryngée [33]
(trachéotomie plus anastomose de la trachée proximale avec l’œsophage).
Détresse respiratoire
Degré Mesures «Dosage»
1 Présence d’une personne permanente tant que la crise dure
2 Haut du corps surélevé en permanence tant que la crise dure
3 Ouvrir la fenêtre, oxygène 1 L/min si BPCO, sinon 2 L/min
4 Sulfate de morphine (morphine) sans traitement morphinique préalable: 5 mg s.c.
avec traitement morphinique préalable: 10 mg s.c., répéter toutes les 1–4 heures ou oralement
(les gouttes sont absorbées par la muqueuse buccale): morphine gouttes 2%.
sans traitement morphinique préalable: 10 mg = 10 gouttes
avec traitement morphinique préalable: 20 mg = 20 gouttes
remplacer successivement les gouttes par MST continus®ou Durogésic TTS®, ou
Sulfate de morphine (Sevedrol®) Supp. à 10 mg ou supp. à 20 mg
5 Lorazepam (Temesta®expidet) 1 à 2,5 mg sublingual ou
Midazolam (Dormicum®) 2,5 mg s.c. ou 1–2,5 mg i.v. lentement. En phase terminale: induire le sommeil par bolus de mida-
zolam 1 mg i.v. toutes les 10 min jusqu’à ce que le patient dorme, puis maintenir le sommeil par
perfusion de midazolam 25 mg dans 250 ml NaCl 0,9%. Vitesse de perfusion: commencer par 1 mg/h
(10 ml/h de solution de perfusion) et augmenter de sorte que le sommeil soit maintenu.
Si désiré, laisser des phases de réveil (p.ex. interrompre la perfusion 2–3 heures avant une visite,
etc.). Intracath. à demeure.
Rire / pleurs irrépressibles
Amitryptiline (Saroten®) 25–75 mg pour la nuit.
Levodopa (Madopar®), tinazidine (Sirdalud®).
Dysarthrie
Entraînement logopédique. Assistance électronique à la communication.
Modifié selon Sieb JP, Jerusalem F, Fresmann J: Symptomatische Therapie bei amyotropher Lateralsklerose. Dtsch med Wschr 1987;112:769–72.

RARE MAIS IMPORTANT Forum Med Suisse No39 26 septembre 2001 975
La méthode n’est pas applicable au stade
avancé de la maladie, à savoir lorsque l’embout
buccal ne peut plus être pincé assez efficace-
ment pour garantir l’imperméabilité à l’air. La
pression nasale inspiratoire lors d’un renifle-
ment (Sniff Nasal Inspiratory Pressure «SNIP»)
est un marqueur plus sensible de la faiblesse
des muscles respiratoires; elle peut être mesu-
rée aussi bien au stade précoce que tardif de la
maladie car sa fiabilité ne dépend pas de l’effi-
cacité de la pince labiale [5].
Gaz sanguins: la saturation en oxygène (SaO2)
mesurée par pulsoxymétrie et, pour autant que
l’appareil soit à disposition, la mesure de la
PCO2en fin d’expiration (PetCO2) devraient être
régulièrement mesurées et d’éventuels résul-
tats anormaux confirmés par une gazométrie
artérielle [2].
Pulsoxymétrie nocturne: on recommande de
la mesurer régulièrement, par exemple 6 fois
par mois en cas de CV <60%, en cas de symp-
tômes d’hypoventilation ou d’hypoxémie
diurne, respectivement d’hypercapnie diurne
[2, 4].
Mesures respiratoires
préventives
Les mesures préventives visent à la mobilisa-
tion des sécrétions et au maintien de la com-
pliance thoracique et respiratoire (tabl. 1). La
physiothérapie respiratoire est prioritaire et la
prise en charge devrait débuter très tôt, par
exemple sitôt le diagnostic établi.
Traitement palliatif (à l’exclusion
de la ventilation) (tabl. 2)
Etant donné que les troubles respiratoires [6],
surtout les états de détresse respiratoire sont
fréquents en cas de SLA, de nombreux patients
vivent avec la constante angoisse d’une suffo-
cation terminale. Cette peur ne se justifie pas.
Les fausses routes à la déglutition en raison de
troubles neurologiques bulbaires peuvent être
empêchées, au début par des mesures conser-
vatrices telles qu’un training spécifique et une
préparation correcte de la nourriture, et plus
tard par l’installation en temps voulu d’une
sonde de gastrostomie percutanée endosco-
pique.
Mais plus important est de savoir que le décès
du patient atteint de SLA n’est pas un événe-
ment dramatique empreint d’angoisse de la
mort et d’une panique d’étouffer. En fait et
selon l’expérience acquise par l’observation de
nombreux patients atteints de SLA, le décès
survient rapidement, paisiblement et sans sen-
sation d’étouffement. Il est d’une importance
capitale d’informer les patients de cette consta-
tation maintes fois répétée. L’expérience du «St.
Christopher Hospice» à Londres livre à ce sujet
des informations très précieuses [10]. Des 124
patients atteints de SLA inclus dans l’étude de
suivi, 106 (94%) décédèrent paisiblement3; la
médication principale consista en opiacés (en
moyenne 30 mg d’équivalent sulfate de mor-
phine par jour) pour 101 patients (89%); 72
(64%) patients reçurent de la phénothiazine, 75
(66%) des anticholinergiques et 68 (60%) des
benzodiazépines. Le décès survint pratique-
ment toujours rapidement (en l’espace
d’heures ou de quelques jours) par arrêt respi-
ratoire. Les auteurs notent (avec pertinence):
«Il n’est pas rare que les patients soient enva-
his d’une angoisse qui repose essentiellement
sur une information inadéquate ou trompeuse
concernant en général les circonstances de leur
décès. Le tableau clinique le plus typique pré-
cédant la mort est celui d’une soudaine et ra-
pide détérioration due à une défaillance respi-
ratoire … En fait, aucun patient de ce collectif
n’est décédé d’étouffement. Le terme ‹étouffe-
ment› … doit être définitivement abandonné4.»
Selon l’expérience de ces confrères anglais, la
détresse respiratoire, les douleurs et les
troubles du sommeil répondent très bien aux
opiacés qui devraient donc être administrés en
fonction des symptômes et non pas être tenus
en réserve pour les stades tardifs: «L’usage ju-
dicieux des opiacés garantit une palliation im-
peccable à chaque stade de la maladie, sans in-
fluencer ni l’évolution ni la durée de vie» [14].
D’ailleurs, l’éditorial qui accompagne la publi-
cation contient l’affirmation (confirmée dans
la publication): «L’administration généreuse
d’opiacés est efficace et n’entraîne sûrement
aucune dépendance» [7]. L’affirmation que
dans cette situation la morphine n’entraîne pas
de dépendance s’appuie notamment sur l’ob-
servation que l’augmentation des doses d’opia-
cés administrées dès le stade précoce de la ma-
ladie ne s’avéra jamais nécessaire en raison
d’un développement d’une dépendance, mais
que le dosage se calquait au contraire typique-
ment sur la symptomatologie.
La connaissance de la possibilité d’une ventila-
tion palliative non invasive telle qu’elle est de
plus en plus souvent mise en œuvre aujourd’hui
a pour conséquence qu’au sein du Corps médi-
cal, on pense facilement qu’il s’agit là de la pre-
mière mesure à envisager pour soulager la
souffrance. Pour la qualité de vie des patients
atteints de SLA, il est pourtant décisif que leurs
médecins traitants connaissent et envisagent
au contraire toute la palette des mesures pal-
liatives, indépendamment du fait que le plan de
traitement introduise ou non la ventilation non
invasive (tabl. 2).
3“We’re settled during this dying
phase”
4“Not infrequently, patients have
anxieties based on inaccurate
and misleading information,
usually concerning the mode
of death. The most typical
clinical picture preceeding
death is one of a sudden and
rapid deterioration due to
respiratory failure ... No Patient
in this series chocked to death.
The term chocking ... must be
abandoned.”

RARE MAIS IMPORTANT Forum Med Suisse No39 26 septembre 2001 976
Ventilation non invasive
et invasive
La ventilation non invasive constitue aujour-
d’hui un traitement palliatif bien établi des
troubles en relation avec la SLA. Elle permet
d’améliorer la qualité du sommeil, de diminuer
la dyspnée et d’écarter les épisodes d’hypoven-
tilation à tendance nocturne au début, puis
aussi à l’état de veille. Il n’existe actuellement
aucune indication valable concernant le
meilleur moment pour la mise en œuvre d’une
ventilation non invasive. On se guidera en fait
sur l’importance des symptômes tels qu’une
mauvaise qualité de sommeil avec agitation
et cauchemars, fatigue diurne, somnolence
diurne excessive et maux de tête. Il est impor-
tant de garder à l’esprit qu’une insuffisance
partielle constatée à l’analyse des gaz sanguins
ou une désaturation nocturne à la pulsoxymé-
trie sont le signe d’une ventilation insuffisante
et ne doivent donc pas être traitées en premier
par l’administration d’oxygène. La ventilation
non invasive peut aussi être instituée précoce-
ment (p.ex. suite à une première bronchite in-
fectieuse) à titre de traitement préventif contre
les infections des voies respiratoires; elle favo-
rise en outre le sommeil en décubitus en cas
d’atteinte prédominante du diaphragme. Les
études les plus récentes semblent indiquer que
la ventilation non invasive allonge la vie des pa-
tients atteints de SLA sans en modifier pourtant
l’issue fatale [8, 9].
Les membres du groupe de travail sont
convaincus qu’à condition d’une sélection adé-
quate, la ventilation non invasive peut amélio-
rer la qualité de vie des patients. En cas d’at-
teinte bulbaire, la ventilation non invasive n’est
pourtant souvent pas possible. Le groupe de
travail est d’avis que l’indication et l’instruction
à une ventilation non invasive doivent impéra-
tivement être données dans le cadre d’une hos-
pitalisation dans un centre qui possède l’expé-
rience de tout le spectre des mesures pallia-
tives, aussi bien neurologiques que respira-
toires. Si cela n’a pas déjà été fait il faut, dans
le cadre de cette hospitalisation, insister sur la
nature palliative de la ventilation. Cela signifie
que le patient et tous les intervenants doivent
être parfaitement conscients que cette forme de
ventilation peut à un moment donné s’avérer
inopérante et qu’il faut alors passer à un autre
traitement, en règle générale une palliation mé-
dicamenteuse, par exemple la morphine.
La ventilation mécanique invasive par tra-
chéostomie permet de vivre au-delà de la dé-
faillance respiratoire terminale, empêche la
broncho-aspiration et facilite l’évacuation des
sécrétions. Le patient qui désire la mise en
œuvre d’un tel moyen doit être dûment informé
qu’il deviendra tétraplégique, qu’il ne peut ni
déglutir ni parler ni se mouvoir en dépit du fait
que la motilité oculaire peut fréquemment en-
core être préservée durant quelques années. Le
patient entre dans une situation de locked-in en
dépit d’une présence d’esprit absolue et il est
complètement dépendant des soins, de l’inté-
grité de fonctionnement de l’appareil de respi-
ration artificielle et du dégagement des voies
respiratoires. Certains systèmes électroniques
peuvent dans certains cas rendre une commu-
nication lente possible. En 1993, Moss [10] a
rapporté que dans la partie nord de l’Illinois,
sur 335 patients atteints de SLA, 19 (5,4%) ont
été ventilés de manière invasive. Ceux-ci né-
cessitaient chacun en moyenne journalière
neuf heures de soins prodigués par les
membres de leur famille ainsi que 15 heures
supplémentaires de soins prodigués par du per-
sonnel soignant externe. Il fallait 3,5 soignants
par patient. Les coûts s’élevaient à $ 153000 et
même jusqu’à $ 366 000 par année, selon que
les patients étaient soignés à domicile ou dans
une institution. L’expérience a par ailleurs
montré que l’équipe soignante au service de ces
patients subit de rapides changements. Une en-
quête nord-américaine sur les patients atteints
de SLA au bénéfice d’une ventilation invasive à
long terme a certes montré que 88% se ré-
jouissent d’être en vie et que 80% se décide-
raient à nouveau pour une telle mesure [11].
A l’Hôpital cantonal de Genève, sous la déno-
mination «VINCRE» (Ventilation à domicile des
Insuffisants Neuromusculaires Chroniques
Respiratoires Evaluation), on a institué une
commission dont la tâche est de conseiller les
médecins qui prennent en charge des patients
atteints de maladie neuromusculaire avec pro-
blèmes respiratoires. Ce groupe, constitué de
professionnels possédant une expérience spé-
cifique de la prise en charge des patients ven-
tilés à domicile a rédigé, suite à un important
travail de réflexion préliminaire, une prise de
position interne dans le but de pouvoir, sur la
base d’un concept reflétant le consensus des
personnes concernées, réagir aux questions
relatives au sujet «ventilation invasive via tra-
chéostomie en cas de SLA et autres maladies
neuromusculaires» [12]. VINCRE recommande
que l’orientation des patients sur la possibilité
de ventilation invasive s’accompagne automa-
tiquement d’une information adéquate sur les
importants problèmes liés à cette mesure thé-
rapeutique. Si le patient envisage une ventila-
tion invasive, il s’agit d’examiner soigneuse-
ment si le patient lui-même et son entourage,
c’est-à-dire en général sa famille, disposent des
ressources humaines nécessaires pour assu-
mer une pareille charge à long terme, proba-
blement des années durant et si des structures
de prise en charge adéquate sont disponibles
(famille?, domicile?, équipe de soins?, centre
spécialisé?). Ce n’est que lorsque ces assises
sont acquises qu’il faut alors prendre avec le pa-
 6
6
 7
7
1
/
7
100%