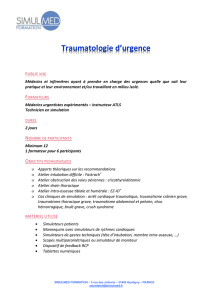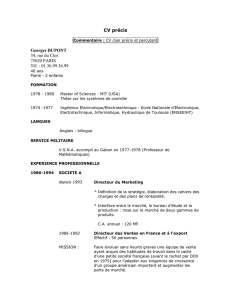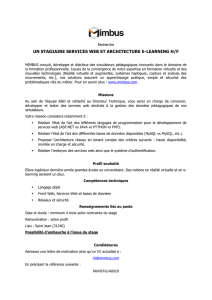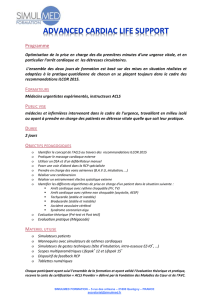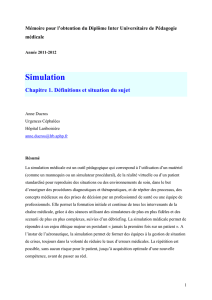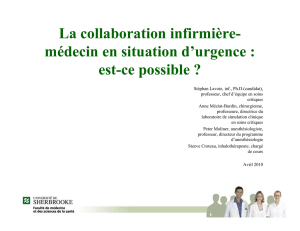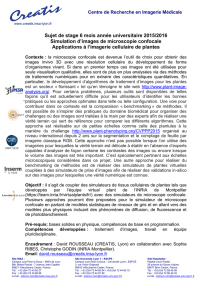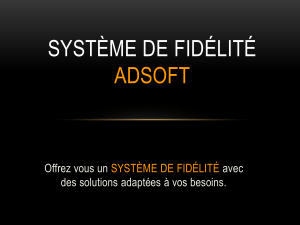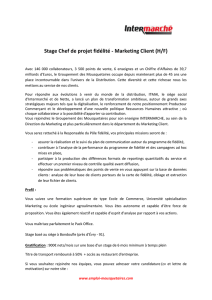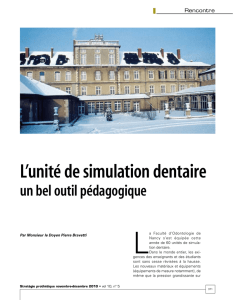La Simulation : Pour quelles compétences

1
La Simulation : Pour quelles compétences ?
I - Place de la simulation en obstétrique
I.a - Existant
Dans les écoles de sages-femmes différentes techniques pédagogiques sont mises
en place pour donner aux étudiants les moyens d’acquérir un savoir théorique et
pratique mais également la faculté de pouvoir les mobiliser en situation réelle en
sachant faire les liens entre la théorie et la pratique.
L’enseignement effectué est constitué par de cours magistraux permettant acquérir
les notions fondamentales et par d’autres supports en fonction des compétences
recherchées :
Tableau 1 : types d’enseignement par compétences
Types de compétences
Enseignements proposés
Aptitude à la relation
Jeux de rôles, études de cas, de dossiers
Aptitude technique
Matériel basse fidélité (bras, tête à intuber,
peau pour sutures)
Aptitude pratique
Atelier de Raisonnement Clinique / travaux
dirigés
Les étudiants ont, dès le début de leur cursus, des stages dans les différents
secteurs en lien avec la maïeutique ; les professionnels de terrain les encadrent et
évaluent leurs aptitudes personnelles à la relation à l’autre et leurs capacités
techniques et pratiques. Ils bénéficient d’accompagnements individuels dans les
différentes unités consistant à prendre en charge une patiente pendant une demi-
journée sous la supervision de l’enseignant sage-femme.
L’expérience clinique lors des stages hospitaliers ne sera pas identique pour tous les
étudiants. Chaque étudiant est unique avec son propre mécanisme d’apprentissage,
ses différents acquis, ses points forts et ses vulnérabilités. Durant les quatre années
de formation au sein des écoles après la PACES, certains seront insuffisamment
confrontés aux situations rares pouvant engager le pronostic vital maternel et/ou
fœtal ; d’où l’intérêt des situations simulées pendant les phases d’apprentissage.

2
I.b - Place de la simulation
La simulation constitue un entraînement en temps réel ou l’étudiant mobilise les
connaissances acquissent en cours théoriques dans le but d’améliorer ses
compétentes techniques (acquisition et mise en pratique des connaissances,
application d’algorithmes et de protocoles, pratique de gestes techniques) et non
techniques (raisonnement diagnostique, comportement en équipe, leadership et
rôles, communication, utilisations des ressources (1,2). Il existe différents types de
simulations, en voici les principales :
I.c - Différents types de simulation
I.c.1 - La simulation avec acteur ou patient standardisé ou simulé
Développement de compétences en matière de communication : consultation
d’annonce notamment en cancérologie, découverte de malformations fœtales, de
mort in utero ou bien information complexe à donner à un patient….
I.c.2 - La simulation basse fidélité ou hybride : améliorer la dextérité en toute
sécurité
Apprentissage par la répétition : l’étudiant peut s’entraîner à améliorer sa
dextérité sur des gestes techniques en toute sécurité et de façon répétitive, sans
risque pour le patient : injections, prises de sang….
Gestes opératoires : techniques des sutures, pose de dispositifs intra utérin,
d’implant contraceptif…
Gestes de réanimation : aspiration, ventilation, intubation, pose d’un
cathétérisme ombilical
Gestes cliniques : palpation des seins, toucher vaginal, examen clinique du
bassin obstétrical, accouchement, délivrance artificielle, révision utérine…..
Reproduction de situations interventionnelles de haute technicité comme les
simulateurs d’angiographie, bronchoscopie…
Dans tous ces gestes l’étudiant peut sans stress s’entraîner jusqu’à acquérir une
technique la plus parfaite possible.

3
Tous ces gestes sont réalisés une première fois avec du matériel appelé « basse
fidélité. » L’objectif est à la fois qualitatif et sécuritaire « jamais la première fois sur le
patient . »
I.c.3 - La simulation haute fidélité : réalité des situations complexes
Des mannequins grandeurs natures pilotés par informatique, permettent de se
retrouver dans des situations cliniques proche de la réalité. La mise en scène
combine à la fois les soins et les situations critiques.
Les séances de simulation sont construites de façon à mettre en immersion des
étudiants ou des professionnels dans un milieu qui se veut fidèle en termes
d’environnement, d’équipement ainsi qu’une fidélité psychologique des situations (3).
En obstétrique certaines situations rares mettent en jeu le pronostic vital maternel
et/ou fœtal parmi elles on peut citer l’hémorragie du post-partum à l’origine d’une
morbi-mortalité élevée, la pré éclampsie sévère, la dystocie des épaules, l’embolie
amniotique, la réanimation néonatale. Ces situations sont sources de stress, de
tension, de désorganisation, rendant la prise en charge des patientes non optimale.
Dans le milieu médical, la situation de crise peut être définie comme une phase
d’aggravation qui requiert une gestion rapide, efficace et coordonnée (1).
I.d - Exemples de scénarios : des plus simples à des situations
complexes
I.d.1 - Technique de l’accouchement
Une étude réalisée au sein des maternités de Port Royal et Saint Vincent de Paul a
démontré l’intérêt pédagogique de la formation à l’accouchement normal à l’aide de
mannequins associée à la formation classique. Cette étude a été réalisée auprès de
deux groupes d’externes. Ceux qui avaient bénéficié d’un apprentissage auprès de
mannequin étaient significativement plus aptes à réaliser les manœuvres en cas
d’accouchement normal comparativement aux externes ayant eu uniquement la
formation habituelle c’est à dire l’enseignement par cours théoriques et directement
auprès des patientes en salle de naissance (4).

4
I.d.2 - Prise en charge de l’hémorragie du post partum
L’hémorragie du post partum est une situation ou la prise en charge doit être
multidisciplinaire (obstétriciens, sages-femmes, anesthésistes, infirmières…..) Elle
doit être parfaitement coordonnée. La défaillance de l’un peut agir par effet domino
sur les autres acteurs de la prise en charge. Les exercices de simulation permettent
de tester la réactivité de chacun et de constater les difficultés existantes (5).
T.Bouin, enseignant à l’école de sages-femmes de Nancy, fait part de son
expérience dans l’utilisation de la simulation médicale hautes technologies lors de la
formation des étudiants sages-femmes.
Mise en scène d’une situation type « hémorragie du post partum », avec un
mannequin Laerdal « SimMon® », ce simulateur contient des scénarios pré
programmés qui peuvent être modifiés ou modulés en fonction des objectifs
pédagogiques individuels et collectifs à atteindre. Dans cette expérience les
étudiants évoluent en binôme, les séances sont filmées, les autres étudiants
observent la scène dans une salle adjacente. Le débriefing de l’ensemble du groupe
se fait en visionnant les images enregistrées et en analysant la situation. Il en ressort
des points négatifs par exemple :
Retard à la prise en charge, délai d’appel trop tardif
Coordination des binômes et leadership encore hésitant
Mais également des points positifs par exemple le fait que tous les étudiants aient
pensé à réaliser un geste adapté (délivrance artificielle) alors que deux tiers d’entre
eux n’en avaient jamais réalisé lors des stages (6).
Ce débriefing est un temps essentiel, il permet de visualiser ses propres erreurs et
celles des autres, permet la réflexion et augmente les acquis. L’étudiant doit passer
par une alternance essais/erreurs et action/réflexion (6,7).
Dans son mémoire AS Souchet démontre l’intérêt d’un atelier pratique avec
mannequin auprès des étudiantes sages-femmes de 4ème année, dans la prise en
charge de l’hémorragie du post partum. Son étude a pour objectif de déterminer les
facteurs favorisant une meilleure assimilation du savoir dans ce domaine. Trois
groupes ont été constituées : (G1 = atelier pratique avec mannequin, rappel

5
théorique et initiation à la révision utérine / G2 = initiation à la révision utérine / G3 =
stage et connaissances théoriques).
Des questionnaires ont été distribués 1 mois et 2 mois après l’atelier; les résultats
démontrent une meilleure assimilation du groupe G1. Néanmoins la moyenne de
bonnes réponses diminue entre le premier et le deuxième questionnaire. Il serait
donc nécessaire de réaliser des réactivations régulières des connaissances (8).
I.e - Focus sur le travail d’équipe
Le centre d’enseignement des soins d’urgences de Montpellier (Cesu) dirigé par le
Docteur Debien, met en place une formation aux gestes et soins d’urgence en salle
de naissance. Elle regroupe différents professionnels : sages-femmes, infirmières
puéricultrices, médecins urgentistes et pédiatres. Les apprenants après un rappel
théorique passent par divers ateliers mannequins « basse et haute fidélité. » Il
ressort qu’en plus des compétences techniques la simulation permet d’explorer les
compétences psychoaffectives, comment communiquer, comment valoriser l’autre
pour donner le meilleur de soi-même. La formation s’avère très positive (9).
Pour le Docteur Debien la simulation permet d’explorer un ensemble de
compétences : procédurales, réflexives, cognitives, psychomotrices, psycho
affectives.
L’apprentissage par l’erreur reste terriblement efficace.
II - Place de la simulation en chirurgie
Pendant longtemps, l’apprentissage de la chirurgie a été réalisé par un
compagnonnage entre un chirurgien expérimenté et son étudiant. Cette pratique était
relativement bien adaptée à la chirurgie ouverte. Cependant, nos maîtres, il y a déjà
quelques décennies, demandaient à leurs étudiants de s’entrainer à des gestes de
bases, telle que la réalisation de nœuds sur un barreau de chaise ou au fond d'un
chapeau. C’était sans doute le début de la simulation.
Au cours des deux dernières décennies, les techniques ont évolué vers des
chirurgies dites mini invasives : endoscopiques, coelioscopiques, robotiques. Ces
techniques permettent une réduction de la morbidité péri opératoire, de la durée
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%