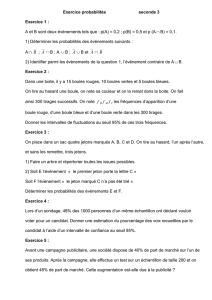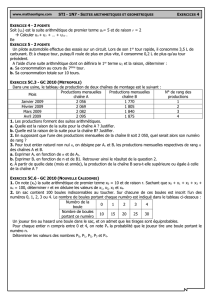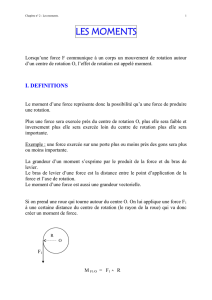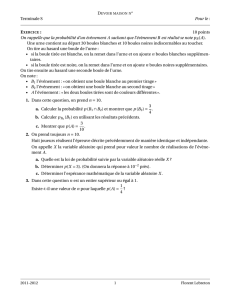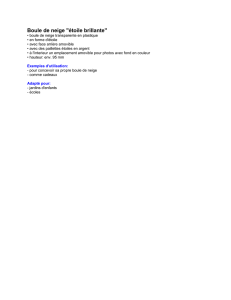L`ARPENTEUR DU WEB : NOTION DE QUANTITÉ DE

L’ARPENTEUR DU WEB
QUANTITÉ DE MOUVEMENT GUY BOUYRIE
1
L’ARPENTEUR DU WEB : NOTION DE QUANTITÉ DE MOUVEMENT
Force vive, quantité de mouvement, énergie cinétique, impulsion, percussion : la physique s’est enrichie
de concepts qu’il n’a pas été facile de démêler tout au long de son histoire ! Nos programmes de lycée
introduisent certains d’entre eux, mais pas toujours là où on les attendrait, comme celui de quantité de
mouvement en terminale S. Incontestablement, la lecture que l’on peut en faire avec nos élèves s’avère
difficile. Par sa grande richesse documentaire, Internet peut nous aider à montrer comment ces concepts ont
pu émerger historiquement ; et certains dispositifs « expérimentaux » comme le billard, ont été de puissants
outils conceptuels pour appréhender certaines de ces grandeurs. Si aucun lycée ne peut actuellement s’offrir
une caméra numérique rapide la seule capable d’analyser ces processus complexes que sont les chocs et
percussions, il est possible de trouver sur le Web de magnifiques vidéos qui seront un support pédagogique
inestimable pour le professeur.
1. VERS LA NOTION DE QUANTITÉ DE MOUVEMENT : CONSERVATION DU MOUVEMENT
Pour DESCARTES, la question du « mouvement » est centrale au point de constituer un des fondements de
ses « Principes philosophiques » publiés en 1644. Contrairement à ses prédécesseurs héritiers d’ARISTOTE,
pour DESCARTES, le repos ou le mouvement ne sont que des états d’un système pour lequel la seule propriété
intrinsèque est son « inertie », un terme qui fut d’ailleurs introduit par KEPLER pour désigner cette capacité
d’un corps à s’opposer de lui-même à toute modification de son état de mouvement ou de son état de repos.
On lira avec intérêt ce bel article émanant de l’Université de Lille, par Sébastien VISCARDY « Sciences du
mouvement de DESCARTES et NEWTON : entre rupture et continuité ».
http://www.bascoe.oma.be/sviscardy/docs/Viscardy_Sciences_mouvement_Descartes_Newton.pdf
Extraits :
Dans la physique aristotélicienne, mouvement et repos s’opposent comme la lumière et les ténèbres : le
premier est un processus, le deuxième un état. DESCARTES rompt radicalement avec cette conception du
mouvement. Le mouvement n’est plus un processus maintenu par une cause – les qualités du corps – et par
lequel un corps rejoint son lieu naturel par un mouvement naturel ou s’en éloigne par un mouvement
violent ; il est un état au même titre que le repos : « que le mouvement & le repos ne sont rien que deux
diverses façons dans le corps où ils se trouvent. [...] un corps est autrement disposé, lors qu’il est transporté,
que lors qu’il ne l’est pas. [...]Que Dieu est la première cause du mouvement, & qu’il en conserve toujours
une égale quantité en l’univers. [...] puis qu’il a mu en plusieurs façons différentes les parties de la matière,
lors qu’il les crée, & qu’il les maintient toutes en la même façon & avec les mêmes lois qu’il leur a fait
observer en leur création, il conserve incessamment en cette matière une égale quantité de mouvement ».
Cette « quantité de mouvement » est donc définie par ce qui caractérise les deux pôles de sa philosophie
mécanique, que sont la matière-étendue et le mouvement, à savoir le produit de l’extension d’un corps par sa
vitesse.
DESCARTES énonce alors trois lois :
Première loi de la nature : « que chaque chose demeure en l’état qu’elle est, pendant que rien ne le change ».
Deuxième loi de la nature : « que tout corps qui se meut, tend à continuer son mouvement en ligne droite ».
Troisième loi de la nature : « si un corps qui se meut en rencontre un autre plus fort que soi, il ne perd rien
de son mouvement, & s’il en rencontre un plus faible qu’il puisse mouvoir, il en perd autant qu’il lui en
donne »
Ce troisième énoncé amène DESCARTES à formuler des règles d’impact entre deux corps qui s’avèreront
inexactes : il faudra attendre les travaux de HUYGENS pour qu’elles soient corrigées.
En effet, DESCARTES estime que lorsqu’un corps léger heurte un corps dur beaucoup plus massif, ce dernier
ne prélève pas de quantité de mouvement, ce qui n’est qu’approximativement vrai. D’autre part, DESCARTES
a des difficultés réelles à interpréter les interactions entre un corps en mouvement et les particules
constitutives du milieu de son environnement, dès lors que ce milieu est « fluide » au point de ne pas opposer
de résistance, ou au contraire dès qu’il s’avère plus compact.
2. CHOCS ET CONSERVATION DE LA QUANTITÉ DE MOUVEMENT : MODÈLE DU BILLARD
Qui d’entre nous n’a pas joué ou regardé jouer au billard ? C’est en observant des collisions sur les tables
de ce jeu populaire que, historiquement, l’idée de la conservation de la quantité de mouvement a été bâtie par
Isaac BEECKMAN, puis René DESCARTES lui-même.
Et le billard est devenu un outil extraordinaire pour des expériences de pensée, imaginées tant par les
physiciens que par les mathématiciens

L’ARPENTEUR DU WEB
QUANTITÉ DE MOUVEMENT GUY BOUYRIE
2
Ainsi, pour suivre l’actualité, le prix Abel 2014 de
mathématiques a été décerné au mathématicien Yakov SINAÏ.
Ses travaux sur les systèmes déterministes d’une part, et
probabilistes d’autre part, ont puisé une bonne partie de leur
inspiration dans ces expériences diaboliques de pensée qui font
appel au billard !
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-yakov-sinai-prix-abel-
2014-32793.php
Pour nos élèves, c’est sans doute le dispositif le plus simple
pour présenter la notion de quantité de mouvement et énoncer
les lois de conservation correspondantes.
Mais quelles sont ces grandeurs qui sont conservées ?
Les physiciens ont eu beaucoup de mal à démêler les grandeurs
utiles pour rendre compte des chocs entre boules de billard.
Quantité de mouvement ? Action ? Force vive ?
Le chemin a été difficile avant d’être capable de formuler ces
lois que nous présentons de manière si succincte et brutale à
nos élèves de terminale S !
Nous allons évoquer leur difficile gestation avant de rencontrer
des cas d’école qu’Internet est à même d’illustrer de façon
extrêmement probante.
2.1. Force vive ou quantité de mouvement ?
LEIBNIZ critiqua de façon virulente les « axiomes » énoncés par les cartésiens qui portent sur la loi de
conservation de la quantité de mouvement à l’issue de chocs entre boules de billard.
Ainsi, en 1686, il écrivit un mémoire paru à Leipzig dans « Acta Eruditorum » dont le titre mérite d’être
reproduit en entier : « Démonstration courte d’une erreur considérable de M. DESCARTES et de quelques
autres touchant une loi de la nature selon laquelle ils soutiennent que Dieu conserve dans la matière la
même quantité de mouvement, de quoi ils abusent dans la mécanique ».
Pour DESCARTES, la quantité de mouvement se mesure grosso modo en multipliant la masse d’un corps par
sa vitesse (la notion de masse est complexe chez DESCARTES et diffère de celle à laquelle on est habitué).
Ainsi, les lois du choc de DESCARTES sont déduites à partir de la thèse de la conservation de la quantité de
mouvement. Pour LEIBNIZ, DESCARTES se trompe. Il y a bien quelque chose qui doit être conservé dans la
Nature et qu’on peut désigner conventionnellement du nom de “Force”, et dont la conservation même suffit
comme base pour construire les lois de la physique. Une fois ce vocabulaire accepté, la thèse de DESCARTES
consiste à dire que la force, en ce sens là, c’est la quantité de mouvement. Cependant, LEIBNIZ pense que
c’est faux. En particulier, pour le cas simple du choc de deux éléments de matière, ce n’est pas la quantité de
mouvement qui se conserve, mais une autre grandeur, que LEIBNIZ nomme « force vive », et qui se calcule en
multipliant la masse par le carré de la vitesse.
Cette force vive est une grandeur proportionnelle à celle que l’on désigne maintenant comme « énergie
cinétique ».
Lire :
http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/profplus/publica/bulletin/bull18/descartes_leibniz.htm
et aussi, ce remarquable résumé écrit par M. Julien BERNARD (UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE) duquel nous
avons tiré certaines des informations indiquées ci-dessus.
http://www.philo-bernard.fr/images/QFV/QFV_R%C3%A9sum%C3%A9.pdf
Il revient ensuite à HUYGENS d’avoir corrigé certaines des affirmations erronées de Descartes, telles
celles-ci : « Lorsqu’un corps B percute un corps C “plus fort” et au repos, il rebondit en conservant son
mouvement initial (sa vitesse) tout en laissant C au repos (règle 4). À l’inverse, lorsque B est initialement au
repos et C en mouvement, ce dernier entraîne B (le “plus faible”) après l’impact (règle 5) » ; pour cela, il lui
a fallu établir de façon solide des règles portant sur la composition des vitesses et la relativité du mouvement,
notions que DESCARTES ne maîtrisait pas (pour lui, le mouvement d’un corps se réduit à son déplacement par
rapport à ceux qui lui sont adjacents et non pas par rapport à un corps de référence).
Figure 1 : le billard, une source d’inspiration
inépuisable pour les scientifiques.
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-
yakov-sinai-prix-abel-2014-32793.php

L’ARPENTEUR DU WEB
QUANTITÉ DE MOUVEMENT GUY BOUYRIE
3
HUYGENS, avec des propos plus mesurés que ceux de LEIBNIZ, considère la loi de conservation de la « force
vive » comme seule habilitée à rendre compte des effets observés à l’issue de chocs entre boules de billard.
L’intégralité des œuvres de HUYGENS est disponible sur le WEB :
https://www.irphe.fr/~clanet/otherpaperfile/articles/Huygens/N0077868_PDF_1_700.pdf
Ce qui nous intéresse ici est à la page 164 du livre numérisé, soit aussi la page 167 du document PDF
correspondant.
Remarquons que HUYGENS a fait cette constatation essentielle que pour le système « isolé » constitué de
deux boules de billard, le mouvement du centre d’inertie du système, avant et après le choc, est rectiligne et
uniforme.
Pour revenir aux objections virulentes effectuées par LEIBNIZ contre les cartésiens, POINCARÉ a fait
remarquer que, maintenant que nous connaissons les vraies lois des chocs entre boules de billards, nous
pouvons nous rendre compte de ce qui était défectueux dans la conception cartésienne des lois du choc et
nous pouvons comprendre pourquoi LEIBNIZ avait raison.
La force vive (aujourd’hui : énergie cinétique) est bien conservée lors du choc élastique entre deux corps (ou
en général dans tout système isolé). En revanche, la quantité de mouvement telle que la comprenait
Descartes (m v), où la notion de vitesse était une grandeur scalaire, ne se conserve pas en général.
En revanche, ce qui est conservé, c’est la quantité de mouvement telle qu’on la concevra plus tard, après les
travaux de NEWTON, c’est-à-dire le produit de la masse par la vitesse, mais où la vitesse est cette fois conçue
comme une grandeur vectorielle. D’ailleurs, LEIBNIZ le savait. Même s’il ne possède pas à proprement parler
la notion de vecteur, il sait qu’il faut projeter la vitesse selon trois axes orthogonaux et qu’il faut orienter
cette vitesse en prenant des composantes aussi bien positives que négatives, pour obtenir la véritable loi de
conservation de la quantité du mouvement. Seule la loi de conservation “vectorielle” de la quantité de
mouvement est compatible avec la loi de conservation de la force vive (énergie cinétique).
Et comme le suggérait LEIBNIZ, de la « conservation de la force vive » peut découler la « conservation de la
quantité de mouvement ».
Figure 2 : HUYGENS et la quantité de mouvement
https://www.irphe.fr/~clanet/otherpaperfile/articles/Huygens/N0077868_PDF_1_700.pdf

L’ARPENTEUR DU WEB
QUANTITÉ DE MOUVEMENT GUY BOUYRIE
4
Le document ci-dessous traduit, en termes modernes, ce travail de LEIBNIZ.
Nous avons alors les outils conceptuels pour rendre compte des observations élémentaires que tout joueur de
billard peut être amené à réaliser. Nous ne débattrons pas ici des raisons qui ont entraîné la disparition du
concept de « force vive » m v 2 au profit de celui « d’énergie cinétique » 1
2 m v 2 qui fait apparaître de façon
si mystérieuse (pour nos élèves et nous-mêmes d’ailleurs) ce fameux facteur de « 1
2 ».
2.2. Physique du billard : chocs élastiques entre deux boules sans « effets » conférés
Cette étude s’appuie sur des exemples pris dans cette remarquable vidéo consacrée aux chocs au billard :
http://www.youtube.com/watch?v=KoOHOL_fdk0
Les boules sont dures, de même masse, et sont frappées ici par le joueur « au centre », à hauteur de leur
centre d’inertie, sans aucun effet. Pour le système constitué par les deux boules, on doit vérifier :
la conservation de la quantité de mouvement du système : p avant
⟶= p après
⟶;
la conservation de l’énergie cinétique du système, avant et après le choc.
Pour mener à bien cette étude, nous nous appuierons sur des séquences de cette vidéo, qui permettent
d’observer les différentes scènes à une cadence de 30 images / s, puis, au ralenti, avec une caméra rapide à
raison de 1000 images / s. Nous retenons ici deux séquences correspondant à :
un choc plein fouet ; un choc latéral.
2.2.1 Un choc plein fouet dit « pleine bille »
Figure 4 : choc de plein fouet ou “carreau ”entre boules dures de même masse ; 3 images successives, juste
avant le choc, au moment du choc, puis juste après le choc. Entre chaque image s’écoule 1/30 e s.
http://www.youtube.com/watch?v=KoOHOL_fdk0
Figure 3 : force vive et quantité de mouvement ; lire page 14 selon :
http://www.philo-bernard.fr/images/QFV/QFV_R%C3%A9sum%C3%A9.pdf

L’ARPENTEUR DU WEB
QUANTITÉ DE MOUVEMENT GUY BOUYRIE
5
Chaque boule utilisée au « snooker » a pour diamètre d = 52,4 mm ; les deux boules ont ici la même masse m
de 127 g.
Le détramage a été effectué avec VirtualDub, logiciel libre qui est un véritable « couteau suisse » du
montage vidéo. http://www.virtualdub.org/.
L’analyse des séquences vidéo est réalisée sous REGAVI, logiciel capable également de produire de façon
immédiate une chronophotographie de la scène filmée, pourvu que les objets intéressants soient bien
contrastés par rapport au fond d’écran.
http://jean-michel.millet.pagesperso-orange.fr/
L’examen de cette première séquence vidéo permet de
comprendre immédiatement que, dans ce cas, il y a
transfert de quantité de mouvement de la boule 1
considérée comme le « projectile » sur la boule 2,
initialement immobile, constituant la « cible ».
Du fait de l’égalité de leur masse, on a ici, très
simplement : p avant = p après, relation qui s’applique ici à des
grandeurs scalaires puisque chaque boule emprunte la
même trajectoire.
m1 v 1 + 0 = 0 + m2 v’2 ; comme m1 = m2, on a : v 1 = v’2,
vitesse du mouvement de translationrectiligne du centre
d’inertie de chaque boule. C’est le cas particulier que
DESCARTES avait su correctement interpréter.
On a également ici :
E c avant = E c après soit : 1
2 m1 v 12 + 0 = 0 + 1
2 m2 v’22 qui permet de trouver encore v 1 = v’2.
C’est en accord avec la conservation de la « force vive » chère à LEIBNIZ et HUYGENS.
Par analyse sous REGAVI / REGRESSI, on vérifie que v 1 = v’2 2,5 m s 1.
2.2.2. Un choc latéral
La boule est propulsée à une vitesse v 1 et vient frapper la boule qui est initialement immobile.
Figure 5 : chronophotographie d’un choc plein fouet
Chronophotographie du choc élastique
Avant le choc : v 1 = 1,30 m s 1 et v 2 = 0 m s 1.
p1
⟶
Après le choc : v’1 0,30 m s 1 et v’2 = 1,25 m s 1
75
°
p1
⟶
p’1
⟶
p’2
⟶
Figure 6 : Choc latéral entre boules dures et conservation de la quantité de mouvement
http://www.youtube.com/watch?v=KoOHOL_fdk0
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%