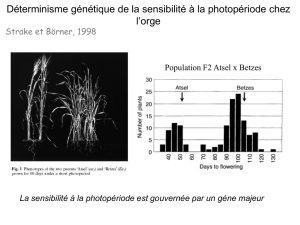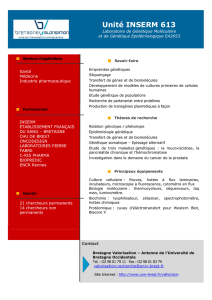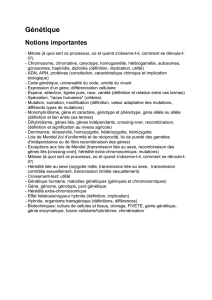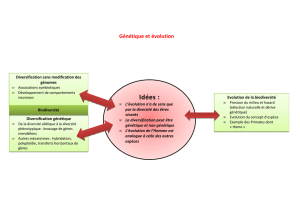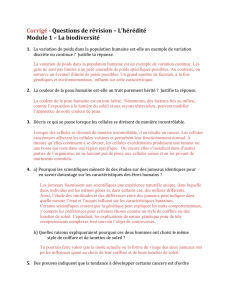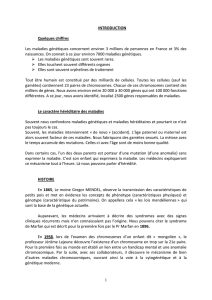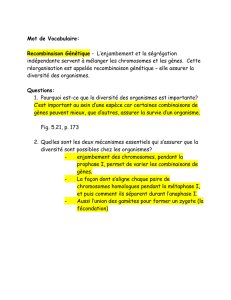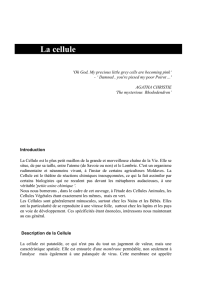De quoi s`agit-il - Risc-CNRS

Nos gènes contiennent les instructions
servant à l’élaboration de notre orga-
nisme. On estime que 20 % d’entre eux s’ex-
priment dans le cerveau, grâce auquel nous
percevons et interprétons le monde avant
de produire les réponses les plus adaptées
possibles. La génétique du comportement
cherche dans quelle mesure notre « carte
d’identité » génétique (ou « génotype ») peut
infl uer sur nos comportements (qui sont
inclus dans nos « phénotypes », ou produits
observables de l’expression des gènes).
Quelles sont les méthodes de cette disci-
pline ? Les chercheurs ont longtemps privi-
légié l’observation, notamment d’enfants
adoptés, et de jumeaux, à environnements
supposés égaux. Les enfants adoptés res-
sembleraient souvent plus à leur famille
biologique qu’à leur famille adoptive. De
même, deux vrais jumeaux se ressemble-
De quoi s’agit-il ?
Le point sur
18 SCIENCES HUMAINES Janvier 2008
Serions-nous soumis à la dictature de nos gènes ? La discrimination génétique
serait-elle en marche ? Depuis une vingtaine d’années, la génétique du
comportement bénéfi cie d’une expansion spectaculaire, porteuse d’espoirs
thérapeutiques et d’appréhensions plus ou moins légitimes.
La génétique du
comportement
JEAN-FRANÇOIS MARMION
raient davantage, par le comportement,
que deux faux jumeaux ou deux frères (ou
sœurs) non jumeaux, et plus encore s’ils ont
été élevés séparément. Malgré certaines
diffi cultés de méthode, ces résultats attes-
tent de l’influence probable de facteurs
génétiques.
La génétique moléculaire, plus récente
et plus précise, présente de meilleures
garanties scientifi ques : elle étudie, pour un
individu ou une famille sur plusieurs géné-
rations, la liaison entre l’expression d’un
comportement et les versions particulières
(ou « allèles ») de certains gènes. Chez l’ani-
mal, la souris représente un cobaye privi-
légié en raison de la similitude de ses gènes
avec les nôtres et de sa fréquence élevée de
reproduction. Il est courant aujourd’hui
d’en comparer des spécimens génétique-
ment identiques à l’exception d’un gène
inactivé. Il est également habituel de créer
des souris transgéniques, auxquelles on a
inoculé un ou des allèles soupçonnés, chez
l’homme, d’induire une pathologie ou d’al-
térer une fonction cognitive. On peut par
exemple produire des souris atteintes de
la maladie de Huntington, ou encore anor-
malement agressives. L’observation des
modifi cations du comportement consécu-
tives à ces manipulations permet d’amé-
liorer notre compréhension de l’action de
gènes précis, et de tester des interventions
thérapeutiques. Mais les résultats ne sont
pas transposables tels quels chez l’être
humain, doté d’une plus grande souplesse
adaptative et évoluant dans des environ-
nements variés. À noter que le prix Nobel
de médecine 2007 a été attribué à trois
chercheurs pour leurs travaux sur les souris
transgéniques. n
N° 189

À chaque comportement
son gène ?
Un gène agit à un niveau élémentaire
bien éloigné de la complexité d’un
comportement. Il programme en effet la
fabrication d’une ou plusieurs protéines.
Celles-ci sont à la base du développement
et du fonctionnement de nos cellules, qui
composent elles-mêmes nos tissus et orga-
nes, grâce auxquels nous évoluons dans
notre environnement…
De plus, il n’y a pas de correspondance
terme à terme entre gènes et phénotypes.
Un gène peut coder des protéines interve-
nant dans plusieurs phénotypes, de même
qu’un phénotype peut résulter de plusieurs
gènes : on connaît par exemple, chez la sou-
ris, un gène lié aussi bien à l’agressivité qu’à
la formation de l’émail dentaire. Certains
gènes agissent différemment suivant leurs
interactions avec d’autres gènes, leur envi-
ronnement cellulaire, leur localisation dans
l’organisme. Ils ne s’expriment parfois qu’à
certaines périodes de la vie (à la puberté) ou
de la journée (pendant le sommeil). Ajou-
tons à cela que certains auront un effet dif-
Janvier 2008 SCIENCES HUMAINES 19
Dans la jungle
de l’ADN
férent selon qu’ils sont transmis par le père
ou la mère, et il apparaît évident que leur
action est probabiliste, et non déterministe.
Les hasards combinatoires sont tels qu’il est
illusoire de tenter de prédire le comporte-
ment d’un individu à partir de son génotype
ou de celui de ses parents (1).
Par conséquent, inutile de rechercher le
gène de la fidélité ou de la compassion !
Dans les années 1960, on croyait la crimi-
nalité induite par un chromosome Y sur-
numéraire. Plus tard, on la décrivait liée à
une confi guration particulière du chromo-
some X, visible chez les enfants atteints du
syndrome de l’X fragile, et dont l’excitabi-
lité aurait auguré des comportements
délinquants. En 1993, on annonçait la
découverte du gène de l’homosexualité.
Ces proclamations tonitruantes sont
considérées aujourd’hui comme autant de
modèles à ne pas suivre… n
(1) Pierre Roubertoux, Existe-t-il des gènes du
comportement ?, Odile Jacob, 2004.
Un gène constitue le support de l’information
biologique héréditaire. Le génome désigne
l’ensemble des gènes propres à une espèce. Celui
de l’être humain en comporte environ 25 000, soit
autant que la souris, ce qui prouve que le nombre ne
fait rien à l’affaire… Si le séquençage du génome
humain a permis de dresser une carte exhaustive
des gènes sur les chromosomes, la découverte de
leur fonction reste à faire et constitue l’objet d’une
autre discipline, la protéomique.Chaque cellule
humaine contient 23 paires de chromosomes (ou
brins d’ADN, acide désoxyribonucléique), qui sont le
support des gènes. Un chromosome de chaque
paire est transmis par la mère, l’autre par le père :
tout individu dispose donc de deux variations de
chaque gène (deux allèles). L’un des deux
seulement peut être réellement actif (gène
« dominant » versus gène « récessif »).
Les jeux combinatoires entre allèles font que chacun
possède sa propre version du génome, le génotype,
qui peut s’exprimer suivant une certaine
confi guration, le phénotype (produit de l’expression
des gènes), pour un caractère donné. Tout individu
est donc génétiquement unique. Si chaque parent
transmet 50 % de son génotype, le phénotype n’est
pas héréditaire. n
Éliane/Zefa/Corbis
N° 189

20 SCIENCES HUMAINES Janvier 2008
L’i ntel l igence est-elle génétique ?
Cette question fait l’objet de débats
virulents. On dénombre plusieurs
centaines de gènes dont chacun pourrait
être impliqué dans le défi cit intellectuel…
Mais à l’heure act uelle, aucun ne constitue
un gène primordial pour le développement
d’une intelligence « normale ». Pourtant,
l’héritabilité (encadré p. 22) du QI est esti-
mée à environ 60 %, ce qui laisse supposer
une contribution massive des gènes sur le
développement intellectuel. L’héritabilité
semble même augmenter au fi l de la vie : le
milieu socioculturel pourrait jouer un rôle
nettement moindre après l’adolescence.
Certains chercheurs, depuis le psycho-
logue Arthur Jensen en 1969, vont plus
loin en transposant le débat sur le terrain
racial. Ainsi The Bell Curve, ouvrage à
succès de Richard Herrnstein et Charles
Murray, soulignait en 1994 les différences
de QI entre Américains noirs et blancs (en
faveur de ces derniers), en privilégiant les
déterminants génétiques au détriment
des facteurs socioéconomiques. Le propos
sous-jacent à ces recherches est que si les
inégalités sociales ont un fondement géné-
tique, il est inutile d’investir dans des aides
aux populations noires, présentées comme
Tout comportement est en
partie génétique puisqu’il
est manifesté par un individu qui
résulte biologiquement
de son génotype. Mais tout
comportement est en
partie le fruit de facteurs
environnementaux puisqu’il
s’exprime au sein d’une société
humaine et d’une biographie
unique, en fonction d’un
contexte variable. Peut-on dire
alors que le comportement est à
50 % génétique et à 50 %
environnemental ? La réponse
est non : il n’y a pas de « part »
respective des gènes et de
l’environnement, pas plus qu’il
n’y a pas de « part » de la
longueur et de la largeur dans la
surface d’un rectangle, pour
reprendre une métaphore
classique. L’exposition à
l’environnement commence
d’ailleurs dans le ventre
maternel, et inclut des
événements biologiques comme
la qualité de l’alimentation ou
l’exposition aux virus. Génétique
et milieu ne sont pas en
compétition, mais en constante
interaction : on dit qu’ils
covarient. Le comportement
d’un individu serait donc à la fois
100 % génétique et 100 %
environnemental (1). n
(1) Richard C. Lewontin, La Triple
Hélice. Les gènes, l’organisme,
l’environnement, Seuil, 2003.
Gènes et environnement : interaction ou compétition ?
biologiquement inférieures, condamnées à
la stagnation et à la criminalité, et suscep-
tibles, avec leur sexualité décrite comme
effrénée, de contaminer le corps social en
disséminant leurs gènes. De telles théories,
typiques du darwinisme social, sont géné-
ralement accueillies par une volée de bois
vert : un autre auteur, Christopher Brand,
a été interdit d’enseigner à l’université
d’Édimbourg en 1996, tandis qu’en 2007,
James Watson, codécouvreur de la struc-
ture de l’ADN et prix Nobel de médecine, a
été exclu de son laboratoire de recherches
pour avoir lui aussi défendu l’idée de diffé-
rences raciales d’intelligence.
De nombreux biologistes, comme Axel
Kahn et Richard Lewontin, sont farouche-
ment opposés à de telles conceptions, et
pas seulement pour des raisons morales.
Scientifi quement, le QI est un instrument
de plus en plus contesté : non seulement il
est sensible à des biais socioculturels, mais
il repose sur une conception globalisante
de l’intelligence, vieille d’un siècle, et qui
ne correspond plus aux connaissances
actuelles. Or, la contribution génétique
à des capacités cognitives plus spécifi-
ques, comme les aptitudes verbales ou la
mémoire, est bien moindre. De plus, même
en acceptant le QI comme instrument
d’évaluation de l’intelligence, il a été mon-
tré que son héritabilité est quatre fois plus
forte dans les familles les plus pauvres que
dans les plus riches (1). Ainsi, plus on est
pauvre, plus le milieu social est important
pour l’intelligence générale, que l’on soit
noir ou blanc. Minimiser les facteurs envi-
ronnementaux conduit donc à une vision
partielle de l’intelligence des populations
noires, qui, aux États-Unis où l’on assiste
aux plus fortes polémiques, sont souvent
les plus défavorisées. Enfi n, on constate
une hausse du QI au fil des générations
dans les pays occidentaux (c’est ce que
l’on appelle l’« effet Flynn »). Le QI moyen
des Français s’est par exemple élevé de
11 points de 1950 à 1980. Le développe-
ment de l’intelligence à un tel rythme ne
peut être expliqué, là encore, par la seule
biologie (2). n
(1) Études citées par Michel Imbert, Traité du
cerveau, Odile Jacob, 2006.
(2) Marie-Duru Bellat et Martine Fournier
(coord.), L’ I n t e l l i g e n c e d e l ’e n f a n t . L’e m p r e i n t e d u
social, éd. Sciences Humaines, 2007.
Rue des Archives
La vie est un long fl euve tranquille
(Étienne Chatilliez, 1988) raconte
l’histoire d’enfants intervertis à
la naissance, et grandissant dans
des environnements sociaux opposés.
N° 189

La psychopathologie représente l’un des
domaines de recherche le plus actifs de
la génétique comportementale. Les généti-
ciens ont répertorié quelque 5 000 maladies
dites monogéniques (phénylcétonurie,
myopathie de Duchenne…) : dans ce cas, la
mutation (héréditaire, ou après la concep-
tion) d’un seul gène est nécessaire et suffi -
sante pour provoquer une cascade de
réactions chimiques. Celles-ci déclenche-
ront une pathologie, qui aura un retentis-
sement sur le comportement (le plus sou-
vent un retard mental).
… Et les troubles psychiques ?
sont donc pas génétiquement program-
més, il existe néanmoins, pour certains
d’entre eux, une vulnérabilité génétique :
plusieurs gènes sont alors nécessaires mais
non suffi sants pour développer la psycho-
pathologie, qui se déclenchera plus ou
moins tôt (si elle se déclenche) et avec plus
ou moins de virulence et de réversibilité,
suivant des facteurs liés à l’histoire person-
nelle du sujet. Enfi n, n’oublions pas que
l’effet des gènes est réversible, au moins
partiellement, par traitement (entretien
p. 22). n
Janvier 2008 SCIENCES HUMAINES 21
Le point sur
Dans les années 1990, les généticiens ont
voulu démontrer l’origine génétique de psy-
chopathologies complexes comme l’autisme,
la schizophrénie ou les troubles bipolaires.
Ils ont dû déchanter. Malgré leur héritabilité
importante, ces maladies, « polygéniques »,
impliquent une multitude de gènes dont
chacun, isolément, a une infl uence vraisem-
blablement faible. En outre, les fl uctuations
comportementales liées à ces pathologies
déjouent parfois les critères diagnostiques et
compliquent les recherches.
Si les troubles psychiques complexes ne
La génétique du comportement
pour quoi faire ?
Les progrès de la génétique permettent
actuellement de développer des théra-
pies postnatales mais aussi, dans une
famille reconnue à risques, de procéder à
des dépistages sur le fœtus et à des diagnos-
tics préimplantatoires sur les embryons
conçus in vitro. Ces tests, qui constituent un
marché prometteur, permettent de prédire
correctement les maladies monogéniques,
mais ne sont pas aussi probants pour les
pathologies polygéniques : ils ne peuvent
alors que suggérer des facteurs de vulnéra-
bilité.
D’où des questions éthiques parfois polémi-
ques. Par exemple, la chorée de Huntington
(l’ancienne « danse de Saint-Guy ») est une
maladie dégénérative conduisant à la perte
progressive de la totalité des fonctions
cognitives et motrices. Il n’existe aucun
traitement efficace. Cette pathologie est
consécutive à la mutation d’un seul gène,
identifi é. Elle est fatale, mais ne se déclen-
che qu’après 40 ans. Faut-il éviter la nais-
sance d’un sujet qui vivrait 40 ans sans
symptômes ? Et pour les maladies polygéni-
ques, dont le déclenchement ne sera qu’hy-
pothétique, jusqu’où peut-on autoriser l’in-
terruption volontaire de grossesse à titre
préventif ? Certains chercheurs, comme
Jacques Testart, mettent en garde contre les
excès de la procréation médicalement assis-
tée conjuguée à la génétique comportemen-
tale, qui mèneraient tout droit à une forme
d’eugénisme au discours pavé de bonnes
intentions, une sorte de « meilleur de mon-
des » où les bébés seraient programmés sur
mesure (1).
On entrevoit également une classifi cation
possible, sinon une ségrégation, des indivi-
dus selon leur génotype. Des tests généti-
ques à l’embauche sont déjà pratiqués aux
États-Unis et à Hong Kong, entre autres,
pour déterminer si les gènes d’un candidat
ne réserveront pas de mauvaises surprises
(vulnérabilité à des produits toxiques, com-
portement potentiellement dangereux…).
En France, cette pratique est interdite, y
compris pour les entreprises américaines
qui s’installent. Dans le même ordre d’idées,
certaines compagnies d’assurances appré-
cieraient fort de pouvoir accéder au géno-
type de leurs souscripteurs, afi n de prendre
en compte leur espérance de vie probable
ou la période de survenue d’une maladie
potentielle. De telles pratiques, prohibées
par la législation française, sont notamment
autorisées en Grande-Bretagne pour certai-
nes pathologies héréditaires. n
(1) Jacques Testart, Le Vivant manipulé, Sand,
2003.
N° 189

Le point sur
Le suicide,
En mars 2007, le futur
président Sarkozy affi rmait
que le suicide et la pédophilie
étaient liés à des
prédispositions génétiques.
Scandales et polémiques…
Mais qu’en pensent les
psychiatres ?
ENTRETIEN AVEC
Franck Bellivier
professeur de psychiatrie à l’hopital
Henri-Mondor de Créteil, spécialiste
de la génétique du suicide.
Le suicide et la pédophilie sont-ils
des conduites ayant des fondements
génétiques ?
Mettons les choses au point tout de
suite. Sur la pédophilie, il n’existe pas
d’études conclusives. En revanche, les
conduites suicidaires sont suivies depuis
plusieurs dizaines d’années par les
psychiatres, et c’est l’un des domaines
les plus avancés en génétique des
comportements.
22 SCIENCES HUMAINES Janvier 2008
DR
À lire
• L’avenir n’est pas écrit
Albert Jacquard et Axel Kahn, Bayard, 2001.
• Les Imposteurs de la génétique
Bertrand Jordan, Seuil, 2000.
• Existe-t-il des gènes du comportement ?
Pierre Roubertoux, Odile Jacob, 2004.
• Des gènes au comportement.
Introduction à la génétique comportementale
Robert Plomin, John C. DeFries, Gerard E. McClearn
et Michael Rutter, 3e éd., De Boeck, 1998.
Pour en savoir plus
(en accès libre pendant un mois)
• « Intelligence : la par t des gènes »
Entretien avec Pierre Roubertoux,
Sciences Humaines, n°164, octobre 2005.
www.scienceshumaines.
com/pourensavoirplus
L’héritabilité est une statistique esti-
mant le degré d’infl uence probable
des facteurs génétiques pour un phéno-
type donné, dans une population donnée.
Par exemple, 1 % de la population géné-
rale est atteint de schizophrénie. Mais pre-
nons une population de 100 personnes,
ayant toutes un frère, une sœur voire un
faux jumeau déjà diagnostiqué comme
schizophrène :dans ce cas, environ 17 dé-
velopperont également la maladie. Pre-
nons à présent 100 autres personnesdont
le vrai jumeau, cette fois, est schizophrène.
Environ 48 seront frappées à leur tour. On
dit que l’héritabilité est de 48 % pour la
schizophrénie, c’est-à-dire que les fac-
teurs génétiques sont prépondérants dans
48 % des cas de la population évaluée, à
environnement semblable.
Les frères, sœurs et faux jumeaux ont à
peu près 50 %de gènes en commun, tandis
que les vrais jumeaux sont génétiquement
identiques. Par conséquent, plus le patri-
moine génétique est proche de celui d’un
malade, plus le risque de développer la
schizophrénie est important : l’héritabilité
augmente avec la proximité génétique.
L’héritabilité, valable pour une population,
n’a pas de sens pour un individu seul : une
héritabilité de 20 % pour un comportement
(dans une population) ne signifie donc
aucunement qu’il soit transmis à 20 % par
les parents (pour un individu). De même,
si l’héritabilité est de 60 % pour le QI, cela
n’entraîne pas que l’intelligence soit à 60 %
héréditaire. L’héritabilité n’explique donc
pas comment, dans quelles proportions,
avec quelle probabilité, avec quels gènes
un caractère se développe dans un orga-
nisme. Enfi n, elle constitue paradoxale-
ment un excellent argument en faveur du
rôle de l’environnement. Car si la génétique
suffi sait à tout expliquer, le risque d’être
atteint, pour un vrai jumeau schizophrène
dont le frère ou la sœur est malade, serait
de 100 %, tous deux portant les mêmes
gènes. n
L’héritabilité, une notion centrale
L’extravagant catcheur britannique Adrian Street au
côté de son père, discret mineur de fond.
Dennis Hutchinson
N° 189
 6
6
1
/
6
100%