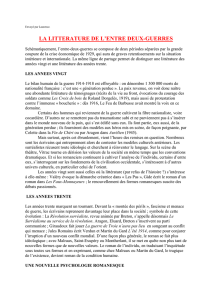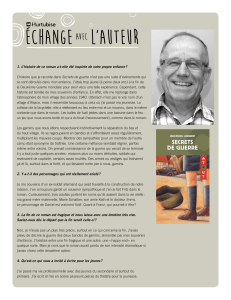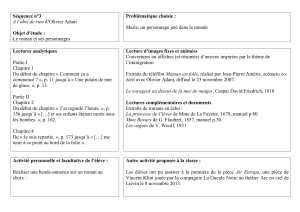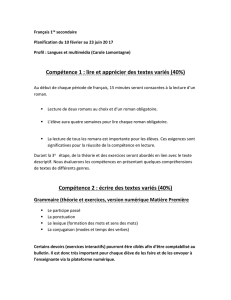Entre réel et utopie - pug

Annales de l’Université Omar Bongo, n° 11, 2005, pp. 457-474
ENTRE REEL ET UTOPIE : LA REPRESENTATION DU VILLAGE
TRADITIONNEL DANS LE ROMAN GABONAIS1
Ludovic OBIANG
Institut de Recherche
en Sciences Humaines
Libreville (Gabon)
Résumé
Le récit est l’un des fondements de l’identité et de l’évolution
des peuples. Le Livre de l’Exode chez les Juifs, l’Odyssée des Hellènes,
Kaydara des Peuls, Soundjata des Malinké, le Mvett des Fangs, etc, ont,
chacun à sa manière, le transposé de leur communauté respective, en
même temps qu’ils en influencent le devenir. Le roman contemporain
ne déroge pas à cette attribution, même s’il s’est de plus en plus orienté
vers une interrogation de sa propre économie, de son fonctionnement
interne. Tributaire majoritairement du récit, il demeure aujourd’hui le
condensé des sociétés qui lui servent de prise, traducteur de leurs
valeurs et de leurs mutations, en même temps qu’il contribue, par
rétroaction, à leur édification progressive.
C’est dans ce double sens qu’on peut étudier la présence du village
traditionnel dans le roman gabonais contemporain. Examiner ses
représentations dans les textes, aussi bien mimétiques qu’éthiques, et en
1 Ce texte est la version remaniée d’une communication donnée à l’occasion d’un séminaire
organisé par le Laboratoire Universitaire de la Tradition Orale (LUTO) sur le thème « Clans,
Lignages et Villages » (du 10 au 15 mai 1999). Notre corpus se limitera donc aux romans
publiés jusqu’à cette date, soit les mêmes que nous analysons dans notre article consacré au
roman gabonais (cf. bibliographie en annexe). Depuis cette date, un certain nombre de romans
ont été publiés qui viennent confirmer la grande vitalité de la littérature gabonaise. Nous
souhaitons que ces œuvres plus récentes soient lues sous l’éclairage du présent article afin de
vérifier si, selon le mot de Cheikh Anta Diop « les grandes lignes [en] sont solides et les
perspectives justes ». Autrement, cet article ayant été conçu à l’initial pour une rencontre
d’anthropologie et pour une thématique spécifique, on admettra qu’il ait d’abord des visées
anthropologiques et que l’accent soit porté sur une certaine perception du village
« traditionnel ». C’est ainsi qu’on ne retrouvera pas forcément les descriptifs d’usages et de
pratiques rituelles de même que les relevés des genres de littérature orale qui constituent très
souvent la méthode en matière de critique « traditionnaliste » africaine.

Ludovic OBIANG
458
induire des propositions sur le degré de déculturation des populations
gabonaises et sur la capacité des romanciers à anticiper l’avenir. Voici
l’objet que nous nous sommes donné.
Mots Clés
Récit ; Village, Lignage, Matiti, Ville, Utopie.
Abstract : The account is one of the bases of the identity and the evolution of the
people. The Book of the Exodus at the Jews, of Hellènes, Kaydara of Peuls, Soundjata of
Malinké, Mvett of Fangs, etc, each one with its manner, are transposed of their
respective community, at the same time as they influence some to become it. The
contemporary novel does not derogate from this attribution, even if it were directed more
and more towards an interrogation of its own economy, of its working procedure.
Tributary mainly of the account, it remains today the digest of the societies which are
used to him as catch, translator of their values and their changes, at the same time as it
contributes, by feedback, with their progressive construction. It is in this double direction
that one can study the presence of the traditional village in the contemporary Gabonese
novel. To examine its representations in the texts, as well mimetic as ethical, and to
induce proposals of them on the degree of deculturation of the Gabonese populations and
on the capacity of the novelists to anticipate the future, here is the object that we were
given.
Key words
Key – Account – Village – Matiti – Town - Utopia
Le récit, qu’il soit traditionnel ou moderne, est un des
fondements de l’identité des peuples. Il constitue pour Grégoire
BIYOGO « la source la plus plausible des valeurs culturelles et religieuses des
peuples »2. Fait de culture, en tant que produit d’une intellection, il est
aussi facteur de culture de par l’influence qu’il exerce en retour sur les
individus. Non seulement il incarne les valeurs et les modèles d’un
peuple à un moment donné de son histoire, mais il porte aussi en lui
leurs interrogations inconscientes, leurs non-dits et leurs angoisses. On
peut légitimement évaluer le degré de déculturation ou de vivacité des
sociétés lignagères gabonaises en étudiant leur incarnation dans le
roman. Quelle place y occupent des catégories fondamentales comme le
2 Grégoire BIYOGO, L'Ecriture et le Mal, Théorie du Désenchantement, Thèse de Doctorat
Nouveau Régime, Université Paris Sorbonne - Paris IV, Mai 1990, p. 434.

Ludovic OBIANG
459
village, le clan, le lignage ; sous quels aspects apparaissent-elles ? Au-delà
des affirmations de surface, quelles mutations profondes et quelles
perspectives les choix d’écriture sous-tendent-ils ? Voici les
questionnements qui animent le présent article. Il s’organisera de ce fait
en en trois principales articulations. Partant d’une perspective
strictement descriptive : (organisation spatiale et architecture puis
organisation sociale et catégories identitaires), nous envisagerons pour
finir une lecture éthique du village. L’intérêt pour nous étant d’accéder
à cette capacité d’anticipation et de sublimation qui de tout temps a fait
de l’Artiste un visionnaire, sinon un démiurge3.
I. Organisation spatiale et architecturale
D’entrée un double constat s’impose. Primo, conformément à
une situation générale et ancienne, « la peinture de la société traditionnelle
occupe incontestablement une place considérable dans l’œuvre des poètes et des
romanciers »4 gabonais. « Le lecteur est surpris, poursuit le critique, par
l’abondance, la récurrence et parfois même le retour en force de motifs empruntés
au monde de la tradition »5. Secundo, contrairement cette fois à une idée
courante, le roman gabonais n’est pas réaliste, encore moins naturaliste,
au sens strict des « courants » littéraires qui domineront le XIXe siècle
littéraire en France. On n’y décèle pas la recherche documentaire,
l’obsession du détail et les présupposés scientistes (génétique, hérédité)
qui vaudront à l’école réaliste d’être traitée « d’artisanat du style » et de
« sous-écriture » par Roland Barthes6.
3 Pour reprendre (très) approximativement les catégories de la socio-critique de Claude
Duchet, qui renvoient à des contenus bien plus complexes, on pourrait dire que notre étude
examinera d’une part la société réelle ou historique telle qu’elle apparaît à travers le roman,
avant de voir en quoi les auteurs font œuvre de création originale en produisant une véritable
société textuelle. C’est à ce niveau que se situe toute la dimension « littéraire » de notre
travail. L’espace littéraire en tant qu’univers « de papier », mais susceptible d’anticiper le réel
ou de l’influencer. L’écrivain doit montrer face à l’anthropologie, science humaine par
excellence, le même degré d’anticipation que les écrivains de science fiction manifestaient avec
les sciences dites exactes.
4 Jacques CHEVRIER, Anthologie nègre, Paris, Armand Colin, Coll. « U », p.123.
5 Idem, p.124.
6 Roland BARTHES, Le degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, Coll. « Point », 1953, 1972, p. 49.
Le critique français instaure un questionnement sur le réel qui mérite d’être élargi à la

Ludovic OBIANG
460
A moins que nous souscrivions à l’hypothèse de Claire L. Dehon
selon laquelle il existerait une forme spécifique de « réalisme » africain,
au modèle du réalisme « merveilleux » qui aujourd’hui encore distingue
nombreux romans antillais :
Le lecteur occidental doit donc s’attendre à ce que les éléments constitutifs
du réalisme africain ne ressemblent pas tous à ceux qui existent dans la littérature
française, ni qu’ils soient employés de la même manière et dans les mêmes buts, ni
que le mode suive une évolution identique7.
Les descriptions dans le roman gabonais peuvent sembler, en
effet, insuffisantes, lapidaires, dotées de caractérisations souvent
allusives, métaphoriques et métonymiques. Ainsi Ferdinand Allogho-
Oke peut-il affirmer que la rue du village de Mba-Ngôme était aussi droite
que « la raie d’un Yorouba en pleine fête. »8 Pour Okoumba-Nkoghe, les
villages « kanigui » d’Alélé et de Ngabaama se caractérisent presque
exclusivement par leurs « toits de paille », au point que ce trait descriptif
se confonde dans l’esprit du narrateur avec les noms de ces villages.
Pour Auguste Moussirou, le village n’existe plus que par le nom
(Mourindi, Mwalo) et par la présence d’une aïeule aimante qui en
entretient la flamme mythologique. Pour Armel Nguimbi Bissielou, le
village est un poste où l’on fait escale le long d’un trajet semé
littérature africaine en général. Cette littérature présentée pendant longtemps comme réaliste
par excellence n’est-elle pas plutôt le chantre d’une certaine vision du monde,
conventionnelle et entendue ? Nous pensons nous que la réalité africaine est beaucoup plus
riche et complexe que ne le révèle la littérature « idéologique » qui a prévalu jusqu’à présent.
Le monde du « surnaturel », qui double l’univers africain mérit,e par exemple, d’être mieux
appréhendé par les écrivains.
7 Claire L. DEHON, Le réalisme africain, le roman francophone en Afrique subsaharienne, Paris,
L’Harmattan 2002, p17. Dans cette œuvre qui pêche quelquefois par son côté péremptoire et
souvent schématique, Claire DEHON, s’attache à enraciner le réalisme dans l’histoire
politique de l’Afrique et à souligner les manifestations aussi bien matinales que récentes de
cette forme particulière de réalisme. L’enjeu d’un tel postulat est qu’il peut soit totalement
désincarner la notion de « réalisme » soit favoriser une complexification et de la notion et de la
théorie littéraire en général. L’auteur penche pour la seconde option. Ce qui l’amène à
construire une véritable poétique du roman africain qui privilégie l’indice, la métaphore et le
positionnement idéologique au détriment de la précision picturale et même chirurgicale qui
caractérisait les réalistes du XIXè en France.
8 Ferdinand ALLOGHO-OKE, Biboubouah, chroniques équatoriales, Paris, L’Harmattan, 1985,
p. 18.

Ludovic OBIANG
461
d’embûches et qui se limite à quelques cases, des cuisines, un corps de
garde et l’hospitalité sans limites d’un chef facétieux.
Autrement, chez la plupart des romanciers, et en particulier chez
Okoumba-Nkoghe (Siana, La mouche et la glu), le village est souvent
assimilé au campement ou au bidonville qui jouxtent la ville. Il y a là un
cas intéressant de transfert ou de transposition des usages villageois dans
l’univers citadin. Le bidonville représente souvent le refuge au sein
duquel le héros se protège des agressions de la ville. C’est dans le
bidonville que se reforment les liens claniques et le minimum de
cohésion ou de solidarité familiales, sinon nationales. Il y a là comme une
ironie du sort, comme une unification à l’envers que Hubbert Freddy
Ndong-Mbeng a parfaitement traduit dans son roman au titre éponyme :
Les matitis : […] Tous les matitis de Libreville n’ont à aucun moment une ethnie
qui leur est propre. Dans chaque matiti on retrouve toujours des originaires
de divers groupes ethniques, même si la bonne cohabitation entre eux n’est pas
toujours évidente. […]. En même temps qu’on retrouve diverses ethnies dans
un même matiti, on retrouve aussi, les « frères » qui ont traversé forêt et
savane pour venir « chercher la vie » à Libreville9.
Comme si le rêve d’unité nationale ou d’intégration régionale
des politiques avait trouvé son accomplissement, non pas dans la « cité »,
prestigieuse à l’image de la mégapole occidentale, mais dans le matiti, ce
rebut architectural et social où la nécessité de l’urgence atténue les
frontières artificielles de la tribu, de l’ethnie ou de la nationalité.
Et, même si le matiti chez Laurent Owondo peut donner
l’impression d’un univers sans issue, étouffant et avilissant (ce qui est le
propre même du bidonville), il n’en demeure pas moins que « ces
pauvres univers en contre-plaqué », suivant la périphrase de Hubert-Freddy
Ndong Mbeng, sont le lieu d’accueil du « déguerpi » sans abri et
représentent, à l’inverse des quartiers « résidentiels », l’espace où
s’exprime encore les vestiges de la proximité, de la solidarité et la force
de survie qui caractérisaient naguère les villages traditionnels.
9 Hubert-Freddy NDONG MBENG, Les matitis, mes pauvres univers en contre-plaqué, en planches
et en tôle…, Paris, Sépia, 1992, p.11.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%