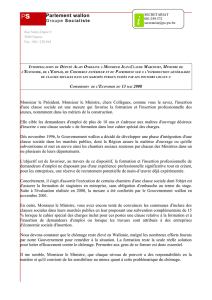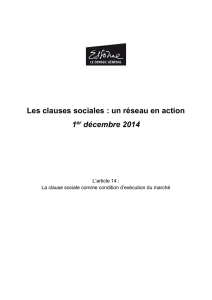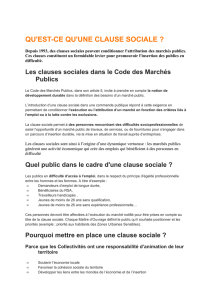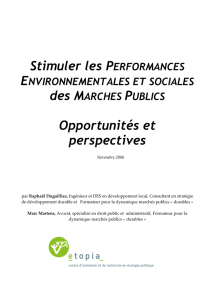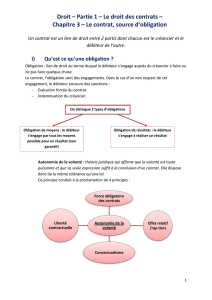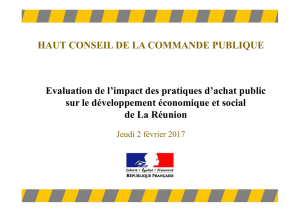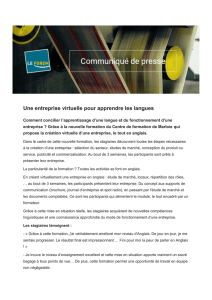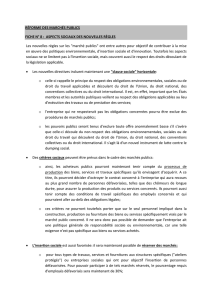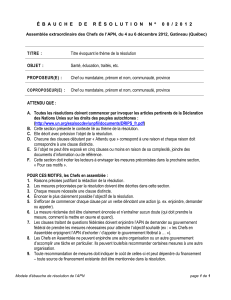Stimuler les performances environnementales et sociales

Stimuler les performances
environnementales et
sociales des marchés publics
Raphaël Dugailliez et Marc Martens, chercheurs-associés à étopia
Novembre 2006

21 Page 2
1 Préambule1
Le législateur a confié à l’exécutif de nombreux outils de politique économique,
plus ou moins directs. Citons les impôts directs et indirects, la TVA, … Les
marchés publics sont un autre volet économique puisqu’ils sont l’instrument des
dépenses de l’Etat. Le PIB belge de 2003 est de 236 m illiards d'euros. Le volume
financier des marchés publics en Belgique peut être estimé à 33 milliards d’EUR,
soit approximativement 14% du PIB. Au vu de l’importance des volumes financiers
en jeu dans les marchés publics et compte tenu de l’évolution de la réglementation
de cette matière, il est donc très clair que les marchés publics sont un très bel outil
de politique économique.
A l’échelle européenne, les acheteurs publics et les autres entités visées par les
directives sur les marchés publics constituent un groupe de consommateurs
important : plus de 1.000 milliards d'EUR, soit quelque 14% du PIB de l'Union.
Les outils de politique environnementale sont aussi nombreux et ont été
considérablement étoffés en quelques années. Citons les normes, l’information, la
sensibilisation, la politique des produits, la police de l’environnement. Il en est un
qui en est à ses prémices et qui fait l’objet du présent article : les marchés publics.
Traditionnellement, l’impact des activités humaines est considéré comme se
réduisant essentiellement à des problèmes de « pollution de l’environnement ». La
solution, estime-t-on alors, consiste à traiter la pollution par le biais de divers
dispositifs techniques intervenant généralement en fin de processus (ce que l'on
désigne habituellement par l'expression anglaise «end of pipe»). Historiquement,
l'approche end-of-pipe s'est développée selon une stratégie administrative
sectorielle. Le traitement des déchets solides, des déchets dangereux ou toxiques,
des déchets liquides, des pollutions atmosphériques, relève généralement de
différents corps administratifs, qui vont de la santé publique au service des eaux.
Toutefois, il faut bien réaliser que la «solution» d'un problème aux yeux d'un
département peut fort bien se révéler n'être que son transfert sur un terrain
relevant d'un autre département, la «dépollution» consistant simplement à
déplacer la pollution. Le traitement des eaux usées, par exemple, produit de l'eau
«propre», mais également des boues d'épuration en très grandes quantités. Or, le
stockage de ces boues ou leur épandage sur les terres agricoles, peut entraîner une
contamination du sol et des eaux souterraines, notamment par des métaux lourds.
De même, l'incinération des déchets solides permet de réduire considérablement
leur volume, mais le stockage des cendres d'incinération présente également un
problème pour le sol et les eaux souterraines. De plus, l'incinération risque de
polluer l'atmosphère. Pour satisfaire aux normes de qualité de l'air, on peut alors
installer des filtres. Ces derniers se chargent de substances solides qu'il convient, à
leur tour, d'éliminer.
Par conséquent, bien que l'approche « end-of-pipe » ait rendu d'indéniables
services ces dernières décennies, il est clair qu'à terme, une telle stratégie sectorielle
ne suffit pas. Par ailleurs, les pays industrialisés sont confrontés à un phénomène
croissant, face auquel la stratégie end-of-pipe est inopérante: le fait que les
émissions polluantes deviennent, proportionnellement, de plus en plus diffuses.
Une brève analyse de la majorité des politiques environnementales illustre
facilement le modèle « end of pipe » de l’économie : l’emploi dans les secteurs
1 Raphaël Dugailliez est ingénieur industriel et titulaire d’un DES en développement local,
consultant en stratégie de développement durable ; Marc Martens, est Avocat spécialisé en
droit public et administratif. Ils sont tous les deux formateurs pour étopia en matière de
marchés publics « durables ».

21 Page 3
environnementaux est majoritairement affecté à la réparation en bout de course
des dégâts causés à l’environnement. Une politique plus ambitieuse viserait à
transférer une partie des ressources financières et humaines vers le développement
de processus, services et produits moins polluants. A long terme, le passif
environnemental (l’empreinte écologique accumulée) se réduirait et ceci
diminuerait les coûts pour la collectivité : l’externalisation des dégâts
environnementaux engendrés par l’économie actuelle est majoritairement
supportée par les pouvoirs publics.
L’internalisation des coûts externes à l’environnement allégerait à moyen terme la
charge globale pour l’Etat et permettrait ainsi de dégager des marges budgétaires à
d’autres politiques.
Nous ne développerons pas ce raisonnement pour le volet social, mais il nous
apparaît que l’analyse sur le volet environnemental du modèle « end of pipe » est
transposable également pour le volet « social » et « emploi » des politiques.
Oui, les marchés publics peuvent grandement influencer l’innovation
technologique, diminuer les impacts environnementaux directs et indirects,
favoriser le développement économique de filières à triple dividende, à fort
potentiel de croissance d’emplois non-délocalisables, citons par exemple la
construction durable, les énergies renouvelables, la chimie verte, les bioplastiques,
le transport écologique et la logistique multimodale, l’agriculture biologique, … et
plus largement tous les secteurs de l’économie sociale.
A ce jour en Belgique francophone, le volet « environnemental » et « social » des
marchés publics n’est que très peu actionné. Cet article est une contribution à
combler un maillon manquant, à savoir le maillon qui permettrait de relier les
fonctionnaires techniques agissant pour compte des adjudicataires, les entreprises
et fédérations patronales des secteurs concernés et les institutions œuvrant à une
prise en compte de l’environnement et du social plus transversale.
Il sera balayé un état non exhaustif des possibilités offertes par la législation ainsi
qu’une analyse plus précise des difficultés à pratiquer les marchés publics
« durables », c’est-à-dire ayant pour but, outre de contribuer à la réalisation du
marché intérieur européen par des achats transparents et non discriminatoires et
d’assurer une allocation optimale des deniers publics en garantissant des achats au
meilleur prix ou meilleur rapport qualité/prix, d’inclure des clauses qui viseront à
une meilleure prise en compte de l’environnement et des impacts éthiques et
sociaux.
Enfin, il est utile de cadrer aussi la prise de conscience belge avec la vague
européenne en matière de marchés publics : en date du 31 mars 2004, le Parlement
européen a adopté la Directive 2004/18/CE relative à la coordination des
procédures de passation de marchés publics de travaux, fournitures et de services
et la Directive 2004/17/CE portant sur la coordination des procédures pour
l’inscription de marchés dans les secteurs de la fourniture d’eau et d’énergie, des
transports et des services postaux. Dorénavant, les Directives permettent de tenir
compte de manière explicite d’exigences et de considérations environnementales,
aussi bien pour les spécifications techniques, les critères de sélection que pour les
critères d’attribution du marché.
La référence explicite à des critères environnementaux dans la réglementation
européenne sur les marchés publics est la conséquence d’une longue évolution,
dans laquelle la Cour européenne de Justice a joué un rôle crucial. Pour les aspects
sociaux, la Commission a permis depuis de nombreuses années des mécanismes
qui sont très peu utilisés en Belgique. Ils seront rappelés dans cet article.

21 Page 4
Il est surprenant de constater que le législateur belge a précédé le législateur
européen. Sous la pression du parti écologiste au sein du gouvernement belge, et
renforcé par l’arrêt du 17 septembre 2002 dans l’affaire C-513-00 (arrêt Concordia
Bus Finland), le législateur belge a, par la loi-programme du 8 avril 2003, modifié
l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certaines
commandes pour l’adjudication de travaux, de fournitures et de services en ce sens
que, désormais, les caractéristiques environnementales peuvent aussi être utilisées
comme critères d’attribution, pour autant qu’elles aient trait à l’objet du marché.
Il est également rappelé au lecteur que le champs d’application de la législation des
marchés publics s’est également élargi au cours des dernières années. Le champ
d’application ratione personae de la directive générale est déterminé quasi
exclusivement2 par la qualité “publique” des entités adjudicatrices.
Celles-ci sont d’une part les personnes publiques classiques (Etat, régions,
communautés, provinces, communes, CPAS, etc.) et d’autre part, une catégorie
d’organismes dits de droit public (ci-après O.D.P.), dont chaque Etat membre
dresse la liste non limitative.
Par O.D.P., l’article 1er de la directive générale entend un organisme :
• créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général de
caractère autre qu’industriel ou commercial ;
• doté de la personnalité juridique ;
• dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités
territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est
soumise à un contrôle de ces derniers, soit l’organe d’administration, de
direction ou de surveillance est composé pour plus de la moitié de
membres désignés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres
organismes de droit public.
A ce propos, la jurisprudence a abondamment précisé ces trois critères. Retenons
simplement que de nombreuses asbl satellites créées pour éviter la lourdeur des
passation de marché ont perdu une partie de leur raison d’être à la lecture de la
jurisprudence de la Cour européenne de justice.
2 Marchés publics et environnement
La Commission européenne offre la possibilité aux acheteurs publics de contribuer
au développement durable en indiquant les possibilités offertes par le cadre
juridique existant et de veiller à la protection de l'environnement à travers les
marchés publics.
En introduisant des considérations environnementales dans les marchés publics,
les organismes publics, les groupes de consommateurs importants, peuvent
réduire considérablement l'impact de la consommation sur notre environnement.
De même, en agissant ainsi, ils constituent un levier important dans la promotion
d'un changement des modes de consommation. Ils font office d'exemple pour les
consommateurs privés.
2 Au contraire de la directive sectorielle régissant pour l’essentiel l’exercice de certaines
activités (énergie, transports, etc.).

21 Page 5
Une étude de 20033 examinant les pratiques en matière de marchés publics dans les
États membres dans l’UE à quinze montre que 19 % seulement de toutes les
administrations publiques font des achats écologiques dans une mesure
appréciable (application de critères environnementaux dans plus de la moitié des
achats). Les principaux obstacles sont des connaissances insuffisantes pour fixer les
bons critères environnementaux dans les documents d'appels d'offres, des
contraintes budgétaires imputables aux prix parfois plus élevés des produits et des
services écologiques et l’insécurité juridique.
Le rôle des autorités publiques et des organismes d’intérêt public (OIP) dans cette
matière n'est donc pas négligeable et est reconnu (voir à ce sujet plusieurs
publications de l’OCDE4). Dans la pratique cependant, des difficultés dans la mise
en œuvre de l'introduction de clauses environnementales dans les marchés publics
sont fréquemment rencontrées. Celles-ci sont, d'une part, d'ordre juridique - que
peut-on faire tout en respectant la législation ? -, d'autre part, d'ordre technique -
qu'est ce qui est mieux pour l'environnement ?
En ce qui concerne les difficultés d'ordre juridique, la Commission européenne a
publié plusieurs documents importants (Acheter vert, manuel des marchés publics
écologiques ; la Communication interprétative sur le droit communautaire
applicable aux marchés publics et les possibilités d'intégrer des considérations
environnementales dans lesdits marchés). Ces documents, dont les points
principaux sont résumés dans cet article, donne des indications très concrètes sur
la manière de prendre en compte l'environnement à travers les différentes étapes
d'une procédure d'attribution d'un marché tout en respectant le cadre juridique des
marchés publics.
Rappelons que les objectifs de la politique des marchés publics sont :
• de contribuer à la réalisation du Marché intérieur par des achats
transparents et non discriminatoires ;
• d’assurer une allocation optimale des deniers publics en garantissant des
achats au meilleur prix ou meilleur rapport qualité/prix.
Tout en assurant le respect de ces objectifs, la protection de l'environnement peut
être prise en compte à chaque stade d'une procédure de passation de marché
public, à savoir :
• La définition de l'objet du marché
• Le choix des spécifications techniques
• La sélection des candidats
• L'attribution du marché
• Les conditions additionnelles
• L'exécution du contrat.
La première occasion pour les autorités publiques et les organismes d’intérêt
public (OIP) de prendre en compte l'environnement se présente lors de la
définition de l'objet du marché – que vais-je construire ou acheter. L’autorité
publique ou l’OIP a la liberté de choisir un produit ou un service "vert" dans la
3http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1045&format=HTML&aged
=0&language=FR&guiLanguage=fr
4 OCDE, La performance environnementale des marchés publics - Vers des politiques
cohérentes, 2003, 244 p ; OCDE, Marchés publics et environnement Problèmes et solutions
pratiques, 2000 ; OCDE, La taille des marchés publics, 2002
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%