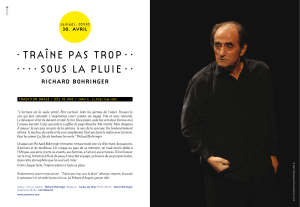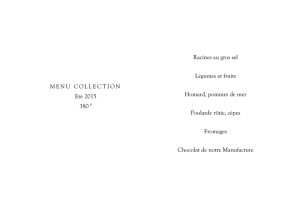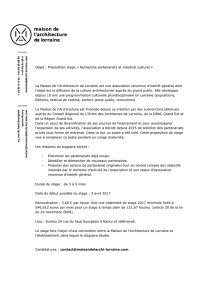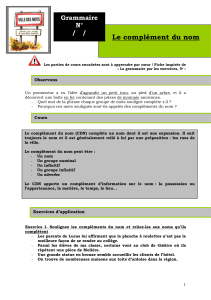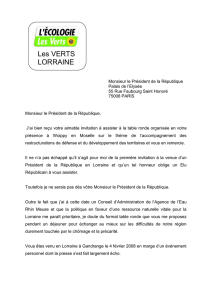J`avais un beau ballon rouge

Théâtre de la manufacture / direction Michel Didym - 10 rue Baron Louis, BP 63349
54014 Nancy Cedex www.theatre-manufacture.fr / 03 83 37 12 99
Administratrice de Production Marion Raffoux
E-mail m.raffoux@theatre-manufacture.fr
Chargée de Diffusion Marine Lelièvre
E-mail [email protected]
© Michel André Didyme
Texte de Angela Dematté
Mise en scène Michel Didym
J’avais un beau
ballon rouge
© Éric Didym
Romane Bohringer et Richard Bohringer
dans
Coup de cœur
du Théâtre public

Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy - Lorraine 2

Depuis son enfance jusqu’à sa mort, c’est la trajectoire fulgurante de la vie de Margherita
Cagol, alias Mara, épouse de Renato Curcio, fondateur et idéologue des Brigades Rouges,
que reparcourt l’auteure. Margherita est une enfant qui grandit et développe sa conscience
politique pendant ses études à la faculté de sociologie de Trente, où elle rencontre Renato
Curcio. Le couple part à Milan, fonde la lutte armée, effectue les premiers enlèvements, mais,
le 6 juin 1975, Mara est tuée au cours d’un affrontement avec les forces de l’ordre.
Dans la pièce d’Angela Dematté, l’interlocuteur omniprésent de Margherita est son père.
À partir de leurs échanges, deux visions du monde entrent en collision : le bon sens commun,
« petit bourgeois », du père et la vision idéologique, intransigeante, de Mara.
Pour évoquer la vie et la mort de Mara Cagol, Angela Dematté s’appuie, en outre, sur des
lettres de Mara à sa mère, des communiqués (successifs) des Brigades Rouges, des extraits
de journaux, photographiant ainsi un moment particulier de l’histoire italienne : la naissance
des Brigades Rouges, le passage à la lutte armée jusqu’à la disparition tragique de Mara.
L’auteure oppose le quotidien à l’exceptionnel car elle choisit – et c’est là le plus intéressant – le
point de vue de l’intime : au centre, la relation entre le Père et la Fille, dans laquelle la raison
« concrète » du père, celle des affects, particulièrement touchante, déteint sur les raisons
quelque peu abstraites et suicidaires de Mara. À travers leurs dialogues, Angela Dematté
raconte non seulement l’histoire d’une des fondatrices des Brigades Rouges mais elle
explore également le rapport concret entre un père et sa fille, fait de silences, de non-dits et
d’incompréhensions. Pour cela, elle a recours au dialecte de Trente, froid et poignant à la fois,
jusqu’au moment de la rupture finale entre Margherita et son père, marquée par un retour à
l’italien exprimant l’aberration du langage idéologique.
La pièce est un témoignage fidèle de cette période de l’histoire : outre sa valeur documentaire
certaine, elle laisse la parole aux « communiqués » de Mara et de son groupe, thématisant ainsi
leur aveuglement et leur isolement, face à l’incompréhension de ce Père qui ne lâche jamais
prise dans sa tentative, sans cesse réitérée, de ramener sa fille aux raisons de la vie et de sa
propre humanité.
J’avais un beau
ballon rouge
Texte de Angela Dematté (Italie)
Mise en scène Michel Didym
Avec Romane Bohringer et Richard Bohringer
Traduction ........................................................... Caroline Michel et Julie Quenehen
Scénographie .........................................................................................Jacques Gabel
Lumières ............................................................................................. Paul Beaureilles
Musique ..................................................................................................... Vassia Zagar
Vidéo..............................................................................Tommy Laszlo et Julien Goetz
Costumes ...........................................................................................Danik Hernandez
Maquillages, coiffures ..............................................................Catherine Saint Sever
Assistante à la mise en scène ............................................................ Lou Bohringer
Avec les voix de ..............................................................Bruno Ricci et Michel Didym
Construction du décor ...................................Atelier du Théâtre de la Manufacture
Production
Théâtre de la Manufacture CDN Nancy-Lorraine
Coproduction
Le Volcan, Scène Nationale Le Havre / Théâtre Anne de Bretagne de Vannes
En partenariat avec Face à face,
Paroles d’Italie pour les scènes de France
Le texte de Angela Demattè a été traduit avec le soutien de la Maison Antoine Vitez,
centre international de la traduction théâtrale www.maisonantoinevitez.com
Création le 15 janvier 2013 au Théâtre de la Manufacture CDN Nancy-Lorraine
J’avais un beau ballon rouge est édité aux Solitaires Intempestifs - collection Mousson
d’été. Traduction de Julie Quénehen et Caroline Michel
Le « Palmarès du Théâtre » a décerné en 2013 le prix « Coup de coeur du Théâtre public »
à Richard Bohringer et Romane Bohringer pour leur interprétation dans ce spectacle.
Durée 1h25
Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy - Lorraine 3

Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy - Lorraine 4
J’avais un beau ballon rouge (citation)
Père. - (Pause) Écoute voir Margherita. Vous pensez vraiment que c’t’histoire de révolution, ça peut
y durer toute la vie ? C’est vrai que je suis pt’être un peu ignare, que j’y pipe rien… mais j’vais te
dire une chose : on change, tu sais, Margherita. Et on s’esquinte aussi. Et petit à petit tu te rendras
compte que toi aussi t’auras envie de ta p’tite maison et de tes vacances à la mer, et d’être avec les
tiens.
Margherita Cagol. - Alors qu’est-ce qu’on fait ? Comment c’est possible de rester là à regarder ce
qui se passe les bras croisés ! Toutes les usines en grève, les gens qu’ont même pas un toit, pas une
lire pour s’acheter à croûter. Les ouvriers qui triment dix heures par jour à se cramer les poumons,
quand c’est pas pire…
P. - Mais vous croyez quoi ? Que c’est vous autres qu’allez changer les choses ?
M. – Pt’être bien qu’oui, en quelque sorte.

Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy - Lorraine 5
J’avais un beau ballon rouge (Avevo un bel pallone rosso), pièce inédite (en français) de la jeune
dramaturge italienne Angela Dematté , est une fiction qui repose sur le socle d’une lourde
réalité. Obéissant à des conventions théâtrales non réalistes (déroulement chronologique
fragmenté, décor non illusionniste, etc.), ce texte a plus que des accents de vérité. Tout en
exposant, de manière humaine et tendre, les rapports intimes de deux personnages rattachés
par les liens du sang (un père et sa fille), il convoque sur scène un moment particulièrement
grave de l’histoire récente, lorsque, dans les années dites « de plomb », le combat politique
d’extrême-gauche a soudainement viré, en Italie, à l’extrémisme de la lutte armée.
La fille dont il est question n’est autre que Margherita Cagol, la compagne de Renato Curcio,
fondateur du mouvement Brigades Rouges dont la pièce, par un enchaînement de scènes qui
s’étalent sur une décennie (de 1965 à 1975), relate indirectement la naissance et la montée en
puissance.
Dans le double espace d’une cuisine et d’une chambre, on assiste à la transformation de la relation
père-fille et, surtout, à la maturation physique et intellectuelle de Margherita, personnage que
travaille, dès l’enfance, le sentiment de l’injustice. Adolescente studieuse, brillante étudiante,
titulaire d’un doctorat en sociologie, elle en arrive, sous l’influence de son compagnon Renato,
à la solution d’un engagement politique radical. Terrain sur lequel son père, représentant d’une
génération respectueuse des valeurs traditionnelles et de l’autorité cléricale, a bien du mal à la
suivre, malgré l’évidence d’une ascension sociale qui lui échappe et l’admiration qu’il porte à sa fille.
La petite histoire familiale s’apprête, ainsi, à faire les frais de la grande Histoire (« l’Histoire avec
sa grande hache », comme dit Georges Perec…). Le dialogue père-fille glisse progressivement
dans la langue de bois de la propagande, et la relation filiale se laisse broyer dans l’engrenage
du terrorisme émergeant. Autrement dit, le public contemporain auquel la pièce s’adresse (et
dont une partie se souvient avoir vécu ce dont on lui parle, tandis que l’autre découvre sans
doute ces événements…) assiste à ce moment de bascule historique à travers le regard et les
points de vue de deux personnages engagés dans une relation qui, de proche et sereine (au
début de la pièce) devient de plus en plus distante et problématique, pour finir de manière
irrémédiable. Car ce drame psychologique et familial est aussi une véritable tragédie, dans
la mesure où la pièce s’achève, en 1975, conformément à la vérité historique, avec la mort de
Margherita, tombée sous les balles des carabiniers.…
Le père perd sa fille en même temps que la gauche européenne perd ses illusions. Le terrorisme
armé, tel qu’il s’est développé alors en Italie et en Allemagne, peut être considéré comme
une tentative ultime et désespérée de résoudre l’injustice sociale qui bouleversait, dans la
scène d’exposition, la petite Margherita. Du fait de sa violence inadmissible et de son échec
impitoyable, il coïncide, plus d’une décennie avant l’effondrement du régime soviétique, avec la
fin des utopies progressistes et le renoncement généralisé aux « idéologies ».
Pour Michel Didym, le choix de Richard et Romane Bohringer comme interprètes des deux
personnages, ressortissait à une évidence. Encore fallait-il avoir, à portée de main, ces deux
monstres-sacrés, et avoir connaissance du fait que, n’ayant jamais encore partagé ensemble la
scène d’un théâtre, le désir de jouer ensemble les travaillait sourdement, au point qu’un projet
de cette nature n’obtiendrait pas seulement leur consentement, mais répondrait à leur vœu le
plus cher. Outre les qualités intrinsèques d’un texte juste, c’est le miracle de cette distribution
idéale (un père et une fille au théâtre comme à la ville) qui enflamme l’enthousiasme des
spectateurs, et ce jeu de la vérité et du théâtre qui saute aux yeux et aux oreilles, dès le début de
la pièce, lorsque Romane Bohringer lance le premier mot de la pièce, celui de la petite Mara :
« Papa ! ».
Olivier Goetz
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%