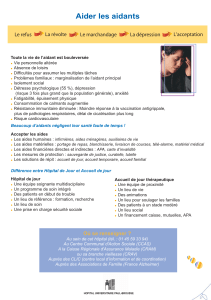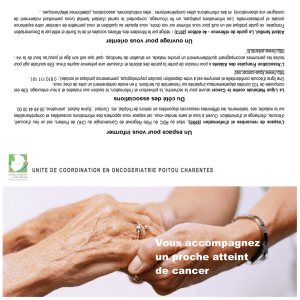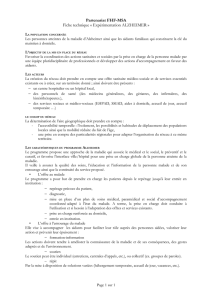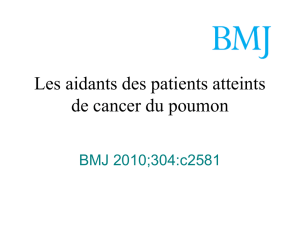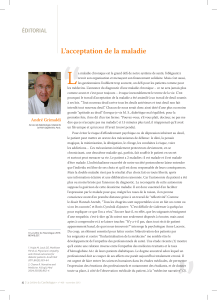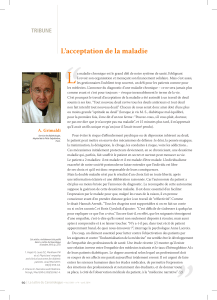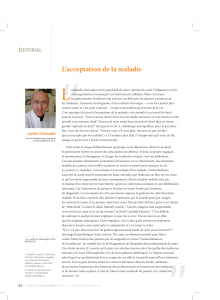RSI 89_BAT - Banque de données en santé publique

Evelyne MALAQUIN-PAVAN,
Cadre Infirmier Spécialiste Clinique, Hôpital Corentin-Celton, APHP
Marylène PIERROT,
Infirmière Conseillère de Santé, retraitée
ACCOMPAGNER UNE PERSONNE ATTEINTE
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER : ASPECTS SPÉCIFIQUES
DU DEUIL DES AIDANTS NATURELS ET PISTES DE SOUTIEN
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 89 - JUIN 2007
76
RECHERCHE
La maladie d’Alzheimer (DTA) entraîne chez le patient des
modifications comportementales, physiques et psychiques
auxquelles l’aidant naturel (famille – conjoint – enfant) va
devoir faire face tout au long de l’évolution de la maladie.
Les auteurs ont cherché à identifier la nature des pertes
vécues par les aidants afin d’en dégager des pistes de sou-
tien préventives et curatives.
Cette recherche-action exploratoire a été menée auprès
de 27 familles sous forme d’entretiens semi-directifs per-
mettant de mettre en évidence leurs difficultés (somatiques
– émotionnelles – affectives -organisationnelles), leurs réac-
tions d’adaptation en résonance avec les pertes du patient
au fil de l’évolution de la DTA ainsi que les éléments per-
mettant de maintenir ou pas le lien famille/proche malade.
L’analyse des résultats obtenus est proposée au regard des
concepts de l’adaptation, de l’attachement et de la séparation,
de l’approche systémique et du coping. Les propos et atti-
tudes des aidants sont mis en lien avec les symptômes du
deuil ainsi qu’avec les interactions soignantes aidantes ou pas.
Cinq temps chronologiques ont été identifiés (l’avant dia-
gnostic – le moment du diagnostic – le maintien à domicile
– l’entrée en institution – la vie en institution). La période
de deuil blanc (liée à la perte de la reconnaissance de ses
proches par le malade) est majoritairement ressentie
comme vecteur de souffrance.
Inscrites dans la dynamique du soutien social, les pistes d’in-
terventions infirmières proposées ciblent principalement
l’entrée et la vie en institution ; elles visent à offrir aux
aidants naturels un soutien adapté, qu’ils fassent le choix ou
pas d’accompagner leurs proches malades tout au long de
l’institutionnalisation.
En annexes, comparaison avec le processus de deuil et
regroupement d’idées-forces aidant à repérer les éléments
facilitant le maintien du lien aidant/proche malade ou d’ac-
célérant sa rupture.
Mots clés : Alzheimer - aidants naturels – pertes - deuil
blanc -adaptation – systémique - soutien social – inter-
ventions infirmières.
RÉSUMÉ
Supporting a person affected by Alzheimer’s
disease : specific aspects of the natural hel-
pers and support tracks
Alzheimer’s disease (DTA) leads to some behavioural, phy-
sical and psychic modifications in the patient that the natu-
ral helper (family-spouse-child) will have to face throughout
the course of the disease. The authors have tried to identi-
fy the nature of losses experienced by helpers so as to bring
out some preventive and curative support tracks.
This preparatory research-action was conducted with
27 families through semi-directive conversations which
enabled to reveal their difficulties (somatic-emotional-affec-
tive-organizational), their reactions of adaptation in echo
with the losses of the patient along the course of the DTA
as well as the elements enabling to maintain or not the ill
person’s family/close relation link.
The analysis of obtained results is proposed according to
the concepts of adaptation, affection and separation, syste-
mic approach and coping. The comments and behaviours of
helpers are put in relation with the symptoms of mourning
as well as with the medical interactions, helper or not.
Five chronological times were identified (before diagnosis-
moment of the diagnosis-keeping at home-admission in ins-
titution-life in institution). The period of white mourning
(connected to the loss of the recognition of his/her close
relations by the patient) is mainly felt as a vector of suffering.
As part of the dynamics of social support, the proposed tracks
of nursing interventions mainly target the admission and life in
institution ; their aim is to offer an adapted support to natural
helpers, whether they make the choice or not to support
their close patients throughout the institutionalization.
In appendices, all the key ideas helping to track down the ele-
ments contributing to maintain the ill person’s helper/close
relation link or accelerating his/her breaking down.
Key words : Alzheimer-natural, helpers-family-losses-
mourning-pre-mourning-white, mourning-affection-adap-
tation-coping-systems, analysis-social, support-nursing
interventions.
ABSTRACT
Travail de recherche effectué dans le cadre d’un mémoire pour l’obtention du Diplôme Universitaire « Le deuil dans la
formation des soignants et des accompagnants », U.F.R. Bobigny, Université Paris Nord, Promotion 1995-1997.

CHEMINEMENT CLINIQUE
ET CONCEPTUEL
En lien avec notre pratique infirmière gériatrique, la pré-
sentation de cette recherche respecte le cheminement
cognitif permettant d’intégrer, au regard de nos connais-
sances antérieures, celles issues de l’enseignement du
Diplôme Universitaire précité complétées par une litté-
rature ciblée. La méthodologie adoptée a été la suivante :
- définition de la problématique à partir du cadre habituel de
référence basé principalement sur les décrets de compé-
tences et règles professionnelles relatifs à l’exercice infirmier,
le modèle conceptuel de soins infirmiers de Callista ROY
(notamment les données des diagnostics infirmiers Stratégies
d’adaptation individuelle ou familiale inefficaces), la systémique
familiale et les connaissances scientifiques gérontologiques
ayant trait à la démence de type Alzheimer (DTA) ;
- questionnement autour des répercussions de la DTA
sur le processus d’attachement et de séparation des
aidants naturels, sur les pertes successives irréversibles
qui peuvent conduire à la rupture anticipée du lien ;
- élaboration d’un guide d’entretien à questions ouvertes
visant à explorer la chronologie adaptative des aidants
naturels dans l’évolution de leur relation avec les aidés ;
- réalisation des 27 entretiens respectant les caractéris-
tiques de l’entretien d’aide infirmier (écoute active,
empathie, reformulation, évaluation des éventuelles
répercussions post-entretiens avec contacts télépho-
niques ou nouvelle rencontre, …) ;
- exploitation des entretiens bruts analysés par une mise en
lien avec la littérature spécifique pour identifier des idées-
forces rémanentes dans la chronologie adaptative de l’ai-
dant, les aspects spécifiques du deuil et repérer des para-
mètres favorisant le maintien ou la rupture de la relation ;
- rédaction de propositions de pistes de soutien.
Problématique
Dans nos activités d’infirmières conseil intervenant dans
des secteurs gérontologiques, nous sommes amenées à
rencontrer des aidants naturels (proches, familles,
conjoints, enfants, fratrie, amis…) qui accompagnent leurs
personnes âgées (aidés) souffrant de démence de type
Alzheimer, et à soutenir les équipes référentes qui assu-
rent les soins sur les 24 heures. Outre les répercussions
habituelles de l’entrée d’un proche en institution, ces
familles sont confrontées à des défis spécifiques liés à
l’évolution même de la maladie de leur proche :
• lourdeur des soins de suppléance dans les activités quo-
tidiennes, ce qui conduit souvent à l’entrée en institu-
tion par épuisement, découragement ou incapacité à
faire face ;
• incompréhension de certains comportements dysfonc-
tionnels (tels que l’errance, les cris, l’agressivité, l’apa-
thie…) présentés par la personne âgée souffrante ;
• impuissance de ne pas ou de ne plus savoir quoi faire ou
comment garder le lien avec celui qui devient «un étran-
ger»-» quelqu’un d’autre»1du fait de la transformation de
sa personnalité initiale, du déficit de communication ver-
bale (aphasie, amnésie…) et/ou non verbale (absence ou
manque de signes de reconnaissance de l’environnement,
de lui-même, de ses proches), de l’absence de validation
en réponse aux stimuli de l’entourage, sans savoir com-
ment pouvoir décoder ce nouveau langage corporel du
patient, empêchant ces aidants de comprendre ou de
rejoindre le «monde intérieur» de ce dernier.
Ces modifications du comportement et de la personna-
lité sont souvent à l’origine de stratégies d’adaptation
familiale inefficaces par :
• modification de la répartition des rôles dans la famille
(fratrie, enfants «maternants»),
• impuissance à répondre aux désirs du proche malade
(«rentrer chez lui», «trouver le sac volé» …),
• usure physique et psychologique au moment où le relais
est passé à l’institution,
• perte du sens de l’échange et de la relation,
• absence de feed-back et de gratification reçus du proche
malade,
• désappointement devant un certain état de mieux être
après l’entrée en institution,
• soucis financiers dus au paiement du prix de journée,
compliquant la relation et pouvant conduire à l’hostilité
face au proche malade.
Eprouvant nous-mêmes de la difficulté à soutenir ces
aidants naturels en crise et leurs soignants référents
(notamment dans leurs interactions parfois conflic-
tuelles avec des familles jugées peu ou « mal pré-
sentes»), nous avons entrepris ce D.U. pour mieux cer-
ner les aspects spécifiques du deuil chez cette
population ciblée. Malgré les compléments de connais-
sances concernant les mécanismes du deuil chez
l’adulte, la personne âgée et l’enfant, les aspects spé-
cifiques à la maladie d’Alzheimer ont été peu traités.
Pourtant, bien qu’isolées les unes des autres, nos
observations cliniques antérieures nous conduisent à
penser que l’histoire de la relation aidant-aidé est ponc-
tuée, au rythme des pertes dues à la DTA, par des
temps/moments-clef où sont sollicités de manière par-
ticulière les mécanismes d’adaptation. Il y aurait ainsi
une chronologie adaptative en 6 grands temps : l’avant
diagnostic, le moment du diagnostic, le maintien
au domicile, l’entrée en institution, la vie dans l’insti-
tution jusqu’au décès, l’après décès… avec, associée à
ACCOMPAGNER UNE PERSONNE ATTEINTE
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER : ASPECTS SPÉCIFIQUES
DU DEUIL DES AIDANTS NATURELS ET PISTES DE SOUTIEN
RECHERCHE
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 89 - JUIN 2007 77
1Les propos en italique sont les mots empruntés au discours des aidants naturels.

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 89 - JUIN 2007
78
l’évolution des comportements dysfonctionnels déjà
difficiles à vivre, une perte essentielle : celle de la
reconnaissance des visages et des personnes qui
peut se produire à tout moment.
Mélange de connaissances, de concepts et d’intuition, ce
constat nous a amenées à nous pencher sur «cette
affaire de famille»2et sur les problématiques de deuil
qui peuvent en découler, orientant cette recherche sur
les aspects spécifiques du deuil tels que racontés par
des aidants naturels accompagnant leur proche souf-
frant de DTA.
Définition des termes et concepts
Aidant : désigne le proche qui a ou a eu un lien fami-
lial ou amical avec la personne malade (au sens d’ai-
dant naturel ou de soignant naturel).
Aidé : désigne la personne âgée souffrant de démence
de type Alzheimer.
Soignant : désigne le professionnel de santé (aide-soi-
gnante, infirmière).
Démence de type Alzheimer ou DTA : désigne un
tableau clinique qui implique une détérioration des
fonctions cognitives survenant dans un état de
conscience normal, d’une gravité suffisante pour avoir
des répercussions sur le comportement social, pro-
fessionnel et sur la personnalité. Le diagnostic de
DTA s’effectue en éliminant les autres affections qui
entraînent des symptômes semblables. La DTA est
un type de démence dont l’issue est irrémédiable
actuellement.
Déficits cognitifs : ensemble de symptômes d’ordre
mental pouvant se traduire, à différents degrés d’inten-
sité et de présence, par des pertes de mémoire, des
perturbations de la pensée, des difficultés de jugement,
d’attention, de concentration, de la désorientation tem-
poro-spaciale, de la labilité émotionnelle et des troubles
du langage.
Comportements dysfonctionnels : la personne âgée
atteinte de démence présente des troubles fonction-
nels entraînant des comportements qualifiés de dys-
fonctionnels parce qu’ils l’empêchent d’accomplir ses
activités quotidiennes, sociales et/ou professionnelles
de la même façon qu’avant sa maladie. Ce sont, en par-
ticulier, la fugue et l’errance, les cris, les mouvements
répétitifs, l’écholalie, l’apathie, l’agitation…
Attachement : «L’attachement peut être défini comme une
relation discriminative, établie avec un objet ou une personne
privilégiée. Le comportement observable consiste en une suite
d’interactions qui visent à maintenir et consolider la relation,
à provoquer un rapprochement physique. L’attachement appa-
raît comme un phénomène primaire nécessaire à l’établisse-
ment de relations sociales ultérieures satisfaisantes»3.
Perte : «La perte peut être définie comme la séparation
avec quelque chose qui constitue une partie de l’individu ou
qui lui appartient. Ce quelque chose peut être une personne
qui vient à lui manquer par décès, ou de toute autre
manière, qui met fin à la relation»4 (séparation, divorce,
maladie…). Toute perte significative entraîne la néces-
sité d’un travail de deuil. S’il s’agit d’une personne, la
perte n’en est pas forcément liée à la mort qui demeure
pourtant le paradigme du travail de deuil même s’il la
déborde largement. La mort imprime au deuil un carac-
tère particulier en raison de sa radicalité, son irréver-
sibilité, son universalité, son implacabilité. Elle oblige au
deuil alors qu’une séparation non mortelle laisse tou-
jours au début l’espoir de retrouvailles5.
Deuil : du bas latin dolus de dolere : souffrir - Larousse
(1995) «état de perte d’un être cher» ; Freud S. (1917)
«réaction à la perte d’un objet d’attachement» ; Hanus
M. (1976) «le deuil exprime toutes les relations et atti-
tudes consécutives à une perte ou à une séparation».
Travail de deuil : «Processus intra psychique, consécutif
à la perte d’un objet d’attachement et par lequel le sujet
réussit progressivement à se détacher de celui-ci»6.Le tra-
vail de deuil est consécutif à la perte - et pas unique-
ment lorsqu’elle est provoquée par la mort - à toute
perte, en particulier d’une valeur, dès lors que ce qui
est perdu avait grande importance pour celui qui en
est frappé7. Le travail de deuil est terminé quand l’en-
deuillé peut «remplacer l’absence effective par une pré-
sence intérieure». Ce travail mobilise une grande éner-
gie qui démobilise pour le reste8.
Pré-deuil : désigne ici le temps d’élaboration psychique
de désinvestissement progressif portant sur certaines
pertes précédant la mort physique. Le véritable travail
de deuil ne se vit qu’après la perte effective de la per-
sonne. L’évolution spécifique par pallier de dégrada-
tion de la démence d’Alzheimer amène l’entourage à
vivre un certain nombre de pertes progressives et suc-
cessives qui sont autant de pré-deuils : renoncement à
un destin ou projets communs, à l’image physique anté-
rieure de l’autre, à la communication et aux échanges
avec lui… Le proche est obligé de vivre au jour le jour,
d’investir le présent comme si l’avenir n’existait pas
tout en maintenant une capacité d’espérance,
d’échange, de présence et d’énergie, pour lui-même
et la personne malade.
2LEVESQUE L., ROUX C., LAUZON S. «Alzheimer : comprendre pour mieux aider». Coll. ERPI -1990, p. 262
3BOLWBY J. «Attachement et perte». PUF Paris, 1984
4HANUS M. «les deuils dans la vie», Maloine, 1994, p 89.
5HANUS M. «Les deuils dans la vie». Maloine, 1994 - p. 93
6LAPLANCHE J., PONTALIS J.B. «Vocabulaire de la psychanalyse», PUF
7HANUS M. «Les deuils dans la vie». Maloine, 1994, p. 93
8PILLOT J. «Deuil et pré-deuil». Bulletin JALMAV n° 4, mars 1986 p. 12

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE ATTEINTE
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER : ASPECTS SPÉCIFIQUES
DU DEUIL DES AIDANTS NATURELS ET PISTES DE SOUTIEN
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 89 - JUIN 2007 79
Il vit une grande part de solitude, d’incertitude. PILLOT
J.9, MAZET P.10 et CORNILLOT P.11 distinguent la capa-
cité d’anticipation de l’être humain (délire anticipa-
toire) du deuil anticipé qui se ferait du vivant de la per-
sonne. Souvent, mort et deuil sont synchrones. La
mort brutale marque la rupture de l’anticipation. A
l’inverse, le deuil préparé permet d’anticiper, sans rup-
ture de relation entre la personne qui vit le deuil et
celle qui est l’objet du deuil bien que non encore
accompli par la mort. Le terme de pré-deuil semble
ici approprié. L’entourage reste impliqué dans la rela-
tion. Certains auteurs ne distinguent pas ce pré-deuil
du deuil anticipé. Ainsi LINDERMANN (1944) nomme
deuil anticipé «les expériences émotionnelles vécues par
certaines personnes avant qu’elles ne perdent un être
cher»12. ALDRICH (1963) définit le deuil d’anticipation
comme «tout deuil qui se produit avant la perte»12, tra-
vaux repris par COSTELLO J. (1996) qui ne fait pas
non plus de distinction en lien avec la mort. On peut
se demander si le débat sur le bien-fondé de «l’antici-
pation de la perte pour augmenter les chances d’obtenir un
ajustement satisfaisant après le décès» décrit par GLICK
& PARKES (1974) ne vient pas de cet amalgame séman-
tique.
Deuil anticipé : «Processus psychologique par lequel peu-
vent passer certains proches déjà pendant l’accompagne-
ment du malade, qui consiste à prendre une grande dis-
tance, réelle ou affective, par rapport au malade, le mettant
déjà au rang des disparus»13. Mécanisme inconscient, il
serait une sorte de mécanisme de défense, de pro-
tection pour l’entourage, visant à un détachement pré-
coce, afin qu’au moment de la mort la perte soit moins
déchirante. Le mourant serait peu à peu désinvesti
avant même d’avoir disparu. Ce phénomène peut être
induit ou renforcé par certaines attitudes médicales
délivrant prématurément aux familles des pronostics
souvent aléatoires et trop rapides, les entraînant à ne
plus pouvoir investir l’autre comme un vivant, entraî-
nant au minimum «un épuisement des motivations, un
rétrécissement de la relation»14 voire une absence totale
de relation. Le lien se rompt à l’initiative du survivant.
Il peut en résulter de la culpabilité, le survivant se pré-
munit contre la fin, la mort mais aussi contre l’antici-
pation heureuse. On pourrait parler de deuil préma-
turé15.
Deuil blanc : désigne ici la réaction à la perte de la
relation d’échange en lien avec une maladie des fonc-
tions supérieures. Certains auteurs comparent les
réactions des familles des personnes atteintes de DTA
à celles des familles qui vivent un deuil (TEUSINK et
MAHLER, 1984). Cependant, au contraire de la mort
qui arrache l’individu à son milieu, la DTA, par son
début insidieux et son évolution graduelle, vient com-
pliquer la phase d’acceptation et fait durer la douleur
(BARNES et AL, 1981) ; ce qui amène un deuil incom-
plet (KAPUST, 1982) ou un veuvage émotif
(LABARGE, 1981)16. Pour POLETTI R.A., «l’accompa-
gnement d’une personne qui, petit à petit, perd ses capa-
cités mentales parce qu’atteinte de sénilité ou de maladie
d’Alzheimer expose au deuil blanc ; ce qui disparaît, ce
dont il faut faire le deuil, c’est avant tout de la relation ver-
bale et de la possibilité de communiquer pleinement avec
la personne atteinte dans son cerveau. D’où pour l’entou-
rage deuil de la relation qui existait avant la maladie, deuil
du rôle, deuil de la normalité, perte de la prédictibilité, perte
du sens»17.
Questionnement et hypothèse
Au terme de cette étape, les questions soulevées à
l’origine du choix des outils d’enquête (forme et fond)
ont été les suivantes :
• Comment l’aidant fait-il face à ces différents moments
chronologiques ?
• A quelles pertes est-il confronté ?
• En quoi les réactions (comportements, émotions,
pensées, actions) aux pertes successives, au fur et à
mesure de cette chronologie, influencent-elles la rela-
tion aidant-aidé ?
• Quelles stratégies d’adaptation utilisent l’aidant pour
faire face au deuil blanc ?
• Qu’est-ce qui favorise le pré-deuil et/ou le deuil anti-
cipé ?
Par projection, l’hypothèse initiale identifiée pouvait
se résumer telle que : la perte de sens, associée à la
perte de la relation (deuil blanc), est à l’origine
d’une rupture de liens (deuil anticipé). Le schéma
ci-après illustre la représentation mentale de départ
de cette étude clinique.
9PILLOT J. Déjà cité
10 MAZET P. Notes de cours D.U. Deuil. Oct. 1996
11 CORNILLOT P. Notes de cours D.U. Deuil. Oct. 1996
12 COSTELLO J. «Le coût émotif des soins palliatifs». European Journal of Palliative care, n° 3, 1996
13 PILLOT J. Déjà cité
14 PILLOT J. Déjà cité
15 CORNILLOT P. Déjà cité
16 Cités par LEVESQUE L., ROUX C., LAUZON S. «Alzheimer : comprendre pour mieux aider». Ed. ERPI - 1990
17 POLETTI R.A., DOBBS B. «Vivre son deuil et croître». Ed. Jouvence, 1993

RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 89 - JUIN 2007
80
ENQUÊTE AUPRÈS DES AIDANTS
NATURELS
Profil de l’échantillon
Basé sur des questions ouvertes, le guide d’entretien
visait à favoriser la narration de l’histoire de vie autour
des différentes périodes d’adaptation à la maladie de
l’aidé (avant l’annonce du diagnostic - lors de l’annonce
du diagnostic - lors de la décision d’institutionnaliser
l’aidé - lors du séjour dans l’institution - au moment
du décès).
Le lieu d’entretien a été celui choisi par l’aidant, à son
domicile ou dans un lieu institutionnel. La durée
moyenne a été de 1h30 [1h15-2h30] pour un nombre
de 1 à 2 entretiens par aidant.
Avec pour seuls critères d’inclusion le fait d’avoir un
proche atteint de DTA et d’être volontaire pour par-
ticiper à l’enquête, l’échantillon total s’est composé de
27 aidants naturels (tableau ci-contre) habitant en Eure-
et-Loir et Ile-de-France, recrutés soit dans nos services
gériatriques d’exercice, soit par signalement de col-
lègues infirmières, médecins libéraux ou hospitaliers.
La présentation des résultats est proposée par
périodes, mettant en lien concept et propos recueillis.
Deux caractéristiques particulières sont à noter pour
un futur travail :
• 3 aidés sur 27 étaient déjà décédés au moment des
entretiens. Le récit/réminiscence des aidants n’est
pas apparu fondamentalement différent du reste du
groupe, malgré les années écoulées depuis la mort
[3 à 10 ans]. L’acuité émotionnelle reste encore vive.
Les données concernant le deuil après la mort phy-
sique de l’aidé n’ont pas été exploitées puisque hors
sujet pour la majorité de ces aidants.
• Seuls 2 aidants présentant un processus de deuil anti-
cipé (dont 1 en rupture totale de liens clairement
énoncée) ont été inclus difficilement puisque la plu-
part d’entre eux ne viennent plus voir leurs proches
malades. Aucun entretien n’a pu être réalisé auprès
d’autres aidants absents pour mesurer les similitudes
et/ou les différences dans les pertes vécues et les
stratégies d’adaptation adoptées, ce qui serait en soi
un réel travail de prévention de santé publique à
investir avec les réseaux du domicile pour soutenir
cette population particulièrement exposée.
Forme des entretiens
La confidentialité et la restitution non linéaire des
entretiens ont été énoncées à chaque rencontre
comme pré-requis. Le respect des temps de silence a
entraîné soit la reprise de la parole sur un autre aspect,
soit l’approfondissement d’un point cité plus succinc-
tement auparavant, soit l’entrée dans une émotion
contenue jusque-là intérieurement.
Les événements ont été très souvent narrés sponta-
nément, l’un faisant repenser à un autre sans respect
de leur chronologie réelle, maillés de souvenirs très
précis exprimés comme des «détails marquants» dans
leur histoire de vie. Tous les aidants ont exprimé phy-
siquement leurs émotions, tristesse, colère, et joie avec
deux grandes tendances :
• une économie de mouvements, une expression rési-
gnée, monocorde, avec une respiration superficielle
et une charge émotionnelle contenue ; comme si la
route parcourue déjà longue avait aidé à intégrer,
digérer, même si la plupart ont exprimé combien le
fait de prendre ce temps pour en parler avait été
bénéfique. 75 % ont exprimé des émotions de tris-
tesse par des larmes ou sanglots et des silences,
hochements de tête, regards bas ou cherchant le sou-
tien, phrases suspendues, …
• une expression volubile, rythmée, débitée d’un ton vif
voire agressif parfois, passionné, avec une gestuelle
abondante, des émotions de colère, de tristesse, des
comportements de déni, une respiration superficielle
et des regards centrés ou fuyants.
Processus attachement-séparation-deuil chez l’aidant D.T.A.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%