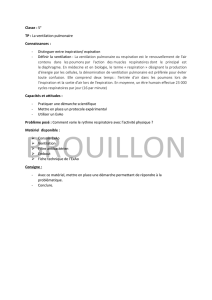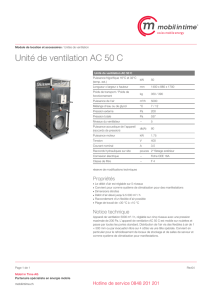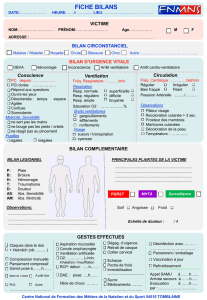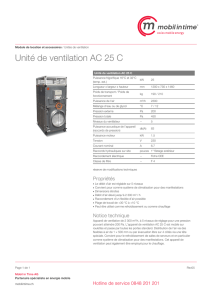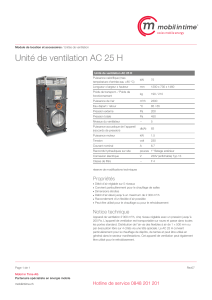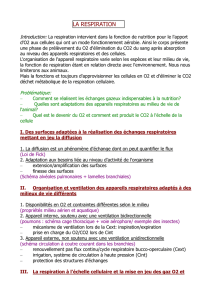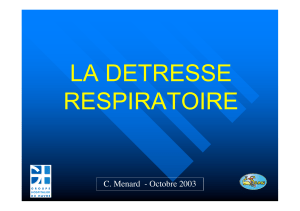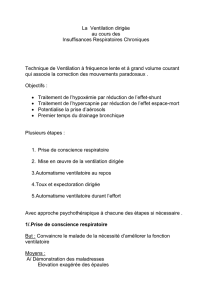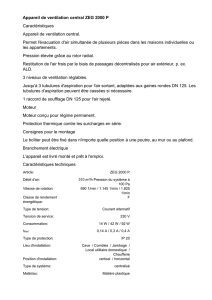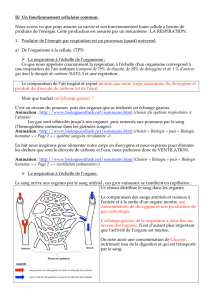Respiration spontanée : un autre aspect de la ventilation protectrice

© Drägerwerk AG & Co. KGaA 1
L'anesthésie générale avec blocage neuromusculaire et la ventilation contrôlée
consécutive sont soupçonnées d'être une cause majeure d'atteinte respiratoire.
Outre les paramètres de la ventilation contrôlée, la respiration spontanée
peropératoire pourrait bien être l'une des voies d'amélioration. Cet article présente
des perspectives intéressantes concernant des idées basées sur la littérature.
Ventilation protectrice dans la salle d'opération
Respiration spontanée:
un autre aspect de la ventilation
protectrice peropératoire?

© Drägerwerk AG & Co. KGaA 2
RESPIRATION SPONTANÉE: UN AUTRE ASPECT DE LA VENTILATION PROTECTRICE PEROPÉRATOIRE?
Ceci s'applique également aussi bien aux patients anesthésiés ayant
des poumons sains qu'aux patients présentant un dysfonctionnement
pulmonaire substantiel. La raison supposée en est le rôle du
diaphragme. En situation de repos pharmacologique, la pression
hydrostatique intra-abdominale pousse contre le diaphragme, ce qui
le déplace davantage vers le crâne, augmentant de fait la pression
de l'antérieur vers le postérieur. Cela contrecarre, voire empêche
les mouvements du diaphragme dans les régions pulmonaires
dépendantes, générant ainsi un déplacement de la ventilation vers
les régions pulmonaires non dépendantes et laissant les régions
pulmonaires dorsales proches du diaphragme moins ventilées ou
atélectatiques. Le moment venu, le volume courant administré
mécaniquement est dirigé principalement vers les parties antérieures
non dépendantes et moins alimentées du poumon, générant de fait
le déséquilibre V/Q mentionné plus tôt5.
...qui s'uniformise
Pendant la respiration spontanée, les parties postérieures du
diaphragme sont plus en mouvement que la plaque de tendon
antérieur, ce qui crée une meilleure ventilation dans les régions
pulmonaires dépendantes, même en position couchée sur le dos.
Ainsi, la correspondance V/Q est meilleure car le diaphragme peut
faire opposition à la compression alvéolaire1,5. L'aération améliorée
des régions pulmonaires juxtadiaphragmatiques est la source d'une
capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) supérieure, associée à une
respiration spontanée1.
Fig.2: image CT (C) d'un patient aux poumons normalement aérés, représentant la
distribution de l'air dans les régions. Image EIT (D) représentant une distribution
homogène de la ventilation.
Divers aspects de la protection des poumons pendant l'anesthésie
générale ont fait l'objet de débat au cours des dernières années.
Nous avons rassemblé pour vous les éléments probants et
recommandations issus de la littérature. La discussion s'est
principalement centrée sur la ventilation mécanique contrôlée,
qui semble faire l'unanimité puisqu'un grand nombre d'opérations
exigent la relaxation neuromusculaire et requièrent ainsi la mise en
place de méthodes de protection de la ventilation mécanique.
Il convient cependant de prendre en compte le fait que la relaxation
neuromusculaire et la ventilation en pression positive consécutive
(obligatoire) semblent être des facteurs signi catifs, eux-mêmes
entraînant une atteinte respiratoire, voire potentiellement les
complications pulmonaires postopératoires citées plus haut, que la
ventilation protectrice a tendance à contrebalancer. Il ne semblerait
donc pas abérant de se demander si la respiration spontanée aussitôt
que possible vers la n de l'anesthésie générale, voire peu de temps
après la sécurisation des voies aériennes, ne serait pas plus béné que.
Conseil : pour plus d'informations techniques de référence,
consultez notre livre électronique «Perspectives technologiques».
Une distribution inégale...
Des études d'imagerie menées chez les animaux ont démontré que
la ventilation n'est pas répartie de manière physiologique pendant
la ventilation obligatoire continue (CMV). Au cours de la CMV,
la ventilation passe vers les régions pulmonaires antérieures, non
dépendantes et moins alimentées, ce qui entraîne le déséquilibre
du rapport ventilation/perfusion (V/Q), phénomène bien connu1.
Fig. 1 : image CT (A) d'un patient souffrant de collapsus pulmonaire dorsal,
représentant la distribution de l'air dans les régions. Image EIT (A) d'un patient
souffrant d'une atteinte pulmonaire comparable, représentant la distribution de la
ventilation dans les régions.
A. Collapsus pulmonaire, B. Collapsus pulmonaire, par image EIT
par image CT
C. Poumon normalement aéré,
par image CT
10%
40%
41%
9%
6%
38%
54%
2%
D. Poumon normalement aéré, par image EIT

© Drägerwerk AG & Co. KGaA 3
RESPIRATION SPONTANÉE: UN AUTRE ASPECT DE LA VENTILATION PROTECTRICE PEROPÉRATOIRE?
Excursion diaphragmatique
Les informations ci-dessus ont également été conrmées par une
recherche étudiant l'excursion diaphragmatique par radioscopie
diaphragmatique pendant la respiration spontanée et pendant la
ventilation en pression positive. Le diaphragme était divisé en trois
segments: supérieur (ventral, non dépendant), central et inférieur
(dorsal, dépendant) an d'analyser les différences. Pendant la
respiration spontanée normale, l'excursion diaphragmatique totale
était signicativement supérieure par rapport aux inspirations
en pression positive. Les données de cette étude montrent
clairement qu'en cas de respiration spontanée, la majeure partie de
l'excursion diaphragmatique est observée dans la région inférieure,
dépendante, qu'il s'agisse d'une inspiration normale ou profonde.
Pendant la ventilation en pression positive, l'excursion
diaphragmatique était moins présente dans la partie inférieure
dépendante, mais plutôt dans la partie supérieure non dépendante,
lorsque des volumes courants inférieurs étaient appliqués.
Ce n'est qu'avec l'application de volumes courants plus importants
que l'excursion diaphragmatique était plus ou moins égale dans
les parties supérieure et inférieure du diaphragme2. Ce point est
tout à fait notable dans le cadre des discussions sur la ventilation
pulmonaire protectrice, qui requiert des volumes courants réduits.
Aide nécessaire
Il semble que la respiration spontanée puisse être la source
de meilleures conditions de ventilateur par rapport à la CMV.
Mais pendant une intervention chirurgicale, les anesthésiques,
notamment les opioïdes, gênent la respiration spontanée parce
qu'ils génèrent une dépression respiratoire7. La comparaison
entre l'anesthésie générale utilisant l'isourane ou le sévourane
avec la ventilation en pression positive (VPP) ou la respiration
spontanée a permis de noter que la VPP a offert de meilleurs
résultats respiratoires par rapport à la respiration spontanée,
spécialement en ce qui concerne l'oxygénation et le CO2 expiré.
Aucune différence n'a été observée concernant les paramètres
hémodynamiques. Toutefois, lors de cette étude, les tentatives de
respiration spontanée n'étaient assistées par aucun moyen actif8.
Brimacombe et al. ont réalisé des tests an de déterminer si l'aide
inspiratoire avec PEP permettrait d'obtenir de meilleurs résultats
par rapport à l'application de CPAP uniquement, sans assistance
en volume courant. Les résultats montrent clairement que l'aide
inspiratoire entraîne une saturation supérieure en oxygène, des valeurs
de CO2 expiré inférieures et des volumes courants expirés supérieurs
par rapport à une CPAP sans assistance en volume courant, offrant
ainsi un échange gazeux plus ecace3. Dans un autre essai, Bosek
et al. ont déterminé que l'aide inspiratoire avec une pression titrée
pour produire un Vt proche de la normale (physiologique) améliore
l'ecacité de la respiration spontanée pendant l'anesthésie par
inhalation, car elle abaisse la fréquence respiratoire et la PaCO2 tout
en préservant l'homéostase hémodynamique4.
Mais la respiration spontanée peropératoire renferme un autre
aspect qui s'étend jusqu'à la période postopératoire. L'essai
mentionné plus tôt par Keller et al. a également déterminé que le
délai d'émergence de l'anesthésie générale avec sévourane a été
réduit de 12minutes à 6minutes lorsque les patients respiraient
spontanément pendant l'anesthésie générale8. Cette découverte a
été tout récemment conrmée par un ECR de Capdevilla et al., qui
suggère que l'aide inspiratoire peropératoire chez les patients avec
masque laryngé réduit le délai d'émergence de l'anesthésie ainsi que
la consommation de propofol par rapport à la ventilation obligatoire
continue. En outre, ils ont déterminé que l'aide inspiratoire améliorait
la fonction respiratoire et ne causait aucun effet secondaire6.
Fig.3: L'activité diaphragmatique pendant la respiration spontanée favorise la
redistribution du gaz dans les zones dépendantes, bien alimentées.
Position du diaphragme
après l'expiration
Position du diaphragme
après l'inspiration

© Drägerwerk AG & Co. KGaA 4
RESPIRATION SPONTANÉE: UN AUTRE ASPECT DE LA VENTILATION PROTECTRICE PEROPÉRATOIRE?
CONCLUSION
Les informations contenues dans ce document ont pour objet de présenter la respiration spontanée comme
un composant potentiellement intéressant de la ventilation protectrice des poumons en salle d'opération pour
une meilleure distribution de la ventilation. Cependant, si la ventilation mécanique reste également à envisager,
voire une nécessité absolue pour divers patients et opérations, la respiration spontanée pourrait constituer
une option de choix à l'avenir pour encore plus d'indications qu'on ne le prévoit aujourd'hui. Des recherches
supplémentaires sont nécessaires pour déterminer ces indications et apporter des éléments probants de
l'ecacité de la respiration spontanée en ventilation peropératoire.
9102245
IMPRINT
ALLEMAGNE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542Lübeck
www.draeger.com
Plus d'infos sur notre site Web
– plus d'informations sur la ventilation protectrice en phase de récupération/de réveil
– plus d'informations sur la ventilation protectrice en phase de maintien
– plus d'informations sur la ventilation protectrice en phase d'induction
– vue d'ensemble de la ventilation protectrice

© Drägerwerk AG & Co. KGaA 5
RESPIRATION SPONTANÉE: UN AUTRE ASPECT DE LA VENTILATION PROTECTRICE PEROPÉRATOIRE?
1. Neumann P, Wrigge H, Zinserling J, et al. Spontaneous breathing affects the spatial ventilation and perfusion distribution during mechanical ventilatory support. Crit
Care Med. 2005 May;33(5):1090-5. Lien
2. Kleinman BS, Frey K, VanDrunen M, et al. Motion of the diaphragm in patients with chronic obstructive pulmonary disease while spontaneously breathing versus during
positive pressure breathing after anesthesia and neuromuscular blockade. Anesthesiology. 2002 Aug;97(2):298-305. Lien
3. Brimacombe J, Keller C, Hörmann C. Pressure support ventilation versus continuous positive airway pressure with the laryngeal mask airway: a randomized crossover
study of anesthetized adult patients. Anesthesiology. 2000 Jun;92(6):1621-3. Lien
4. Bosek V1, Roy L, Smith RA. Pressure support improves eciency of spontaneous breathing during inhalation anesthesia. J Clin Anesth. 1996 Feb;8(1):9-12. Lien
5. Putensen C, Muders T, Varelmann D, Wrigge H. The impact of spontaneous breathing during mechanical ventilation. Curr Opin Crit Care. 2006 Feb;12(1):13-8. Lien
6. Capdevila X, Jung B, Bernard N, et al. Effects of pressure support ventilation mode on emergence time and intra-operative ventilatory function: a randomized controlled
trial. PLoS One. 2014 Dec 23;9(12):e115139. Lien
7. Dahan A, Aarts L, Smith TW. Incidence, Reversal, and Prevention of Opioid-induced Respiratory Depression. Anesthesiology. 2010 Jan;112(1):226-38. Lien
8. Keller C, Sparr HJ, Luger TJ, Brimacombe J. Patient outcomes with positive pressure versus spontaneous ventilation in non-paralysed adults with the laryngeal mask.
Can J Anaesth. 1998 Jun;45(6):564-7. Lien
RÉFÉRENCES
1
/
5
100%