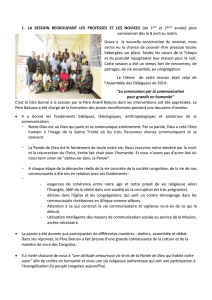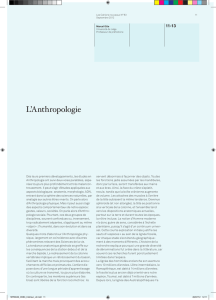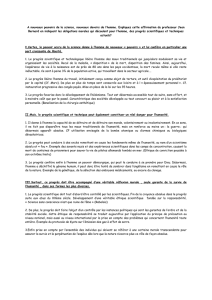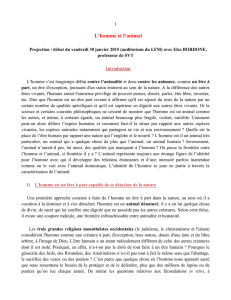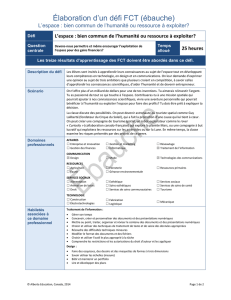Chapitre 1 : la culture Problématique générale du chapitre 1 : qu`est

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2015-2016
Cours Olivier Verdun
1
Chapitre 1 : la culture
Problématique générale du chapitre 1 : qu’est-ce qu’un homme ?
La question « Qu’est-ce qu’un homme ? » ou « Qu’est-ce que l’homme ? » est la question
centrale de la philosophie, qui recoupe, selon Kant, toutes les autres questions : « Que puis-je
connaître ? », « Que dois-je faire ? », « Que puis-je espérer ? ». La question « Qu’est-ce
que ? » est du reste le commencement de la sagesse, car elle suppose la suspension
provisoire de toute relation purement pragmatique aux choses, aux actes, au langage. Il s’agit
de s’interroger sur l’essence de la chose examinée, sur ce qu’il y a d’identique, d’universel
dans toutes ses manifestations. On entend par « essence » ce par quoi la chose est ce qu’elle
est, ce qui la définit en propre.
A la question « Qu’est-ce qu’un homme ? », les réponses, dans l’histoire de la philosophie,
ne manquent pas : on a pu ainsi définir l’homme comme un animal politique qui parle
(Aristote), un animal à deux pieds sans plumes (Platon), un être qui rit (Rabelais), qui pense
(Descartes), qui juge (Kant), qui travaille (Marx) ou qui crée (Bergson). Or ces définitions
sont trop étroites, puisqu’elles ne valent pas pour tous les hommes : le débile profond, qui ne
parle pas, ne raisonne pas, ne juge pas, ne travaille pas, ne fait pas de politique, n’en est pas
moins homme pour autant. Un homme reste un homme, même quand il a cessé de
fonctionner normalement. En sorte que l’humanité ne se définit pas par ce qu’elle fait ou sait
faire. Par ce qu’elle est ? Sans doute. Mais qu’est-elle ?
Poser la question « Qu’est-ce que l’homme ? », c’est se demander si l’on peut définir
l’homme. En quoi la définition de l’homme est-elle problématique, c’est-à-dire ne va pas de
soi ? « Définir », c’est déterminer par une formule précise l’ensemble des caractères propres à
une catégorie de réalités. Toute définition est une délimitation par le biais d’un concept. Les
choses, les animaux, que les scientifiques classent suivant des catégories et des genres dont
les contours sont bien dessinés, se prêtent sans trop de difficulté à une définition, car leur
réalité est stable. Mais l’être humain se prête mal à ce type de classification : les hommes sont
difficiles à cataloguer, à qualifier précisément. Ce qui est vrai pour l’espèce l’est encore plus
pour l’individu : nous changeons au cours d’une vie, notre identité est ouverte, fluide et il est
difficile, voire impossible, de nous cerner précisément.
Y a-t-il, dès lors, une nature humaine, une essence universelle, des traits communs à tous
les hommes au-delà de leurs différences ? L’homme n’est-il pas, au contraire, un être
indéterminé, indéfinissable, inachevé, en perpétuel devenir ? Comment définir un être en
constant devenir ? L’homme, écrit Nietzsche, est « l’animal qui n’est pas encore fixé de
manière stable » (§ 62 de Par-delà bien et mal). A l’article « Homme » de l’Encyclopédie,
Diderot souligne, à propos de la définition de l’homme : « ce que nous sommes ne peut pas
être compris dans une définition ».
N’est-il pas, en outre, dangereux de vouloir enfermer l’homme et, a fortiori, l’individu,
dans une définition ? La prétention de définir l’homme peut aboutir, en effet, à son
objectivation (vouloir faire de l’homme un objet) comme le fait, par exemple, la science.
Dans son livre Si c’est un homme, Primo Levi a vécu et décrit le moment où le nombre, le

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2015-2016
Cours Olivier Verdun
2
chiffre, le numéro, devenus l‘outil le plus efficace de la définition de l’homme, donc de la
stigmatisation du non-homme (le juif), tue le nom d’un homme en s’y substituant. Une fois
supprimé le nom d’un homme que l’on remplace par un matricule, donc une fois niée son
humanité, il devient plus facile de la supprimer physiquement, puisque son statut ne diffère
plus de celui d’un « chien » ou d’un « cochon ». L’ambition de fixer des définitions serrées
de l’homme comporte un danger qui est d’en finir avec certains hommes. Ainsi sera-t-on
tenté de distinguer les hommes entre eux, en séparant ceux qui satisfont à la définition de
l’homme de ceux qui n’y satisfont pas et ne peuvent que s’en trouver exclus de fait
(barbares/civilisés, hommes/sous-hommes, Juifs/Aryens, etc.).
Définir l’homme, ce serait donc le nier, l’aliéner, l’objectiver. Ce qui définit
paradoxalement l’homme, c’est son caractère indéfinissable, insaisissable, équivoque,
instable. L’homme se distingue de tous les autres êtres en ceci qu’il se définit par sa
résistance même à toute définition. L’homme perd son identité s’il l’identifie, il se perd s’il
se trouve. En d’autres termes, son essence consiste à n’en avoir aucune, sa définition
d’excéder toute définition, en sorte qu’en lui-même il s’outrepasse lui-même. L’homme reste
lui-même aussi longtemps qu’il s’échappe à lui-même.
Mais comment parler des droits de l’homme si l’on ne sait de quoi – ou de qui – l’on
parle ? L’idée que les hommes n’ont aucune commune nature et qu’il n’y a donc entre eux
que des différences irréductibles et indépassables - des différences culturelles - n’est-elle pas
à son tour désastreuse ? Dans L’espèce humaine, Robert Antelme souligne que la mise en
question de la qualité d’homme provoque une réaction presque biologique d’appartenance à
l’espèce humaine : « Il n’y a pas d’espèces humaines, il n’y a qu’une espèce humaine. C’est
parce que nous sommes des hommes comme eux que les S.S. seront toujours en définitive
impuissants devant nous ».
Ainsi, pour parler des droits de l’homme, il nous faut au moins un critère, un signe
distinctif, une marque d’appartenance, ce qu’Aristote appelle une « différence spécifique ».
Laquelle ? - L’espèce à laquelle nous appartenons. L’humanité est une donnée, elle est
d’abord une certaine espèce animale : nous sommes des mammifères, nous faisons partie de
l’ordre des primates, de la famille des hominiens, du genre homo, de l’espèce sapiens. Plutôt
que de définir l’homme de façon fonctionnelle par ce qu’il fait, on peut proposer une
définition générique : « Est un être humain tout être né de deux êtres humains » (André
Comte-Sponville, Présentations de la philosophie, chapitre 11, « L’homme »). « Qu’il parle
ou pas, qu’il pense ou pas, qu’il soit ou non capable de socialisation, de création ou de travail,
tout être entrant dans cette définition a les mêmes droits que nous (même s’il ne peut, en fait,
les exercer), ou plutôt, mais cela revient au même, nous avons les mêmes devoirs vis-à-vis de
lui » (ibid.). Biologisme strict, et de précaution !
C’est dire qu’avant d’être une valeur et une vertu, l’humanité est un fait, une espèce
biologique. On naît homme et on devient humain par l’éducation, la culture. Il y a bien
sûr des hommes inhumains à force de cruauté, de sauvagerie, de barbarie. Mais ce serait
l’être autant qu’eux que de leur contester l’appartenance à l’humanité. Celui qui échoue à
devenir humain n’en est pas moins homme pour autant. L’humanité est donc reçue avant
d’être créée ; elle est naturelle avant d’être culturelle ; ce n’est pas une essence, c’est une
filiation : « homme, parce que fils de l’homme » (Comte-Sponville, ibid.). En ce sens,

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2015-2016
Cours Olivier Verdun
3
l’homme n’est pas, comme Dieu, s’il existe, cause de soi (causa sui), mais le résultat d’une
histoire, qui le traverse et le constitue : « Il n’est ce qu’il fait que parce qu’il est, d’abord, ce
qui le fait (son corps, son passé, son éducation…) » (ibid.).
Mais si l’humanité est une transmission, elle est aussi, du coup, une fidélité. Elle n’est pas
une essence, qu’il faudrait contempler, ni un dieu, qu’il faudrait adorer : c’est une espèce
qu’il faut préserver, une histoire qu’il faut connaître, un ensemble d’individus qu’il faut
reconnaître, une valeur, donc, qu’il faut défendre. C’est ce qu’on appelle « l’humanisme »,
qui consiste à accorder une valeur à l’humanité, c’est-à-dire à s’imposer, vis-à-vis de tout être
humain, un certain nombre de devoirs et d’interdits. C’est précisément ce qu’on appelle
aujourd’hui les droits de l’homme. L’humanité ne se réduit donc pas à une espèce
biologique : elle désigne une conquête, un idéal, une vocation, un horizon. L’homme est un
être mortel, dont l’humanité est fragile, vacillante ; il nous appartient de le défendre et de
faire qu’il soit humain, plus humain.
Si l’homme est un être en devenir, c’est par la culture, en effet, qu’il s’humanise en se
libérant de sa dépendance initiale à l’égard de la nature, même si cette libération peut
également prendre l’aspect d’une nouvelle servitude ou aliénation. Mais que faut-il entendre
par « culture » ? Doit-on parler de la « culture » (au singulier) ou de « cultures » (au pluriel) ?
La culture est-elle ce qui unit les hommes ou ce qui les divise ? Et faut-il opposer, comme on
le fait généralement, la culture à la nature ?
Le mot « culture » vient du latin « colere » qui signifie « cultiver », soigner, entretenir,
préserver, travailler, mettre en valeur un champ, une terre en vue de la rendre propre à
l’habitation humaine (ex : cultiver du maïs). L'agriculture désigne ainsi le processus par
lequel la terre, une fois travaillée par l'homme, produit un fruit que la terre ne pouvait
féconder par elle-même.
Cicéron, dans Tusculanes (II 13), parle de la culture pour les choses de l’esprit (cultura
animi) qu’il compare au travail des champs : « […] de même qu’un champ, si fertile soit-il,
ne peut être fructueux sans culture (sine cultura) ; de même l’esprit ne peut l’être sans
enseignement (sine doctrina) […]. Or la culture de l’esprit, c’est la philosophie. Elle extirpe
radicalement les vices et met les esprits à recevoir les semences, leur confie et, je le dis ainsi,
sème ce qui, avec le temps, produira la plus abondante des récoltes ». La culture désigne ici
les activités mentales et les productions de l’esprit en général, l'ensemble des processus par
lesquels l'homme met en valeur ses propres facultés linguistiques, intellectuelles, spirituelles,
morales, artistiques, comme il met en valeur la nature en cultivant la terre pour en récolter les
produits.
Ainsi, avoir une solide culture ou être cultivé, ce n’est pas seulement posséder des
connaissances étendues dans beaucoup de domaines, ce n’est pas seulement être instruit et
savant, c'est être capable d'assimiler ces connaissances en vue d'un perfectionnement. Il ne
faut pas seulement avoir une tête bien pleine, encore faut-il qu'elle soit bien faite. En sorte
que la culture désigne l’ensemble des connaissances acquises qui permettent de développer le
sens critique, le goût, le jugement.
Quand on parle de la culture mexicaine ou de la culture gay, le terme de culture a un sens

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2015-2016
Cours Olivier Verdun
4
ethnologique ou sociologique : la culture désigne l'ensemble des techniques et des savoirs,
des coutumes et des institutions, des croyances (comme la religion) et des
représentations (comme l'art) forgées par une communauté. La culture, c’est donc
l'ensemble des faits symboliques et des institutions qui ajoutent à la nature une
signification dont celle-ci semblait dépourvue. Le terme de culture s'utilise alors au pluriel
(« les cultures ») pour désigner les manières d’être, les pensées, les habitudes de tout ordre
qui distinguent un peuple ou un groupe d’un autre.
Il ne faut pas confondre culture et civilisation : si la culture renvoie aux usages et
croyances humaines, le mot « civilisation » que l’on emploie au singulier comporte une
connotation laudative, c’est-à-dire l’idée d’un mouvement continu de l’humanité vers plus
de connaissances et de lumières. La notion de civilisation a partie liée avec celle de
progrès, - progrès scientifique, technique, politique, mais aussi moral : la civilisation est
l’état d’avancement des mœurs, des connaissances, et s’oppose à l’état sauvage (état
primitif, naturel, animal, de la « forêt ») et à la barbarie (celui qui n'est pas civilisé). Dans
cette optique, on serait plus ou moins civilisé selon les époques et les continents. Certaines
sociétés seraient plus civilisées que d’autres. Certaines cultures seraient supérieures à
d’autres. Ainsi a-t-on longtemps pensé que les sociétés dites primitives étaient moins
civilisées que les sociétés industrielles.
Le mot « culture » revêt ainsi trois acceptions principales : la culture comme
connaissances acquises par l'éducation et l'instruction; la culture comme l’ensemble des
activités et des résultats des activités qui témoignent d’une capacité à s’écarter de la nature
et à la transformer ; la culture au sens des différentes manières dont les hommes se sont
appropriés un territoire. L'idée de transformation et d’amélioration est commune à ces trois
acceptions, - transformation de soi, de sa nature ; transformation de la nature, de
l'environnement, de la réalité extérieure.
De la question « Qu’est-ce que la culture ? » ou « En quoi l’homme est-il un être de
culture ? », nous glisserons ensuite, dans ce chapitre 1, à la question « Comment l’homme se
cultive-t-il ? ». De nombreuses activités permettent à l’homme, en effet, de manifester ses
aptitudes à la culture, comme le langage, le travail, la technique, l’art, l’histoire.
La culture désigne, en un sens plus fondamental encore, l'ensemble des faits
symboliques qui ajoutent à la nature une signification dont celle-ci semblait dépourvue.
Pour devenir humain, chaque individu doit, à l’instar de l’enfant sauvage Victor de
L’Aveyron, accéder à la dimension symbolique de l’existence humaine par l’apprentissage
d’une langue. Le langage, que certains philosophes considèrent comme le propre de
l’homme, est ainsi le fait culturel par excellence : il est d’abord une partie de la culture en
tant qu’aptitude que nous recevons de la tradition; il est ensuite un instrument essentiel par
lequel nous nous assimilons la culture de notre groupe (le langage).
Homo loquax, l’homme est aussi homo laborans et homo faber – un être qui travaille, qui
fabrique des outils et qui, ce faisant, ne cesse de transformer la nature tout en se transformant
lui-même. Comment alors évaluer cette transformation ? Est-elle positive ou négative ? Le
travail est-il une malédiction ou la condition de notre liberté ? La technique nous libère-t-elle
ou bien constitue-t-elle une forme de servitude ? (le travail, la technique).

Lycée franco-mexicain – Année scolaire 2015-2016
Cours Olivier Verdun
5
Outre sa capacité à modifier en profondeur la réalité par le travail et la technique,
l’homme est aussi un créateur qui tente, à travers l’art, de mettre en forme symboliquement
ses pensées, ses émotions, sa représentation du monde. En ce sens, l’artiste peut ou a pu se
croire investi d’un pouvoir quasi divin, puisqu’il rivalise d’une certaine façon avec la nature
qu’il tente soit d’imiter, soit de transfigurer ou de sublimer, en accouchant d’œuvres tout à
fait singulières et inexistantes dans la nature - les œuvres d’art ? (l’art)
Enfin, la spécificité de l’homme se traduit au plus haut point dans le fait qu’il a une
histoire, qu’il est non seulement d’un lieu, d’une culture particulière, mais aussi d’un temps,
d’une époque. Si l’homme, en tant qu’être vivant, est le résultat d’une longue évolution
biologique, lui seul a une histoire dont il est à la fois l’acteur et le spectateur souvent passif.
(l’histoire)
1
/
5
100%